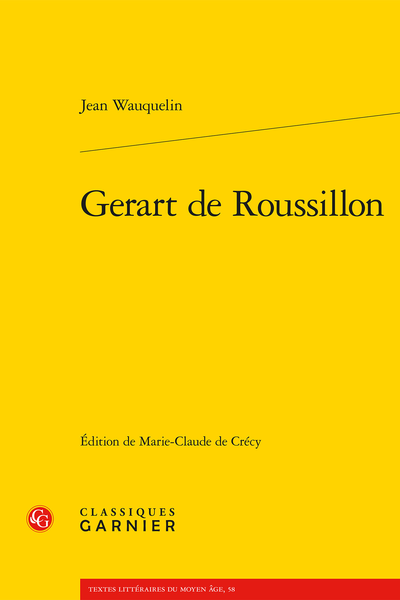
Proverbes et phrases d’allure sentencieuse, citations bibliques ou d’auteurs chrétiens, exempla
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Gerart de Roussillon
- Pages : 657 à 668
- Collection : Textes littéraires du Moyen Âge, n° 58
- Série : Mises en prose, n° 8
- Thème CLIL : 3438 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Oeuvres classiques -- Moyen Age
- EAN : 9782406101246
- ISBN : 978-2-406-10124-6
- ISSN : 2261-0804
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-10124-6.p.0657
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 05/05/2021
- Langue : Français
Proverbes et phrases
d’allure sentencieuse1,
citations bibliques
ou d’auteurs chrétiens, exempla
En relation avec la Fortune
XIII, 21 / v. 447, 1308, 2261 : Fortune tourne et retourne se roelz en peu d’eure.
XIII, 22 : O inremediable Fortune qui ensi as tourné et destourné ta tresdoubteuse roe.
LXII, 126 / v. 2261 : Fortune tourne et retourne souvent sa roe à sa volenté ; malditte Fortune ! pour quoy as tu ensi tourné ta roe contre ce trestant proedomme.
XXXVI, 68 : Fortune nous a bouté jus de sa roe.
CXXXV, 310 : Fortune, mere de tristresce et de desolation, que tu me monstre dolantement le destour de ta roe quant à moy que tu as eslevé à roy fais tel despit que tu as eslevé mon subget sus le plus hault de ta haultesce et moy mis au desoubz de victore et de proesce Mo 764, Ha F134, Di S, s.v. Fortune et roue.
LV, 108 ; XCIX, 218 : Fortune l’avoit mervileusement (inraisonnablement) mis (tout) au (plus) bas : Mo 557.
XCIX, 219 : Maintenant verra on se Fortune me sera ossy contraire, CII (227) : Ha F119, F134 ; TPMA, s.v. Glück
658Autres
X, 17 : il n’est si dure ne si trenchant espee que de fain. Ha E 58 ; TPMA s.v. Hunger.
XVIII, 31 : celli est fol qui boutte son doy entre le bos et l’escorche2, Ha D112 ; Di S, s.v. doigt.
XXII, 40 : paul parler, bien besongnier : LRL, série XV, p. 654 (Proverbes communsxve siècle) ; Mo 105 ; Ha P48 ; Di S, s.v. parler, parleur.
XXXII, 59 / v. 1137-1138) : sages est celli qui rien ne mesprent et folz est chilz qui rien ne doubte de ce que il prent ou tolt par estorsse ou malle tollete : proche de LRL, série V, p. 348 (Marie de France, Fable 92).
XXXII, 59, repris LXXVIII, 159 : sires n’est de ses paÿs qui de ses hommes est haÿs, voir LRL, série VII, p. 549 ; Ha S99 ; Di S, s.v. sire.
XXXIV, 65 / v. 1214 : en guerre ne en oevre de fait n’a nulle quelconque amour, foy ne leaulté ?
XXXVI, 67 : … les femmes font à croire aucune foix : le conseil de Berthe, qui s’appuie sur Caton, s’oppose au proverbe courant Li roge matin et li consail feminin ne sont pas à croire Mo 1112, connu sous différentes formes voir Ha F41.
XXXVI, 68 / v. 1257-1258) : soeffre la parolle de ta femme puis que tu vois que elle parolle de ton preu ou pourfit : Caton, Distiques III, 23 (Uxoris linguam, si frugi est, ferre memento ; / Namque malum est non velle pati nec posse tacere) ; LRL, Appendices, p. 922 : Uxoris linguam…
XLIV, 82 : fol i bee : Di S, s.v. fol, fou.
XLV, 84 : où cat n’a, souris revelle : Mo (SB) 1563 ; Ha C95 ; Di S, s.v. chat.
XLVI, 86 / v. 1618 : ce que fol pensse souvent demeure : LRL, série V, Proverbes communsxve siècle, p. 347 ; Mo 948, Mo (SB) 1320 ; Ha F139 ; Di S,
659s.v. fol, fou, également utilisé par Wauquelin dans La Belle Hélène de Constantinople (CXVI, 15).
XLVII, 87 : se il eussent esté en jeu parti jamais Franchoix n’en fuist retournéz en France, Ha J14 ; Di S, s.v. jeu.
XLVII, 88* : mieulx amans morir à honneur que fuir à honte : Mo (SB) 1272 ; Ha M228 ; Di S, s.v. honneur, mourir.
LIV, 105 : force tont le pré ; force pest le pré : LRL, Appendices, p. 902 ; Mo (SB) 1003 ; Ha F 113 ; Di S, s.v. force, voir le commentaire de Meyer, Girart … op. cit., p. 293, n. 5 : dans ce proverbe très répandu au moyen âge, le mot force représentant forfex et désignant de « grands ciseaux avec lesquels on tondait les prés », a été très tôt confondu son homonyme, représentant le mot vis.
LIX, 117 : S’ensi estoit que mauvaise volenté fuist comptee pour fait par la maniere que la bonne : Ha V145 : Volonté (Bonne volonté) (Bon vouloir) (Mauvaise volonté) est réputée pour le fait (est comptée pour œuvre), Di S, s.v. volonté, vouloir : bonne volonté est repute pour fait ; volonté du fait est reputee pour le mesfait (renvoie à intention :l’intention juge l’omme, l’action). Ha C181 : A l’effect la chose est prouvee (Christine de Pizan, Dittié de Jeanne d’Arc) ; Mo (SB) 1080 : li fait se preuvent, Mo (SB) 1144 : l’uevre se preuve.
LXII, 126 / v. 2262, et plus haut v. 496 : tel rit au matin qui pleure au soir : Mo (SB) 2368 ; Ha R53 ; Di S, s.v. rire ; Bible, Proverbes, 14, 13 Dans le rire même, le cœur trouve la peine, et la joie s’achève en chagrin.
LXVI, 134 : Bonne doctrine prent en lui qui se castie par aultruy : LRL XV, p. 667 (Proverbes aux Philosophes) ; Mo (SB) 314, 2265 ; Ha O45 ; Di S, s.v. doctrine.
LXVII, 136 / v. 2453 : comme le or se purge en la fournaise : Ha ≈ O64 ; Di S, s.v. or ; voir Livre de la Sagesse, 3, 6, Ecclésiastique 2, 5 ; Prov. 27, 21 ; également utilisé par Wauquelin, La Belle Hélène de Constantinople (CXII, 52) et La Manequine (XLV, 11).
LXX, 142 : quant le chief est en bon point, ossi sont tous les membres : proche de Mo 443 ; Ha C108 ; Di S, s.v. chef, chief.
LXXVIII, 159, voir XXXII, 59 : sires n’est de ses paÿs qui de ses hommes est haÿs.
LXXVIII, 160 : Le monde va en empirant : tout va pis que devant (Livre des proverbesxve siècle), LRL, série XV, p. 864.
LXXX, 166 : ensi est il de creature, car plus est bien paree par dehors, tant est elle plus ville par dedens, Di S, s.v. dedans.
660LXXX, 167 : mais lui devoit souffir par bonne raison de en prendre la laine en tamps convenable et oportun Ha P68 : A bon pasteur apartient ses brebis tondre en non point escorchier (s’oppose à XXXII, 60).
LXXXII, 170 : Fay dont que de bon meritte tu rechoive bon leuwier : également utilisé par Wauquelin, La Belle Hélène de Constantinople (LVI, 70 ; CXVIII, 81 ; CXXV, 42)
LXXXVI, 184 : tel jure de son marchié qui depuis en laisse : Mo 2359, Ha J52, Di S, s.v. marché, également utilisé par Wauquelin dans La Manequine (XI 16).
LXXXVII, 187 ; CXIX, 275 / v. 3213-3214 : qui n’est garnis, il est honnis : Mo 2050 ; Di S, s.v. garnir.
LXXXVIII, 190 : on ne prent point tel cat sans mouffle : Mo 371, 372 ; Di S, s.v. chat.
XCIX, 193 / v. 3278 : j’ameroie mieulx … morir à honneur en deffendant mon droit et l’onneur de mes amis que à plus vivre en telle vieulté et deshonneur : Mo (SB) 1272 ; Ha M 228 ; également utilisé par Wauquelin dans La Manequine (XLVIII, 13).
XCIII, 201 : encore n’estoit il point couchié qui aroit male nuit : Ha N46 ; Di S, s.v. nuit.
XCVIII, 214 / v. 3537-3538 : mieulx vault fuyr que malvaisement actendre : Mo (SB) 1245 ; Ha F185 ; Di S, s.v. fuir.
CVIII, 243 / v. 3840 : vielle haynne apporte nouvelle mort : proche de Mo 2474 ; Di S, s.v. haine.
CXII, 258 : on fait bien aulcune fois de son droit son tort : Robert le Clerc d’Arras, Les Vers de la mort, éd. Annette Brasseur et Roger Berger, Genève, Droz, 2009, v. 2899.
CXVIII, 271 / v. 4121-4122 : Qui pour aultruy prie pour ly meisme labeure : DMFs.v. labourer : Qui pour autrui procure pour soi mesme laboure (Proverbes en rimes, c. 1485-1490) ; Ha P 266.
CXXXIV, 306 / v. 4767 : la mort, qui homme ne femme n’espargne ;
CXXXV, 308 : la mort n’espargne homme viel ne josne, la mort n’espairgne nulluy : TPMA, s.v. Tod ; Mo (SB) 1011 ; CLXV, 376 : Or advint que aprez le cours de nature il leur convint payer le treüt que leurs predicesseurs avoient payet, c’est asavoir le tribu de la mort, laquelle ne poet homme ne creature nulle fuyr ne escaper : Ha M200 ; Di S, s.v. mort.
CXXXV, 308 : mettre en sa trappe : voir Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la charrette ou Lancelot, v. 193, Texte établi par Pierre Kunstmann,
661Ottawa/Nancy, Université d’Ottawa / Laboratoire de français ancien, ATILF, 2009 : « Et vos, s’il vos plest, me redites, / An cele tonbe qui girra ? / – Sire, cil qui delivrera / Toz ces qui sont pris a la trape / El rëaume don nus n’eschape. »
CXXXVI, 311 : honneur vault à homme sur toute rien et qui n’a honneur il n’a rien : Di S, s.v. honneur.
CXLIX, 340 / v. 5331-5332 : qui ne vuelt mettre raison en ly, raison s’y met d’elle meisme :voir LRL, Série no XV, p. 852 ; Di S, s.v. raison.
CLXV, 375 : rien ne vault le bon commenchement ne le moyen se le definement n’est bon : Isidore de Séville, Sentences, II (ou III) De desperatione peccantium 14, 8 : In vita hominis finis quaerendus est, quoniam Deus non respicit quales antea viximus, sed quales circa vitae finem erimus, voir aussi Wauquelin, La Belle Hélène de Constantinople (prologue).
CLXV, 375 / v. 5973-5974 (déjà cité v. 501-502) : envis poet mal morir qui vit bonnement, [et que envis peut bien morir cellui qui vit mauvaisement : adaptation du proverbe de bonne vie, bonne fin Mo 471 ; de mauvaise vie, mauvaise fin Mo 521,Di S, s.v. vie.
CLXV, 375 / v. 5975 : et dist on que la bonne vie attrait la bonne fin, proche de Mo 471. Les proverbes qui concernent la relation entre la vie menée et la mort sont nombreux et proches de ce qu’énonce Wauquelin, qui écrit dans la Chronique des ducs de Brabant « Au darrain, afin que ce qui est escript ne fausist point, c’est assavoir : Celuy ne puet bien morir qui mal aura vescu, il fut occis par Ermenfroy, le noble et vaillant homme qu’il avoit grandement injurié » Wauquelin, Chronique des ducs de Brabant, éd. P. F. X. De Ram, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 1854-1860, t. I, ch. xxxix, p. 129.
CLXV, 376 : voir CXXXV, 308.
Citations latines non bibliques
XXXI, 59 / v. 1135-1136 : Le Poete qui dist Sompnia ne cures, nam mens humana quod operat dum vigillat sperat etc. … qui vault à dire en franchoix … Disticha Catonis, II, 31, 1-2 (éd. Boas) ; cf.Ecclésiaste 5, 2, 6 ; Ecclésiastique 34, 1-7 ; Guillaume de Lorris, Roman de la Rose,
662v. 1-2. Ha S106 ; TPMA s.v. Traum ; voir aussi La Belle Hélène de Constantinople (XXXI, 96).
LXXXII, 169 : patere legem quam ipse tuleris. Caton, Disticha, Sententiolae, Breves sententiae, 49.
LXXXVI, 184 : Ira impedit animum ne possit cernere verum, Disticha Catonis, II, 4b.
Citations bibliques ou d’auteurs chrétiens3
I, 1 : post mortem lauda : Ecclésiastique, 11, 28 : ante mortem ne laudes hominem quemquam quoniam in filiis suis agnoscitur vir ; Ha G28, Di S, s.v. jugement.
XIV, 24 : Judicia tua abissus multa : Psaumes, 35, 7 ; Saint Paul, Épîtres, Romains 11, 33, cité par Hassel G28, Du Stefano s.v. jugement ; également utilisé par Wauquelin en français dans La Belle Hélène de Constantinople (X, 25).
XXIX, 54 : non coronabitur nisi quy legitime certaverit : Saint Paul, 2, Épîtres, Timothée, 2, 5 ; également utilisé par Wauquelin dans La Manequine (IV, 14).
XXXVI, 68 / v. 1262-1274 : Livre de Judith, 13, 1-9 ; également utilisé par Wauquelin dans La Manequine (XIII, 7, 9).
XXXVI, 68 / v. 1283-1302 : Livre d’Esther, 3, 6 sq., et 7, 10.
LII, 100-101 : Quya respexit humilitatem ancille sue fecit michymagna qui potens est, Évangiles, Luc, I, 48-49.
LVIII, 114 : Vindica sanguinem justum (qui effusus est) : proche de Psaumes, 78, 10 ; également utilisé par Wauquelin dans La Belle Hélène de Constantinople (LXV, 8-9).
663LIX, 118 : in inferno nulla est redemptio : office des morts, 3e nocturne des matines de l’office des morts, dernière phrase du répons 7e leçon, Job, 17.
LXVII, 135 : la sience du monde n’estoit à Dieu que follie, Saint Paul, I Épîtres, Corinthiens, 3, 19.
LXVII, 136 / v. 2402 ; LXXIV, 152 ; XCV, 206 / v. 3421-3422 ; CII, 227 / v. 3630-3631 : Nostre Signeur, qui les orguilleux abaisse et les humbles exauce et Deposuit potentes de sed[e] et exaltavit humiles etc., Évangiles, Luc, 1, 52.
LXVIII, 138 / Vita, § 18, v. 2463-2464 : Dominus erigit elisos, Psaumes, 144, 14, Dominus solvit compeditos, Psaumes, 145, 7, 8 ; également utilisé par Wauquelin dans LaManequine (LIX, 9).
LXXVII, 157 / Vita § 31, v. 2699 : Marta autem sattagebat etc., Évangiles,Luc, 11, 40.
LXXVII, 159 : Si les puelt on comparer au crapault enfflet de venin qui crieve en sentant l’oudeur de la vingne : renvoie au sermon sur le Cantique des cantiques de saint Bernard, Sancti Bernardi abbatis claraevallensis. Opera omnia, éd. Mabillon, Paris, 1839, t. I, Sermones in cantica, Sermo LX, p. 3029.
LXXXV, 179 / v. 3131-3134 : À ce pourpoz dist la sainte Escripture “ensi que la grant vertu et la mesure des bons soelt en eulx et en tous aultres haÿr l’ordure de vice, ensi tous malvais par leur grant malignité heent tous ceulx qui sont de tous biens plains et affaitiés”, proche de Proverbes 29, 27, Vulgate, Abominantur justi virum impium, et abominatur impii eos qui in recta sunt via, trad. Le Maistre de Sacy : “Les justes ont en abomination les méchants, et les méchants ont en abomination ceux qui marchent par la droite voie”.
LXXXV, 179-180 / Vita § 36, v. 3140-3141 : Considerat peccator justum et querit mortificare eum, Psaumes, 36, 32.
XC, 194 / Vita § 43, v. 3289-3290 ; repris incomplètement en CXLII, 325 : “La victore ne gist point en la multitude mais où il plaist à Dieu seulement”, I Maccabées 3, 19.
XCV, 206, voir supra LXVII, 134.
XCVIII, 215* / Vita § 60 et v. 3559-3560 : Non salvatur rex per multam virtutem etc., c’est à dire que « pour la grant multitude de puissance ou de vertu ne sera point le roy saulvé », Psaumes, 32, 16.
XCVIII, 215-216 / Vita § 60, v. 3963-3964 : Ecce oculi Domini super metuentes eum, Psaumes, 32, 18.
664XCVIII, 216 / Vita § 60, v. 3565-3566 : le gayant ne sera ja saulvez pour sa grant vertu ou puissanche, mais seulement cely qui met en Dieu sa fianche et qui de bon coer sert et aime. Psaumes, 32, 16, 18.
CI, 226 : Beati mites quoniam ipsi possidebunt terram, Évangiles, Matthieu, 5, 4.
CII, 227, voir supra LXVII, 135.
CII, 228 : Cum audieritis prelia et seditiones nolite terrere, Évangiles, Luc 21, 9.
CXVII, 270 : Miseremini mei, miseremini mei saltem vos amici mei, etc. … Livre de Job, 19, 21.
CXVIII, 271 / v. 4205-4206 : elle vuelt que on faiche à aultruy ce que on volroit que on ly feist : Évangiles, Luc, 6, 31 ; Ha F4 ; Di S, s.v. faire, utilisé également par Wauquelin dans La Manequine (XIII, 7).
CXVIII, 272 / v. 4223-4224 : Et oratio mea in sinu meo revertetur, Psaumes, 34, 13.
CXXII, 281 / v. 4365-4366 : Évangiles : Si sustulisti eum dicito michi, Évangiles, Jean, 20, 15… l’angele qui ly dist Non est hic … surrexit, Évangiles, Matthieu 28, 6.
CLVI, 356 / Vita, § 93, v. 5599-5600 : Quod uni ex minimis meis fecistis michi fecistis, Évangiles, Matthieu 25, 40.
CLVII, 357 / Vita § 93, sacra scriptura, v. 5597-5598 : Comme l’escripture tesmongne l’argument de vraie dilection et de bonnes oevresest le exhibition de l’oevre, voir dans les Sermons de saint Grégoire l’homélie 30, sur l’évangile de Jean 14, 23-31, 3 juin 591, Pentecôte : probatio dilectionis, exhibitio est operis.
CLX, 361 / Vita § 152, sacra eloquentia, v. 5685-5690 : Et l’escripture tesmongne pour chose toute veritable que plus est le tamps saint etdevot et la personne bonne et en volenté de faire bonne oevre de tant plus s’efforche l’anemy d’enfer par sa droite rage de empeschier et faire trebuchier ceulx qui ont bon corage ?
CLX, 366 / Vita § 163, v. 5803-5804 : Salvabitur inquiens vir infidelis per mulierem fidelem, Saint Paul, Épîtres, I Corinthiens 7, 14.
CLX, 367 / Vita § 165, v. 5815-5816 : qui sanat contritos corde et alligat contritiones eorum, Psaumes, 146, 3.
CLX, 367 / Vita § 165, v. 5817 : Elevat quem cadentem de lacu miserie et de luto fecis, Psaumes, 39, 3.
CLX, 367 / Vita, § 165 (divina eloquentia) v. 5819-5822 : Non longitudo temporis sed sincera cordis contricio consiliat penitentem Deo etc. ?
665CLX, 367-368 / Vita § 166, v. 5827-5830 : Voluntatem timencium se facietet deprecationem eorum exaudiet et salvos faciet eos, Psaumes, 144, 19.
CLXII, 370 / v. 5863-5870 : Alterius nuptam non concupisceris, Deutéronome, 5, 21.
CLXII, 370 / v. 5871 : Et dabit illi dominus Deus sedem David patris ejus, Évangiles, Luc, 1, 32.
CLXII, 370 / Vita § 225, v. 5874 : Inveni David servum meum secondum cor meum, Actes des Apôtres, 13, 22.
CLXVII, 379 / Vita § 170, v. 6047 : par la plenitude de ses jours on le pooit comparer à Abraham, Genèse 25, 8.
CLXXIX, 403 / v. 6417-6418 ; CLXXXIV, 417 / v. 6619) : Te Deum laudamus : hymne latine d’action de grâces, appelée “hymne ambrosienne”, bien qu’elle ait été composée à la fin du ive ou au début du ve siècle, non par saint Ambroise après le baptême de saint Augustin, comme le dit la légende, mais par Nicétas, évêque de Rémésiana (Dacie).
CLXXXVI, 424 / v. 6707-6708 : Nostre Seigneur dist en l’euvangille en parlant du pere de famille qui envoia les ouvriers en sa vigne que otant eulrent ceulx qui vinrent à midy que ceulx qui avoient porté tout le fais du jour, combien que en sa vie ou prosperité ne se doibt nulz fiier, Évangiles, Matthieu, 20, 1-16.
CLXXXVI, 424 : Memorare novissima et in eternum non peccabis, Ecclésiastique 7, 40.
CLXXXVI, 425 : Plus vitanda est sola peccati feditas quam quelibet tormentorum immanitas, Liber de contritione cordis, œuvre attribuée à saint Augustin, mais dans la rubrique incertus, voir Patrologia latina, 40 0948, caput VIII.
CLXXXVI, 424 : Le texte utilisé par Wauquelin, y compris la citation de l’Ecclésiastique, est le début du traité Cordiale de quattuor novissimis de Gerardus de Vliederhoven.
Pour les citations les références sont celles de la Vulgate, site Bibliotheca Augustana (le texte n’étant pas toujours exactement identique).
666Les exempla4
Souvent connus depuis l’Antiquité ils constituent un patrimoine dans lequel puisent maints auteurs. Si le Speculum majus de Vincent de Beauvais en offre un grand nombre, un clerc instruit pouvait connaître différentes versions. Wauquelin reprend les différents exempla, fréquemment utilisés au Moyen Âge, qu’il trouve dans le roman en alexandrins, sans qu’on puisse déterminer quelle a été sa source personnelle, si elle est autre que le roman en vers5.
LXVII, 134-135 / v. 2375-2381 : Auguste qui faisait apprendre un métier aux filles : Suétone, La vie des douze Césars, Auguste 64, 73, Speculum historiale V, 46 (Tubach no 5383).
LXVII, 135-136 / v. 2386-2448 : le service d’une sainte femme et les religieuses : Palladius, Histoire lausiaque6, p. 98-106 ; Speculum historiale XVII, 83.
LXXVIII, 160-161 / v. 2733-2749 : le tyran et la vieille femme : le texte de Valère-Maxime, Facta et dicta memorabilia, VI, 2, ext. 2 ; Speculum historiale III, 73.
LXXVIII, 161 / v. 2755-2770 : Titus et la journée perdue : Suétone, La Vie des douze Césars, IX, Titus, 8 ; Speculum historiale, IX, 9, Speculum doctrinale, V, 6, Speculum historiale IX, 68 ; Jacques de Voragine, La légende dorée, éd. publiée sous la direction d’Alain Boureau, avec Monique Goullet et la collaboration de Pascal Collomb, Laurence Moulinier
667et Stefano Mula. « La légende dorée et ses images », Dominique Donadieu-Rigaut, Paris, Gallimard, 2004, p. 363, Tubach no 1459.
LXXIX, 162-164 / v. 2776-2818 : les deux pauvres, le frère du roi et la trompette de la mort : saint Jean Damascène, Barlaam et Josaphat ; Speculum historiale XV, 10 ; La légende dorée, op. cit. p. 1007.
LXXX, 164-165 / 2831-2852 : le roi des singes : Speculum doctrinale III, 121 ; Speculum historiale III, 7.
LXXX, 165-166 / v. 2855-2866 : la modestie de César Auguste : Suétone, La vie des douze Césars, II, Auguste, 53 ; selon Köhler, c’est du texte d’Orose (VI, 22) que celui du Gerard est le plus proche ; Speculum historiale, V, 45. Tubach no 4675.
LXXX, 166* / v. 2871-2894 : les quatre coffres : saint Jean Damascène, Barlaam et Josaphat, Speculum historiale XV, 10 ; Saints Barlaam et Josaphat, Légende dorée, op. cit., p. 1007-1008 ; Tubach no 967.
LXXX, 167 / v. 2901-2904 : la tonte des brebis : Suétone, La Vie des douze Césars, III, Tibère, 32 ; Orose VII, 4 ; Speculum historiale, VI, 1. Ham précise que dans le Speculum morale (I, 3, 98), ce passage est suivi du même exemplum que dans le Gerard (les mutations d’officiers et le pauvre, les mouches et le malade).
LXXXI, 167 / v. 2915-2926 : les mutations d’officiers et le pauvre, les mouches et le malade : Flavius Josephe, Antiquités judaïques XVIII, 6, 5 ; Speculum doctrinale VII, 23 ; Speculum historiale VI, 126, Speculum morale I, 3, 98.
LXXXI, 168 / v. 2929-2938 : le roi et le fils du mauvais juge : Valère Maxime Facta et dicta memorabilia, VI, 3, externa § 3 ; Speculum doctrinale IV, 66 ; Speculum historiale III, 19 ; Jacques de Guise, l’Histoire de Hainaut, « De Cambyse, rege Persarum » ; Tubach no 2859.
LXXXII, 169 / v. 2951-2964 : la justice du juge faite à son fils adultère : Valère Maxime Facta et dicta memorabilia, VI, 5, externa § 3 ; Speculum doctrinale IV, 66 et 162 ; ≈ Tubach no 1944.
LXXXII, 170 / v. 2970-2994 : Trajan et la veuve : Jean Diacre Vita Gregorii II, 44 ; Speculum historiale IX, 46 ; Légende dorée, op. cit. p. 237 (note 50, p. 118, à propos de la fausse attribution à Grégoire IX dans l’exemplum référencé Tubach no 2368), et Tubach no 4989 et 5267 (sans la partie relative à Grégoire).
LXXXII, 171 / v. 3000-3012 : la modération de Romulus : Aulu-Gelle, Nuits attiques, XI, 14. Speculum historiale II, 99 ; Tubach no 4129.
668LXXXIII, 172-173 / v. 3019-3042 : le roi prévoyant : Jean Damascène, Barlaam et Josaphat, Légende dorée, op. cit., p. 1010-1011 ; Speculum historiale XV, 17 ; Speculum morale II, 1, 4 ; Tubach no 2907.
LXXXIII, 173-174 / v. 3053-3080 : la jeune fille qui fait pardonner sa mère : Valère Maxime, Facta et dicta memorabilia, V, 4, 7 : De la piété filiale ; Speculum doctrinale IV, 41 Speculum historiale V, 125 ; Tubach no 3969.
CXXVI, 290 / v. 4489-4491 : les péchés effacés grâce à l’intercession de Marie-Madeleine, voir Légende dorée, op. cit., p. 520 ; Tubach no 1202.
1 Les citations ou proverbes que l’on trouve dans le roman en alexandrins sont signalés par le numéro du vers dans l’édition Ham. Di S = Di Stefano, Ha = Hassel ; LRL= Le Roux de Lincy, Mo = Morawski, TPMA = Thesaurus Proverbiorum Medii Aevii ; les références du livre d’Élisabeth Schulze-Busacker, Proverbes et expressions proverbiales dans la littérature narrative du Moyen Âge français. Recueil et analyse, Paris, Champion, 1985, sont indiquées entre parenthèses (SB) après Morawski quand elle reprend des proverbes identifiés par Morawski.
2 L’origine de ce proverbe pourrait être tirée de l’anecdote racontée par Aulu-Gelle, Nuits attiques, XV, 16 : « Milon de Crotone était un athlète fort célèbre par sa force extraordinaire. Quoiqu’il eût cessé depuis longtemps déjà de concourir dans les jeux publics, il voulut, un jour, bien qu’il eût atteint un âge avancé, éprouver s’il lui restait encore quelque force. Il traversait tout seul une forêt ; près de sa route se trouvait un chêne fendu déjà de plusieurs côtés. Il mit ses doigts dans les fentes et essaya de séparer l’arbre en deux parties. Il commença bien à écarter les fentes jusqu’au centre et se reposa un moment de ses efforts tout en laissant ses mains dans l’ouverture. Mais, sans qu’il s’en doutât, les deux parties de l’arbre se rejoignirent et retinrent si fortement les mains de l’athlète, qu’il ne put se dégager. Les bêtes féroces de la forêt le mirent en pièces. »
3 La plupart des citations en latin proviennent de la Bible ; dans la Vita dont nous disposons et qui n’est pas celle dont Wauquelin s’est servi, elles sont présentées soit avec leur source (David, le Psalmiste, Mathieu, l’Apôtre), soit sans référence, soit incluses dans la narration, parfois avec la mention sacra scriptura (CLVII, 357, § 93), sacra eloquia (CLVIII, 361, § 152), divina eloquia (CLX, 367, § 165). Mais il arrive que Wauquelin attribue à la sainte escripture une référence qui n’est pas biblique (Sermons de saint Grégoire), et parfois la citation n’a pu être identifiée : une exclamation empruntée à la Vita 1, qui ne présente aucune référence, même implicite (LXVIII, 137) : O ! fellix nimirum et preciosa …
4 Frédéric C. Tubach, Index exemplorum. A handbook of Medieval Religious Tales, Helsinski, 1969.
5 Ces différentes sources ont été étudiées par Reinhold Köhler, « Die Beispiele aus Geschichte und Dichtung in dem altfranzösischen Roman von Girart von Rossillon », Jahrbuch für romanische und englische Sprache und Literatur, 14, 1875, p. 1-31. Johannes Bolte a repris et complété l’article de Köhler dans Kleinere Schriften zur erzählenden Dichtung des Mittelaters von Reinhold Köhler, Berlin, 1900, II, p. 359-393 ; l’ordre de succession des exempla dans les œuvres a pu orienter Köhler dans sa recherche de la source utilisée. Ham donne un aperçu de ce travail dans son introduction au roman en alexandrins, op. cit. p. 14, 91-95. Wauquelin s’étant principalement servi du roman en vers, je cite seulement l’origine de ces exempla très connus et arbitrairement la référence à Vincent de Beauvais. Je renvoie à l’édition de Ham ou à l’article de Köhler pour les précisions concernant les autres auteurs médiévaux ; j’ai mentionné également Jacques de Guise, dont Wauquelin a traduit l’Histoire de Hainaut, éd. Fortia d’Urban, Paris-Bruxelles, 1826, tome II, p. 270-271.
6 Palladius, Histoire Lausiaque, éd. dom C. Butler, Cambridge, 1904.