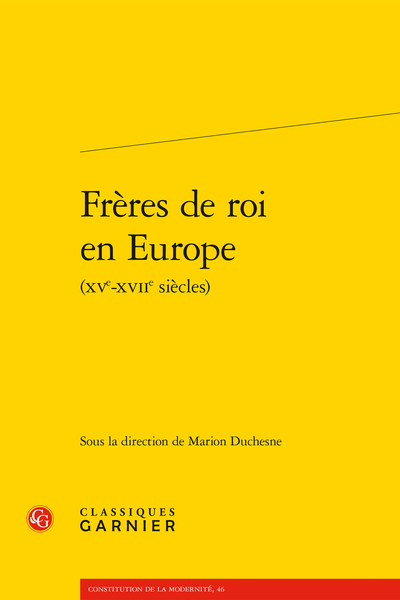
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Frères de roi en Europe (xve-xviie siècles)
- Pages : 377 à 381
- Collection : Constitution de la modernité, n° 46
- Thème CLIL : 4127 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie éthique et politique
- EAN : 9782406165361
- ISBN : 978-2-406-16536-1
- ISSN : 2494-7407
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16536-1.p.0377
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 22/05/2024
- Langue : Français
RÉSUMÉS
Marion Duchesne, « Introduction »
L’introduction expose les particularités du statut du frère de roi, lequel occupe une situation particulièrement inconfortable au sein de la famille royale. L’ouvrage, qui vise à éclairer les nombreux enjeux liés aux cadets royaux dans les monarchies européennes de l’époque moderne, est ensuite situé dans une histoire de la germanité encore balbutiante, ce qui fait toute son originalité. Enfin, articulées en quatre parties, les 16 contributions font l’objet d’une présentation détaillée.
Arlette Jouanna, « L’incommodité d’être le frère du roi. Les cas de Louis d’Orléans, de Charles de France, de François de Valois et de Gaston d’Orléans »
Les frères de Charles VI, Louis XI, Henri III et Louis XIV ont longtemps pu espérer devenir rois, soit du fait de la fragilité biologique de leurs neveux, soit par suite de la stérilité totale ou prolongée des époux royaux. Ils ont attiré ceux qui rêvaient de changement, faisant ainsi figure de suspects potentiels aux yeux de leur aîné. Les ambiguïtés de leur condition éclairent les paradoxes de la légitimité monarchique, longtemps partagée entre les fondements privés et publics du pouvoir.
Pascale Mormiche, « Aîné et cadets, éducation chez les princes (xviie-xviiie siècles) »
Comprendre ce qui est réellement enseigné aux princes français entre le xviie et le xviiie siècle peut relever de la gageure. En revanche, il est possible, en analysant la mise en place des structures des Maisons et le personnel, l’âge du passage aux hommes, voire les relations entre frères, de montrer que les éducations des princes sont menées de manière relativement similaire tant qu’il n’y a pas d’héritier autre que le cadet, celui-ci devant pouvoir prendre la place de l’aîné s’il décède.
378Elisabetta Lurgo, « Philippe d’Orléans et Louis xiv. Une solidarité interiorisée »
Dans cette contribution, je souhaite présenter une réflexion sur le programme éducatif proposé à Philippe d’Orléans dès l’enfance, notamment dans le domaine religieux, pour mettre en valeur la place qu’y tient la relation avec la royauté, incarnée par son aîné. En puisant dans les écrits des précepteurs et des confidents spirituels de Philippe d’Orléans, ainsi que dans les lettres du prince, je voudrais cerner la manière dont ce choix éducatif est finalement intériorisé par Philippe.
Jonathan Spangler, « In Service to the King’s Brother. Aristocratic Court Families and Alternative Pathways to Royal Patronage in Early Modern France, 1550-1700 »
Cet article analyse le mécénat dans les maisons de trois princes français, frères cadets de rois, entre 1550 et 1700. Au cours de cette période, on constate que les frustrations liées au fait d’être le frère cadet d’un roi conduisent à une transformation du mécénat princier, qui passe de la concurrence à la collaboration. Dans les trois cas, ces maisons constituent un important point d’accès à la cour pour d’autres puînés, issus des grandes familles de la cour ou de la noblesse provinciale.
Jean-Pierre Jardin, « Amour fraternel et intérêt politique dans la Castille du xive-xve siècle. Henri iii de Castille et son très loyal frère Ferdinand »
Les relations entre les souverains et leurs frères sont rarement faciles au Moyen Âge. Henri III de Castille et son frère Ferdinand constituent une exception à la règle : s’il faut en croire les textes d’époque, les deux frères ont étroitement collaboré dans le gouvernement du royaume, l’aîné, au caractère aigri par la maladie, pouvant compter sur l’amour sans faille de son cadet. Ce travail propose une réflexion sur la réalité de cette collaboration et sur les non-dits qui la sous-tendent.
Fabien Salesse, « L’apanage auvergnat d’Henri de Valois. Un outil symbolique dans la négociation d’un pouvoir politique territorialisé pour Monsieur (1572-1573) »
Frère puîné de Charles IX, Henri est âgé de quinze ans lorsque le monarque, de concert avec Catherine de Médicis, lui octroie les terres qui composent 379son apanage, dont la partie auvergnate nous occupe ici. Nous observerons comment Henri cherche à y devenir un courtier de la faveur royale et comment il s’engage dans le jeu politique régional pour montrer à son frère et sa mère qu’il entend obtenir davantage de considération politique et participer au renforcement de la monarchie.
Aurore Causin, « Défendre le droit de la succession royale. Les princes et le pouvoir royal dans l’affaire des légitimés (1716-1717) »
Au xviiie siècle, l’affaire des légitimés est le lieu d’un affrontement entre les princes du sang et les princes légitimés. Fondée sur la contestation de l’habilitation à succéder accordée par Louis XIV à ces derniers, la querelle conduit les partis à débattre des notions structurantes du droit de la succession royale. En cherchant à défendre des droits menacés, les partis en viennent à transformer le droit de la succession royale et le pouvoir royal qui ressort affaibli de la querelle.
Gautier Mingous, « Communiquer avec Monseigneur. Les ducs d’Anjou et d’Alençon comme relais de la politique royale dans la correspondance des pouvoirs lyonnais (années 1560-1570) »
Cet article s’intéresse aux échanges de lettres que Henri d’Anjou et François d’Alençon entretiennent avec Lyon dans les années 1560-1570, se faisant ainsi les relais fondamentaux entre pouvoir royal et communautés locales au moment où la société sombre dans la guerre civile. Il s’agit d’offrir une vision contrastée des stratégies déployées par le roi pour affermir, grâce à ses frères, son pouvoir dans le royaume.
Rubén González Cuerva, « Dos archiduques en busca de patrón. Ernesto y Alberto de Austria en la red dinástica de los Habsburgo »
Cet article analyse les carrières des archiducs Ernest et Albert d’Autriche dans le contexte des tensions entre Philippe II et Rodolphe II pour exercer l’autorité familiale. Par l’intermédiaire de leurs domestiques et des contacts familiaux entretenus au fil du temps, les archiducs négocient leurs loyautés et responsabilités au sein de l’unité dynastique. Le gouvernement des Pays-Bas leur permet de s’insérer avec une relative autonomie dans la constellation de la cour des Habsbourg.
380Miguel Conde Pazos, « Príncipes de una corona electiva. Los hermanos de Ladislao iv de Polonia en la política europea »
Ce travail s’intéresse aux tentatives des frères du roi Ladislas IV de Pologne (1632-1648) d’améliorer leur sort grâce à la protection du roi d’Espagne (recherche de pensions et de charges dans la monarchie ou encore de candidates au mariage) ainsi qu’à la manière dont la cour de Madrid a utilisé ces aspirations pour tenter d’influencer l’attitude de la couronne polono-lituanienne dans le conflit européen. Il s’agit d’esquisser les lignes générales qui ont caractérisé ce type de contacts.
Valeria Caldarella Allaire, « Être frère, être oncle, être roi. Le cas de Frédéric Ier d’Aragon »
Avant de devenir souverain du royaume de Naples, Frédéric d’Aragon vécut en tant que parent de rois. Quelle place lui fut alors assignée ? Fut-il perçu comme une menace et donc écarté du pouvoir, ou bien plutôt inclus dans les rouages politiques qui garantissaient le bon fonctionnement du gouvernement aragonais ? Cet article se propose de parcourir certains des moments les plus saisissants de la seconde moitié du xve siècle napolitain pour apporter des éléments de réponse à ces questionnements.
Santiago Martínez Hernández, « Anatomía de un príncipe disimulado. El infante Don Carlos de Austria (1607-1632), primer hermano de Felipe iv »
L’infant Charles d’Autriche, premier des frères de Philippe IV, a longtemps été une figure ignorée des Habsbourg espagnols, malgré sa position d’héritier présomptif de la Monarchie hispanique entre 1621 et 1629. Ces pages ont pour objectif d’offrir une relecture du potentiel politique et dynastique du frère du monarque, à partir de l’analyse de la métamorphose que son statut institutionnel et son image publique ont connu entre 1621 et 1632, date de sa mort.
Emmanuel Lemée, « James Stuart, prince pluriel au service du roi son frère »
Avant d’accéder au trône d’Angleterre sous le nom de James II, James Stuart avait déjà vécu plusieurs vies. De prince soldat en exil à broker royal, il endossa successivement toutes les variantes du rôle de frère du roi, toujours au service de Charles II et de la Couronne. Le caractère indéfini de sa position lui 381offrait de multiples opportunités de s’affirmer et constituait à la fois un fardeau sisyphéen, en l’obligeant à se réinventer pour conserver sa place auprès du roi.
Anne-Gaëlle Leterrier-Gagliano, « “Tu seras à bon droit notre Hercule-François”. L’engagement des poètes au service de François d’Alençon »
François d’Alençon est un personnage de terne mémoire : frère et héritier d’Henri III, il s’oppose régulièrement à son aîné. Cependant, le duc est aussi un personnage raffiné, entouré d’une cour qui diffuse le portrait d’un homme politique compétent et soucieux de paix. C’est l’écart entre les discours proposés et la perception des actions du duc qui est abordé ici afin d’analyser les stratégies de ce puîné avide d’une place hors de l’ombre de son frère.
Pierre Gatulle, « Les ressorts de l’exemplarité et de l’opprobre. Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII »
Comment la dignité de frère du roi s’est-elle construite entre l’exemplarité et le déshonneur ? L’exemplarité des précédents frères du roi n’est pas mise en avant très longtemps et Gaston d’Orléans va chercher à s’en émanciper notamment dans l’affaire de son second mariage, avec Marguerite de Lorraine. La diversité des arguments et de leurs supports est frappante, alors que l’opprobre l’emporte avec la légende noire de Gaston d’Orléans, révélatrice d’un infléchissement du statut du frère du roi.
Cem Algul, « Les frères du Grand Turc dans la littérature fictionnelle française des xvie et xviie siècles »
L’article se concentre sur les fictions littéraires françaises des xvie et xviie siècles dont la trame s’inspire des crises de succession au sein de l’Empire ottoman. Dans la dynastie ottomane, celui des héritiers qui accédait au trône pouvait légalement supprimer ses frères. Les auteurs mettent en spectacle la cruauté attribuée aux sultans, l’objectif étant de mettre en valeur des considérations politiques à travers des fictions où le Turc sert de miroir à la monarchie française.