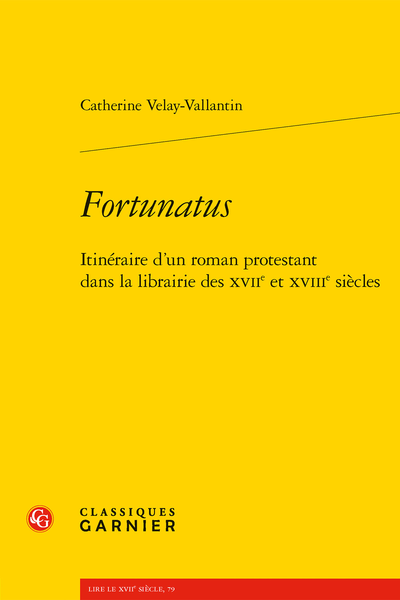
Préface Fortunatus en Angleterre
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Fortunatus. Itinéraire d’un roman protestant dans la librairie des xviie et xviiie siècles
- Pages : 8 à 14
- Collection : Lire le xviie siècle, n° 79
- Série : Romans, contes et nouvelles, n° 11
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406147251
- ISBN : 978-2-406-14725-1
- ISSN : 2257-915X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14725-1.p.0008
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 07/06/2023
- Langue : Français
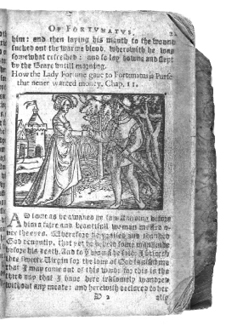
Fig. 1 – The right pleasant and variable tragicall historie of Fortunatus.
Whereby a yong man may learne how to behaue himself in all worldly affaires,
and casuall chances. First penned in the Dutch tongue. Therehence abstracted, and now first of all published in English, By T.G., London, Printed by George Miller, 1640.
Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Digital Collection : General Collection, BRBL, Yale University Library, Call Number : Ih F779 640.
9PRÉFACE
Fortunatus en Angleterre
L ’ Histoire des Aventures heureuses et malheureuses de Fortunatus a été l’un des textes les plus fréquemment publiés dans l’Europe de la première modernité. Paru en allemand à Augsbourg en 1509, le roman a été traduit aux xvie et xviie siècles non seulement en hollandais, anglais, français et italien, mais aussi en polonais, danois, suédois, hongrois et islandais. Sa trajectoire est un exemple extrême de la mobilité des textes, recomposés, remaniés, augmentés ou abrégés au fil des traductions et des éditions. Dans son livre savant et inventif, Catherine Velay-Vallantin rappelle les raisons d’une telle malléabilité qui modifie les motifs et séquences de la narration, inscrit le texte dans différents genres et lui donne des significations politiques, sociales et religieuses différentes selon les temps et les lieux.
Avant 1509, l’histoire qui fait la trame du roman a déjà une longue histoire : celle d’un conte placé dans la classification d’Aarne et Thompson parmi les contes qui manient objets magiques et fruits. Ses motifs essentiels sont ainsi décrits : un homme reçoit d’une princesse un objet magique (une bourse inépuisable, un chapeau qui transporte immédiatement dans un autre lieu) ; l’objet est volé par une autre princesse et il n’est récupéré qu’après que celle-ci a mangé une pomme merveilleuse qui fait disparaître les cornes qui lui étaient poussées après qu’elle eut mangé une autre pomme, maléfique celle-là. La première version écrite du conte se rencontre dans le manuscrit des Gesta Romanorum, un manuscrit rédigé entre la fin du xive siècle et le début du xve siècle. La trame est la matière de très nombreux contes, collectés par les folkloristes. Catherine Velay-Vallantin en cite deux : l’un recueilli en 1915 auprès des Indiens Penobscot dans le Maine, l’autre enregistré à Terre-Neuve en 1975. Mais dans son livre, son propos n’est pas de comparer les variantes orales du conte avec les versions imprimées de l’histoire. Il s’agit de comprendre comment les choix de traduction, les variantes textuelles et les décisions 10éditoriales ont attribué à l’histoire des significations et des publics différents dans chacun des contextes de sa publication.
Catherine Velay-Vallantin s’arrête sur l’un des épisodes de cette longue histoire textuelle : les traductions anglaises de Fortunatus. D’emblée, l’enquête rencontre la difficulté créée par l’absence d’éditions connues, non pas par la survivance d’exemplaires imprimés, mais seulement par les mentions qui en sont faites dans des documents d’archives. Il en va ainsi du premier Fortunatus anglais. Le 22 juin 1615, le libraire Richard Field fait enregistrer par la communauté des libraires et imprimeurs de Londres son droit de propriété sur un livre dont le titre est The Historye of Fortunatus. Il n’en existe aucun exemplaire imprimé. Field a-t-il vraiment publié le texte ? Ou bien, tous les exemplaires de son édition ont-ils disparus ? On peut rappeler qu’il avait imprimé en 1593 le poème de Shakespeare Venus and Adonis et que ne subsiste qu’un seul exemplaire de cette édition. Le 3 avril 1626, après le décès de Richard Field, sa veuve transfère la propriété de dix-neuf titres au libraire George Miller, avec, parmi eux, The Historye of Fortunatus. Le texte a-t-il été publié dans une édition elle aussi perdue ? En tout cas, ce n’est qu’avec son édition de 1640, dont un seul exemplaire a été conservé, que le texte anglais nous est connu, publié sous le titre de The right pleasant and variable tragicall historie of Fortunatus. Le roman, qui recevra au fil des éditions et des traductions de multiples assignations génériques, commence donc sa carrière imprimée anglaise comme une « histoire tragique », ce qui avait été le cas d’Hamlet dans ses deux premières éditions de 1603 et 1604.
La transmission du manuscrit possédé par Richard Field à George Miller laisse supposer que le texte publié en 1640 est celui de 1615. Une affirmation de son titre long retient l’attention. Le livre, un in-octavo de 222 pages, est présenté comme « First penned in the Dutch tongue ». La formule dissimule que l’édition originale de Fortunatus n’est pas hollandaise, mais allemande et que le traducteur anglais a traduit l’histoire à partir d’une édition du texte allemand, celle de 1549 à Francfort ou celle de 1588 à Cologne. La fausse identité hollandaise proclamée par le titre anglais avait un double propos : inscrire le livre dans le contexte de la politique d’alliance entre l’Angleterre et les Provinces Unies et situer son édition dans les réseaux des collaborations nouées entre les éditeurs protestants anglais, français et hollandais. Elle est un premier indice qui conduit à la thèse centrale du livre de Catherine Velay-Vallantin, qui 11tient le Fortunatus anglais de la première moitié du xviie siècle pour un « roman protestant », fidèle au texte allemand « protestantisé » de 1549 et pensé comme un instrument au service de la propagande réformée.
Après avoir attiré l’attention sur le phénomène fondamental et pourtant peu commenté des éditions disparues et des livres perdus, Catherine Velay-Vallantin montre, à partir de minutieuses lectures, sensibles à des détails textuels qui pourraient paraître insignifiants, ce que les textes cachent. L’utilisation de fausses indications quant à l’origine des textes traduits n’est pas uniquement anglaise. La première édition française de l’Histoire des Aventures de Fortunatus, publiée à Rouen en 1626, est dite « Nouvellement traduit de l’espagnol », alors que l’espagnol est l’une des langues dans lesquelles le roman n’a jamais été publié à l’époque moderne. La raison de la menterie est éditoriale. Il s’agissait d’inscrire le livre dans l’horizon d’attente créé par le succès des récits venus d’Espagne : romans de chevalerie, romans picaresques ou, bien sûr, l’histoire de l’hidalgo de la Manche. Dans ce contexte, Fortunatus pouvait être lu comme un curieux assemblage entre le désenchantement chevaleresque et les péripéties des vies picaresques, entre l’honneur souvent bafoué et l’argent, abondant grâce à Dame Fortune mais aussi dérobé ou dilapidé.
En Angleterre, les choix faits par le traducteur Thomas Gainsford, dont Catherine Velay-Vallantin reconstruit précisément la carrière militaire et littéraire, donne au texte une autre résonance, celle d’un « puritanisme politique » qui fait du livre, tout à la fois, un récit de voyages de grande ampleur et riche en informations, un plaidoyer pour une Irlande colonisée et protestante, et un écrit habité par les références implicites à la situation politique du temps. La démonstration est menée à deux échelles : celle, politique ou religieuse, des épisodes essentiels de la narration (ainsi la description de l’Irlande ou la descente dans le Purgatoire) et celle, lexicale, des décisions prises pour la traduction de certains mots.
Ce premier Fortunatus anglais fut suivi de nombreux autres, qui attribuèrent au récit de nouvelles significations. Catherine Velay-Vallantin marque les temps forts de cette trajectoire, en portant l’attention sur les relations entre les mutations de la forme ou du genre du texte et ses possibles lectures et lecteurs. Avec les éditions de Thomas Haley en 1682 ou celle de William Onley en 1702, le récit est divisé en deux 12parties bien distinctes : l’histoire du père, Fortunatus, avec sa bourse inépuisable et son chapeau magique, et les aventures des fils, Andolocia et Ampedo. Sous une forme très réduite, il est l’une des « stories » compilées dans des ouvrages de première éducation qui associent abécédaire, syllabaire, préceptes, exemples et brèves histoires. Le livre The Child’s new Play-Thing publié par Thomas Cooper en 1742, inaugure cet usage didactique de Fortunatus. Fortunatus constitue également l’un des titres du répertoire des « chapbooks », vendus par les colporteurs. Là encore, les éditions conservées ne donnent qu’une fausse idée de la circulation massive de ces livres fragiles, voués à la disparition. Les catalogues des libraires des xviie et xviiie siècles en mentionnent des éditions dont il n’existe plus aucun exemplaire. Avec d’autres enquêtes, ce constat invite à réviser la notion de « livres rares ». Le premier Folio des pièces de Shakespeare paru en 1623 n’est pas rare : 234 exemplaires en ont été conservés. En revanche, les ouvrages brochés du colportage, « chapbooks » anglais, « pliegos sueltos » ibériques et certains titres de la Bibliothèque bleue française, le sont effectivement. Nombreuses sont leurs éditions qui appartiennent au grand continent des livres perdus.
Le livre de Catherine Velay-Vallantin est aussi une invitation à la comparaison. Devenue « chapbook », publiée en petit format et dans des versions très abrégées en Angleterre, l’histoire de Fortunatus est aussi entrée dans le catalogue des éditeurs des livres bleus, colportés dans les villes puis les campagnes françaises. Alfred Morin en a recensé onze éditions publiées à Troyes entre la mi-xviie siècle et la fin du xviiie siècle. Elles appartiennent à trois familles d’éditions : les éditions imprimées pour les libraires parisiens Jean Musier ou Antoine de Rafflé, les éditions des Oudot, qui mentionnent une approbation de 1705, et les éditions des Garnier, publiées sous une permission de 1728. Dans tous les exemplaires le titre est le même : Histoire des aventures heureuses et malheureuses de Fotrtunatus, avec sa bourse et son chapeau, enseignant comment un jeune homme doit se gouverner, tant envers les grands que les petits. Certaines éditions rappellent l’indication mensongère de Rouen en 1626 : « nouvellement traduit de l’espagnol ». Dans le catalogue troyen, le récit, qui n’est pas abrégé et occupe deux cents pages, est situé entre la littérature picaresque, celle de l’Aventurier Buscon, et les instructions pour la jeunesse. Le format in-octavo de toutes ses éditions l’éloigne, en revanche, des anciens romans de chevalerie, présentés aussi comme des « Histoires », 13celles de Huon de Bordeaux, de Valentin et Orson ou des Quatre fils Aymon, mais toujours publiés dans le format in-quarto.
L’analyse minutieuse des éditions successives d’un « même » récit telle que la mène Catherine Velay-Vallantin propose une belle leçon de méthode. Pour chacun des états imprimés de l’histoire de Fortunatus, elle explore méthodiquement les raisons de la mobilité de l’œuvre. Les plus évidentes tiennent aux variantes du texte lui-même, remanié à des fins religieuses, contracté pour s’ajuster à un lectorat juvénile ou populaire, infléchi pour mieux convenir au genre qui lui est attribué : récit d’initiation, roman de chevalerie ou littérature de la gueuserie, histoire tragi-comique, « exemplum » moral, description géographique, bulletin d’information – et d’autres encore. Ces variations textuelles ne peuvent être séparées de la matérialité de la publication. Celle-ci impose format et longueur et elle établit une intertextualité éditoriale, soit au sein d’une politique rendue visible par les autres textes publiés par le même éditeur, soit dans les livres eux-mêmes lorsqu’ils associent dans une même reliure Fortunatus et d’autres œuvres.
L’étude prend soigneusement en compte ce qui dans le livre n’est pas le texte. De là, l’attention portée aux caractères typographiques (le texte du Fortunatus de 1640 est publié en « black letter », la gothique anglaise qui le « naturalise ») et aux illustrations. Catherine Velay-Vallantin s’attache tout particulièrement aux gravures qui donnent à voir la Fortune, en reprenant ou ignorant l’iconographie héritée des livres d’emblèmes. Dans le Fortunatus, ces images font écho aux deux significations de l’allégorie : la Fortune est pourvoyeuse d’une richesse sans limite, telle que l’est la bourse donnée à Fortunatus, le bien nommé, mais elle est aussi juchée sur une roue inexorable qui fait succéder la chute au triomphe, la pauvreté à l’opulence, comme le montre la vie du héros et de ses fils.
Deux autres raisons rendent compte de la mobilité des œuvres. D’abord, leur mode d’attribution. Toutes les éditions anglaises de Fortunatus sont publiées sous le régime de l’anonymat, sans nom d’auteur. Celui-ci n’est présent que dans l’édition de 1640 avec ses seules initiales, « By T. G. » – ce qui a permis de l’identifier et de situer l’édition du récit dans la trajectoire d’auteur de Thomas Gainsford. Le roman a été pour lui comme un laboratoire pour les écrits historiques, politiques et pamphlétaires qu’il publiera entre 1615 et 1624, date de son décès pendant la peste. Les textes changent aussi du fait de leur appropriation 14par les lecteurs. Catherine Velay-Vallantin a recueilli avec patience quelques rares témoignages des lectures des Fortunatus anglais aux xviie et xviiie siècles. La lecture que Francis Kirkman rappelle dans son autobiographie, publiée en 1673, ou celle qu’il attribue au héros de son roman picaresque, The English Rogue, sont des lectures du temps de l’enfance. Dans la première moitié du siècle, même si le titre de 1640 destine le livre aux jeunes hommes qui y apprendront comment bien se comporter dans les affaires du monde et les circonstances imprévues, le récit avait sans nul doute un public plus large et plus varié, composé par d’anciens militaires, comme l’était Gainsford lui-même, par les nobles et les notables, ces « curteous readers » que mentionne l’adresse au lecteur, partagés entre la nostalgie des hauts-faits chevaleresques et les exigences prosaïques du quotidien, et par tous ceux qui aimaient les histoires, celles que disaient les contes et les romans comme celles écrites au présent par les affrontements contemporains, violents, incertains, lus en filigrane dans le récit fabuleux.
Catherine Velay-Vallantin invite au voyage entre la magie des objets merveilleux du conte et les réalités politiques du temps des traductions et des éditions, entre la fable et l’histoire. Emboîtons-lui le pas.
Roger Chartier
Collège de France