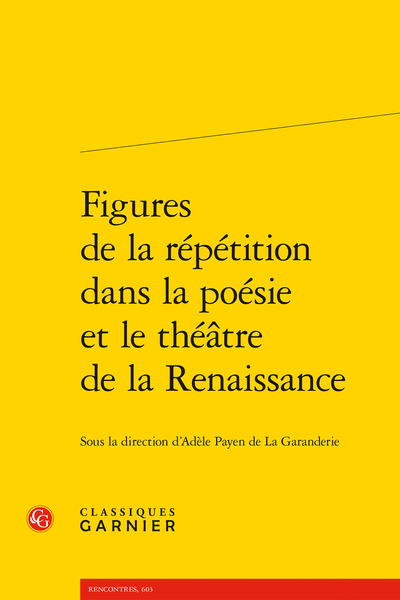
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Figures de la répétition dans la poésie et le théâtre de la Renaissance
- Pages : 209 à 212
- Collection : Rencontres, n° 603
- Série : Rhétorique, stylistique, sémiotique, n° 11
- Thème CLIL : 3154 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Linguistique, Sciences du langage -- Stylistique et analyse du discours, esthétique
- EAN : 9782406154013
- ISBN : 978-2-406-15401-3
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15401-3.p.0209
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 03/01/2024
- Langue : Français
Résumés
François Rouget, « Préface »
Les huit études réunies dans le présent volume s’attachent à définir la nature, la place, les formes et les enjeux – les limites aussi – de la répétition dans le répertoire littéraire français, de Clément Marot à Agrippa d’Aubigné. Cette approche, particulièrement fructueuse, et qui s’inscrit dans le cadre actuel des recherches en rhétorique, accorde la part du lion à la poésie de la Pléiade, sans négliger toutefois la génération précédente, fondatrice, et le théâtre.
Adèle Payen de La Garanderie, « Introduction. Figure, (con)figuration, figurativité, et autres dérivations : réflexions sur la répétition au xvie siècle »
Figures ancillaires et néanmoins essentielles, les répétitions manifestent l’expansion en acte du discours autant qu’elles en étayent la dynamique soucieuse de variation. Inclassables, elles signalent pourtant des efforts d’innovation morphologique et lexicale et consacrent la victoire de la diction sur la métrique. Leur figurativité polymorphe aide à mesurer l’ampleur de mutations signifiantes affectant les genres et les formes poétiques au xvie siècle.
Anne-Pascale Pouey-Mounou, « D’Érasme à Fouquelin, les figures de répétition autour de la Pléiade (Ronsard, Ode à Michel de L’Hospital) »
Phénomène majeur, mais peu théorisé chez les poètes de la Pléiade, les figures de répétition sont à envisager comme le moyen d’une poétique plus globale centrée sur les mots. Un parcours à travers les traités rhétoriques du xvie siècle, d’Érasme à Fouquelin, et l’exemple de l’Ode à Michel de L’Hospital, permettent de préciser la perception musicale, sémantique et morphologique qui est faite d’elles, et l’attention portée par la Pléiade à la dérivation comme ressource tropique par excellence.
210Ullrich Langer, « La répétition de “doux”. De l’intensité à l’espace intime (Pétrarque, Du Bellay, Ronsard, Habert) »
Le mot doux et ses variantes morphologiques figurent souvent dans la lyrique renaissante. La rhétorique comprend sa répétition comme une amplification servant de preuve dans la démonstration de l’obsession amoureuse. L’examen de quatre poètes – Pétrarque, Du Bellay, Ronsard et Habert – révèle un usage varié de la répétition de doux, bien au-delà de l’amplification : saturant les vers, il amène une concentration radicale sur la bien-aimée et la construction d’un espace érotique intime.
Sylvain Garnier, « Entre métrique et rhétorique, les refrains au théâtre de la Renaissance à l’âge baroque »
Alors qu’il est relativement fréquent dans le théâtre des rhétoriqueurs de la première moitié du xvie siècle et le théâtre baroque du premier tiers du xviie siècle, le refrain disparaît pratiquement de la dramaturgie humaniste et de la dramaturgie classique ; et ces phases d’engouement ou de désamour pour cette forme d’écriture spécifique s’expliquent en grande partie par les lectures poétiques, rhétoriques ou musicales que l’on peut faire du refrain en fonction des époques.
Romain Benini et Adeline Desbois-Ientile, « Répétitions à double fond(s) dans la chanson “Changeons propos” de Clément Marot »
La chanson « Changeons propos » de Marot présente des répétitions à la fois structurelles et matérielles qui signalent l’appartenance du poème à un double architexte : la chanson de vendanges d’une part, la poésie virtuose des grands rhétoriqueurs d’autre part. Elles font de la chanson un exemple de cette esthétique de l’entre-deux (haut et bas, populaire et savant) des premières décennies du xvie siècle, et une nouvelle preuve de la virtuosité légère du poète.
Sarah Caro, « Les répétitions dans les Amours de Ronsard et de Baïf (1552-1555). Figures linéaires, figures circulaires »
Si les figures de répétition, dans les Amours de Ronsard et de Baïf, se mettent au service à la fois d’un « remembrement » du corps féminin fragmenté et d’une érotisation, cet article montre qu’elles sont utilisées différemment 211par les deux poètes : alors que Ronsard a surtout recours à des figures de répétition circulaires (le chiasme et l’anadiplose), Baïf favorise les répétitions linéaires, qu’elles soient verticales (dans le cas de l’anaphore) ou horizontales (dans celui de l’épizeuxe).
Emma Fayard, « Le reflet et l’écho. Répétitions et métamorphoses dans le Bocage de Ronsard (1554) »
Que signifie, dans le paradigme rhétorique d’une copia diverse par essence, l’usage massif de figures fondées sur le retour systématique du même ? Ce paradoxe ronsardien, qu’illustre le Bocage, trouve sa résolution dans le caractère oratoire de la répétition poétique. Il faut en penser les figures comme des outils de la dispositio, et établir les conditions – énonciatives principalement – de leur pertinence. Devenues « nombres », elles laissent alors entendre le souffle lyrique du poète.
Adèle Payen de La Garanderie, « L’art de (se) ramentevoir. Les répétitions dans les Gayetez (1554) d’Olivier de Magny »
Étudiant les figures de répétitions dans leurs interactions avec les trois dominantes poétiques du recueil d’Olivier de Magny – la familiarité, l’érotisme et la spontanéité –, cet article propose de nouvelles pistes de réflexion sur le genre de la folastrie réinventé en gayeté. Les stratégies poétiques, stylistiques et musicales d’itération et de remémoration contribuent à l’élaboration de joyeuses îles fortunées où le poète, maître de la liaison, triomphe de toutes les déchirures du temps.
Julie Chabroux-Richin, « La répétition comme “figure de construction” poétique dans quelques sonnets du Printemps d’Agrippa d’Aubigné »
À partir de sonnets représentatifs du phénomène, ce parcours dans le Printemps d’Aubigné a pour objectif de montrer combien la figure de la répétition est un élément essentiel de renouveau poétique. Employée à la fois comme un outil de structuration rythmique et de structuration sémantique, la figure de rhétorique change de statut en s’inscrivant dans le processus même de la construction du poème. Cet article met au jour les effets de potentialisation réciproque de la répétition et du sonnet.
212Anne-Pascale Pouey-Mounou, « Conclusion »
Omniprésentes et dédaignées, les figures de répétition ont beaucoup à nous dire de la façon dont se structurent et évoluent les conceptions de la chanson, de la poésie et du théâtre en vers, du xvie au xviie siècle. À travers un riche échantillonnage de figures et de postures d’auteurs, ce volume esquisse une histoire de leurs formes et de leurs fonctions (structurante, dynamisante, transgressive), dans une « fête des sens » (à tous les sens du terme) où la représentation se fait présence.