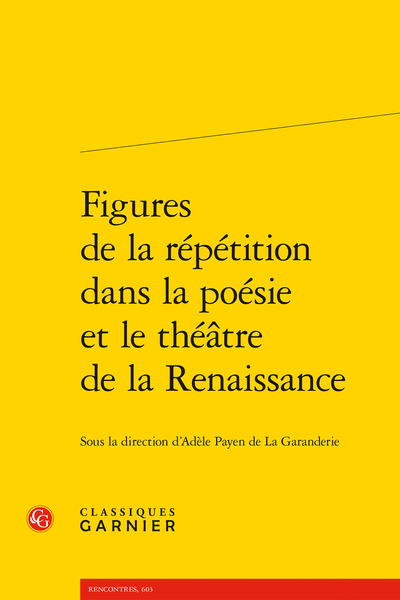
Préface
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Figures de la répétition dans la poésie et le théâtre de la Renaissance
- Auteur : Rouget (François)
- Résumé : Les huit études réunies dans le présent volume s’attachent à définir la nature, la place, les formes et les enjeux – les limites aussi – de la répétition dans le répertoire littéraire français, de Clément Marot à Agrippa d’Aubigné. Cette approche, particulièrement fructueuse, et qui s’inscrit dans le cadre actuel des recherches en rhétorique, accorde la part du lion à la poésie de la Pléiade, sans négliger toutefois la génération précédente, fondatrice, et le théâtre.
- Pages : 7 à 10
- Collection : Rencontres, n° 603
- Série : Rhétorique, stylistique, sémiotique, n° 11
- Thème CLIL : 3154 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Linguistique, Sciences du langage -- Stylistique et analyse du discours, esthétique
- EAN : 9782406154013
- ISBN : 978-2-406-15401-3
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15401-3.p.0007
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 03/01/2024
- Langue : Français
- Mots-clés : Littérature, auteur, répéter, rhéteur, théâtre, œuvre
Préface
Nos contemporains, peu familiarisés avec l’esthétique de la Renaissance, semblent éprouver un sentiment de déception, voire de lassitude, à la lecture d’un texte du xvie siècle. Les spécialistes eux-mêmes ne confessent-ils pas parfois leur gêne devant tant de poèmes d’amour de cette époque qui tentent de redire en français l’un des motifs expressifs de la topique pétrarquienne ?
Établie sur un principe de relation mimétique, la littérature peut dérouter celui qui ne possède pas les codes de réception des œuvres, mais séduire celui qui s’efforce de percer la vérité qui se cache derrière le voile des fables. Ce faisant, il est invité à mesurer l’écart qui sépare l’imitation du texte-source, et à apprécier, par l’exercice de duplication ou de répétition, l’ingéniosité de l’imitateur, qui fait varier l’expression du modèle et tente de le dépasser.
Dans la perspective d’une création mimétique (de la Nature ou des œuvres), l’acte de répétition est essentiel à la littérature. Comme tous les concepts, la répétition possède une grammaire qui vaut par sa souplesse et sa plasticité. À travers cette opération, elle recourt à des outils thématiques, rhétoriques, stylistiques et prosodiques dont les effets restent inattendus. Réussie, la répétition structure le texte et lui donne un sens cohérent. Bavarde, elle tombe dans le verbiage superficiel.
Quelle que soit l’époque, les théoriciens de la littérature se sont interrogés sur la nature et le rôle de la répétition, et ils sont parvenus à émettre des conclusions souvent discordantes. Quintilien observe que ce sont l’admiration excessive et l’inspiration abondante qui ont conduit Stésichore à imiter de trop près Homère, et à devenir « redondant et diffus » (redundat atque effunditur1). Inversement, Jacques Peletier félicite 8Virgile de s’être « gardé des redites qui sont en Homère2 ». Au nom du principe de clarté, les deux critiques ont compris le risque que la répétition mal maîtrisée faisait encourir à l’apprenti poète. Mais ce n’est pas dire qu’ils ont proscrit cette opération de l’esprit, tant s’en faut. Les rhéteurs, tel Cicéron, ont toujours recommandé l’usage de répétitions de mots ou de tournures, de figures de style – autant de « reprises3 » conférant de la noblesse et de l’éclat au discours. Jérôme Vida, dans son Art poétique, en a retenu la leçon, qui proclame le primat de la varietas dans l’abondance des mots et des figures choisies par le poète4. À la fin du siècle, Le Tasse ne le dira pas autrement :
La répétition de mots est encore un ornement propre à enrichir le poème et à lui donner de la magnificence […]. Mais ce qui donne une emphase particulière au discours quand on redouble un mot, c’est que celui-ci soit de sens ou de ton élevé […]5.
Ainsi, chacun s’accorde pour croire au bien-fondé de la répétition lorsqu’elle est motivée sémantiquement. Répéter, sans reproduire à l’identique, ne procure-t-il pas un plaisir infini ? Mieux, l’empreinte d’un poète ne se caractérise-t-elle pas par la récurrence de mythèmes et de stylèmes qui forgent son imaginaire intérieur ?
On peut le penser lorsqu’on relit, comme nous y invite Anne-Pascale Pouey-Mounou6, l’« Avertissement au lecteur » des Quatre premiers livres des9Odes (1550) de Ronsard. Tandis qu’il vient de renouveler sa proclamation du droit à l’inconstance et à la liberté créatrice, le Vendômois défend la constance de ses expressions, à l’image de ses modèles tutélaires :
Au surplus, lecteur, tu ne seras émerveillé si je redi souvent mémes mots, mémes sentences, et mémes trais de vers, en cela imitateur des poëtes Grecs, et principalement d’Homere, qui jamais, ou bien peu ne change un bon mot, ou quelque trac de bons vers, quand une fois il se l’est fait familier7.
Les répétitions, ou « atomes du petit monde de [s]es inventions8 », concernent le lexique, les sujets et la prosodie. À cela, il faut ajouter naturellement les figures de style (anaphores, anadiploses, épanalepses, etc.) qui impriment une physionomie et un rythme, c’est-à-dire constituent une mémoire de la poésie9.
Infiniment renouvelée, la répétition apporte ainsi un véritable plaisir, que vient conforter la variété des « arguments » et des formes. Si la création, comme l’a rappelé Ullrich Langer10, implique un souci récurrent de recherche de variété qui favorise les « plaisirs du changement », elle agit à partir d’un socle thématique et formel que mettent en relief les variations qui en sont issues. En somme, la répétition définit la relation du même à l’autre. Elle œuvre à produire de l’unité, un sens jamais figé, un espace reconnaissable où l’esprit peut voyager à son gré. Sans répétition, point de repères ni de contours définissant un ensemble d’idées stables et pertinentes. La pensée d’un écrivain, son style, sa prosodie se mesurent à l’aune de récurrences ou de répétitions qui donnent une permanence à son œuvre. Ce sont parfois des images obsédantes (Charles Maurron11), des habitudes (spontanées ou concertées), des préférences rythmiques. Sans elles, il n’y aurait point d’équilibre ni d’harmonie ; l’œuvre littéraire demeurerait inorganisée, présenterait l’image d’un chaos ou d’une masse informe d’objets et de sensations.
10L’écrivain de la Renaissance est donc placé devant deux chemins : celui, familier, de la tradition ; ou l’autre, inconnu, de la nouveauté. Le meilleur sait qu’il faut concilier les deux approches pour assurer une marge de liberté, et conférer à ses œuvres de l’ordre dans la variété. Stabilité et mouvance, varietas dans l’unité.
Cette dialectique, qu’on peut concevoir comme la confrontation de forces centrifuge et centripète, régit une bonne partie des textes et préserve leur originalité de la redondance creuse et stérile. D’une manière originale, les huit études réunies dans le présent volume s’attachent à définir la nature, la place, les formes et les enjeux – les limites aussi – de la répétition dans le répertoire littéraire français, de Clément Marot à Agrippa d’Aubigné. Cette approche, particulièrement fructueuse, et qui s’inscrit dans le cadre actuel des recherches en rhétorique, accorde la part du lion à la poésie de la Pléiade, sans négliger toutefois la génération précédente, fondatrice, et le théâtre. C’est dire si la publication de cet ouvrage, conçu et dirigé par Adèle Payen de La Garanderie, est la bienvenue. Prémices d’une réflexion collective, ces Figures de la répétition ouvrent des voies nouvelles à l’analyse. Gageons qu’elles en susciteront beaucoup d’autres !
François Rouget
Queen’s University
1 Quintilien, Institution oratoire, X, 1, 62 : « Reddit enim personis in agendo simul loquendoque debitam dignitatem, ac si tenuisset modum, uidetur aemulari proximus Homerum potuisse, sed redundat atque effunditur, quod ut est reprehendendum, ita copiae uitium est » (« Il restitue en effet à ses personnages à la fois dans les actions et dans les paroles la dignité qui leur est due, et, s’il avait gardé la mesure, il aurait apparemment pu rivaliser au plus près avec Homère, mais il est redondant et diffus, ce qui appelle la critique, bien que ce soit un défaut dû à l’abondance »), édition et traduction de Jean Cousin, Paris, Les Belles Lettres, 1979, t. VI, p. 87.
2 Jacques Peletier du Mans, Art poétique (1555), in Traités de poétique et de rhétorique de la Renaissance, édition de Francis Goyet, Paris, LGF, « Livre de Poche Classique », 1990, p. 257-258.
3 Cicéron, Divisions de l’art oratoire, VI, 20 : « Illustris est autem oratio, si et uerba grauitate delecta ponuntur et translata et supralata, et ad nomen adiuncta et duplicata et idem significantia, atque ab ipsa actione atque imitatione rerum non abhorrentia » (« On donne de l’éclat au style en se servant de mots choisis pour leur allure noble, de métaphores, d’hyperboles, d’épithètes, de reprises, de synonymes, pourvu que tout cela ne jure pas avec le ton général du discours et avec la réalité »), édition et traduction d’Henri Bornecque, Paris, Les Belles Lettres, 1969, p. 10.
4 Jérôme Vida, De Arte poetica / Art poétique, édition et traduction de Jean Pappe, Genève, Droz, 2013, III, v. 32-43, p. 176-177.
5 Le Tasse, Discours du poème héroïque, à la suite du Discours de l’art poétique, édition et traduction de Françoise Graziani, Paris, Aubier, 1997, p. 318-319.
6 Voir sa contribution, infra, p. 25.
7 Voir les Œuvres complètes, édition de Paul Laumonier, Raymond Lebègue et Isidore Silver, Paris, STFM, t. I, 1973 (1re éd. 1914), p. 55.
8 Ibid.
9 Dans cette perspective, on relira avec profit les essais pénétrants d’Albert Py (Imitation et Renaissance dans la poésie de Ronsard, Genève, Droz, 1984) et de Nathalie Dauvois (Mnémosyne. Ronsard, une poétique de la mémoire, Paris, H. Champion, 1992 ; réédition Paris, Classiques Garnier, 2006).
10 Voir Penser les formes du plaisir littéraire à la Renaissance, Paris, Classiques Garnier, 2009, en particulier la deuxième partie (« Plaisirs du changement »), p. 59 sqq.
11 Voir Des métaphores obsédantes au mythe personnel, Paris, José Corti, 1976.