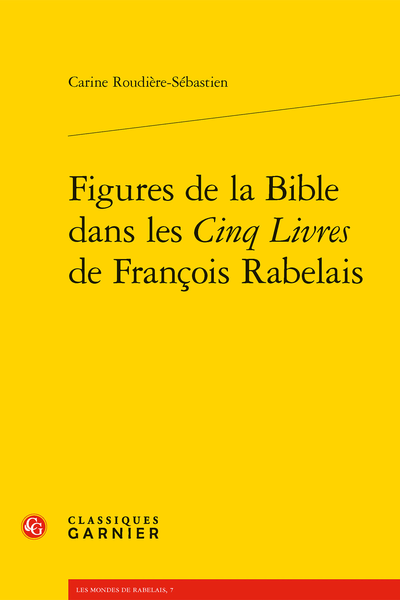
Introduction aux annexes
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Figures de la Bible dans les Cinq Livres de François Rabelais
- Pages : 321 à 323
- Collection : Les Mondes de Rabelais, n° 7
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406145295
- ISBN : 978-2-406-14529-5
- ISSN : 2264-427X
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14529-5.p.0321
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 01/03/2023
- Langue : Français
Introduction
aux ANNEXES
Toute citation est « ablation1 ». Les citations ci-dessous ne donnent que la phrase ou l’expression contenant l’allusion la plus manifeste à la Bible, en précisant chaque fois l’énonciateur de cette référence, mais le texte de Rabelais tisse de plus amples liens avec le texte biblique. La figure d’Assuérus en offre un exemple. Au chapitre li du Gargantua, le géant, victorieux de l’armée picrocholine, prend les dispositions qui conviennent : il règle le sort des prisonniers, enterre les morts, fortifie la ville pour mieux la protéger à l’avenir, paie ses soldats et ramène avec lui les plus valeureux d’entre eux auprès de Grandgousier son père, dont la réaction est à la hauteur de l’événement :
A la vue et venue d’iceulx le bon homme fut tant joyeux, que possible ne seroit descripre. Adonc leur feist un festin le plus magnificque, le plus abundant et plus delitieux, que feust veu depuis le temps du roy Assuere. (G, li, p. 136)
La suite du chapitre ne semble plus faire mention d’Assuérus, roi du Livre d’Esther. Pourtant la description de la magnificence du festin offert par Grandgousier, dont la joie se décline sur le mode de l’hyperbole suit l’Ancien Testament. Voici le texte de Rabelais :
A l’issue de table il distribua à chascun d’iceulx tout le parement de son buffet qui estoit au poys de dishuyt cent mille quatorze bezans d’or : en grands vases d’antique, grands poutz, grans bassins, grands tasses, couppes, potetz, candelabres, calathes, nacelles, violiers, drageouoirs, et aultre telle vaisselle toute d’or massif, oultre la pierrerie, esmail et ouvraige, qui par estime de tous excedoit en pris la matiere d’ilceulx. (G, li, p. 136-137)
Voici maintenant le passage du Livre d’Esther :
C’était au temps d’Assuérus, cet Assuérus dont l’empire s’étendait de l’Inde à l’Éthiopie […]. En ce temps-là, comme il siégeait sur son trône royal […], il donna un banquet, présidé par lui, à tous ses grands officiers et serviteurs 322chefs […] Il voulait étaler à leurs yeux la richesse et la magnificence de son royaume ainsi que l’éclat splendide de sa grandeur […] Ce n’étaient que tentures de toile blanche et de pourpre violette attachées par des cordons de byssus et de pourpre rouge, eux-mêmes suspendus à des anneaux d’argent fixés sur des colonnes de marbre blanc, lits d’or et d’argent sur un dallage de pierres rares, de marbre blanc, de nacre et de mosaïques ! Pour boire, des coupes d’or, toutes différentes, et abondance de vin offert par le roi avec une libéralité royale. (Esther, i, 1-21)
La description biblique insiste sur la magnificence et l’abondance du banquet. Dans la narration rabelaisienne, les énumérations sont là pour rivaliser avec cette profusion. Comme dans le texte source, l’insistance est mise sur l’extraordinaire des matériaux. Ce n’est plus tant le contenu du banquet (les mets et le vin) qui doit susciter l’admiration du lecteur, mais les contenants distribués aux compagnons de Gargantua, contenants qui finissent par se transformer en terres et châteaux. C’est ainsi que Frère Jean, pourvu le dernier, recevra en partage le pays de Thélème dont il fera l’usage que l’on sait.
L’épisode biblique d’Assuérus ne finit pas aussi noblement. On devinait déjà la part d’orgueil qui gouvernait l’ordonnance du banquet. Il ne s’agissait pas pour lui de remercier de valeureux guerriers, mais d’étaler sa richesse et sa puissance aux yeux de sujets qui peut-être risquaient de les mettre en cause. Et comme la reine Vasthi, d’une grande beauté, refuse d’obéir aux ordres de son époux qui lui demande d’apparaître devant les convives, Assuérus entre dans une terrible rage, répudie la reine et publie un avis royal établissant que tout mari est « maître chez lui ». L’histoire se termine cependant sur un espoir de liberté. La répudiation de Vasthi place finalement Esther sur le trône, et permet à celle-ci de défendre le peuple juif, de le réhabiliter dans l’empire et de lever les interdictions qui pesaient sur lui. Le péché d’orgueil du roi et sa volonté obstinée d’être maître à tout prix le conduisent paradoxalement à se plier à la volonté d’une femme et à reconnaître la liberté des juifs. Ce sont l’ordonnance d’Esther et sa lutte contre les ennemis du peuple élu qui donnent ainsi naissance au livre du même nom.
Si Grandgousier, comme le roi de Suse, est redevenu maître de son royaume, le don qu’il fait aboutit à la création de l’abbaye de Thélème dont le mot d’ordre est, au rebours de l’avis biblique, « Fay ce que vouldras ». Les deux épisodes, biblique et rabelaisien, débouchent donc parallèlement sur la création d’espaces de liberté inattendus. De manière implicite, Rabelais réécrit l’épisode en utilisant souterrainement ses 323différents éléments pour en transformer la portée et donner à comprendre tout autre chose. On voit bien là, que pour mesurer la portée du personnage de Grandgousier dans cet épisode, il faudrait citer toute la fin du chapitre li, et tout le chapitre i du Livre d’Esther, ce que nos relevés ne permettent pas. Le lecteur aura donc à l’esprit que les liens entre les citations suivantes ne se révèlent pleinement qu’à la lecture des références complètes.
1 Antoine Compagnon, La Seconde main, op. cit., p. 20.