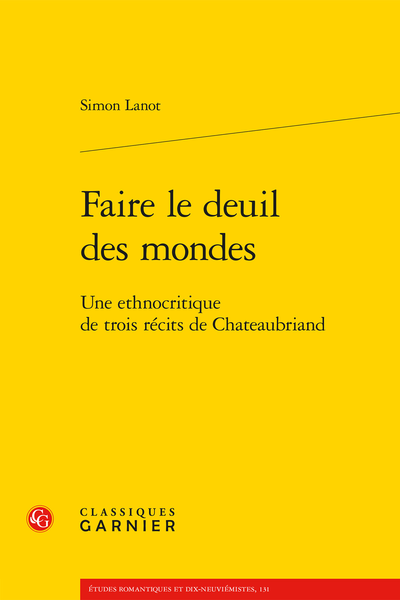
Introduction à la deuxième partie
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Faire le deuil des mondes. Une ethnocritique de trois récits de Chateaubriand
- Pages : 101 à 103
- Collection : Études romantiques et dix-neuviémistes, n° 131
- Série : Lire Chateaubriand, n° 9
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406157939
- ISBN : 978-2-406-15793-9
- ISSN : 2258-4943
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15793-9.p.0101
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 20/12/2023
- Langue : Français
Introduction
à la deuxième partie
En étudiant la polyphonie culturelle constitutive des textes littéraires, l’ethnocritique de la littérature analyse tout particulièrement la manière dont ils opèrent une « textualisation » des pratiques culturelles et des cosmologies minorées, marginalisées ou dominées. À partir de données ethnographiques, le récit d’Atala reconfigure des rites pratiqués dans les cultures autochtones d’Amérique du Nord, lesquels sont menacées de disparition au moment où le lecteur le découvre. Le récit se déroule avant la rupture épocale, à une époque où les cultures autochtones n’étaient pas encore marginalisées et minorées. Au début du « Récit », le narrateur, Chactas, précise qu’au moment de sa naissance (72 ans avant la situation dans laquelle il se trouve, à savoir 1725), les « Espagnols s’étaient depuis peu établis dans la baie de Pensacola, mais aucun blanc n’habitait encore la Louisiane1. » Chateaubriand compose son roman en intégrant de nombreuses sources livresques, ainsi que des observations faites lors de son voyage en 1791-1792. L’insertion des intertextes savants a fait l’objet de plusieurs études2 ; Marc Fumaroli relègue l’auteur du Voyage en Amérique au rang d’un « ethnologue amateur3 ». Les termes « ethnographie » et « ethnologie » n’existent pas encore4 lorsque l’écrivain compose Atala. Cependant, Chateaubriand dispose d’un vaste matériau composé de relations écrites par des missionnaires ou des voyageurs traitant de l’histoire des peuples autochtones d’Amérique, de leurs modes de vie, de leurs systèmes religieux et politiques ; dans le sillage 102de Montaigne et de Rousseau5, il prête une attention toute particulière aux mœurs, aux rites et aux coutumes des « Sauvages » en montrant comment ils procèdent d’un système cosmologique particulier. L’auteur d’Atala, à la différence de Rousseau ou de Montaigne, a effectivement voyagé au « Nouveau Monde » ; cependant, son œuvre littéraire est celle d’un voyageur qui a, en amont et en aval de son périple, voyagé dans les bibliothèques.
Notre but est de montrer comment le texte construit, par une sorte de bricolage6 à partir de sources savantes, sa propre logique culturelle, c’est-à-dire une « grammaire ritique » originale7. Claude Lévi-Strauss établit un lien original entre la « réflexion mythique » et la création artistique à partir de cette notion de bricolage : « Comme le bricolage sur le plan technique, la réflexion mythique peut atteindre, sur le plan intellectuel, des résultats brillants et imprévus. Réciproquement, on a souvent le caractère mythopoétique du bricolage : que ce soit sur le plan de l’art, dit “brut” ou “naïf” ; dans l’architecture fantastique de la villa du Facteur Cheval ; dans celle des décors de Georges Méliès8 ». Nous appréhenderons le texte d’Atala, comme un bricolagemythopoétique à partir d’éléments ethnographiques (ou plutôt pré-ethnographiques) divers et cousus de manière originale. Mais faire l’inventaire des éléments constitutifs d’une œuvre ne suffit pas à l’expliquer ; l’horizon descriptif et interprétatif de l’ethnocritique est « la culture du texte dans sa singularité relative et non l’indexation de la culture du texte9 ». Atala invente un monde à part entière régi par une cosmologie qui lui est propre et à laquelle le lecteur est initié. L’initiation du lecteur s’opère 103au seuil de la fiction, dans son « Prologue », qui raconte l’arrivée de René chez les Natchez. La courte description d’un rite de chasse nous semble fonctionner comme un rite de passage : passage pour René dans la communauté des chasseurs, passage pour le lecteur dans le monde de la fiction auquel il vient d’être initié. « René est de la troupe10 » : cette courte phrase qui atteste de l’intégration du personnage à la communauté des chasseurs après une série de rituels fonctionne de manière méta-textuelle comme l’initiation du lecteur à la logique cosmologique qui préside dans la fiction.
1 AT, p. 38. Chactas serait donc né vers 1653.
2 Voir surtout Pierino Gallo, Chateaubriand et l’épopée du Nouveau Monde. Intertextualité, imitations, transgressions, Paris, Eurédit, 2019.
3 Marc Fumaroli, Poésie et Terreur, op. cit., p. 241.
4 Selon le Dictionnaire historique de la langue française (dirigé par Alain Rey), le terme est attesté en 1819 ; « ethnographe » apparaît en 1827. Le mot « ethnographie » désigne à l’origine le classement des peuples d’après leurs langues.
5 Dans Tristes Tropiques, Claude Lévi-Strauss présente Rousseau comme « le plus ethnographe des philosophes » : « s’il n’a jamais voyagé dans les terres lointaines, sa documentation était aussi complète qu’il était possible à un homme de son temps, et il la vivifiait – à la différence de Voltaire – par une curiosité pleine de sympathie pour les mœurs paysannes et la pensée populaire » (Tristes Tropiques, ch. xxxviii, Œuvres,Paris, Gallimard, NRF, « Bibliothèque de la Pléiade », 2008, p. 418).
6 Nous empruntons cette notion de bricolage à Claude Lévi-Strauss, qui en fait le principe de la « pensée sauvage », laquelle, à la différence de la « pensée scientifique ou ingénieuse », assemble des éléments hétéroclites. Voir à ce sujet le premier chapitre de La Pensée sauvage (Œuvres, op. cit., p. 559-596).
7 Marie Scarpa, L’éternelle jeune fille. Une ethnocritique du Rêve de Zola, Paris, Champion, 2009.
8 Claude Lévi-Strauss, La Pensée sauvage, op. cit., p. 577.
9 Jean-Marie Privat et Marie Scarpa, « Ethnocritique et anthropologie(s) de la littérature », L’Homme, no 206, p. 187.
10 AT, Prologue, p. 37.