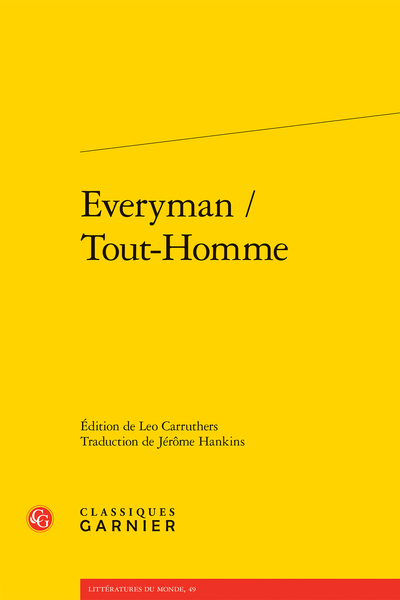
Annexe I La langue de la pièce anglaise
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Everyman / Tout-Homme
- Pages : 141 à 142
- Collection : Littératures du monde, n° 49
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406138303
- ISBN : 978-2-406-13830-3
- ISSN : 2261-5911
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-13830-3.p.0141
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 19/04/2023
- Langue : Français
Annexe I
La langue de la pièce anglaise
Comme nous l’avons vu, la mentalité qu’exprime cette moralité correspond au catholicisme ordinaire du Moyen Âge tardif, ce qui est normal pour une œuvre d’origine monastique comme Elckerlijc, composée avant 1485. Mais il ne faut pas confondre mentalité et langue. Bien que la traduction anglaise, réalisée sans doute vers 1510, ait vu le jour seulement une génération après l’original flamand, la langue d’Everyman est celle de la Renaissance, qu’on appelle aussi la première modernité.
Les philologues divisent l’histoire de la langue anglaise en plusieurs périodes : 700-1100 pour le vieil anglais (encore proche de ses racines germaniques), 1100-1500 pour le moyen anglais (caractérisé par l’influence du français), 1500-1650 pour l’anglais de la Renaissance (Shakespeare étant son plus haut représentant), 1650-1900 pour l’anglais moderne, enfin de 1900 à nos jours pour l’anglais contemporain. Conventionnelle, pratique, cette répartition historique en chiffres ronds reste néanmoins discutable ; en effet, la transition d’une phase linguistique à une autre est une affaire subtile, complexe, le fruit de multiples changements qui ne peuvent se limiter dans leur ensemble à une seule année. Il est néanmoins vrai que l’anglais du début du xvie siècle se démarque du moyen anglais. Sans doute l’arrivée de l’imprimerie y est pour beaucoup. Rappelons que c’est en 1476 que le premier imprimeur anglais, William Caxton, ouvre sa presse à Westminster, ce qui accéléra l’évolution de la langue1.
Formes pronominales et verbales désuètes dans Everyman
142Dans un premier temps, le texte du xvie siècle peut paraître étrange à celui qui ne connaît que l’anglais de nos jours, non seulement à cause des différences d’orthographe mais aussi et surtout à cause des désinences grammaticales qui étaient encore en place. Les personnes ayant lu Shakespeare en version originale retrouveront dans Everyman quelques traits communs avec la langue du grand dramaturge, traits auxquels on s’habitue en peu de temps sans trop de difficulté. En premier lieu, certaines désinences pronominales et verbales attirent l’œil contemporain, notamment celles de la seconde personne du singulier, car l’anglais moderne, à défaut de les avoir entièrement éliminées, a simplifié le système.
Dans l’anglais d’Everyman, le second pronom personnel du singulier, cas direct et indirect, se disent thou et thee (« tu, toi ») ; l’adjectif possessif singulier est thy (« ton, ta, tes »), et le pronom possessif thine (« tien, tienne »). En revanche, le nominatif pluriel du pronom est ye (« vous »), son cas indirect you (« à vous »). Ce dernier you finira par évincer, en anglais standard, non seulement le nominatif pluriel ye, mais aussi les deux cas du singulier, thou et thee. De même, l’adjectif possessif moderne est your, le pronom possessif yours. On peut donc affirmer qu’en anglais de nos jours, d’un point de vue grammatical, cette prédominance du pluriel signifie qu’on vouvoie tout le monde – mais sans volonté particulière de la part des locuteurs, car plus personne n’y pense. Ce n’était pas le cas au xvie siècle quand le singulier était encore bien implanté dans les esprits. Si la langue orale bannit aujourd’hui les formes anciennes du singulier (il serait impossible, en effet, d’employer thou, thee, thy, thine, dans une conversation courante), ces mots n’ont pas encore été oubliés ; en effet, ils peuvent figurer de temps à autre dans la littérature, particulièrement en langage poétique ou dans les hymnes traditionnels, où l’effet produit est à la fois intimiste et archaïque.
Correspondant au pronom thou, le verbe possède une désinence, -(e)st, au présent comme au passé, marquant la seconde personne du singulier. Cela donne des tournures comme thou hast « tu as » (v. 109), thou comest « tu arrives » (v. 119), et thou mayst « tu pourras » (v. 151), etc.
Quant à la troisième personne du singulier au présent de l’indicatif, le verbe prend la désinence -eth (ancêtre du -s actuel), par exemple he thynketh « il pense » (v. 95). La même désinence, aujourd’hui disparue, se trouve au pluriel : children sytteth « les enfants vivent » (v. 760), etc.
1 L’ouvrage de référence le plus important en la matière, le Middle English Dictionary (24 volumes, 1954-2001), s’arrête en 1475, l’année avant la création de la presse de Caxton. Le dictionnaire du moyen anglais ne prend plus en compte les sources écrites ou imprimées après cette date.