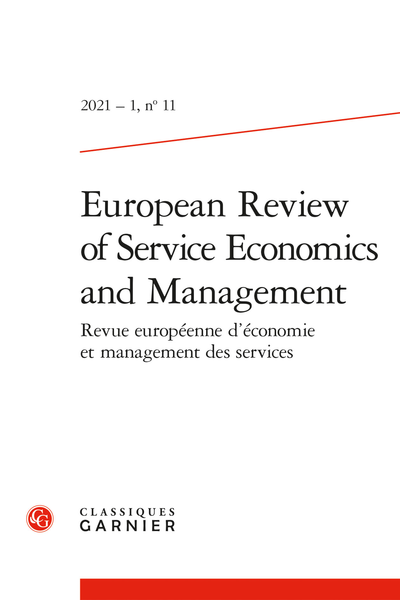
Comptes rendus de thèses
- Type de publication : Article de revue
- Revue : European Review of Service Economics and Management Revue européenne d’économie et management des services
2021 – 1, n° 11. varia - Pages : 179 à 189
- Revue : Revue Européenne d’Économie et Management des Services
- Thème CLIL : 3306 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie de la mondialisation et du développement
- EAN : 9782406120520
- ISBN : 978-2-406-12052-0
- ISSN : 2555-0284
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12052-0.p.0179
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 23/06/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langues : Anglais, Français
Francesca Serravalle (2020), Augmented reality in retail: an analysis of this immersive technology through consumers’ and retailers’ perception, Thèse de doctorat en Sciences de Gestion (PhD in Business Management), University Lyon 3 (IAE Business School and University of Turin (co-tutelle), defended 25th November 2020.
PhD supervisor: Régine Vanheems, Full Professor, University Jean Moulin-Lyon 3, and Milena Viassone, Associate Professor, Università degli Studi di Torino.
PhD committee: Gilles Pache, Full Professor, Aix-Marseille Université (Président); Camal Gallouj, Full Professor, Université Sorbonne Paris Nord (Rapporteur); Lara Penco, Full Professor, Università degli Studi di Genova (Rapporteure); Anna Claudia Pellicelli, Associate Professor, Università degli Studi di Torino (Suffragante).
Technologies have become increasingly pervasive in the daily lives of consumers, offering them new experiences. This development has sparked scientific interest in the academic community, although research on this topic is still scarce. Thus, the aim of this PhD work is to study the perception of consumers and retailers of the use of immersive technologies (with particular focus on Augmented Reality, AR) in the retail world. In particular, the impact of these technologies on consumers’ behavioural intentions (willingness to buy, positive recommendation, online and offline traffic creation) is analysed.
Retailers are therefore faced with a big challenge: creating an attractive and unique experience by offering consumers the opportunity to use digital technologies in-store. In addition, consumer’s participation in the use of AR brings them into a state of immersion. In this regard, some authors describe this consumers’ immersion as a state of flow. Such immersion enhances both the consumer’s experience and learning by creating distortions in terms of temporal perception and control of their behaviour. The results reported in the work of this thesis show that this immersive flow has a mediating function between the use of 180AR and the different consumer responses after the virtual experience with AR.
More specifically, this thesis has been organised into three scientific articles, each of which has contributed to one of the research objectives described above.
Chapter 2 explores the influence of AR on the consumer purchase path. A qualitative exploratory study (20 semi-structured interviews) highlights the Italian consumers’ barriers to use immersive technologies while shopping. This study still reveals a certain reluctance to change or combine traditional and digital channels by consumers. This is in line with Hofstede’s cultural compass, which shows that risk aversion is a very relevant indicator in Italy. So, three elements should be emphasised:
1) The individual presents both a favourable and an unfavourable belief about AR. Indeed, all respondents are curious to try this technology for the first time, even if they do not trust it at all, for example: “It’s curious, but I’m a bit reluctant to use this technology, because it detaches us from reality, we lose the horizon. It could be useful for work or during a break, but the problem remains that we are subject to the use of too much technology” (Simona, 24 years).
2) Consumers are influenced by their expectations that relate to their beliefs about AR technology, for example: “It can be interesting in terms of online sales, but you have to already have some knowledge of the product, in the sense that you are already a customer of that brand, and you just want to understand what effect it can give, maybe with a different colour” (Diego, 50 years).
3) If consumers are optimistic and present a certain innovativeness with respect to technologies, they are more receptive and interesting in trying it out. In fact, those who present discomfort and insecurity are less participative during the try-on with the AR mobile application, for example: “I don’t care about this technology and I don’t know if consumers would be interested in it” (Marita, 61 years).
“I don’t have any resistance to innovation. If a technology interests me and intrigues me, I try it right away”. (Sarah, 24 years).
Then, Chapter 3 investigates retailers’ perspective, examining their perception of immersive technologies and their willingness to adopt them in-store. Using a multiple-case study approach, this study reveals Italian SMEs’ awareness of all the benefits offered by introducing immersive 181technologies, despite their risk aversion leads them to cautiously embrace technological innovations, resulting in the adoption of the simplest and cheapest technologies (e.g. the QR-Code). Innovation is therefore implemented gradually, with the aim of minimising risk-taking in SMEs with limited financial resources compared to large companies. Thus, the analysis of the data collected from section two of the questionnaire revealed two main categories influencing the perception of retailer readiness for AR: (a) business resistance to change and (b) the utilitarian aspect of this technology when it is introduced. Unfortunately, without breaking down the first category, it is difficult for enterprises to understand the full benefits of this type of technology. We know that firms are inclined to use a new technology if they believe in and support its use in a business. Without this element, enterprises prefer to reject an innovation, avoiding the risk of failure: “The difficulty is always that the mental legacy is to keep it where it is. So, sometimes it seems that new changes make something more difficult instead of facilitating it” (Owner Beta, 49 years).
Other enterprises are worried about losing their market position in terms of quality and professionalism, being overtaken by these kinds of technologies. Thus, the commoditisation of the profession could lead to a disqualification of the professionalism of retailers by automating a service currently offered to customise customer needs: “I hope AR does not increase internet shopping at the expense of in-store shopping” (Owner Alpha, 39 years).
The second category describes retailers’ perceptions of AR technology as a useful tool to improve understanding in the final appearance of a customised product by virtually testing the product, including through the overlay function: “I see AR as particularly useful in the furniture sector. Here the objects are real, you can change colour, having an immediate test of the products” (Owner of Beta, 49 years).
Finally, the last study (Chapter 4) highlights the mediating role of the flow AR experience between product involvement and consumer behavioural responses (willingness to buy the item, visit the physical shop, visit the website and recommend the experience). Thus, consumers’ immersion in the virtual purchase is greater when supported by immersive technologies such as AR, which helps consumers to virtually visualise the product. Consequently, the greater the consumers’ immersion in the virtual try-on, the higher will be their attitude towards the virtual 182experience. This attitude will manifest itself in a positive behavioural intention in terms of recommending the experience, willingness to buy the product or visiting the physical and online shop. In particular, the strength of this moderation is particularly strong in the relationship between AR flow experience and willingness to visit the retailer’s physical shop (β =0.95, p=0.000). This provides an interesting insight for retailers who want to introduce these technologies to generate traffic within their physical shops.
In addition, this PhD thesis shows an interesting result from the consumer’s point of view: when the technology is used alone, and there is no emotional implication towards the product category, the consumer’s perception focuses on the “WOW” effect, without generating any implication in terms of behavioural intentions. Moreover, in those sectors where the offline experience creates added value (e.g. clothing and food), without an emotional involvement of consumers in this specific product category, the AR experience does not replace the physical experience, creating no behavioural intention in consumers. On the contrary, when consumers are involved in the product category, the virtual experience with a product category projects them into a flow state, which enhances their experience, strongly influencing their behavioural intentions. Indeed, given the emotional involvement in a product, the greater the immersion in the digital experience, the more willing consumers are to buy the product, recommend the experience and visit the retailer’ online site and physical shop. Briefly, AR affects consumers’ immersive flow state and subsequent behavioural intentions only when their involvement with the product category is strong.
Keywords: Augmented Reality, Product Involvement, Consumer Behaviour, Perception, Omni-channel, Retailing.
183*
* *
Véréna Bourbia (2020), Le rôle de la diversité urbaine et commerciale sur les pratiques logistiques des commerces de détail alimentaire en ville : le cas des Hauts-de-France, Thèse de doctorat en Géographie, Université de Lille et Université Gustave Eiffel, soutenue le 18 décembre 2020.
Directrices de thèse : Corinne Blanquart, Université Gustave Eiffel (Co-directrice de thèse) ; Faridah Djellal, Professeure, Université de Lille (Co-directrice de thèse).
Membre du jury : Camal Gallouj, Professeur à l’Université Sorbonne Paris Nord (Rapporteur) ; Dominique Mignot, Ingénieur en chef des Ponts (Examinateur) ; Gwenaelle Raton, chargée de recherche à l’Université Gustave Eiffel (co-encadrante) ; Nathalie Lemarchand, Professeure à l’Université Paris 8 (Examinatrice) ; et Michel Savy, Professeur émérite, Université Paris Est (Rapporteur).
La logistique urbaine est une problématique dont se ré-emparent les acteurs publics depuis plusieurs années. Dans la mesure où cette logistique est source d’externalités négatives (pollution, nuisance sonore, congestion), les acteurs en question tentent de réguler ces externalités par des solutions réglementaires ou d’aménagement. La mise en place de ces solutions nécessite de s’appuyer sur des données faisant état de la logistique urbaine sur le territoire considéré. Ces données analysent le plus souvent les pratiques logistiques des établissements en fonction de leur secteur d’activité. Or, les évolutions du paysage commercial révèlent une multiplication des formats et des concepts ayant chacun des pratiques logistiques différentes, à l’image d’un supermarché à l’approvisionnement classique et d’un supermarché pratiquant les circuits de proximité. Ces différences de pratiques logistiques apparaissent indépendantes du secteur d’activité. Plus encore, l’appareil commercial peut différer d’une ville à l’autre, impactant tout autant les pratiques d’approvisionnement. Partant de ce double constat, cette thèse est une contribution à l’analyse des pratiques logistiques des commerces en villes, en avançant l’hypothèse 184que la diversité commerciale et urbaine impacte les pratiques logistiques. À partir du cas des commerces de détail alimentaires dans les Hauts-de-France, la démarche propose d’abord de recréer une typologie de commerces aux pratiques logistiques homogènes. Elle se poursuit ensuite avec l’analyse de la distribution de ces catégories de commerces dans différents types de villes des Hauts-de-France.
Ce travail de thèse s’organise en deux parties : l’une posant les bases théoriques de notre recherche, l’autre étant consacrée à la mise en place et à l’expérimentation de notre méthodologie.
La première partie est ainsi dédiée à l’analyse de l’objet d’étude sous les trois aspects tels qu’ils s’intègrent dans la problématique : la logistique urbaine et ses enjeux, la stratégie logistique des commerces alimentaires, la localisation interurbaine et intra-urbaine des commerces alimentaires. Le chapitre 1 est consacré à la logistique, constituant ainsi un premier aspect du cadre théorique. Il en définit les contours et en présente les différents acteurs. Il démontre surtout que la logistique urbaine constitue un enjeu de régulation pour les politiques publiques tout en soulignant la nécessité d’en approfondir les formes de connaissance.
Le chapitre 2 se recentre sur le commerce de détail alimentaire et étaye la première hypothèse de travail. Il montre qu’au sein d’un même secteur d’activité, les pratiques logistiques peuvent être multiples. Cette diversité de pratiques peut être d’ordre organisationnel ou spatial. Ce chapitre 2 sera ainsi l’occasion de prendre en compte les différentes formes de circuits et de réseaux dont peut relever un point de vente.
La dimension territoriale est au cœur du chapitre 3, qui se concentre sur les déterminants de localisation des commerces alimentaires. Ce chapitre ambitionne ainsi d’étayer la deuxième hypothèse de travail en montrant que la localisation des commerces ne dépend pas uniquement de la taille de la ville, mais inclut d’autres caractéristiques territoriales. Il s’intéresse à la différenciation des implantations commerciales en procédant à une analyse multi-scalaire : à l’échelle interurbaine et à l’échelle intra-urbaine.
Une fois les bases théoriques posées, la seconde partie de la thèse est consacrée à la méthodologie et aux résultats obtenus. Le chapitre 4 est ainsi dédié à l’élaboration de la méthodologie et à sa mise en œuvre à proprement parler. Temps crucial de la thèse, ce chapitre permet d’abord d’expliciter l’influence des enquêtes TMV sur la méthodologie et les choix 185qui ont été effectués en termes de terrain. À la suite, l’auteure élabore une typologie de commerces aux pratiques de logistique homogène. Enfin, elle détaille les indicateurs urbains retenus pour analyser la structure commerciale des villes à travers la typologie nouvellement constituée. À l’issue de ce chapitre, elle débouche sur une typologie de commerces homogènes d’un point de vue logistique et des données urbaines auxquelles les confronter pour identifier des déterminants influençant leur implantation.
Le chapitre 5 est consacré au travail statistique permettant de fonder une typologie de villes aux pratiques logistiques différenciées selon les caractéristiques de leur appareil commercial. Il s’articule autour de deux parties : premièrement, la constitution d’une typologie de villes sur la base des variables identifiées comme déterminantes des implantations commerciales ; deuxièmement, la qualification des profils commerciaux des types de ville obtenus, en intégrant cette fois les variables identifiées comme déterminantes des choix logistiques. L’enjeu est de vérifier si des choix d’organisation logistique peuvent être associés à des types d’unité urbaine.
Le chapitre 6, dernière étape de cette thèse, permet d’approfondir l’analyse des profils logistiques des types d’unités urbaines obtenues via des études de cas. Ces études reposent sur une série d’entretiens menés auprès de commerçants et de têtes de réseaux, issus des différentes catégories construites, au sein de chaque type de villes identifié. Cet approfondissement permet de qualifier plus finement les pratiques logistiques des catégories de commerces et, ainsi, d’affiner le profil logistique des types de villes obtenus par le travail statistique. Autrement dit, l’auteur propose une ébauche de profils logistiques des types de ville qu’elle associe à des propositions de solutions logistiques adaptées. L’ambition finale de la thèse est de permettre l’identification des leviers d’action les plus adaptés en termes de logistique urbaine pour les acteurs publics, selon les types de ville.
La thèse s’inscrit donc naturellement dans une perspective systémique de la logistique urbaine, dans laquelle il serait possible d’induire les pratiques logistiques d’un territoire à partir de ses caractéristiques urbaines.
Mots-clés : logistique urbaine, commerce alimentaire, ville, Hauts-de-France, stratégie logistique, localisation commerciale.
186*
* *
Débora Allam Firley, (2020), Spécificités de l’innovation dans les services d’assurance : le cas de l’agent général, Université Sorbonne Paris Nord, Soutenue le 11 janvier 2021.
Directeur de thèse : Camal Gallouj Professeur à l’Université Sorbonne Paris Nord.
Membres du jury : François Grima, Professeur, Université Paris-Est Créteil, (Rapporteur) ; Gilles Pache, Professeur, Université Aix Marseille (Rapporteur) ; Faridah Djellal, Université de Lille (Présidente) ; Yvon Pesqueux, Cnam (Suffragant) ; Céline Viala, Maîtresse de conférences, Université Sorbonne Paris Nord (Suffragante) ; Fabienne Alvarez, Maîtresse de conférences, Université des Antilles (Suffragante).
Cette thèse cherche à mettre en évidence les spécificités de l’innovation dans les services d’assurance. Elle repose sur une étude de cas unique, basée sur une participation observante dans une agence générale d’assurance. C’est l’approche de l’assurance à la fois en tant que service et en tant qu’organisation, et la collecte de données de l’intérieur qui constituent l’originalité de cette thèse. La structure étudiée, PME familiale d’assurance basée aux Antilles françaises, présente des caractéristiques permettant de répondre à la question de recherche : « comment innove-t-on dans l’assurance ? ». En particulier, la présence d’un service de traitement du sinistre, la grande proximité avec les équipes, et l’accès à une grande partie des étapes de la chaîne de valeur fondent l’intérêt du cas.
La partie théorique explore le champ de l’innovation dans les services. Nous soulignons tout d’abord l’existence de plusieurs approches analytiques dans lesquelles se sont inscrits les travaux dédiés à l’innovation dans les services. Pour ce faire, nous prenons appui sur les travaux fondateurs de l’innovation dans les services. Ainsi, nous montrons que l’émergence d’un paradigme scientifique donne lieu à plusieurs compréhensions du phénomène innovation. Cependant, loin de se contredire, ces différentes 187approches constituent un approfondissement autant qu’une adaptation aux transformations de l’environnement économique. Le poids croissant des services dans les systèmes économiques est l’une d’entre elles. En effet, le développement de la responsabilité sociale des entreprises laisse entrevoir une lecture sociale des innovations de services.
Nous nous intéressons ensuite aux différentes tentatives de modélisation de l’innovation dans les services et montrons qu’un certain nombre de ces travaux justifient la nécessité d’études sectorielles.
La question des formes que peut prendre l’innovation appelle au même constat. La grande diversité des services permet d’ouvrir de larges espaces d’innovation. Du process au service, de l’amélioration à la transformation, les services peuvent ainsi innover dans plusieurs dimensions. Cette large palette de possibles soulève ainsi plusieurs questionnements, propres aux services. Comment en effet distinguer le process du produit/service ? La distinction est-elle pertinente ? Des travaux existants nous incitent à sortir d’une vision dichotomique pour considérer le service et le process comme un écosystème permettant la réalisation du service.
La question de la radicalité de l’innovation est également au cœur des spécificités des services. Si les travaux de Schumpeter adoptent une vision économique, les travaux de Gallouj et Weinstein (Innovation in services, Research Policy, 1997) ont quant à eux permis d’identifier des formes d’innovation propres aux services. Toutes ne font pas l’objet d’un consensus. En particulier, l’innovation dite ad hoc est remise en question. Pourtant, tout comme les innovations dites « incrémentales », les innovations visant à l’amélioration continue semblent centrales dans les services.
Enfin, certains travaux mettent en évidence que l’innovation dans l’entreprise de services est également un phénomène économique et managérial qui implique la présence et la mobilisation d’acteurs et de compétences diverses. Il nécessite d’être mesuré, quantifié, et pour ce faire, la mise en place d’outils de mesure propres aux services est nécessaire. Enfin, il doit être caractérisé à l’intérieur de chaque spécificité sectorielle.
Nous soulignons ensuite les particularités de l’assurance, et les différents travaux qui ont lié assurance et innovation. L’assurance est un service qui mobilise une multitude d’acteurs, qui sont autant d’espaces d’innovation et d’écosystèmes conjoints. Ainsi, au milieu de cette apparente hétérogénéité, nous présentons un axe central du service et de l’entreprise : la chaîne de 188valeur assurance. Cet axe d’observation, qui constitue un point de vue original, souligne les différentes évolutions qui affectent l’assurance et ainsi, les espaces d’innovation qui peuvent exister dans ce secteur.
Enfin, nous questionnons les études consacrées à l’innovation dans l’assurance en tant qu’organisation et en tant que service. L’assurance est en effet, généralement utilisée comme illustration des services dits « financiers », mais les spécificités du service assurance semblent peu intégrées, en particulier sa temporalité. La consommation du service est ainsi déconnectée d’acte d’achat, et reste hypothétique. On peut souligner notamment l’importance de la relation client dans ce contexte, qui constitue ainsi un espace d’innovation, tout comme la maîtrise du risque. De nouvelles assurances se construisent ainsi autour du rôle à la fois économique et social de l’assurance, en favorisant le développement des pays émergents.
Les principaux résultats de nos travaux identifient des spécificités de l’innovation dans les services d’assurance sur trois axes : l’organisation, les formes, et les impacts.
Au niveau de l’organisation, nous avons pu souligner l’existence d’une mécanique générale basée sur les problématiques opérationnelles, où les différents projets d’innovation sont développés de manière informelle, selon un schéma qui semble pourtant générique. Les différents acteurs (départements comptable, commercial, traitement des sinistres, voire partenaires extérieurs) mobilisent différentes trajectoires (technologique, méthodologique, servicielle) et produisent des innovations en réponse à des problématiques sectorielles et spécifiques, que nous avons identifiées (client, marché, opération). Parmi elles, l’enjeu réglementaire est une spécificité de l’assurance. En effet, parfois à l’origine des projets (pour permettre une adaptation), la règlementation apparaît toutefois comme un frein à différents stades d’évolution des initiatives.
Nos observations ont mis en évidence plusieurs formes d’innovation, dans les différents départements de l’entreprise. En particulier, les innovations de produit/service relatives, les innovations de process permettant une amélioration de la réalisation du service, et les innovations de management ont été les plus fréquentes. En termes d’innovations de service, nous avons souligné le recours à l’ajout de services élémentaires périphériques.
Au niveau des impacts, nous avons observé que l’innovation joue un rôle sur des espaces allant au-delà de la simple efficacité opérationnelle. 189L’impact de l’innovation sur l’emploi, la formation et l’organisation du travail ont été particulièrement mis en évidence. Ainsi, l’innovation est un levier d’amélioration des compétences des collaborateurs, mais également un outil d’amélioration de l’organisation. Les ambitions commerciales et stratégiques sont autant de défis que l’innovation permet de relever dans l’entreprise.
Enfin, notre analyse des interactions entre les différentes parties prenantes (collaborateurs, dirigeants, partenaires, clients) révèle des dynamiques peu documentées qui sont autant de perspectives de recherche : la coopétition entre l’assureur et son partenaire distributeur, l’incidence de la nature familiale, l’innovation sociale en assurance.
La dynamique particulière entre l’agent général et l’assureur mandant relève du champ de la coopétition, définie comme la collaboration proche entre deux acteurs concurrents. Ce concept fait l’objet d’un intérêt croissant de la part des chercheurs, l’étudier dans le contexte assurantiel est ainsi une perspective intéressante.
Nos résultats montrent que la nature familiale de l’entreprise, et en particulier le rôle central du dirigeant, a une incidence sur l’implication des collaborateurs dans l’innovation. Les entreprises familiales constituent une forme d’organisation répandue dans le secteur de l’assurance. Il y a donc un intérêt certain à investiguer ce champ théorique. Enfin, nous questionnons la nature sociale d’une innovation de procédé. Le cadre de l’assurance devient alors l’opportunité de proposer une grille de lecture sociale de l’innovation dans les services.
Pour finir, nous questionnons les orientations futures de l’assurance. Dans un premier temps, nous revenons à la question du lien entre innovation sociale et innovation de services. En mettant en perspective les différentes formes d’assurance, les notions de risques individuels et collectifs, et le rôle préventif de l’assurance, nous mettons en évidence la nécessaire « socialisation » de l’assurance. Enfin, à la lumière des innovations observées dans notre étude de cas et de la chaîne de valeur assurance, nous réfléchissons aux perspectives d’évolutions de l’assurance. En particulier, nous soulignons la façon dont l’innovation peut transformer le secteur de l’assurance, en modifiant les emplois et l’organisation de la chaîne de valeur.
Mots clés : Innovation, assurance, services financiers, nouvelles technologies, entreprises familiales.