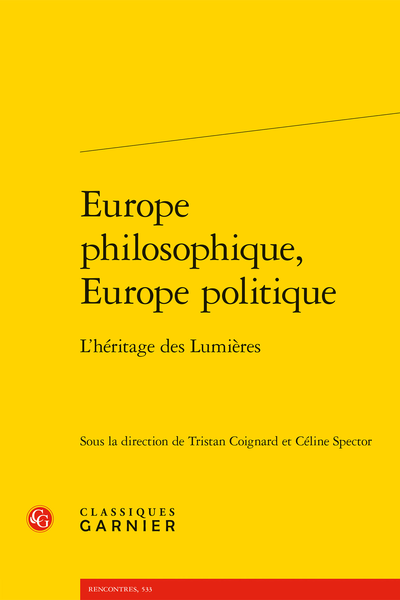
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Europe philosophique, Europe politique. L’héritage des Lumières
- Pages : 271 à 274
- Collection : Rencontres, n° 533
- Série : Le dix-huitième siècle, n° 39
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406125358
- ISBN : 978-2-406-12535-8
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-12535-8.p.0271
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 02/02/2022
- Langue : Français
Résumés
Céline Spector et Tristan Coignard, « Europe philosophique, Europe politique. L’héritage des Lumières »
L’article soutient qu’il est possible de déceler dans les ambiguïtés et les tensions des Lumières des ressources théoriques fertiles qui nourrissent, jusqu’à nos jours, les questionnements sur l’Europe. L’approche historique et réflexive adoptée par les philosophes du xviiie siècle ouvre la voie à une analyse critique qui enrichit les débats actuels sur les promesses et les impasses du projet européen. L’examen des usages de l’héritage des Lumières devient ainsi central.
Catherine Colliot-Thélène, « Des Lumières à l’Union européenne ? »
Cet article montre que l’on peut invoquer l’héritage des Lumières à propos de l’Union européenne, à la condition de préciser la manière dont on entend ce terme. Les « Lumières » ne sont que l’une des composantes de la boîte à outils intellectuels dans laquelle les penseurs et acteurs politiques des xxe et xxie siècle ont puisé. L’héritage des Lumières est reconfiguré par les « héritiers » et l’usage qu’ils en font en fonction des intérêts qui sont aujourd’hui les leurs.
Michaël Foessel, « Kant : l’Europe, le monde ? »
Cette contribution analyse le rapport entre le cosmopolitisme kantien et la question européenne dans Vers la paix perpétuelle. Il rend compte de l’absence de référence à l’Europe dans un contexte où Kant défend une extension de la citoyenneté au-delà des frontières des États. Il traite de cette absence à partir de la critique de la « monarchie universelle ». Enfin, il offre quelques hypothèses sur le choc en retour de ce contexte sur les tentatives d’actualisation du cosmopolitisme kantien.
272Daniela Heimpel, « Quelle éducation à la citoyenneté pour l’Europe transnationale ? »
Cet article étudie les implications d’une lecture transnationale et cosmopolitique de l’UE pour penser l’éducation à la citoyenneté européenne. Intégrant l’idée de la coexistence des États membres et de l’Union, ce projet implique de coconstruire les deux types de citoyennetés. Il vise non seulement à ouvrir les citoyennetés des États membres les unes aux autres et à décloisonner les espaces nationaux, mais cherche également à déconstruire plus largement les « frontières de l’altérité ».
Philippe Crignon, « De l’Europe républicaine à la République européenne »
L’article propose d’évaluer ce qui manque à l’Union européenne pour devenir une forme politique et démocratique, légitime et efficiente. L’Europe se caractérise par sa nature libérale, résultat d’une intégration plus négative que positive, et il apparaît nécessaire de la rééquilibrer par une forme de républicanisme. Cependant, entre le modèle d’une Europe républicaine et celui d’une République européenne, le second doit être privilégié si l’on veut satisfaire les attentes politiques des peuples européens.
Hugo Canihac, « Penser l’Europe après l’État.Le nouveau constitutionnalisme communautaire et l’héritage de David Hume »
Cette contribution explore les idées politiques sous-jacentes à l’une des théories juridiques de l’Union européenne les plus influentes depuis le début des années 1990 : le « pluralisme constitutionnel ». Analyser la pensée du fondateur de ce courant, Neil MacCormick, qui revendique une filiation directe avec celle de David Hume, permet de complexifier la généalogie des idées constitutionnelles de l’UE et d’esquisser une voie pour dépasser le clivage entre cosmopolitisme et nationalisme.
Aliénor Ballangé, « “Pas assez de Montesquieu” en Europe ? De l’Europe philosophique de Montesquieu à l’Europe politique de Wilhelm Röpke »
Au début des années 1940, le fondateur de l’ordolibéralisme allemand, Wilhelm Röpke, déplore que l’Europe a connu « trop de Rousseau et de Voltaire et pas assez de Montesquieu ». À partir de cette formule énigmatique, nous 273analysons l’Europe politique de Röpke autant que l’Europe philosophique de Montesquieu. Précisément, nous étudions le rapport ambigu que ces deux penseurs entretiennent à l’endroit d’une Europe « nation de nations » et d’une économie politique paradoxalement libérale et ordonnée.
Nicolas Arens, « D’un (anti-)fédéralisme démocratique ? L’Union européenne au prisme de Montesquieu et du débat constitutionnel américain »
La fédéralisation d’entités politiques est-elle bonne ou mauvaise pour la démocratie ? L’article revient à la lecture de Montesquieu que font les fédéralistes et leurs opposants. Selon les uns, la fédération équilibre les démocraties domestiques en permettant au peuple d’agir. Pour les autres, la fédération met en péril l’homogénéité d’un peuple qui contracte précisément dans le but d’être souverain. Les innovations conceptuelles américaines permettent ainsi d’enrichir des débats comparables sur l’UE.
Céline Spector, « La “voie rousseauiste” et les impasses de la critique souverainiste de l’Union européenne »
Cette contribution tente d’éclairer la manière dont une certaine interprétation de Rousseau vient étayer l’argumentaire souverainiste. Il s’agit de déceler les malentendus et les distorsions qu’une telle lecture suppose, mais aussi de montrer que l’auteur de l’Extrait du Projet de paix perpétuelle de M. l’abbé de Saint-Pierre a défendu le projet d’une confédération fondée sur un contrat social entre peuples européens, ayant pour vocation de préserver la liberté des peuples associés.
Pierre Crétois, « L’Europe et la question de la souveraineté. L’Union européenne à l’épreuve du contrat social »
Penser l’Europe au prisme du contrat social permet d’en comprendre les ambivalences. L’Europe est-elle un contrat social entre États ou entre citoyens ? L’Europe est ambivalente, elle oscille entre une confédération d’États souverains et un État fédéral. Elle échoue à n’être qu’une confédération parce qu’elle empiète trop sur l’indépendance de ses États membres. Pourtant, dans le même temps, elle se refuse à réunir les conditions institutionnelles d’un contrat social entre citoyens d’Europe.
274Tristan Coignard, « Une hospitalité universelle et inconditionnelle ? L’accueil des réfugiés en Europe et les références ambivalentes à l’héritage des Lumières »
La notion d’hospitalité nourrit un important débat international en philosophie politique, suscité par l’évolution constante de la législation concernant l’accueil des réfugiés en Europe. L’article se propose de reconstituer les usages des références aux Lumières dans ce débat. Il s’y révèle que cet héritage est complexe, dans sa dimension théorique et dans sa mise en œuvre au xviiie siècle. Sans recul critique, il ne permet pas de revendiquer, au nom des Lumières historiques, une hospitalité universelle.
Alexandre Dupeyrix, « Actualité de la critique romantique ? »
Afin de mieux saisir les difficultés auxquelles est confronté le projet européen, l’article revient aux critiques adressées aux idéaux cosmopolitiques et universalistes des Lumières, dès la fin du xviiie siècle, par les écrivains romantiques allemands. Notre hypothèse est en effet que, depuis l’avènement de la modernité politique, nous ne cessons d’expérimenter un certain nombre de tensions que le romantisme allemand avait déjà, en son temps, identifiées et thématisées.
Maïwenn Roudaut, « Démocratie, critique et éducation en Europe. L’héritage de l’École de Francfort »
Partant d’une réflexion sur le diagnostic de « déficit démocratique » européen et de l’impasse dans laquelle se trouvent les théories de la démocratie transnationale développées en études européennes, le présent article entend montrer que, paradoxalement, une pensée critique des Lumières comme celle représentée par la première génération de l’École de Francfort, peut être réinvestie (dans ses prémisses épistémologiques notamment) pour penser à nouveaux frais le problème de la démocratie en Europe.