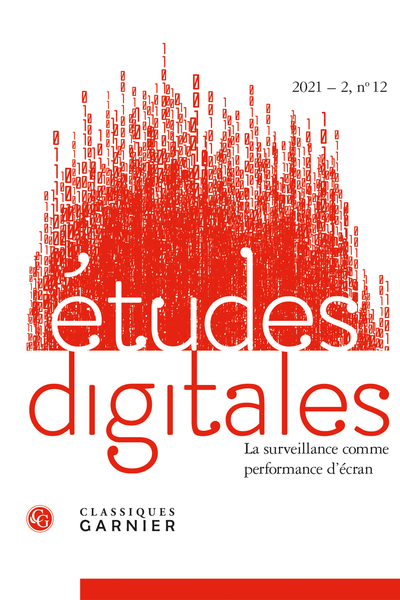
Reviews
- Publication type: Journal article
- Journal: Études digitales
2021 – 2, n° 12. La surveillance comme performance d’écran - Author: Gosset (Audrey)
- Pages: 253 to 258
- Journal: Digital Studies
- CLIL theme: 3157 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Sciences de l'information et de la communication
- EAN: 9782406160014
- ISBN: 978-2-406-16001-4
- ISSN: 2497-1650
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-16001-4.p.0253
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 12-06-2023
- Periodicity: Biannual
- Language: French
AFFECTOLOGIE DU TROUBLE
Esth-éthique de l’instable
Alain Mons, L’étendue du trouble. Créations contemporaines, Montréal, Liber, « L’imaginaire et le contemporain », 2023, 232 p. ISBN 978-2-89578-453-1
L ’ étendue du trouble d’Alain Mons nous offre une réflexion critique sur la crise du sensible que traversent nos sociétés contemporaines hyper-connectées et standardisées, tout en ouvrant des lignes de fuite pour inventer notre devenir numérique de manière sensible et éclairée. L’ouvrage se présente comme une anthologie de pratiques esthétiques, une œuvre chorale pour reprendre les termes de l’auteur, qui nous plonge dans une expérience de lecture ondoyante. Le philosophe déambule à travers les créations contemporaines – décrites au cours des dix chapitres qui composent l’ouvrage – et les expose tour à tour comme des moyens de ressaisie sensible ou des écarts réflexifs. À travers la mise en mouvement des corps sensibles mais aussi l’expérience de la vacance ontologique, les dispositifs esthétiques ouvrent des lignes de fuite dans un réel devenu statique, programmatique. Ces pratiques, ainsi que la réflexion essayante de Mons, nous disposent au sensible et, par là même, nous resituent en bordure du sens, à savoir dans le trouble. Le trouble est exploré comme un concept fécond, englobant une multitude de significations et de dimensions.
Terme protéiforme s’il en est, le trouble évoque aussi bien le mélange, l’hybridité et l’impureté, que le désordre social, le vertige, le chaos. Le trouble est également lié aux affects, aux émotions qui nous habitent et qui influencent notre perception du monde. Le trouble est mouvement, mise en branle, ilbouscule nos représentations – le trouble est donc à la base du développement psycho-social des individus, mais se veut aussi abîme ouvrant au sens. Sous la plume de Mons, le trouble se fait maïeutique et condition d’ouverture aux possibles de création. Ainsi, il 254est à l’origine de tout un pan de l’art moderne et contemporain. C’est dans le trouble que se loge le sens – ou les sens – qui nous touchent et que nous touchons.
Dans L’étendue du trouble, chaque chapitre est consacré à une pratique, et l’examen de Mons s’étend des dispositifs les plus traditionnels, installations [Bill Viola, Harun Farocki] (I), théâtre [Guy Cassiers, Steve McQueen] (II), danse [Pina Bausch, Meg Stuart] (III), photographie [Eija-Liisa Ahtila, Nan Goldin] (V), cinéma [Béla Tarr, Antonioni] (VI), littérature [D.H. Lawrence] (IX)) aux espaces urbains, à la rue [François Vogel, Franck Scurti] (IV), à l’architecture créant des ambiances [exposition Dynamo] (X), au flou (VIII), en somme à tous les espaces d’ouverture des affects et des formes sensibles. L’exploration quasi exhaustive – mais aussi tâtonnante – des pratiques esthétiques caractéristiques de notre modernité ouvre au sensible et aux sens selon différentes modalités. Toutes les créations esthétiques étudiées sont décrites comme autant de moyens de faire l’expérience de l’expérience. Par-delà une herméneutique des pratiques, Mons se concentre sur le geste esthétique comme possibilité d’éprouver le trouble sensiblement et d’ainsi ressentir notre époque.
Les pratiques esthétiques saisies par Mons opèrent de manière sensible, en effleurant les individus, et ce afin de provoquer un réengagement corporel. Les installations vidéo de l’artiste finlandaise Eija-Liisa Ahtila par exemple, exposées au Jeu de Paume en 2008, se présentent sous la forme d’un agencement d’écrans à même de créer des échos visuels. La scénographie ainsi que les thèmes traités par l’artiste, permettent d’encourager chez le spectateur un regard labile, une mouvance dans la perception et une réflexion profonde sur les potentialités de la matière corporelle, à la fois évanescente et débordante. Certaines créations agissent plutôt en créant une atmosphère d’étrangeté à même de susciter un décalage réflexif : c’est le cas de l’œuvre d’Harun Farocki intitulée Deep Play, présentée lors de l’exposition Documenta en 2007, où des images de la finale de la coupe du monde opposant la France à l’Italie tournent en boucle sur les douze écrans de l’installation. À ces images médiatiques sont ajoutées des images de simulateurs et de vidéosurveillance. Cette immersion visuelle déstabilisante plonge le spectateur dans une expérience « étrange » de « coprésence d’images », suscitant une réflexion sur notre immersion quotidienne contrainte et subie dans ces images, qui participent à la « fabrication des subjectivités » 255(p. 31). Cette double manière d’opérer, à la fois sensée et sensible – les deux n’étant jamais excluantes, ni limitées à une pratique – fait effet de deux manières différentes. Certaines pratiques permettent de mettre les corps en mouvement, de faire éprouver l’expérience grâce à un pur excès, grâce au débordement sensible qui engage à se resituer dans le flux vital de l’existence. Il s’agit là de recouvrer un mouvement phénoménologique où la sensation joue le rôle central dans la ressaisie de soi qui s’était perdue dans l’accaparement des dispositifs numériques. D’autres pratiques se concentrent sur la suspension, créent des trouages dans le réel et dans l’hypercaptation des présences pour nous resituer dans une véritable métaphysique de la présence, qui n’existe que dans le potentiel d’absence, d’indisponibilité au monde nécessaire pour vivre.
L’ouverture née d’une praxis du trouble dans ses diverses acceptions, permet de retrouver le flux absolu. Pour Mons, il apparaît crucial de cultiver une ouverture au sens et il nous semble à cet égard que le philosophe s’inscrit dans une tradition philosophique du mouvement, en se faisant expérimentateur de l’étendue du trouble en tant qu’« assemblages de territoires sensibles » (p. 14). Recouvrer le flux vital de l’existence – qui n’est pas celui du numérique qui nous traverse sans nous pénétrer – revient à s’extraire de la catégorisation et de la fixité toujours plus prononcée. Mettre à l’épreuve notre plasticité dans le flux de la création c’est introduire de l’inattendu dans la machine bien réglée du néo-libéralisme. Mons embrasse dans cet ouvrage le trouble car c’est précisément dans cette possibilité même de s’accorder à la fluidité du monde que réside la véritable expérience.
Mais outre leur puissance de mise en mouvement, les œuvres décrites par Mons sont aussi révélées comme des moyens de mettre en place une désintensification, un court-circuit, allant jusqu’à l’expérience de la vacance ontologique qui permet aux individus de recouvrer une part de souveraineté en s’accordant à une ontologie glissante, par l’expérience de la différance. À l’ère de l’accaparement de nos attentions par les technologies numériques instrumentalisées par les systèmes néolibéraux, où l’on cherche à nous contraindre à une pure présence et à la tyrannie de l’immédiateté, le trouble permet de créer un écart, un trouage, une zone d’ombre : la notion de métaphysique de la présence, si chère à Derrida, se confronte à l’instantanéité. Cette modalité d’une présence faite d’absences permet de pallier l’exposition technologique qui entrave 256notre relation aux autres et à nous-mêmes. L’être humain a besoin d’une alternance de mise en lumière et d’existence dans le trouble pour bien vivre, or les technologies instrumentalisées ont rendu les zones d’ombres inaccessibles et la mise en lumière constante invivable. Assumer le trouble revient donc à faire face à nos propres vacances, et aux trouages qui nous permettent de gagner en capacité de métamorphose.Composer avec les vacances, c’est aussi voir dans le désœuvrement non pas le revers du travail, voire sa négation, mais plutôt la contemplation comme permettant un « suspens » grâce auquel nous pouvons « désactiver les réflexes conditionnés » et considérer notre propre puissance d’agir (p. 26). Ces modalités ouvrent des possibles et permettent in fine de recouvrir une expérience de souveraineté par des ouvertures sensibles et imaginaires.
Bill Viola, par les espaces scénographiques qu’il crée, apparaît comme l’exemple le plus emblématique de ce double potentiel d’une mise en mouvement sous forme de « plongée » et d’une « interruption ». Les corps des visiteurs se trouvent souvent absorbés par un « univers aquatique » devant ses œuvres, or, à ce mouvement s’ajoute souvent une « désintensification ». Une mise en disponibilité s’effectue grâce au jeu de l’interruption qui laisse place à une « excédance » devenant la condition de la libération du « devenir » (p. 57). Nous notons ainsi que cette double logique du flux et de la suspension converge vers un même but : une disposition corporelle au sensible et une ouverture des imaginaires, à savoir la création d’une philosophie du devenir comme éthique, comme esthétique. Mons propose une affectologie générale induite par le geste esthétique.
L ’ étendue du trouble se présente comme une invitation à repenser nos environnements contemporains devenus insoutenables. L’auteur dénonce avec justesse l’instrumentalisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, dans notre société occidentale programmatique et performative, et révèle la crise du sensible qui y règne. Nous nous situons dans état général d’apathie, d’hyperexposition sans possibilité de nous réfugier dans les ombres, les zones de trouble. L’étouffement des vibrations sensibles et corporelles, l’annihilation de la possibilité qu’un accident se produise et qu’il vienne perturber le cours de notre existence bien réglée est caractéristique de notre modernité tardive. Cependant, Mons démontre également la faille inhérente à ce modèle : « l’hypercapitalisme exerce une pression telle qu’elle s’échappe par toutes les fissures et les bords possibles. […] Cette observation met en évidence 257l’explosion sensible et le trouble comme télescopage de notre modernité. Cela nous oblige à adopter un regard fluide et en mouvement pour faire face à ces défis contemporains. » (p. 211). Le « processus de perfectibilité normée [qui] s’accélère grâce à une culture numérique et techno-biologique […] imprègne les subjectivités sociales et individuelles » mais « se heurte à une expérience du réel […] déconcertante à maints égards », car « rempli[e] de ratages, d’erreurs, d’excès ou de manques, de trous et de tâches » (p. 16). Mons étudie une voie esthétique qui permet de sortir de la sidération, de quitter la stase. Le philosophe nous enjoint à lâcher prise sur les permanences fictives qui entravent notre capacité à accueillir le devenir. Dans ce contexte, l’expérience de l’hésitation devient cruciale, dans un embrassement du mouvement. Toute l’entreprise de Mons se situe dans une volonté de faire de cette étendue du trouble une heuristique à même de se déployer comme une philosophie du possible. L’auteur nous incite à nous resituer « dans le fleuve du devenir », à l’instar des enseignements d’Héraclite, en adoptant le trouble comme nouveau socle pour vivre selon des modalités changeantes. La déambulation théorique à laquelle Mons nous convie reproduit une pratique d’expérimentation du réel, et le livre se présente comme un manifeste contre le déterminisme.
Les pratiques esthétiques sous examen se révèlent alors comme des pratiques de résistance, n’opérant pas de manière frontale mais sous forme de « guérillas » (p. 203) pour mettre le système en échec. Ces pratiques se logent dans les interstices d’un réel devenu programmatique, où la réification se fait le paradigme dominant – elles se développent comme des mauvaises herbes, proliférantes et inarrêtables. L’ouvrage s’expose comme une « clinique » (p. 167), qui nous invite à naviguer dansle trouble, en ne nous y engouffrant pas totalement, mais en l’accueillant comme une disposition ontologique. C’est dans le trouble que résident des possibilités d’invention, dans le trouble que se situent les lignes de fuites, l’ouverture des imaginaires. L’invention comme un geste vital permet à la fois de déployer des « constellations ontologiques imprévues » et de favoriser une plasticité de la « subjectivité collective qui traverse les singularités » (p. 209). Le fait de se sentir sentir nous permet d’éprouver notre puissance de transformation individuelle et collective. L’étendue du trouble se veut donc à la fois riposte poético-sensible et appel au désœuvrement créateur, visant à retrouver une forme de vivabilité dans la révélation esthétique.
258Alain Mons est professeur honoraire en sciences de la communication et arts à l’université Bordeaux Montaigne. Il travaille sur la communication du sensible et des imaginaires, l’esthétique généralisée dans le rapport aux images, aux corps, les représentations de la ville, les arts contemporains, et les espaces existentiels à travers les mutations des perceptions et des affects. Auteur ou directeur de plusieurs ouvrages, il a récemment publié Les lieux du sensible (CNRS éditions) et dirigé Présence/absence. Les battements du contemporain (Presses universitaires de Bordeaux).
Audrey Gosset
Doctorante,
Université Bordeaux-Montaigne