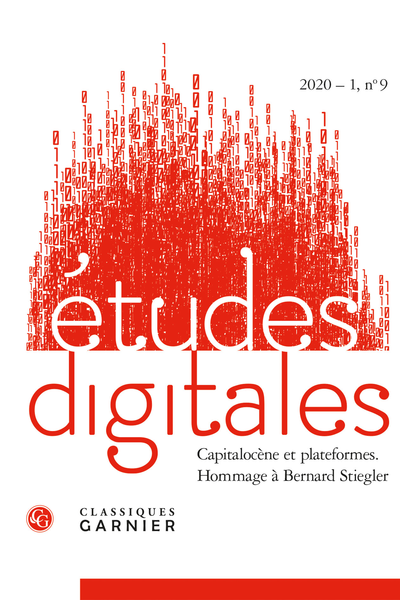
Le Capitalocène et la justice planétaire
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Études digitales
2020 – 1, n° 9. Capitalocène et plateformes. Hommage à Bernard Stiegler - Auteur : Moore (Jason W.)
- Résumé : La crise que nous vivons n’est pas la faillite d’une espèce, c’est la faillite d’un système. Voici l’histoire d’un modèle interprétatif alternatif qui considère l’Anthropocène comme un discours biaisé qui blâme les victimes, ainsi qu’un mauvais marchepied pour le mouvement écologiste à venir. Nous vivons dans le Capitalocène, l’âge du capital. Qu’est-ce que le Capitalocène ? C’est une manière d’appréhender le capitalisme comme un système géographique et historique, interconnecté et structuré.
- Pages : 53 à 65
- Revue : Études digitales
- Thème CLIL : 3157 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Sciences de l'information et de la communication
- EAN : 9782406115212
- ISBN : 978-2-406-11521-2
- ISSN : 2497-1650
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-11521-2.p.0053
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 26/05/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Anthropocène, Capitalocène, capitalisme, écologie, modernité
Le Capitalocène
et la justice planétaire
La crise que nous vivons n’est pas la faillite d’une espèce, c’est la faillite d’un système.
Voici l’histoire d’un modèle interprétatif alternatif qui considère l’Anthropocène comme un discours biaisé qui blâme les victimes, ainsi qu’un mauvais marchepied pour le mouvement écologiste à venir.
Qui est responsable pour la crise climatique ?
Pour toute personne qui ne serait pas un négationniste climatique, il y a une réponse facile à cette question : l’humanité. Qui, dans son bon sens, contesterait l’idée que le changement climatique est anthropogénique (d’origine humaine) ? Ne vivons-nous pas dans l’Anthropocène : l’âge de l’homme comme force géologique ?
Eh bien, oui et non. Il s’avère que dire « les humains l’ont fait ! » peut obscurcir autant que clarifier les choses. Il y a une différence politique immense, grande comme le monde, entre le fait de dire « les humains l’ont fait ! » ou « certains humains l’ont fait ! » Penseurs radicaux et militants de la justice climatique ont commencé à remettre en question une répartition tout à fait égalitaire de la responsabilité historique du changement climatique, dans un système qui s’est précisément engagé dans une distribution très inégale de la richesse et du pouvoir. De ce point de vue, l’expression changement climatique anthrogénique est une manière particulière de blâmer les victimes de l’exploitation, de la violence et de la pauvreté. Une alternative plus précise à proposer ? Notre ère est une ère de crise climatique capitalogénique.
Capitalogénique : « fait par le capital ». Comme son frère jumeau, le Capitalocène, cela peut sonner étrange quand on le dit. Cependant, cela n’a pas grand-chose à voir avec le mot – c’est bien plutôt parce que sous l’hégémonie bourgeoise : on nous apprend à voir avec suspicion toute langue qui nomme le système. Mais nommer le système, les formes d’oppression 54et la logique d’exploitation, c’est ce qu’ont toujours fait les mouvements sociaux émancipateurs. Les mouvements pour la justice se développent grâce à de nouvelles idées et à de nouveaux langages. Le pouvoir de nommer une injustice structure la pensée et la stratégie, ce que les mouvements ouvriers, anticoloniaux et féministes ont souligné de façon spectaculaire au cours du long xxe siècle. À cet égard, l’environnementalisme dominant depuis 1968 – « l’environnementalisme des riches » (Peter Dauvergne) – a été un désastre complet. L’« empreinte écologique » attire l’attention sur la consommation individuelle et orientée vers le marché. L’Anthropocène (et avant cela, le vaisseau spatial Terre) nous dit que la crise planétaire est plus ou moins une conséquence naturelle de la nature humaine – comme si la crise climatique d’aujourd’hui relevait du fait que les humains sont des humains, de la même manière que les serpents sont des serpents et les zèbres, des zèbres. La vérité est plus nuancée, plus identifiable et plus accessible : nous vivons dans le Capitalocène, l’âge du capital. Nous savons – historiquement et dans la crise actuelle – qui sont les responsables de la crise climatique. Ils ont des noms et des adresses, à commencer par les huit hommes les plus riches du monde qui possèdent plus de richesses que les 3, 6 milliards d’humains les plus pauvres.
Qu’est-ce que le Capitalocène ? Permettez-moi de commencer par dire ce que n’est pas le Capitalocène. Ce n’est pas un parent pauvre de la géologie et de l’Anthropocène. De même que ce n’est pas un argument qui affirme qu’un système économique est le moteur d’une crise planétaire – bien que l’économie soit cruciale. C’est une façon de comprendre le capitalisme en tant que système géographique et historique interconnecté. Suivant cette perspective, le Capitalocène est une géopoétique pour donner un sens au capitalisme en tant qu’écologie-monde1 de pouvoir et de re/production dans le réseau de la vie2.
55Nous allons creuser ce concept de Capitalocène dans un instant. Mais avant cela, soyons clairs sur celui d’Anthropocène, qui connaît deux versions. La première concerne l’Anthropocène géologique3. C’est la préoccupation des géologues et des scientifiques du système Terre. Leur attention principale porte sur les clous d’or4 : des marqueurs clés de la couche stratigraphique qui identifient les époques géologiques. Dans le cas de l’Anthropocène, ces clous sont généralement reconnus par la présence de plastiques, d’os de poulet et de déchets nucléaires. (Telle est la contribution du capitalisme à l’histoire géologique !) De façon alternative et perspicace, les biogéographes Simon Lewis et Mark Maslin soutiennent que 1610 marque l’aube de l’Anthropocène géologique. Considérée comme l’« Orbis Spike », ou la collision des mondes, la période entre 1492 et 1610 n’a pas été seulement témoin de l’invasion de Christophe Colomb et ses troupes. Le génocide qui s’en est suivi dans les Amériques a entraîné la régénération des forêts et une réduction rapide des émissions de CO2 en 1550, ce qui a contribué à certaines des décennies les plus froides du Petit âge glaciaire (vers 1300-1850). L’Anthropocène géologique est donc une abstraction délibérée des relations historiques afin de clarifier les relations biogéographiques des humains (en tant qu’espèce) et de la biosphère. C’est tout à fait raisonnable. La thèse du Capitalocène n’est pas un argument sur l’histoire géologique.
Il s’agit d’un argument sur la géohistoire – quelque chose qui inclut les changements biogéologiques comme des éléments fondamentaux dans l’histoire humaine des relations de pouvoir et de production. Ici, le Capitalocène affronte la seconde version de l’Anthropocène : 56l’Anthropocène populaire5. Cette seconde version de l’Anthropocène englobe une discussion beaucoup plus large dans le domaine des sciences humaines et sociales. C’est une conversation sur le développement des réalités, historiques et contemporaines, de la crise planétaire. Il n’y a pas de séparation claire et nette entre les deux, et de nombreux scientifiques du système Terre ont été heureux de passer de l’Anthropocène géologique à l’Anthropocène populaire, et vice-versa !
Pour l’Anthropocène populaire, le problème est l’« Homme » et la « Nature6 » – un problème qui contient bien plus qu’un petit préjugé sexiste, comme Kate Raworth l’indique clairement quand elle dit que nous vivons dans le Masculinocène. Cet Anthropocène présente un modèle de crise planétaire qui est tout sauf nouveau. Il réincarne une cosmologie de l’Humanité et de la Nature qui remonte d’une certaine manière à 1492 – et d’une autre à Thomas Malthus et au xviiie siècle. C’est le récit de l’Humanité faisant des choses terribles à la Nature. Et le moteur de ces choses terribles est, comme toujours, le spectre de la surpopulation – une idée qui a toujours justifié l’oppression violente des femmes et des peuples de couleur.
Vous avez peut-être remarqué que j’ai mis des majuscules à ces mots d’« Humanité » et de « Nature ». C’est parce que ce ne sont pas de simples mots, mais des abstractions qui ont été considérées comme réelles par les empires, les États en voie de modernisation et les capitalistes afin de dévaloriser et rabaisser7 la nature humaine et extra-humaine de toute 57sorte. Historiquement, la plupart des êtres humains ont été pratiquement exclus de l’appartenance à l’Humanité. Dans l’histoire du capitalisme, il n’y eut que très peu place sur le banc de l’anthropos pour quiconque n’était pas blanc, mâle et bourgeois. À partir de 1492, les super riches et leurs alliés empereurs ont dépossédé les peuples de couleur, les peuples autochtones et pratiquement toutes les femmes de leur Humanité, et les ont assignés à la Nature – de la sorte, ils pouvaient être mieux transformés en occasions de faire des profits. Le résultat est que la cosmologie de l’Homme et de la Nature dans l’Anthropocène populaire n’est pas seulement une analyse erronée, mais qu’elle est impliquée dans des histoires concrètes de domination. Quand l’Anthropocène populaire refuse de nommer le changement climatique capitalogénique, il ne voit pas que le problème n’est pas l’Homme et la Nature, mais certains hommes engagés dans la domination et la destruction rentable de la plupart des humains et du reste de la nature.
L’Anthropocène populaire insinue que tous les humains en sont à l’origine, alors que ce n’est clairement pas le cas. La part américaine et ouest-européenne des émissions de CO2 entre 1850 et 2012 est trois fois supérieure à celle de la Chine. Mais, même cela, ce n’est enfoncer le clou assez loin. Une telle comptabilité nationale s’apparente à l’individualisation de la responsabilité de la crise climatique. Nul compte n’est fait de la centralité du capital américain et ouest-européen dans l’industrialisation mondiale depuis 1945. Depuis les années 1990, par exemple, les émissions de la Chine ont massivement servi les marchés d’exportation européens et américains et ont été financées pendant des décennies par d’investissements étrangers considérables. Il existe un système mondial de pouvoir et de capital qui est toujours avide d’une nature bon marché plus importante, ce qui, depuis les années 1970, a entraîné un accroissement considérable des inégalités de classes. Prenons l’exemple des États-Unis, le chef de file historique mondial en matière de carbonisation de l’atmosphère. Attribuer à tous les Américains une part égale de responsabilité dans le réchauffement de la planète relève 58d’une grande dissimulation. Les États-Unis ont été, dès le début, une république de type apartheid fondée sur le génocide, la dépossession et l’esclavage. Certains Américains sont responsables des émissions américaines : les propriétaires de capitaux, de plantations et d’esclaves (ou les prisons privées actuelles), les usines et les banques.
L’argument du Capitalocène rejette donc le nivellement anthropocentrique – « Nous avons rencontré l’ennemi, et il s’agit de nous » (comme dans l’affiche emblématique de Walt Kelly du Jour de la Terre en 1970) – ainsi que le réductionnisme économique. Bien entendu, le capitalisme est un système d’accumulation infinie du capital. Mais la thèse du Capitalocène dit que pour comprendre la crise planétaire aujourd’hui, nous devons considérer le capitalisme comme une écologie-monde de pouvoir, de production et de reproduction. Dans cette perspective, les moments « sociaux » de la domination de classe, de la suprématie blanche et du patriarcat au cours de la modernité sont intimement liés aux projets environnementaux visant l’accumulation infinie du capital. De façon essentielle, la grande innovation du capitalisme depuis ses origines, après 1492, a été d’inventer la pratique de l’appropriation de la Nature. Cette Nature n’était pas seulement une idée, mais une réalité territoriale et culturelle qui englobait et contrôlait les femmes, les peuples colonisés et les réseaux extra-humains de la vie. Parce que les réseaux de la vie résistent à l’uniformisation, à l’accélération et à l’homogénéisation de la maximisation du profit capitaliste, le capitalisme n’a jamais été étroitement économique : la domination culturelle et la force politique ont rendu possible la dévastation capitalogénique de la nature humaine et extra-humaine à chaque tournant.
Pourquoi 1492, et non pas 1850 ou 1945 ? Il ne fait aucun doute que les fameux graphiques « en crosse de hockey » de l’Anthropocène indiquent des points d’inflexion majeurs en ce qui concerne la carbonisation et bien d’autres choses à ces points, en particulier les tournants dont nous venons de parler. Ce sont des représentations des conséquences, mais pas des causes de la crise planétaire. La thèse du Capitalocène poursuit des analyses qui relient ces conséquences aux histoires plus anciennes de domination de classes, de racisme et de sexisme, qui se forment toutes, au sens moderne du terme, après 1492.
Au xvie siècle, nous voyons une rupture dans la façon dont les scientifiques, les capitalistes et les généraux d’empires comprenaient la réalité 59planétaire. Dans l’Europe médiévale, l’homme et le reste de la nature étaient compris en termes hiérarchiques, comme la « grande chaîne des êtres ». Mais il n’y avait pas de séparation stricte entre les relations humaines et le reste de la nature. Des mots tels que « nature », « civilisation », « sauvagerie » et « société » n’ont pris leur sens moderne dans la langue anglaise qu’entre 1550 et 1650. Ce n’est pas une coïncidence, s’il s’agissait en même temps de l’époque de la révolution agricole capitaliste de l’Angleterre, de la révolution moderne des mines de charbon, de l’invasion de l’Irlande (1541). Ce tournant culturel ne s’est pas produit de manière isolée au sein de l’Anglosphère – il y avait des mouvements apparentés en cours dans d’autres langues d’Europe occidentale à peu près à la même époque, alors que le monde atlantique subissait un tournant capitaliste. Cette rupture radicale avec les anciennes façons de connaître la réalité, auparavant holistiques (mais toujours hiérarchiques), a cédé la place au dualisme de la « Civilisation » et de la « Sauvagerie ».
Partout et à chaque fois que les navires européens débarquaient des soldats, des prêtres et des marchands, ils rencontraient immédiatement des « sauvages ». Au Moyen Âge, le mot signifiait fort et féroce ; il signifiait maintenant l’antonyme de la « Civilisation ». Les sauvages habitaient quelque chose qu’on appelait la nature sauvage, et c’était la tâche des conquérants civilisés de répandre la parole du Christ et du Progrès. La nature sauvage de cette époque était souvent appelée « friche » – et dans les colonies, elle justifiait le défrichage des terres pour que celles-ci et leurs habitants sauvages puissent être mis au travail à moindres coûts. Le code binaire « Civilisation » et « Sauvagerie » constitue un système d’exploitation essentiel pour la modernité, fondé sur la dépossession des êtres humains de leur humanité. Cette dépossession – qui ne s’est pas produite une seule fois, mais plusieurs fois – était le sort réservé aux peuples autochtones, aux Irlandais, à presque toutes les femmes, aux esclaves africains, aux peuples coloniaux du monde entier. C’est cette géoculture capitaliste qui reproduit une dévalorisation extraordinaire de la vie et du travail, indispensable à toute flambée économique mondiale, mais aussi violente, avilissante, et se consumant d’elle-même.
Le langage de la « Société » et de la « Nature » n’est donc pas seulement la langue de la révolution coloniale-bourgeoise dans son sens le plus large, mais aussi une praxis d’aliénation, tout aussi fondamentale pour l’hégémonie du capitalisme que l’hégémonie de l’aliénation des 60relations de travail modernes. La « Société » et la « Nature » fétichisent l’essentiel des relations aliénées de violence et de domination sous le capitalisme. Le récit de Marx sur le fétichisme de la marchandise, par lequel les ouvriers en viennent à percevoir les fruits de leur travail comme une puissance étrangère qui les dépasse et les domine, est évidemment central. Il y a une autre forme d’aliénation qui va de pair avec ce fétichisme de la marchandise. C’est le fétichisme civilisationnel. Cette aliénation n’est pas entre les « hommes » et la « nature ». C’est un projet de certains humains – blancs, bourgeois, masculins pendant l’essor du capitalisme – de dévaloriser la plupart des humains et des formes de vies qui les accompagnent. Si le fétichisme des marchandises est un antagonisme fondamental du capital et du prolétariat, le fétichisme civilisationnel est l’antagonisme historique mondial entre le capital et le biotariat (Stephen Collis) – les formes de vie, vivantes et mortes, qui fournissent le travail/énergie non rémunéré qui rend le capitalisme possible. Le fétichisme civilisationnel nous apprend à penser la relation entre le capitalisme et le réseau de la vie comme une relation entre les objets, plutôt que comme une relation intériorisante et extériorisante de création d’environnement. Tout ce que Marx dit sur le fétichisme des marchandises a été préfiguré – à la fois logiquement et historiquement – par une série de fétiches civilisationnels, avec la ligne de démarcation entre « Civilisation » et « Sauvagerie » comme pivot géoculturel. L’essor du capitalisme n’a pas inventé le travail salarié, il a inventé le prolétariat moderne dans le cadre d’un projet toujours plus audacieux de mise au travail gratuite ou à bas coûts des natures de toute sorte : le biotariart. Comme le fétichisme de la marchandise, le fétichisme de la civilisation n’était – et ne demeure – pas seulement une idée mais une praxis et une rationalité de la domination du monde. Depuis 1492, cette ligne – entre « Civilisé » et « Sauvage » – a façonné la vie moderne et le pouvoir, la production et la reproduction. Réinventé à chaque époque du capitalisme, il est aujourd’hui réaffirmé d’une manière puissante – alors que les populistes autoritaires d’un autre temps militarisent et sécurisent les frontières contre les « proliférations » de réfugiés provoquées par la trinité de la guerre sans fin, la dépossession raciale et les crises climatiques du Capitalocène tardif.
L’année 1492 marque non seulement un changement géoculturel, mais aussi une transition biogéographique sans précédent dans l’histoire 61humaine. L’invasion de Christophe Colomb et ses troupes ont marqué le début de la réunification géohistorique de la Pangée, le supercontinent qui s’est disloqué et a dérivé il y a près de 175 millions. Cette Pangée moderne constituait, aux yeux des banquiers, des rois et des nobles d’Europe, une sorte d’entrepôt pratiquement illimité de main-d’œuvre, de nourriture, d’énergie et de matières premières bon marché. C’est ici, dans la zone atlantique de la Pangée moderne, que le capitalisme et la crise planétaire actuelle ont pris naissance. Au cours des trois siècles qui ont suivi, la triple alliance du capitalisme – l’empire, le capital et la science – a rendu possible la plus grande et la plus rapide transformation des relations entre le travail, la vie, et la terre, de l’histoire humaine. Seule la genèse de l’agriculture sédentaire à l’aube de l’Holocène, il y a près 12 000 ans, rivalise avec la révolution écologique du capitalisme précoce. Des siècles bien avant les machines à vapeur de Newcomen et Watt : les banquiers, les propriétaires de plantations, les industriels, les marchands et les empires européens avaient déjà transformé les relations planétaires entre le travail, la vie, et la terre à une échelle et à une vitesse jamais vues auparavant. Du Brésil aux Andes, en passant par la Baltique, les forêts ont été abattues, des systèmes de travail forcé ont été imposés aux Africains, aux peuples autochtones et aux Slaves, et des approvisionnements indispensables en nourriture bon marché, en bois et en argent ont été expédiés vers les centres de richesse et de pouvoir par bateaux. Pendant ce temps, les femmes en Europe – sans parler des colonies ! – ont été soumises à un régime de travail coercitif plus impitoyable que tout ce que l’on connaissait sous le féodalisme. Les femmes ont été expulsées de la « Civilisation », leur vie et leur travail ont été étroitement surveillés et redéfinis comme « non-travail » (Silvia Federici) : précisément parce que le « travail des femmes » appartenait à la sphère de la « Nature ».
L’histoire de la crise planétaire est généralement racontée à travers le prisme de « La Révolution industrielle ». Personne ne remet en question le fait que les industrialisations successives ont coïncidé avec des points d’inflexion majeurs dans l’utilisation des ressources et les seuils de contamination (Mais l’industrialisation est bien antérieure au xixe siècle !) Expliquer les origines de la crise planétaire par le biais des transformations technologiques est cependant un puissant réductionnisme. La Révolution industrielle britannique, par exemple, devait 62tout au coton bon marché ; au travail non rémunéré de générations de peuples indigènes qui ont coproduit une variété de coton adaptée à la production mécanique (G. hirsutum) ; aux génocides et aux dépossessions des Cherokees et bien d’autres dans le Sud des États-Unis ; au mécanisme du coton gin qui séparait la graine du coton de sa fibre et qui a multiplié par cinquante la productivité du travail ; aux esclaves africains qui ont travaillé dans les champs de coton. L’industrialisation de l’Angleterre n’aurait pas été non plus possible sans la révolution oppressive dans le domaine du genre et de la fertilité du siècle précédent, qui a soumis les soins et les capacités de reproduction des femmes aux impératifs démographiques du capital.
Ces instantanés de l’histoire du capitalisme nous disent que ce système particulier a toujours dépendu des frontières liées aux natures bon marché – des natures non marchandisées dont le travail peut être approprié gratuitement ou à faibles coûts par le biais de la violence, la domination culturelle et les marchés. Ces frontières ont été cruciales parce que le capitalisme est le système le plus prodigieusement gaspilleur jamais créé. C’est ce qui explique l’extraordinaire fuite en avant du capitalisme. Pour survivre, il a dû clôturer la planète à la fois comme une source de nature bon marché et comme un dépotoir planétaire. Aujourd’hui, ces deux frontières qui permettent une réduction radicale des coûts, et donc une maximisation des profits, se ferment. D’une part, la catégorie de « bon marché » est une relation sujette à l’épuisement – les travailleurs et les paysans se révoltent et résistent, les mines sont épuisées, la fertilité des sols est érodée. D’autre part, l’assignation de l’atmosphère planétaire par le capitalisme, et d’autres biens communs, à accueillir ses déchets a franchi un seuil critique. Le changement d’époque climatique est l’expression la plus dramatique de ce point de basculement, où l’on constate que la contamination du monde déstabilise de plus en plus les réalisations historiques du capitalisme, son régime alimentaire bon marché en premier lieu. Ces deux stratégies, la nature bon marché et les décharges bon marché, sont de plus en plus épuisées, alors que la géographie des formes de vies et des occasions du faire du profit entre dans une phase morbide. La crise climatique est en train de tout changer – comme nous le rappelle Naomi Klein. L’écologie-monde du capitalisme subit une inversion d’époque – ou mieux, une implosion – à mesure que la nature cesse d’être bon marché et commence à 63monter une résistance toujours plus efficace. Partout dans le monde, les réseaux de la vie remettent en question les stratégies de réduction des coûts du capital, et deviennent une réalité qui maximise les coûts pour le capital. Le changement climatique (mais pas seulement) rend tout plus cher pour le capital – et plus dangereux pour le reste d’entre nous.
C’est la fin de la nature bon marché. C’est un énorme problème pour le capitalisme, construit sur la pratique du rabaissement : rabaissement dans le sens du prix, mais aussi rabaissement dans le sens de la domination culturelle. Le premier relève de la sphère de l’économie politique, tandis que le second de la domination culturelle recourant à l’hégémonie impériale, le racisme et le sexisme. L’un des problèmes les plus centraux de la justice planétaire aujourd’hui est de forger une stratégie qui définisse la notion de justice autour de ces deux procédés, et surtout contre ceux-ci, et de considérer que les conséquences biophysiques les plus violentes et les plus meurtrières de cette contamination et de cette stagnation économique sont maintenant infligées aux populations les plus constamment désignées comme appartenant à la « Nature » depuis 1492 : les femmes, les populations néocoloniales, et les peuples de couleur.
C’est une situation désastreuse pour tout le monde sur la planète Terre. Mais il y a des raisons d’espérer. Une leçon clé que j’ai tirée de l’étude de l’histoire du climat au cours des 2 000 dernières années est la suivante : les classes dirigeantes ont rarement survécu aux changements climatiques. L’effondrement du pouvoir romain en Occident a coïncidé avec la période froide de l’Âge sombre (vers 400-750). La crise du féodalisme s’est produite au cours du siècle qui a suivi l’arrivée du Petit âge glaciaire (vers 1300-1850). Les crises politiques les plus graves du début du capitalisme – jusqu’au milieu du xxe siècle – ont coïncidé avec les décennies les plus graves du Petit âge glaciaire au xviie siècle. Le climat ne détermine rien, mais les changements climatiques sont cousus au tissu de la production, de la reproduction, de la gouvernance, de la culture… bref, tout ! Bien entendu, les changements climatiques qui se produisent actuellement seront plus importants que tout ce que nous avons vu au cours des 12 000 dernières années. Le « business as usual » – les systèmes de domination de classe et de production et tout le reste – ne survivent jamais à des changements climatiques majeurs. La fin de l’Holocène et l’aube de l’Anthropocène géologique peuvent 64donc être saluées comme un moment de possibilité politique sans précédent – la fin du Capitalocène.
Certes, le capitalisme se poursuit. Mais c’est un cadavre qui marche encore. Ce qui doit se produire maintenant, c’est un changement radical qui lie la décarbonisation, la démocratisation et la démarchandisation. Cela devra bouleverser la logique du Green New Deal. Une telle vision radicale guidera le Nouveau Deal Vert et les liens cruciaux qu’il établit entre la justice économique, les services sociaux et la durabilité environnementale, en direction de la démarchandisation du logement, du transport, des soins et de l’éducation – mais aussi, la garantie de la justice alimentaire et climatique, en dissociant l’agriculture de la tyrannie des monocultures capitalistes.
C’est précisément cette impulsion radicale qui est au cœur de l’écologie-monde en tant que conversation8. Cette conversation se définit par son ouverture fondamentale à repenser les anciens modèles intellectuels – rien de moins, mais pas seulement, que le partage entre « Société » et « Nature » – et à encourager un nouveau dialogue entre chercheurs, artistes, militants et scientifiques, qui explorent ensemble l’idée selon laquelle le capitalisme se constitue comme une écologie de pouvoir, de production et de reproduction au sein du réseau de la vie. C’est une conversation qui insiste sur le fait qu’il n’y a pas de politique du travail sans nature, ni de politique de la nature sans travail ; qui souligne que la justice climatique est une justice reproductive ; qui défie l’apartheid climatique par un abolitionnisme climatique.
Le Capitalocène n’est donc pas un mot nouveau pour railler l’Anthropocène. C’est une invitation à discuter sur la façon dont nous pourrions démanteler, analytiquement et pratiquement, la tyrannie de l’« Homme » et de la « Nature ». C’est une façon de donner un sens à l’enfer planétaire, en soulignant que la crise climatique est un changement géohistorique qui inclut des molécules de gaz à effet de serre, mais ne peut être réduit à des courbes de parties par million (ppm). La crise climatique est un moment géohistorique qui combine systématiquement la pollution par les gaz à effet de serre avec la fracture climatique, le patriarcat de classes et l’apartheid climatique. L’histoire de la justice au xxie siècle dépendra de notre capacité à 65identifier ces antagonismes et ces interdépendances mutuelles, et de notre capacité à construire des coalitions politiques qui transcendent ces contradictions planétaires.
Jason W. Moore
Source : Jason W. Moore, « Capitalocène & Planetary Justice », Maize, 6, 2019, p. 49-54
Traduction de Fabien Colombo
1 Note du traducteur : La notion d’« écologie-monde » (world-ecology) chez Jason W. Moore s’appuie notamment sur les travaux d’Immanuel Wallerstein concernant le « système-monde moderne » (modern world-system), mais aussi de Fernand Braudel sur l’« économie-monde ». Pour plus de précisions sur ce point, voir : Jason W. Moore, « Capitalism as World-Ecology : Braudel and Marx on Environmental History », Organization & Environment, 1 December 2003, vol. 16, no 4, p. 514-517 ; Jason W. Moore, « The Modern World-Systemas environmental history ? Ecology and the rise of capitalism », Theory and Society, 1 juin 2003, vol. 32, no 3, p. 307-377.
2 Note du traducteur : le terme utilisé est « web of life ». Il renvoie, en particulier, à l’ouvrage de Fritjof Capra, The Web of life : A New Scientific Understanding of Living Systems (Anchor Books, 1996), qui a été traduit en français de la manière suivante : La toile de la vie : Une nouvelle interprétation scientifique des systèmes vivants (Éditions du Rocher, 2003). Comme Fritjof Capra et Jason W. Moore insistent sur l’idée de connexions entre le vivant, de relations entre les entités, l’aspect réticulaire de la notion a été privilégié ici, mais laisse ouvert la compréhension de celle-ci comme « la toile du vivant », le « maillage de la vie », « le tissu du vivant », etc., par exemple.
3 Note du traducteur : le terme original est « Geological Anthropocene ». La typographie a été légèrement modifiée pour rendre le reste du texte plus lisible.
4 Note du traducteur : en anglais, le terme de « golden spike » renvoie en géologie à l’identification d’une démarcation physique entre deux strates, sans que celles-ci ne se chevauchent ou ne laisse de vide. Lorsque de tels points sont identifiés, par la communauté internationale des géologues à l’échelle du monde, un « golden spike » – un « clou d’or » en français, et en réalité une pique de métal cuivré – est alors planté à l’endroit où cette démarcation est observée. Les clous d’or sont aussi connus sous l’abréviation de « GSSP » en anglais, pour « Global Boundary Stratotype Section and Point », ou de « SMP », pour « points stratotypiques mondiaux », en français.
5 Note du traducteur : le terme original est « Popular Anthropocene ». La typographie a été légèrement modifiée pour rendre le reste du texte plus lisible.
6 Note du traducteur : l’auteur parle souvent de l’opposition entre l’Homme et la Nature (« Man and Nature »), voire de l’Homme à la Nature (« Man versus Nature »), en recourant souvent à des majuscules, des italiques, ou des guillemets afin d’indiquer qu’il s’agit d’abstractions historiquement construites – et, en particulier, à déconstruire. Dans ce cas précis, nous rajoutons les guillemets pour bien montrer le caractère abstrait de ces notions, sans reproduire cette typographie par la suite, suggérant que les majuscules souvent employées par l’auteur seront suffisantes pour le rappeler. Pour plus de précisions, voir : Jason W. Moore, « The Capitalocene, Part I : on the nature and origins of our ecological crisis », The Journal of Peasant Studies, 4 mai 2017, vol. 44, no 3, p. 594-630 ; Jason W. Moore, « The Capitalocene Part II : accumulation by appropriation and the centrality of unpaid work/energy », The Journal of Peasant Studies, 23 février 2018, vol. 45, no 2, p. 237-279.
7 Note du traducteur : le terme exact est « cheapen ». La notion de « cheap » est particulièrement importante dans le travail de Jason W. Moore. Elle renvoie tout autant à un rabaissement économique des coûts, qu’à un rabaissement des considérations morales pour ce faire. Elle concerne ainsi la valeur au sens économique et moral du terme, et fait coïncider ce qui est « bon marché » avec ce qui est au « bas de l’échelle » de la reconnaissance d’un groupe donné. Le sens du mot en anglais invite ainsi le lecteur à associer les idées de bon marché, de bas de gamme, de rabaissement, de dévalorisation, et dépréciation, etc., afin de pleinement le comprendre. Pour plus de précisions, voir : Raj Patel et Jason W. Moore, A History of the World in Seven Cheap Things : A Guide to Capitalism, Nature, and the Future of the Planet, Oakland, University of California Press, 2017.
8 Pour plus de précisions à ce sujet, voir le Réseau de recherche sur l’écologie-monde que coordonne Jason W. Moore : https://worldecologynetwork.wordpress.com.