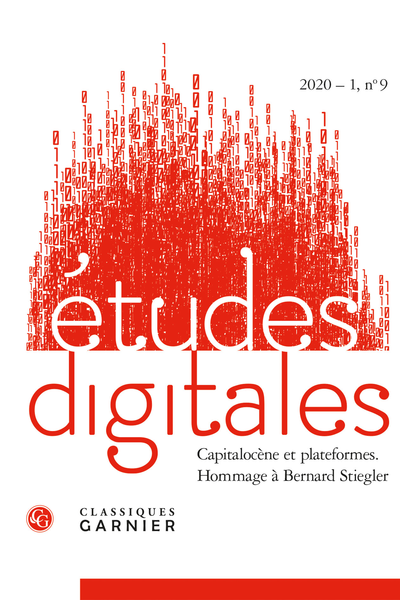
Idiodiversity, the meaning and reason for translating Tribute to Bernard Stiegler
- Publication type: Journal article
- Journal: Études digitales
2020 – 1, n° 9. Capitalocène et plateformes. Hommage à Bernard Stiegler - Author: Krzykawski (Michał)
- Abstract: This article introduces the concept of idiodiversity in the wake of the concept of idiotext proposed by Bernard Stiegler. Having translation as the preferred operating mode, idiodiversity can be seen as an alternative to translation that has become automatic calculation. However, this article is above all a translator's testimony and a tribute to Bernard Stiegler's thought, made from the very space of the translation of his works.
- Pages: 329 to 352
- Journal: Digital Studies
- CLIL theme: 3157 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Sciences de l'information et de la communication
- EAN: 9782406115212
- ISBN: 978-2-406-11521-2
- ISSN: 2497-1650
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-11521-2.p.0329
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 05-26-2021
- Periodicity: Biannual
- Language: French
- Keyword: Bernard Stiegler, idiome, tenderness, affect, friendship, entropy, belief
L’idiodiversité, Le sens
et la raison de traduire
Hommage à Bernard Stiegler
[…] car ce qui me constitue, c’est encore mon langage en tant qu’il est idiomatique.
Bernard Stiegler, Passer à l’acte.
[…] la singularité de cette localité toujours idiomatique qu’est l’idiotexte. »
Bernard Stiegler, Le nouveau conflit des facultés et des fonctions dans l’Anthropocène.
Dès les premières lignes du premier volume de La technique et le temps publié en 1994 jusqu’à Bifurquer publié en 20201, Bernard Stiegler a toujours posé « la question technique comme la question philosophique » en refusant de considérer la technique comme une des « régions d’un savoir philosophique supposé plus général2. » Dans sa philosophie, qu’il définissait à cet effet comme « une hyperphilosophie3 », la question de l’idiome s’imposait au fur et à mesure qu’il concrétisait, notamment à travers ses initiatives diverses, les concepts de noodiversité4 et technodiversité, notamment en dialogue avec Yuk Hui5. L’idiome y devenait le milieu d’expression de la singularité ainsi que de production de 330différance, au sens de Jacques Derrida, à travers des organes artificiels (exosomatiques). Ainsi, comme il l’a annoncé dans Le nouveau conflit des facultés et des fonctions dans l’Anthropocène, texte accompagnant son fameux triptyque republié dans un seul volume, le 7e volume de La technique et le temps devait-il avoir pour titre Le défaut qu’il faut. Idiome, idios, idiotie6. Pourtant, l’importance de la question de l’idiome, ainsi que celle de la localité avec laquelle l’idiome a partie liée, est déjà avouée dans Passer à l’acte où Bernard Stiegler rapporte ces deux questions à son devenir philosophe hors du commun. « J’ai dès lors tenté d’isoler des degrés de localités par diverses variations imaginaires et pratiques signifiantes », écrit-il en se remémorant sa cellule de prison, cette « local-ité par défaut et le défaut comme la local-ité7 », et en signalant la question qu’il aura posée à travers les sciences.
L’objectif de cet article est de proposer, dans le sillage de ce que Stiegler a esquissé comme « idiotexte8 », le concept d’idiodiversité comme support de la noodiversité et variante de la technodiversité, laquelle l’idiodiversité elle-même a la traduction pour son modus operandi. Ma proposition ne sert pas à amplifier vainement le très riche appareil conceptuel que nous avons hérité de Bernard Stiegler. D’une manière générale, il s’agit dans ce qui suit de montrer comment les instruments stieglériens peuvent nourrir la traductologie comme discipline à part entière et renouveler ses épistémologies, afin de surmonter la non-époque de la traduction, c’est-à-dire l’époque de la traduction devenue calcul automatique. Plus concrètement, et dans « l’entretien infini9 » avec la pensée de Stiegler, je me propose de montrer pourquoi c’est la traduction qui peut apparaître comme une technique de prédilection pour pratiquer la noodiversité et la technodiversité à travers les idiomes, eux-mêmes étant des systèmes organiques artificiels et ouverts. Enfin, sur le plan herméneutique et dans l’espace de la traduction de l’œuvre stieglérienne, il s’agit de transformer la traduction en un instrument qui serve à continuer 331à interroger sa pensée et lire ses ouvrages, qui se voulaient eux-mêmes des instruments. « Travaille ton instrument ! » – nous disait-il, rappelant la recette que Pierre Schaeffer a apprise par son père.
Il existerait donc, aux côtés du « savoir-théoriser10 » et d’autres savoirs11, le savoir-traduire qui n’a de cesse de renouveler la saveur de tout savoir qui s’exprime à travers des concepts ou théorèmes dans une langue et son idiome spécifique (y compris ses diversifications régionales – ces localités attachées aux territoires en quoi toute langue consiste), ainsi que d’œuvrer pour maintenir ce savoir ouvert et sujet à des transformations trans-idiomatiques nécessaires. Il s’ensuivrait que tout savoir théorique qui n’est pas traduit est voué à s’effacer ou, ce qui revient au même, à l’idiotie qui hante tout idiome12.
Si cette idiotie peut parler de nos jours soit à travers des « nationalismes ontologiques » issues de l’idée du génie des langues (idée fort dangereuse, notamment avec la déferlante des nationalismes d’aujourd’hui), soit à travers le « tout-à-l’anglais13 », elle est surtout produite par la traduction automatique. Que la traduction automatique, du fait qu’elle tend à absorber le temps à mettre dans le travail de traduction, détruise la savoir-traduire et, par conséquent, est porteuse de « dénoétisation14 », cela est une évidence. Face à ce devenir-automatique de la traduction, l’idiodiversité, qui considère la traduction comme porteuse de nouveauté, plutôt qu’une simple répétition mécanisable, peut s’imposer comme une alternative et promettre l’avenir de la traduction après l’automatisation. Or, il ne s’agit nullement de condamner les technologies numériques de traduction, dont les machines conçues à la base de réseaux de neurones artificiels, mais de les libérer d’« un 332usage vicieux15 » – et cela à travers l’invention et la cultivation de nouvelles pratiques translinguistiques de traduction technologiquement assistée, qui favorisent des processus de noétisation au lieu de les annihiler. Je pense ici particulièrement à la notion de « cultuel », telle qu’elle a été réinventée et laïcisée par Stiegler. Pour lui, les cultes sont des « pratiques régulières » qui rendent possible « un inattendu et un improbable où le jeu ne cesse de s’inventer à nouveau ». Ainsi, comme il faudrait en appeler à « des consciences cultuelles de l’image16 » dans le cadre d’une authentique politique technologique renforçant la noo- et technodiversité, il faudrait du coup faire éveiller des consciences cultuelles de la traduction dans l’esprit de l’idiodiversité.
Certes, revendiquer une telle politique depuis le modèle technologique dominant et foncièrement totalisant peut paraître comme un rêve. Or, Bernard, outre qu’il fut l’hyperphilosophe de la technique, qui passait aussi, surtout en France, pour un penseur politique17, fut le grand penseur du rêve. En effet, il nous enseignait que « pour faire de la politique, il faut rêver18 » –précisément parce que, contrairement aux idées reçues, ainsi qu’à la mécréante bassesse du post-politique, la faculté de rêver est hautement rationnelle. Il y ajoutait cependant que la noèse digne de ce nom doit être capable de reconnaître que ses rêves réalisables peuvent muter en des cauchemars aussi réalisables et qu’elle doit savoir les éprouver sinon en souffrir. La traduction automatique est l’exemple d’un tel rêve réalisable devenu cauchemardesque qui amortit l’épreuve de la traduction. Il est grand temps de refaire cette épreuve, que Berman, dans l’un des ouvrages-phares pour l’herméneutique en traductologie, appelle « l’épreuve de l’étranger19 » sous le signe et en vue de l’idiodiversité.
333Que cette teneur affectionnée me soit pardonnée. Je ne peux même pas cacher maintenant les liens d’affection qui me lient avec la pensée de Bernard Stiegler. Or, au-delà de son affection à lui dont j’ai pu faire l’expérience, j’aimerais montrer pourquoi l’affection (et plus généralement l’affectivité) est très précisément la qualité qui passe par la traduction et continue à se propager à travers le travail de traduction pour y produire des liens transidiomatiques et conceptuels inouïs. Et c’est pour cela même qu’il faut bien croire à la puissance de traduire en reliant l’idiodiversité à la croyance et à la nécessité du sens de croire. Bernard Stiegler a consacré à la question de la croyance les plus belles de ses pages. Dans Vouloir croire. Aux mains de l’intellect, originairement texte d’une conférence prononcée en 2004 lors d’un colloque consacré à Jaques Derrida et en sa présence, nous lisons :
En quelque sorte, il faudrait vouloir croire aux mains de l’intellect, au fait que l’intellect a des mains, qu’il en a toujours eues, et que cela durera, qu’il aura encore et toujours des mains, que rien n’est encore perdu – parce qu’avoir des mains, ici, cela signifie pouvoir faire quelque chose ; en cela, j’aurais aussi pu tourner ainsi mon titre : Vouloir croire et pouvoir faire.
Mais Vouloir croire. Aux mains de l’intellect, cela dit aussi que même lorsqu’on est aux mains de l’intellect, aux prises avec l’intellect, emprisonné dans l’intellect, entre ses mains – comme on dit en français « être aux mains de la police », c’est-à-dire arrêté par la police, et en cela, impuissant –, il faut continuer à croire, il faut vouloir croire20.
Face à sa disparition et, du coup, étant aux prises avec la traduction automatique, qui est bel et bien l’ouvrage des mains de l’intellect, nous devons peut-être, fût-ce au prix d’un effort surhumain auquel il nous incitait pour « demeurer des êtres non-inhumains21 », croire encore plus qu’avant, afin même de lui rester fidèle.
334Le non-inhumain, l’anti-anthropique,
le surhumain
Pour montrer comment l’idiodiversité peut être mobilisée au service de la désautomatisation, regardons de plus près ce que c’est l’idiotexte et comment ce concept est lui-même localisé dans la localité conceptuelle stieglérienne. D’abord, l’idiotexte est un système organique artificiel (exorganique dans le sens où il est constitué par un ou des organes qui ne sont pas corporels, c’est-à-dire endosomatiques) dont le fonctionnement relève de l’évolution exosomatique. À la suite des travaux de l’économiste roumain Nicolas Georgescu-Roegen, qui lui-même s’appuie sur les travaux d’Alfred Lotka, Stiegler montre que le cours de cette évolution a été subordonné au processus économique et qu’elle est désormais aux prises avec le calcul de l’époque de la data economy. Par conséquent, même si le processus économique devrait être vu comme l’extension du processus biologique ou « l’essence biologique de l’homme22 », celle-ci ne se réduisant d’ailleurs ni au calculable ni aux mécanismes probabilistiques, force est de constater que l’exosomatisation, dans cet état de fait, « impose de remplacer la biologie par l’économie23. » Et il semble vital d’ajouter que ces mécanismes probabilistiques caractérisent non seulement le paradigme de l’économie néoclassique critiqué par Georgescu-Roegen qui, ayant terminé les études en statistique à la Sorbonne, déclarait que « le système mathématique ne peut pas décrire les phénomènes économiques24. » Ces mécanismes sont aussi typiques de l’information computationnelle – dont les systèmes de traduction automatique, largement basés sur la statistique.
En critiquant Georgescu-Roegen dès l’intérieur de sa proposition de bio-économie, Stiegler insiste sur le caractère irréductiblement pharmacologique (curatif et toxique à la fois) de tout organe exosomatique. Pour « panser le saut depuis l’Entropocène dans le Néganthropocène », il faut 335surmonter la bi-polarité entropie/anti-entropie et « penser l’organogenèse exosomatique au-delà de l’anti-entropie que l’organe exosomatique est à la fois entropique et anti-entropique : c’est un pharmakon25. » C’est pourquoi en mettant le concept d’entropie au cœur de ses derniers travaux, ainsi que des activités du collectif Internation26, il ne cessait de nous renvoyer à ses travaux antérieurs sur la pharmacologie27. De surcroît, dans son invention conceptuelle tout à fait exceptionnelle, il a proposé les concepts d’anthropie et anti-anthropie. Outre qu’ils font le pont entre ces deux pans de son œuvre hétérodoxe, ces deux concepts nous montrent très précisément ce qui reste à panser et à faire dans l’état d’urgence de l’Anthropocène qu’il a renommé l’Entropocène pour montrer que tous les maux de cette non-époque viennent de l’augmentation massive de l’entropie.
Or, cette entropie qui augmente est effectivement le produit spécifique de l’économie humaine-devenue-inhumaine : c’est l’entropie anthropique (anthropie), qui ne se réduit donc pas à l’entropie vue sous l’angle thermodynamique et biologique, même si elle la provoque. L’anthropie génère des effets entropiques qu’il faut donc voir sur le plan logique, et non pas biologique ou thermodynamique, ainsi que les rattacher au devenir-symbolique du milieu humain, ce devenir lui-même participant du vaste processus de l’exosomatisation qu’il faut aborder à cet effet depuis la perspective pharmacologique. C’est précisément pour cela que lutter contre l’entropie ne peut se faire qu’à travers la lutte contre l’anthropie, c’est-à-dire pour le(s) monde(s) ou les localités font croître de l’anti-anthropie et en finissent avec « la mécroissance28 » induite par le modèle macro-économique planétaire.
C’est pour cela que ce qui nous appartient, c’est de faire un saut dans le Néganthropocène qu’il faut bien panser. Pourquoi un saut ? Parce que nous ne pouvons ouvrir ce Néganthropocène, c’est-à-dire l’Anthropocène non-inhumain : anti-anthropique, et en cela, surhumain29 qu’à l’aide 336des mêmes organes exosomatiques qui, comme pharmaka, ne cessent de nous empoisonner. C’est en ce sens que le saut auquel nous encourageait Bernard, « le plus grand tragiste depuis Nietzsche30 », le saut qu’il faut bien faire, ne peut se faire comme un saut tragique. C’est en ce sens aussi que nous devons toujours remettre du temps pour comprendre (produisant du coup de l’anti-anthropie) qu’il avait raison derrière « son haut niveau d’exigence théorique et de précision du vocabulaire31 », ce qui revient à comprendre que ses concepts n’avaient rien à voir avec le jargon théorique et, en revanche, ils avaient tout à voir avec une pensée large et profonde. C’est en ce sens enfin, et par cette voix amicale plurielle, que nous devons développer « la vitalité et l’intelligence du groupe32 » qui multipliaient l’énergie de Bernard. Ce n’est que par ce travail bien hors emploi que nous pouvons ouvrir des bifurcations, dont celles idiotextuelles.
L’idiotexte et la localité
Il faut voir l’idiotexte avec une attention portée à cette richesse conceptuelle stieglérienne, à la fois très hétérogène et très rigoureuse, pour en saisir l’importance et pour voir combien l’idiotexte permet de 337voir le travail de traduction sous un autre jour. Il faut du coup mesurer la prégnance du concept de localité qui a tout à voir avec celui d’idiotexte. Sur le plan général – aussi biologique (organique) que technologique (exorganique ou exosomatique), aussi individuel que collectif –, c’est l’organisme (comme système dynamique ouvert) qui crée la localité et qui l’habite en l’animant temporairement, et en cela, en la transformant, l’entropie ne pouvant ainsi être différée que localement, c’est-à-dire dans un lieu concret, et à travers la production des différences. Si ce lieu est matériellement lié à un territoire, il ne s’y limite pas. Or, en tant qu’un lieu habitable et désirable pour les organismes, la localité ne peut pourtant pas être illimitée. La localité ouverte sans limites n’est concevable qu’en tant que globalisation qui lui fait la guerre et qui produit réactivement des localités fermées : des localismes et nationalismes d’extrême-droite. Stiegler identifie une telle localisation, comme production des lieux vivables, à une spatialisation, tout en soulignant que, dans le cas des organismes humains, cette spatialisation est elle-même produite par l’exosomatisation (qui est alors anti-entropique par ce qu’elle revient à animer temporairement une localité et diffère l’augmentation de l’entropie), et que cette exosomatisation peut-être aussi bien entropique (alors elle amortit ce temps qu’il faut remettre pour produire de l’anti-antropie et, par conséquent, produit de la désorientation depuis un espace artificiel fermé qui ne débouche sur aucun avenir)33. Bref, la localité prend ici tout le sens que lui confère le mot latin localitas : propriété nécessaire de corps ou propriété d’être dans l’espace. Or, cet espace n’est plus à comprendre en termes newtoniens (espace absolu), du fait qu’il se produit dans le temps différant et dans le processus de l’exosomatisation. C’est en cela que c’est un espace à la fois artificiel et la seule possible.
Sur le plan informationnel (celui des data), qui a pourtant tout à voir avec ce plan général, l’organisme (qu’il faut toujours voir comme système), peut être vu aussi comme idiotexte. Le fonctionnement de celui-ci vient être perturbé par l’information qui le traverse. L’information peut être définie comme néquentropique pour autant qu’elle entraîne la modification d’état de l’idiotexte. Or, par ce changement d’optique permettant d’envisager le système organique comme idiotexte, Stiegler nous propose une alternative à la data economy, en prenant les data non 338pas pour l’information, mais pour la « donnée34 », comme s’il voulait les réinventer à partir de leur origine archaïque – n’oublions pas que le datum, en latin, veut dire le don. Ainsi, faudrait-il voir l’idiotexte non pas comme système de calcul (ce qui est bien le cas de la data economy), mais
comme sense data, comme ce qui fournit à l’entendement ce que Kant appelle le divers de l’intuition, qui est toujours l’objet d’une interprétation en fonction de ce que Kant appelle le principe subjectif de différenciation par où s’agencent le sens interne et le sens externe35.
Dans cette optique, l’idiotexte, comme système dynamique et vivant,
est aussi un système interprétatif – et plus précisément, un système ouvert qui interprète dans l’instabilité fonctionnelle de son milieu exosomatique hautement infidèle cette infidélité même, et donc ce qu’il en est de la promesse de fidélité […], la fidélité étant la condition du maintien de l’idiotexte dans cette ouverture, à savoir : la vérité comme pouvoir de bifurquer d’un système qui, sans ce savoir, serait voué à se fermer, c’est-à-dire à s’auto-détruire par l’augmentation inéluctable du taux d’entropie dans la localité en quoi il consiste, aussi bien que de ce que nous appelons ici l’anthropie, dont l’accroissement sans limites conduit à l’effacement de cette localité36.
Ce système interprétatif, dit Stiegler, est capable de différer noétiquement cet effacement, qui est pourtant inéluctable à l’échelle universelle de l’existence du vivant et qui, sur le plan du vivant potentiellement noétique qu’est le vivant humain, prend la forme du non-savoir ou de la dénégation. En effet, ce système
temporise [cet effacement] en le spatialisant, c’est-à-dire en l’exosomatisant, autrement dit, en l’ex-primant […], ce système est donc herméneutique : il ne fait pas de calcul sur des informations37.
339La traduction automatique
et les finalités de la traduction
Revisitée depuis cette perspective idiotextuelle, la traduction, qui est elle-même un travail interprétatif par excellence, est exorganiquement liée à cette ex-pression dont elle est en même temps l’ex-tension et la trans-position dans une localité différente. Ce que Berman a défini comme « espace de la traduction38 » participerait donc du processus de cette spatialisation décrite par Stiegler et en serait son prolongement, ainsi que la transformation de l’espace noétique d’un idiotexte. Cet espace de la traduction, que Berman définit comme « espace d’accomplissement », a tout à voir avec la catégorie stieglérienne de l’inachevable (qu’il a souvent rapporté au processus de l’individuation39). En effet, il s’agit du « domaine d’essentiel inaccomplissement qui caractérise la traduction. » Tout comme tout idiotexte demande la traduction, toute traduction demande des retraductions, c’est-à-dire des réinterprétations qui actualisent l’idiotexte déjà transformé par les données et rechargent son potentiel noétique. « C’est seulement aux retraductions qu’il incombe d’atteindre – de temps en temps – l’accompli », dit Berman. Mais d’habitude, quand on prend le travail de traduction pour celui d’interprétation dans l’association différante de deux systèmes interprétatifs ouverts (idiotexte original et idiotexte traduit, eux-mêmes mobilisant d’autres idiotextes ou appartenant à des idiotextes supérieurs), l’accompli s’exprime par l’inachevable poursuite de la perfection.
Stiegler a bien montré que cette perfection a été amortie par la performance du calcul et la quantification devenue « l’opérateur de toute transformation40 » au cours du xxe siècle. Et le calcul doit être vu ici comme faculté de l’entendement (que Kant identifiait à l’intellect, en rapportant Verstand à intellectus). La traduction automatique (comme une forme perfectionnée et autrement performante et prolétarisante de ce que Marx a défini comme le general intellect, c’est-à-dire l’intellect 340extériorisé dans les machines41) est l’accomplissement de cette performance computationnelle qui met en question le sens même de l’interprétation et détruit le savoir-traduire.
Entendons-nous. Il est tout à fait probable que la machine Google sera bientôt parfaitement capable de traduire calculer La société automatique 1. L’avenir du travail – cela est d’ailleurs en train de s’accomplir.
Le 23 juin 2008, en analysant dans Wired le modèle d’affaires de Google, Chris Anderson montra que tous les services offerts par cette entreprise – qui sont basés sur ce que Frédéric Kaplan a appelé depuis le capitalisme linguistique – sont réalisés sans aucune référence à une théorie du langage, quelle qu’elle soit. Partant de là, et tenant un raisonnement similaire en matière d’épidémologie googlienne, il en vint à poser en principe que, avec ce qu’on appelle aujourd’hui les big data, constitués par les milliards de données analysables en temps réel par le calcul intensif, il n’y a plus besoin ni de théorie, ni de théoriciens – comme si les data « scientists », spécialistes des mathématiques appliquées à de très grandes bases de données par l’intermédiaire d’algorithmes, pouvaient se substituer aux théoriciens que sont toujours, en principe, les scientifiques, quels que soient les champs et les disciplines scientifiques concernés42,
écrit Bernard Stiegler au début de son livre.
Le résultat du calcul effectué par la machine dite intelligente n’est toujours pas parfait. Or, compte tenu de la complexité et la longueur de la phrase stieglérienne, qui posent autant de problèmes au traducteur et requièrent des décisions parfois difficiles, on constate que ce calcul est malicieusement efficient et devient de plus en plus comparable au magnifique travail de Dan Ross.
Le résultat du calcul de Google :
On June 23, 2008, by analyzing Google’s business model in Wired, Chris Anderson showed that all the services offered by this company—which are based on what Frédéric Kaplan has called since linguistic capitalism—are carried out without any reference to a theory of language, whatever it is.
Starting from there, and using a similar reasoning in terms of Googlian epidemology, he came to pose in principle that, with what is called today big data, constituted by the billions of data that can be analyzed in real time by the intensive computing, there is no longer any need for theory or theoreticians – as if data “scientists”, specialists 341in mathematics applied to very large databases through algorithms, could take the place of theorists that in principle scientists always are, regardless of the fields and scientific disciplines involved
Le résultat du travail de Dan Ross :
In an analysis of Google’s business model in Wired on 23 June 2008, Chris Anderson showed that the services provided by this company—which are based on what Frédéric Kaplan has called linguistic capitalism—operate without any reference whatsoever to a theory of language.
Continuing with a form of reasoning similar to that which he applies to the epidemiology of Google, Anderson comes to the conclusion that what is referred to today as ‘big data’, consisting of gigabytes of data that can be analysed in real time via high-performance computing, no longer has any need for either theory or theorists—as if data ‘scientists’, specialists in the application of mathematics to very large databases through the use of algorithms, could replace those theoreticians that scientists always are in principle, regardless of the scientific field or discipline with which they happen to be concerned43.
Et plus nous utiliserons Google translator (en « apprenant l’intelligence artificielle », fût-ce au prix du désapprentissage de nous-mêmes) pour traduire des textes théoriques complexes, plus cette intelligence sera efficiente et smart, c’est-à-dire maligne.
Comment donc faire avec et depuis cet espace artificiel et artificiellement absolutisé de Google, pour sauver l’âme noétique traduisante, étant donné que ce devenir-automatique de la traduction devenue calcul est inéluctable ? D’abord en rappelant, dans le sillage de la pensée stieglérienne, que les finalités du travail de traduction se localisent bien au-delà de l’efficience du calcul, si exact que soit le résultat de ce dernier. L’enjeu ne consiste pas tellement à maudire la traduction automatique, même s’il ne faut jamais oublier la leçon de Simondon : « l’automatisme est un assez bas degré de perfection technique [parce que] pour rendre une machine automatique, il faut sacrifier bien des possibilités de fonctionnement, bien des usages possibles44. » Il s’agit plutôt d’inventer une nouvelle mesure pour la traduction et de retrouver d’autres usages des machines à traduire comme conditions de possibilité de nouvelles pratiques de traduction qui nous permettent 342de surmonter la bassesse technologique qu’incarne la machine algorithimique Google et de relier la traduction à la noèse, c’est-à-dire y discerner une activité anti-anthropique.
De l’affection à la « surpréhension »
dans la traduction. L’herméneutique
et le néguentropique
En caractérisant les propriétés de l’idiotexte qui est pénétré par les informations comme data, Stiegler a bien reconnu la puissance séduisante des big data. La traduction automatique est un exemple particulièrement frappant de cette puissance dans la mesure où elle nous montre la saveur qualitative que nous perdons avec la prolétarisation (perte) du savoir-traduire, induite par la traduction comme calcul purement quantitatif.
Je peux bien sûr mobiliser des techniques analytiques et en cela computationnelles au service de l’établissement, certifié par l’entendement, de données que je dois interpréter, c’est-à-dire par rapport auxquelles je dois décider. Mais je suis affecté par ce qui, à travers ce qui ne se constitue pas comme des informations, mais comme des données au sens de Kant, se présente à moi comme un motif de ma raison, ou comme un écho d’un tel motif, motif de ma raison qui exprime mon désir en tant qu’il consiste en une activité noétique […]45
C’est cette affectivité (et l’affection) que nous perdons avec la traduction automatique insipide qui désaffecte aussi le travail de traduction lui-même, faute d’ouvrir la possibilité même d’être affecté dans une épreuve de l’idiodiversité.
Qu’il me soit permis, pour témoigner de cette épreuve, d’évoquer ma propre expérience de traducteur. À la fin de la postface de ma traduction d’États de choc, que Bernard Stiegler m’avait autorisé à publier, j’écrivais que le travail de traduction m’a obligé à faire l’expérience du français qui, en l’occurrence, est devenue l’expérience du latin (que je ne peux passivement connaître et pratiquer que grâce au développement technologique qui a radicalement transformé les conditions et la localité de 343travail du traducteur). Par cette prothèse intermédiaire voire auxiliaire, cette double expérience technique m’a offert des solutions concrètes qui ouvraient (et œuvraient) la langue polonaise. Or, un tel ouvrage s’imposait tantôt comme un choix esthétique, tantôt comme une nécessité logique, notamment dans ces passages où Stiegler développe sa pensée en se rapportant à des concepts allemands déjà traduits en français et reconçus en quelque sorte au sein du français – concepts qui, en fonction de leurs équivalents reconnus qui existent déjà en polonais, fermaient certains sens, mais en ouvraient d’autres, tout en maintenant ouvert l’idiotexte français46. Ainsi, la traduction, comme l’écrivait Gadamer et comme j’y crois, n’a finalement pas apporté une perte, mais un gain47 ; elle a ouvert une expérience herméneutique.
L’hermeneia comme « empêtrement dans une conversation que nous sommes48 » est-ce en quoi consiste la raison de traduire. Or, pour Stiegler, cette conversation serait pourtant dia-logique, plutôt que dialectique, techno-logique plutôt que simplement langagière, et foncièrement délibérative : elle contribuerait à émerger la localité d’un nous collectif, plutôt qu’un « je » et un « tu » qui constitue désormais « la fusion d’horizons » au-delà d’« une naïve assimilation49. », ce nous collectif, nous tous, consistant en une multiplicité de nous collectifs locaux, multilingues et associés. À cet effet il est possible de définir cette conversation trans-idiomatique et voir dans la traduction réciproque ce qui ouvre et maintient les associations. Il s’agit d’un changement d’optique effectué depuis l’hermeneia et il nous faudra relire Stiegler sous cet angle pour voir comment il a contribué à réinventer la tradition herméneutique. Passer de la conversation entre un « je » et un « tu » à l’hermeneia (interprétation) comme instrument de produire et ajuster des nous collectifs est d’une importance majeur. Ce passage faisant, il s’agit bien de réinterpréter l’herméneutique elle-même pour la refonder comme néguentropie et pour l’ouvrir à la science. Le passage du web herméneutique vers le « web néguentropique doit se 344lire précisément en ce sens50. Par son modèle de l’hermeneia, Stiegler a peut-être frayé le chemin à ce qu’il faudrait appeler une herméneutique scientifique qui promette une composition de la raison et la science, au-delà de la technoscience, ainsi que des postures de la philosophie du xxe siècle, qui a tenté de se définir en opposition à la science.
Je comprends après-coup le gain de la hermeneia ainsi élargie et multipliée en me remémorant le travail sur la traduction de Constituer l’Europe 2. Le motif européen. Bernard, qui nous a répété qu’il fallait toujours penser le plus prés possible de Kant (ce qui revient à le critiquer, le troisième volume de La technique et le temps en est la preuve) a aussi ouvert la raison kantienne. Il concevait la raison « à la française » : non pas à partir de Vernunft (« l’allemand appelle ici le mot Grund, le fondement, comme l’anglais grounds »), mais à partir du « motif [qui] s’impose à nous comme ce qui doit être repensé, et ce, en tant qu’il désigne en français la raison même51. Or, il faut faire recours à trois manières différentes de traduire cette raison, si l’on veut la réexprimer en polonais : rozum (au moment où le sens de la raison se situe au plus près de Vernunft et, du coup, d’Aufklärung, pour rappeler la traduction française de la Dialektik der Aufklärung comme Dialectique de la Raison), racja (au moment où l’on parle, par exemple, de la raison d’état ou dans l’expression « avoir raison ») et powód (l’équivalent exact de la raison comme motif qui pousse à l’action. Puisque le mot motif existe aussi en polonais, la traduction du titre (Motyw europejski52) s’est faite sans problème.
C’est en passant par mes propres mains cette raison « française », qui en appelle à des formes plus concrètes en polonais et s’y concrétise au sens même de Simondon, que j’ai pu la retrouver, rouvrir, reconceptualiser et, last but not least, défranciser dans ma langue maternelle là où je n’aurai peut-être jamais cherché cette raison, si je n’avais pas pu traduire Stiegler – traduire, car une lecture ordinaire, bien qu’il soit toujours déjà une traduction dans la mesure où traduire consiste d’abord à interpréter, ne m’aurait peut-être jamais permis ce genre de retrouvailles. Il devait donc y avoir dans cette compréhension un élément de ce que Bernard Stiegler aura finalement appelé surpréhension, c’est-à-dire
345un élément qui dépasse la compréhension (Verstandnis), autrement dit, qui dépasse l’entendement (Verstand), dépassement par où nous pouvons commencer à « penser par nous-mêmes », c’est-à-dire : à exercer les pouvoirs synthétiques qu’a la raison de juger de ce que jusqu’alors nous avions plutôt tendance à consommer : la marchandise se faisant passer pour un savoir53.
Ou, dans le contexte de la traduction automatique : le calcul se faisant passer pour une traduction.
C’est que nous perdons par la traduction automatique – qui est très précisément « entropique et indifférante, c’est-à-dire tendant à éliminer les détours et à raccourcir les délais de la différance54 » dont la traduction est l’opérateur – c’est la possibilité du transindividuel (au sens de Simondon) qui s’ouvre par le partage de l’affect dans cette épreuve du transidiomatique. « Celui qui lit s’y trouve mis au travail, mis à contribution, c’est-à-dire contraint de s’individuer en individuant ce qu’il lit à partir de lui-même, et en se lisant lui-même à travers ce qu’il lit55 », écrit Stiegler en décrivant la manière dont on lit l’œuvre philosophique56. Or, celui qui traduit l’expérience ainsi inscrite en partageant l’affection de celui qui s’individue dans une telle lecture-écriture résolue ne peut que s’individuer qu’à son tour depuis les longs circuits de transindividuation.
Le sensationnel du traduire
Compte tenu de cette affection qui passe par la traduction et s’y propage, il semble opportun de mobiliser en vue de l’idiodiversité le « sensationnel » dont parlait Stiegler lorsqu’il reprenait le nous aristotélicien (l’âme noétique), cette reprise se faisant pourtant « dans un 346rapport insurmontable à l’âme sensitive57. » Il existerait donc « la sensitivité du noétique », c’est-à-dire « la puissance du noétique », qu’il faut donc, puisqu’elle est noétique, c’est-à-dire qu’elle a partie liée avec le logos, considérer comme « inscrite dans la logique ». Il s’ensuit que
le sensible noétique ouvre au sens comme semiosis, et non seulement comme aisthesis. « Logique » ne veut pas dire alors conforme aux règles de la rationalité, mais inscrit dans un devenir-symbolique. Tout sensible en acte devient, pour une âme noétique, support d’une expression. Cette expression […], c’est un logos – parole ou geste : narration, poème, musique, gravure, représentation sous toutes ses formes, mais aussi savoir-faire et savoir-vivre en général. Ce n’est pas ainsi que la métaphysique comprend le logos, mais c’est ainsi qu’il faut le comprendre58.
Mais pourquoi le faut-il et comment ce « il faut » apodictique participe de cette logique qui ne se réduit pas au rationnel sans défier cependant les lois de la raison (comme motif) ? Il s’agit de montrer que, avec le devenir-symbolique, l’âme sensible et potentiellement noétique trouve son expression dans l’ex-clamation, comme si le mot ex-pression ne suffisait pas pour rendre compte de son expérience ; elle devient sensationnelle :
Ce devenir symbolique comme logos qui n’a cours qu’ex-primé, je l’appelle une ex-clamation : l’expérience noétique du sensible est exclamative. Elle s’exclame devant le sensible en tant qu’il est sensationnel, c’est-à-dire expérience d’une singularité incommensurable, et toujours en excès. L’âme exclamative, c’est-à-dire sensationnelle et non seulement sensitive, élargit son sens en l’exclamant symboliquement59.
On devine que ce sensationnel qui nourrit l’âme potentiellement noétique doit être vu sous un angle pharmacologique. En effet, avec le devenir-technologique des supports symboliques qui lui permettent de s’exclamer, l’âme sensationnelle peut aussi bien tomber sous le poids des sensations qui ne sont destinées qu’à faire sensation et conditionnées par les industries dites parfois « du divertissement » (c’est-à-dire aussi de l’éloignement ou du détournement, si l’on se tient au premier sens de divertir, du noétique que le sentir sensationnel peut faire émerger). Or, ce n’est pas que ces industries soient dénoétisantes en propre. Si 347elles le sont de fait, c’est parce qu’elles se nourrissent à leur tour de cette tendance insurmontable typique de « la structure de la psyché noétique » :
L’âme noétique ne l’est toujours pas en acte : son mode d’être ordinaire est simplement sensitif, ce qui veut dire qu’elle reste au stade de sa puissance inerte, de sa puissance impuissante. Ce n’est que par intermittence qu’elle passe au stade sensationnel du noétique, qui est aussi son stade extra-ordinaire60.
Il existerait par analogie – mais l’analogie doit être surpréhendée ici au sens de Simondon, c’est-à-dire comme méthode permettant de discerner des identités de rapports qui s’appuient sur des différences, plutôt que sur des ressemblances61 – le sensationnel du traduire. Compte tenu de ces différences, il faut d’abord constater que l’automatisation en général ressemble à la basse logique62 des industries culturelles dans la mesure où elle nuit au sensationnel et favorise sa régression vers le sensitif, ce qui mène finalement à la dénoétisation. En revanche, la différence que cette analogie nous permet de discerner, c’est que la traduction devenue calcul automatique, du fait qu’elle est purement mécanique et entièrement basée sur la computation, vient éliminer à la fois le sensationnel et le sensitif (dans la mesure où elle exosomatise le sensitif sur un mode entropique : elle le désincarne et rend insensible, ce qui, in fine, ne peut produire que de la désaffection).
Or, traduire, c’est vivre à « ce stade sensationnel du noétique ». Et si y vivre constamment est impossible matériellement (aussi parce que c’est une occupation plutôt mal payée et éminemment intermittente), c’est parce que c’est un travail ordinaire avec tout ce que l’ordinaire peut avoir de pénible. Si bien que si l’on voulait associer ce travail à l’éthos du traducteur, il aurait tout à voir à l’artisanat [craftsmanship] redéfini par 348Richard Sennett et consistant en le désir de bien faire son travail63. Que cet éthos est annihilé par la traduction réduite au calcul automatique, cela va de soi, toute éthique demandant faire des choix et prendre des décisions.
Sans ce sensationnel partagé que la traduction reproduit en le transformant, elle ne saurait pas trouver de moyen d’expression pour ce (et celui) qui s’exclame(nt) à travers le texte traduisant déjà (intra-idiomatiquement, au sein de son propre idiome64) cette exclamation et demandant de la retraduire (inter-idiomatiquement, d’un idiome à l’autre). Ce n’est qu’en communiquant ce sensationnel qui est précisément « toujours en excès », et comme proprement inachevable car obligeant à rouvrir cet excès encore, que la traduction peut être pratiquée comme une tâche noétique et prendre tout son sens. Il nous faut discerner un pharmakon idiomatique archaïque qu’est la traduction du noûs grec par le sensus latin, qui rattache malencontreusement la noèse à l’entendement, c’est-à-dire à l’intellectus65. Il semble que, avec le concept du sensationnel qui traduit la sensitivité du noétique, Bernard Stiegler ait voulu restituer – à sa manière thérapeutique singulière66 et depuis ce qu’il aura finalement appelé « internation67 », l’hétérogénéité du noétique grec. Or, par une chance qui peut émerger dans le passage contingeant d’un idiome à l’autre, et en s’inscrivant dans le « devenir-symbolique » du sens, le sens stieglérien nous indique aussi une direction (sen en langues germaniques), cette direction étant désormais : bifurquer à travers les localités associées qui ne se limitent pas à leurs territoires aussi parce que le sens de leur association consiste en les liens transidiomatiques de l’idiodiversité.
349Si je m’empêtre délibérément dans ces archaïsmes pour témoigner de ce sensationnel du traduire, c’est parce que c’est à partir de la transformation de l’archaïque que Stiegler n’a eu de cesse de poursuivre la recherche de la nouveauté : « dans l’archaïque, si l’on sait en mesurer le poids et le prix, il y a des arkhaï, des principes, dont il est possible de réactiver le sens pour inventer de nouveaux fondements68. »
La nécromasse idiomatique.
De l’idiosphère à l’idiodiversité en pansant l’idiotexte
Ce goût de l’archaïque porteur de richesse à réinventer va pourtant de pair, chez Stiegler, avec le refus décidé de tout archaïsme dans la mesure où celui-ci définit ce qui est périmé, notamment l’archaïsme scientifique structurel produisant le modèle hyper-économique destructeur69. Cette richesse de l’archaïque n’est toujours qu’on puissance : elle n’a de valeur et en devient une qu’en passe d’être revalorisée dans un acte de réinvention. Comment ne pas penser ici, en interrogeant la question de l’idiome, à la nécromasse idiomatique comme analogon de ce que Bernard Stiegler a si bellement défini comme nécromasse noétique :
La nécromasse noétique (qui est aussi et toujours en quelque façon poétique) est aussi indispensable aux vivants noétiques que la nécromasse formée par l’humus issu de la décomposition des végétaux et des cadavres est indispensable à la biomasse végétale et animale70.
Par analogie, la nécromasse idiomatique, qui ne peut s’animer que dans la transformation effectuée dans le processus de traduction (qu’il s’agisse de la traduction intra- ou inter-idiomatique), est indispensable aux vivants qui s’expriment, s’exclament et s’interprètent à travers leurs idiomes. Si cette analogie a certainement ses limites, c’est parce que la vie noétique elle-même, comme activité symbolique, ne se limite pas aux pratiques langagières et peut se traduire par d’autres formes 350d’expression. Or pour ce qui est de ses pratiques, l’idiodiversité, dont la traduction est le modus operandi, serait un support technique de la noodiversité, dans la mesure où le langage (comme écriture) – outre qu’il apparaît comme un (ex)organisme pour ce qui est du fonctionnement de son idiome, lui-même se composant de multiples idiomes singuliers et collectifs qui font des mondes – est surtout un système technique. Elle serait aussi une variante de la technodiversité, dans la mesure où celle-ci elle-même est le support matériel de la technodiversité. Ainsi ni la noodiversité ni la technodiversité ne sauraient exister sans traduction dont la traduction linguistique est un cas spécifique, et qui n’est pourtant pas sans rapport avec le sens de la traduction en biologie71.
Comme la noodiversité a pour but de défier la noosphère afin de surmonter le système, d’abord par la transformation de la manière dont nous avons tendance à concevoir le système72, l’idiodiversité tente de surmonter l’idiosphère et y provoquer ce que Simondon a défini comme « résonance interne73. » Surmonter le système ne revient pourtant pas à le contester, mais à le repenser, c’est-à-dire à le panser, afin de le libérer de la formule close dans laquelle la notion même de système est enfouie. Dans cette perspective, le travail de traduction-interprétation peut apparaître comme une méthode et une pratique d’une telle libération, qui est aussi bien une délibération, en l’occurrence, sur les choix possibles et manières de faire pour bien traduire. Il peut nous signaler aussi comment nous pouvons nous libérer de l’étau algorithmique de la traduction automatique qu’il faut voir d’ailleurs comme le produit de ce que j’appelle l’idiosphère.
Si nous prenons la langue (et plus précisément l’écriture) pour un système technique qui est constitutif de la pensée, il faut admettre que le fait linguistique, comme le système technique en général, accuse deux tendances : totalisation et spécialisation. Si ces tendances sont difficiles à saisir au moment où une innovation, elle-même issue de l’évolution 351technologique continue, transforme irréversiblement le milieu vivant, c’est parce que, notamment à son stade précoce, elle produit aussi de la diversité. La très courte histoire de la traduction automatique – depuis l’ALPAC (Automatic Language Processing Advisory Committee), comité fondé en 1964 par le gouvernement américain et présidé par John R. Peirce, jusqu’à la machine Google – montre bien comment ces deux tendances bien contradictoires sont pourtant intimement liées. C’est pourquoi l’idiosphère, qui a émergé au cours du xxe siècle avec le développement de la techno-science, notamment la linguistique computationnelle, apparaît comme une extension de la noosphère et la technosphère telles que les a définies Vernadsky74.
Tout comme la noosphère et la technosphère, et contrairement à la biosphère, l’idiosphère, avec le développement de la traduction devenue calcul automatique, se traduit par la même tendance à l’homogénéisation (l’entropie), elle-même résultant de la totalisation et la spécialisation. L’enjeu consiste donc à proposer une autre approche systémique de la langue, ce qui ne peut se faire qu’en dépassant les limites de la linguistique du xxe siècle à travers des réinterprétations critiques. Le motif de cette tâche permettrait de surmonter l’idiosphère devenue monolinguiste, en vue de promouvoir l’idiodiversité, ainsi que de reconnaître la fonction éco-techno-systémique des localités idiomatiques. Si cette tâche revient à réhabiliter et revaloriser la traduction face à l’automatisation, ce n’est ni pour condamner la traduction automatique ni pour déterminer comment, par exemple, traduire un ouvrage de Bernard Stiegler, sans où à l’aide de l’apprentissage automatique dans les réseaux de neurones artificiels et partir de la big database traitée par des mécanismes statistiques. L’enjeu n’est pas là. Il consiste, en revanche, à réinventer la fonction de la traduction comme ce que Whitehead décrivait comme « fonction de la raison », cette raison, désormais rattachée au motif, étant « the organ of emphasis upon novelty75. » S’il faut bien combattre la traduction calcul automatique, c’est en vue de lutter pour cette nouveauté idiomatique dont le travail de traduction est porteur.
352Ayant relu Marx bien au-delà de tous les marxismes, Bernard Stiegler a conçu les nouveaux fondements de la critique de l’économie politique. Le dernier projet d’envergure qu’il planifiait, et qu’il voulait mettre en œuvre avec les collaborateurs qu’il a su mobiliser, avait pour ambition de concevoir les nouveaux fondements de l’informatique théorique pour, comme il nous disait, dépasser le modèle de l’informatique entropique, basé sur la machine de Turing. Ce que j’ai tenté de proposer ici comme idiodiversité, avec la traduction comme son mode opératoire, va dans ce sens et se veut un supplément de l’informatique théorique néguentropique à venir. En fait, la question qui s’impose est de dépasser le modèle de la grammaire chomskienne qui, avec la statistique, la philosophie analytique du langage, la théorie computationnelle du mind et la neuroscience, a ouvert la porte à la traduction automatique. L’idiodiversité peut constituer un point de départ et la cause finale de cet immense travail à faire, travail qui nous incombe dans la continuité de la pensée de Bernard Stiegler et des travaux qu’il a inspirés.
Michał Krzykawski
Université de Silésie à Katowice, Centre for Critical Technology Studies
1 Bifurquer. « Il n’y a pas d’alternative », sous la direction de Bernard Stiegler avec le collectif Internation, Les Liens Qui Libèrent, Paris 2020.
2 Bernard Stiegler, Philosopher par accident. Entretiens avec Élie During, Galilée, Paris, 2004, p. 22.
3 Ibid., p. 22.
4 Bernard Stiegler, The Neguanthropocene, Open Humanities Press, London, 2019.
5 Yuk Hui, Recursivity and Contingency, Rowman & Littlefield International, Lanham, Maryland, 2019.
6 Bernard Stiegler, Le nouveau conflit des facultés et des fonctions dans l’Anthropocène, in : La technique et le temps, Fayard, Paris, 2018, p. 863.
7 Bernard Stiegler, Passer à l’acte, Galilée, Paris, 2003, p. 53.
8 Ibid., p. 862-863.
9 Pour le dire comme Blanchot qui était pour lui un écrivain important et qu’il cite en exergue de La faute d’Épiméthée. C’est à partir de ce que Blanchot a défini comme « changement d’époque » que Stiegler aura pensé et pansé pour combattre notre non-époque (Maurice Blanchot, L’entretien infini, Gallimard, Paris, 1969, s. 396).
10 Bernard Stiegler, États de choc. Bêtise et savoir au xxie siècle, Mille et une nuits, Paris, 2012, p. 209.
11 Notamment « savoir vivre ensemble, savoir-faire et coopérer, savoir admirer, considérer et conceptualiser » qui doivent être « diversement partagés » et dont il en Balagna quelques jours avant sa mort, d’après le témoignage de Vannina Bernard-Leoni, Toni Casalonga, Jean-Michel Sorba, paru le 10 août 2020 dans Corse-Matin.
12 C’est Jacques Derrida qui remarque « cet extraordinaire champ magnétique du sens et des usages qui relie en grec l’idios de l’idiome particulier ou singulier à l’idiotês, à l’idiotie de l’idiotês » (Jacques Derrida, Séminaire La bête et le souverain. Volume I (2001-2002), Galilée, Paris, 2008, p. 237)
13 Vocabulaire européen des philosophies. Dictionnaire des intraduisible, sous la direction de Barbara Cassin, Seuil/Le Robert, Paris, 2019 (2004), p. xviii-xix.
14 Bernard Stiegler, Qu’appelle-t-on panser ? 2. La leçon de Greta Thunberg, Les Liens Qui Libèrent, Paris, 2020, p. 40.
15 Gilbert Simondon, Technique et eschatologie : le devenir des objets techniques (résumé) (1972), in : Sur la technique, PUF, Paris, 2014, p. 331.
16 Bernard Stiegler, Constituer l’Europe 1. Dans un monde sans vergogne, Galilée, Paris, 2004, p. 71-72.
17 Cf. Sacha Loeve, Xavier Guchet, and Bernadette Bensaude Vincent, Is There a French Philosophy of Technology ? General Introduction, in : French Philosophy of Technology. Classical Readings and Contemporary Approaches, sous la redaction de Sacha Loeve, Xavier Guchet, and Bernadette Bensaude Vincent, Springer, 2018, p. 4.
18 Bernard Stiegler, Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ?, Les Liens Qui Libèrent, Paris 2016, p. 446.
19 Cf. Antoine Berman, L’Épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique. Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin, Gallimard, Paris, 1995 (1984).
20 Bernard Stiegler, Mécréance et discrédit 1. La décadence des démocraties industrielles, Galilée, Paris, 2004, p. 176.
21 Bernard Stiegler, Qu’appelle-t-on panser ? 1. L’immense régression, Les Liens Qui Libèrent, Paris, 2018, p. 163.
22 Cf. Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts and London, 1971, p. 352.
23 Bernard Stiegler, Le nouveau conflit des facultés…, p. 850.
24 Cité après A Biographical Dictionary of Dissenting Economists. Second Edition, sous la direction de Philip Arestis et Malcolm Sawyer Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, 2000, p. 220.
25 Bernard Stiegler, Le nouveau conflit des facultés…, p. 850.
26 https://internation.world/.
27 Cf. Bernard Stiegler, Prendre soin. De la jeunesse et des générations, Flammarion, Paris, 2008 et Pharmacologie du Front national, Flammarion, Paris, 2013.
28 Cf. Bernard Stiegler, Alain Giffard et Christian Fauré, Pour en finir avec la mécroissance. Quelques réflexions d’Ars Industrialis, Flammarion, Paris, 2009.
29 Le terme Néganthropocène provient du terme néguentropie (entropie négative), proposé par Erwin Schrödinger (cf. Erwin Schrödinger, Qu’est-ce que la vie ? De la physique à la biologie, traduit de l’anglais par Léon Keffler, Seuil, Paris, 1993). En parlant de néguentropie par rapport aux organismes vivants, Schrödinger voulait montrer qu’ils sont capables de limiter l’augmentation du taux d’entropie vue sous l’angle thermodynamique et à la mesure de l’univers, en échangeant la matière et l’énergie avec le milieu extérieur. En poursuivant les intuitions de Schrödinger, Francis Bailly, Giuseppe Longo et Maël Montévil, montrent cependant que la néguentropie n’explique pas tout à fait la logique de l’organisation des organismes et leur capacité de produire des nouveautés à l’aide de nouveaux organes et nouvelles fonctions qu’ils remplissent (cf. Francis Bailly, Giuseppe Longo, « Biological organization and anti-entropy », Journal of Biological Systems, vol. 17, 1/2009, p. 63-96 et Giuseppe Longo, Maël Montévil, Perspectives on Organisms : Biological Time, Symmetries and Singularities (Lecture Notes in Morphogenesis), Springer, 2014). Pour rendre compte de cette capacité spécifique du vivant, ils proposent le terme anti-antropie, repris à son tour par Stiegler qui parle de l’anti-anthropie afin de souligner la spécificité du vivant humain – bien au-delà et très loin de « l’anthropocentrisme » que pourraient lui reprocher les « posthumanistes ».
30 Yuk Hui, The Wind Rises : In Memory of Bernard, publié le 7 août 2020. https://www.urbanomic.com/document/in-memory-of-bernard/.
31 Bernard Umbrecht, Bernard Stiegler (1952-2020), Le SauteRhin, publiée le 11 août 2020. https://www.lesauterhin.eu/bernard-stiegler-1952-2020/.
32 Maël Montévil, le texte.
33 Bernard Stiegler, Le nouveau conflit des facultés…, p. 848.
34 Ibid., p. 862.
35 Ibid., p. 862-863.
36 Ibid., p. 863.
37 Ibid., p. 863.
38 Antoine Berman, « La retraduction comme espace de la traduction », Palimpsestes [En ligne], 4 | 1990, mis en ligne le 22 décembre 2010, consulté le 11 août 2020. URL : http://journals.openedition.org/palimpsestes/596 ; DOI : https://doi.org/10.4000/palimpsestes.596.
39 Cf. Bernard Stiegler, Constituer l’Europe 1, p. 100.
40 Bernard Stiegler, Constituer l’Europe 2. Le motif européen, Galilée, Paris, 2005, p. 31.
41 Cf. Bernard Stiegler, États de choc, chapitre vi, consacré à la relecture des Fondements de la critique de l’économie politique, p. 201-242.
42 Bernard Stiegler, La société automatique 1. L’avenir du travail, p. 9.
43 Bernard Stiegler, Automatic society. Volume 1 The Future of Work, traduit par Dan Ross, Polity, Cambridge, UK, Malden, MA, 2016, p. 1.
44 Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Aubier, Paris, 1958, p. 11.
45 Bernard Stiegler, Le nouveau conflit des facultés…, p. 864.
46 Bernard Stiegler, Wstrząsy. Głupota i wiedza w XXI wieku, traduit par Michał Krzykawski, PWN, Warszawa, 2017, p. 558.
47 Cf. Hans-Georg Gadamer, Lesen ist wie Übersetzen, in : Ästhetik und Poetik I. Kunst als Aussage, Gessamelte Werke. Bd. 8. J.C.B Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1993, p. 279-285.
48 Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode. Les grandes lignes d’une herméneutique philosophique, traduit par Étienne Sacre, édition intégrale revue et corrigée par Pierre Fruchon, Jean Grondin et Gilbert Merlio, Seuil, Paris, 1996, p. 405.
49 Ibid., p. 328.
50 La toile que nous voulons. Le web néguentropique, sous la direction de Bernard Stiegler, FYP éditions, Limoges, 2017, p. 20-21.
51 Bernard Stiegler, Constituer l’Europe 2. Le motif européen, p. 19.
52 Bernard Stiegler, Ukonstytuować Europę 2. Motyw europejski, traduit par Michał Krzykawski, Eperons-Ostrogi, Kraków 2020.
53 Bernard Stiegler, Le nouveau conflit des facultés…, p. 861.
54 Ibid., p. 849.
55 Bernard Stiegler, États de choc, p. 188.
56 qui est bien sa manière de lire à lui, car « à la différence de la science, la philosophie est toujours philosophie d’un philosophe, et, comme le dit Nietzsche, la première question que pose une philosophie est “qui ?” » (Bernard Stiegler, Passer à l’acte, p. 18). Mais pour bien comprendre cette différence, il faut bien reconnaître que la philosophie ne s’oppose pas à la science mais est obligé de faire avec la science : pour pouvoir à la fois produire même cette différence fondamentale et demeurer philosophie à la mesure du xxie siècle.
57 Bernard Stiegler, Mécréance et discrédit 1, p. 177.
58 Ibid., p. 178-179.
59 Ibid., p. 179.
60 Ibid., p. 179.
61 Cf. Gilbert Simondon, L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information, Millon, Grenoble, 2005, p. 108.
62 Qui est aussi bête dans la mesure où la bêtise participe de la bêtise : « La bêtise et, plus profondément, ce dont elle est symptôme : une manière basse de penser » (Gilles Deleuze, Nietzsche et la philosophie, PUF, Paris, 1962, p. 120). Or la bêtise – pas seulement comme la bassesse sensitive, mais aussi comme l’absence de sensationnel qui permet de faire un acte noétique, cet acte se faisant pourtant toujours avec des organes techniques pharmaco-logiques dont les industries culturelles et les dispositifs automatiques – est la structure même de la pensée (Bernard Stiegler, États de choc, p. 93).
63 Cf. Richard Sennett, Ce que sait la main. La culture de l’artisanat, traduit par Pierre-Emmanuel Dauzat, Albin Michel, Paris, 2010.
64 Qui n’est pourtant jamais proprement sien, comme l’a montré Jacques Derrida (Signéponge, Seuil, Paris, 1988)
65 Vocabulaire européen des philosophies, p. 1133.
66 Et partir du sens très riche du thérapeuô et d’après Bailly : « prendre soin, servir, entourer de soins, sollicitude : honorer les dieux, les parents ; faire le service des temples, s’occuper des choses du culte, cultiver la terre, prendre soin de son âme, de son intelligence, rendre service, donner des soins médicaux, traiter, prendre soin de soi » (Bernard Stiegler, Mécréance et discrédit 3. L’esprit perdu du capitalisme, Galilée, Paris, 2006, p. 13-14.
67 Empruntée a Marcel Mauss, cette notion, qui aura finalement donné le nom au collectif éponyme fondé en septembre 2017 à son initiative, apparaît explicitement en 2013, dans les deux derniers chapitre d’État de choc.
68 Bernard Stiegler, Constituer l’Europe 2, p. 119.
69 Bifurquer, p. 17.
70 Bernard Stiegler, Qu’appelle-t-on panser ?, p. 17.
71 Cf. Maël, Montévil, Entropies and the Anthropocene crisis, AI & Society : Knowledge, Culture and Communication, Springer Verlag, à paraître. ffhal-02398756f.
72 Cf. Yuk Hui, Recursivity and Contingency, p. 264.
73 Gilbert Simondon, Les limites du progrès humain, in : Sur la technique, PUF, 2014, p. 272. Cf. Yuk Hui, The Question Concerning Technology in China. An Essay in Cosmotechnics, Urbanomics, Falmouth, 2017, p. 311. Je développerai l’analyse de l’idiodiversité à partir de Simondon, notamment par une réinterprétation de la relation traduction/transduction qu’on retrouve chez lui, dans l’article « Towards Idiodiversity. Retranslating Cybernetics » (à paraître).
74 Cf. Vladimir Vernadsky, The Biosphere, traduit par David B. Langmuir, Copernicus, New York, 1997 et “The Biosphere and the Noosphere”, Scientific American, nº 33 (1), 1945, p. 1-12.
75 Whitehead, Alfred North, The Function of Reason, Princeton University Press, Princeton, 1929, p. 20.