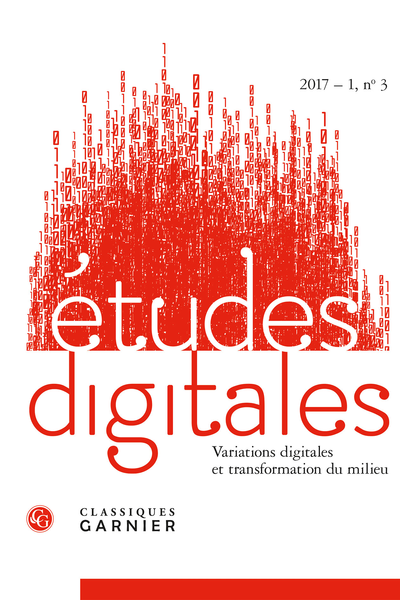
Robert Estivals, un pionnier des sciences de l’écrit (1927-2016)
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Études digitales
2017 – 1, n° 3. Variations digitales et transformation du milieu - Auteur : Estivals (Danièle)
- Pages : 161 à 166
- Revue : Études digitales
- Thème CLIL : 3157 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Sciences de l'information et de la communication
- EAN : 9782406085317
- ISBN : 978-2-406-08531-7
- ISSN : 2497-1650
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-08531-7.p.0161
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 05/11/2018
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Robert Estivals, un pionnier
des sciences de l’écrit (1927-2016)
Né à Paris et mort à Noyon, l’homme demeure l’un des pionniers des sciences de l’information et de la communication, son œuvre reste encore peu connue et diffusée. La revue Études Digitales avait prévu de le rencontrer à la fin de l’été dernier pour préparer en sa compagnie un grand entretien. Sa disparition récente est pour nous l’occasion de souligner la richesse des perspectives ouvertes par son activité particulièrement dense et multiple. Sa femme Danièle Cordier-Estivals nous a fait l’honneur d’accepter de publier son récent discours prononcé à l’Université de Bordeaux-Montaigne, où son mari fut professeur.
Avant de laisser la parole à son épouse qui retrace la carrière Robert Estivals selon le prisme de la bibliologie, soulignons brièvement quelques autres traits majeurs de sa démarche. Nous aurons aussi un portrait, sinon complet, du moins plus précis de la richesse du personnage. Notons préalablement que la fécondité de la démarche d’Estivals s’ancre dans un dialogue entre les arts et les sciences.
C’est depuis une démarche avant-gardiste lié au mouvement Lettriste d’Isidor Isou, puis ultra-lettriste et situationniste qu’Estivals arrive au Signisme et au Schématisme. Ce parcours multiple s’exprimera dans la revue Grâmmes, qu’il dirige, qui témoigne d’une exigence double alliant création et rigueur scientifique.
Le schématisme donnera lieu par la suite de sa carrière à un développement théorique important dans trois ouvrages, entre 2002 et 2003, qui consacrent sa démarche et lui apporte une cohérence d’ensemble. Sa « Théorie générale de la Schématisation » propose rien de moins qu’une épistémologie des sciences cognitives, un renouveau dans l’appréhension sémiotique du langage lu, parlé, écrit et graphique, et enfin une théorie de la communication fondée sur la schématisation qui distribue les figures de l’arbre, du réseau et du labyrinthe.
162C’est d’une manière constante qu’Estivals se distingue en ne dissociant jamais cette fois l’approche conceptuelle des méthodes quantitatives dans une démarche qui le mènera à des métriques toujours abordées dans une complexité qui ne réduit jamais la bibliométrie à l’indice de citation.
Pour la revue Études Digitales, Estivals anticipe du courant actuel des sciences de l’information et de la communication qui se tourne vers les humanités digitales. N’organise-t-il pas en 1988 à bordeaux un colloque intitulé : « Schémas, Neuroscience, Informatique et Communication » dont les actes seront publiés (Revue de Bibliologie no 30).
Finalement, l’intérêt exceptionnel de Robert Estivals est d’amorcer par la bibliologie qui réexamine le document dans la perspective d’une science de l’écrit qui sera ensuite replacé dans le cadre de la communication. Après son ouvrage, La bibliologie, c’est avec la coordination de l’ouvrage Les sciences de l’écrit en 1993 que se déploie l’horizon d’une approche globale prenant la forme d’une classification des sciences de l’information et de la communication, où se réaffirme le rôle structurant de l’information et de ses supports dans les processus cognitifs. En créant le néologisme bibliomatique, Estivals envisage les « écrits informatisés » (Revue de bibliologie, no 76, 2002) qui aujourd’hui forment l’enjeu des recherches menées par la revue Études Digitales. C’est en se situant entre la lettre et le chiffre indique un chemin à suivre pour comprendre la relation entre les littératies et les numératies.
Discours de Madame Danièle Cordier-Estivals
Discours prononcé à Bordeaux le 7 décembre 2016, lors du séminaire Humanités Digitales organisé dans le cadre de l’école doctorale de l’université Bordeaux-Montaigne par l’équipe E3D du Laboratoire MICA.
Chers amis bibliologues,
C’est pour moi un grand honneur de faire revivre la mémoire de mon époux Robert Estivals qui nous a quittés précipitamment le 10 août 1632016. Je tenterai alors de vous retracer son parcours dans l’univers de la bibliologie dans ces quelques mots.
Durant toute sa vie, Robert aura eu pour but de faire briller cette noble discipline que représente la bibliologie, en ayant pour principe de ne pas céder aux préjugés mais en respectant des démarches scientifiques.
Phase 1 : 1945-1948 : l’initiation
En 1945, à la fin de la deuxième guerre mondiale, à 18 ans, Robert rencontra Victor Zoltowski (Polonais, 1900-1969) au quartier latin qui le forma aux techniques d’élaboration des statistiques bibliographiques nécessaires à ses propres travaux. Cette démarche trouva un écho dans sa réflexion et le décida à poursuivre le même type de recherches en les consacrant au cycle des langues régionales en France.
Phase 2 : 1948-1959 : la critique des sources et le dépôt légal
Élaborant à son tour la statistique des livres en langues régionales, il fut confronté à un premier problème : celui de la critique des sources, c’est-à-dire de l’histoire du dépôt légal qui n’avait jamais préoccupé Victor Zoltowski. Le problème était simple : quelle était la valeur réelle des statistiques qu’il venait d’élaborer ? Cette problématique eut pour conséquence de l’éloigner de Victor Zoltowski, de l’amener à suivre les cours du Professeur Ernest Labrousse (1893-1988), Professeur des Universités, inventeur de l’Histoire sérielle et quantitative, à l’école pratique des hautes études, de soutenir son mémoire en 1959 et à le publier la même année. Ceci marqua alors le début de son parcours dans la recherche des diplômes universitaires dans le respect absolu de la méthodologie scientifique.
Phase 3 : 1959-1963 : le mémoire et le doctorat d’histoire
L’histoire du dépôt légal l’amena ensuite à étudier la production des livres en France sous la censure depuis le début du xviie siècle : ce qui lui permit d’aborder les cycles de la production française des livres du xviie au xixe siècles. Il en résulta la publication d’un mémoire titré « Le dépôt légal sous l’Ancien Régime de 1537 à 1791 » sous la direction de M. Ernest Labrousse ; puis, toujours sous la direction de M. Labrousse, la thèse de doctorat d’État d’Histoire intitulé « La 164statistique bibliographique de la France sous la monarchie au xviiie » aux éditions Mouton et Compagnie.
Phase 4 : 1963-1971 : le CNRS et la préparation
de la thèse de doctorat ès Lettres
Début 1963, Robert entra au CNRS pour préparer sa thèse de doctorat ès Lettres (avec l’obtention de la mention Très honorable) qui fut soutenue en 1971 toujours à la Sorbonne (La bibliométrie bibliographique). Ce nouveau travail l’avait conduit de la théorie des cycles à la méthodologie générale de la bibliologie. Quelque temps après, ses travaux attirèrent l’attention du Professeur Robert Escarpit à l’Université de Bordeaux III qui venait d’être chargé par le Ministre de créer, dans cette université, une section consacrée aux sciences de la communication. Robert fut nommé, fin 1968, Maître-assistant à l’Université de Bordeaux III.
Phase 5 : 1971-1981 : la composition de la bibliologie
Son travail, durant cette période, évolua systématiquement de la méthodologie dont il avait alors acquis la compétence à la discipline. Plusieurs publications intervinrent :
–Schéma pour la bibliologie ;
–La bibliologie, science du livre ;
Et, grâce à un travail international mené pour le compte du CNRS, la publication plus tardive de l’ouvrage intitulé Le livre dans le monde, qui, pour la première fois à notre connaissance utilisait, comme théorie explicative, la systémique, la théorie des systèmes, créée autrefois par Ludwig von Bertalanffy (1983).
Phase 6 : 1981-1988 : l’ouverture sur la politique
scientifique nationale et internationale :
La nomination au CNU en 1981 devait ouvrir une nouvelle période de nature principalement politique et scientifique. Après le CNU, le directeur du livre Jean Gattegno le nomma président du colloque sur le livre qui eut lieu au Centre Georges Pompidou en 1984. Entre-temps, les éditions des PUF (Presses Universitaires de France) lui avaient proposé 165de publier en 1987 un premier travail de synthèse sur la bibliologie dans la précieuse collection « Que sais-je ? ».
Phase 7 : 1988-1993 : la bibliologie scientifique internationale :
À cette époque, toute la théorie de la bibliologie scientifique avait été, phase après phase, créée spécialement en France et en Belgique. Mais son objectif, maintenant, devait être de développer cette discipline sur le plan international, et, par conséquent, de passer de l’appui politique français à l’appui international que représentait l’UNESCO en la personne de Marcia Lord, directrice du bureau de l’UNESCO à Paris. Le soutien administratif et financier de cette institution internationale fut acquis au lendemain du colloque de Tunis grâce à des appuis politiques français. Le principal objectif de mon époux ne fut pas seulement de réunir des colloques nationaux dans différents pays mais surtout de regrouper des chercheurs connus et originaux pour réaliser la publication, après 8 ans de travail collectif, en 1993, de la première encyclopédie internationale de la bibliologie qui réunissait 84 auteurs de 18 pays. Les travaux qu’il avait menés depuis 1970, dans divers pays de régimes politiques différents, lui permirent de réunir une bibliographie de la bibliologie produite en langues étrangères réalisées le plus souvent par un seul auteur. C’est ainsi qu’il existe des bibliologies en langues espagnole, portugaise, italienne, allemande, belge et de différents pays slaves, russes… Mais ce qui fut publié en 1993 sous le titre Les sciences de l’écrit permit de recueillir, sur des sujets identiques ou différents, les positions scientifiques des auteurs étrangers les plus connus. Cette même année 1993 il fut d’abord nommé dans le cadre français comme professeur à la classe exceptionnelle ; puis, avec son départ à la retraite comme professeur émérite, la conclusion de sa carrière universitaire. Il fut aussi nommé Professeur Honoris Causa de l’Université de Sofia en Bulgarie. Ceci ne l’empêcha pas de poursuivre l’action internationale commencée bien plus tôt.
Phase 8 : 1994-2014 : les derniers travaux de Robert Estivals
Dès après la publication des Sciences de l’écrit, première encyclopédie internationale de bibliologie et les sciences de l’écrit, le cheminement du développement de l’AIB se produisit d’une manière régulière en deux parties :
166–la continuation du développement des comités nationaux et des colloques. Notons, à cette occasion, la réalisation d’un colloque scientifique organisé par le Professeur Fernand Texier, recteur de l’université Senghor, à Alexandrie en Égypte, qui eut lieu à la nouvelle bibliothèque d’Alexandrie qui faisait le lien avec l’ancienne datant de l’Antiquité.
–puis, sur deux ans en 2008 et 2009, la synthèse générale qui avait été, dès le début, son objectif final et ceci sous la forme de deux ouvrages :
le premier en 2008 : La bibliologie appliquée
le second en 2009 : La bibliologie scientifique, synthèse systématique des apports de l’AIB. Cette synthèse sur deux ans présente un avantage considérable au plan de l’histoire de la bibliologie.
Je vous remercie encore pour cet hommage que vous rendez à mon époux qui souhaitait plus que tout trouver un successeur pour faire perdurer ses travaux dans le temps et assurer ainsi une continuité à la bibliologie.
Bibliographie
Œuvres importantes de Robert Estivals
Les trois tomes de la « Théorie générale de la schématisation » publiés entre 2002 et 2003 aux éditions L’Harmattan.
On pourra aussi consulter avec intérêt la fiche Wikipédia qui bien qu’incomplète présente une liste des autres ouvrages.