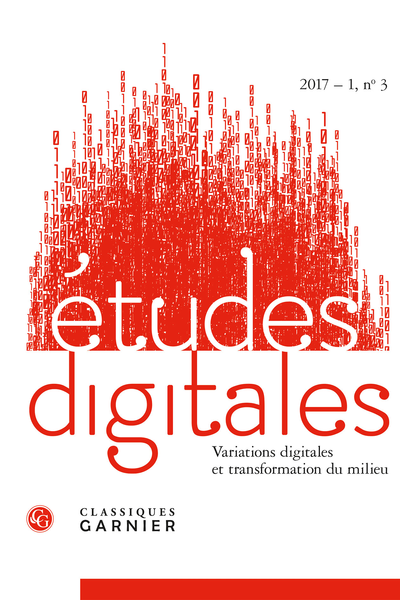
Penser avec les mains, voir avec les doigts Petit plaidoyer pour une esthétique de nos vies digitales
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Études digitales
2017 – 1, n° 3. Variations digitales et transformation du milieu - Auteur : Chardel (Pierre-Antoine)
- Pages : 235 à 238
- Revue : Études digitales
- Thème CLIL : 3157 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Sciences de l'information et de la communication
- EAN : 9782406085317
- ISBN : 978-2-406-08531-7
- ISSN : 2497-1650
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-08531-7.p.0235
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 05/11/2018
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Penser avec les mains,
voir avec les doigts
Petit plaidoyer pour une esthétique
de nos vies digitales
La main renvoie à un art de faire et de manier, à une capacité d’exercer une technique, en permettant d’intervenir sur la matière, au gré de l’imagination. La matière est ainsi coupée, modelée ou taillée. On a bien sûr ici à l’esprit l’idée que la technique peut se concevoir comme une prolongation de la main. La main est aussi ce qui permet à l’acte de penser de s’épanouir, voire de s’affirmer dans la singularité d’un geste. On penserait avant tout en écrivant à la main, comme l’a affirmé Martin Heidegger dans Qu’appelle-t-on penser1 ? Nous pensons parce que nous manions des idées, ce qui est autre chose que l’action de les manipuler à des fins purement instrumentales. Mais alors que dire de notre condition présente ? Les machines à écrire et, désormais, nos machines multifonctionnelles que sont nos smartphones, nos ordinateurs et nos tablettes marqueraient-elles un amoindrissement de nos expériences sensibles en faisant advenir, de manière unidimensionnelle, le règne du nombre et du calcul ?
Si un système informatique est constitué de séries de codes et de nombres, l’interrogation qu’il motive concernant d’éventuelles pratiques de réception peut conjointement nous inciter (comme pour instaurer une résistance saine et raisonnée) à affirmer un tout autre champ lexical : celui qui ferait signe vers une esthétique de la réception. Il nous inciterait ainsi à penser en faveur d’une appropriation inventive des objets techniques. Comme l’a exprimé Mikel Dufrenne en réfléchissant aux conditions d’une éthique qui soit à même de faire face aux logiques de nivellement qui surgissent des sociétés industrielles : « l’uniformisation 236des moyens n’implique nullement l’uniformisation des fins2 ». Il convient pour cela de veiller à la sauvegarde de finalités que nous voulons faire valoir dans notre rapport aux médiations technologiques. Les moyens ne peuvent en aucune façon appauvrir les ambitions qui doivent les définir en termes de production de sens ou de valeurs. Aucune partition ne peut être jouée d’avance dans la relation que nous entretenons avec les machines. Nous devons donc sans cesse pouvoir reprendre la main sur les systèmes qui les définissent. Le doigté avec lequel cette reprise en main doit se produire est sans nul doute une recherche aussi délicate que nécessaire.
Dans nos environnements technologiques de plus en plus complexes, nous vivons avec le sentiment que nous devrions nous laisser emporter par le plaisir d’exercer un art de produire du sens avec nos mains, en renouant de la sorte avec les pratiques du tâtonnement, du bricolage, du travail sur les formes, dans une expérience qui puisse en fin de compte s’avérer phénoménologiquement plus digitale que numérique (en nous permettant alors de renouer avec la racine latine du mot digital : digitus ; le « doigt »). L’affirmation d’une telle dimension empirique se confond avec un engagement qui s’assume comme à la fois herméneutique et critique. C’est bien cette double articulation qu’il semble primordial d’assumer aujourd’hui, à l’ère dite « hypermoderne », en nous faisant renouer avec une culture de la matière.
Car une réalité matérielle et corporelle s’exprime en effet dans nos vies digitales. En écrivant par le biais de nos claviers (d’ordinateurs ou de tablettes), nous travaillons avec nos doigts autant qu’avec notre esprit. Nos stimulations intellectuelles se traduisent par les rythmes inconstants de nos mouvements de doigts. Nous sommes, en cela, des travailleurs manuels. Nous pianotons sans cesse, au risque de ressentir une fatigue physique parfois très intense dans le creux de nos mains, à la fin d’une journée ou en début de nuit, après que nous ayons passé des heures à écrire. L’interaction avec nos médiations technologiques par lesquelles nous écrivons est une expérience digitale, au sens propre du terme : car nos doigts sont bien toujours au travail, à l’œuvre pourrait-on dire.
237Qui plus est, les évolutions que nous connaissons aujourd’hui avec nos écrans tactiles ne sont pas déliées d’une expérience corporelle immédiate. Nous lisons et nous nous informons par le toucher, un peu comme si des parts du monde pouvaient nous arriver à tout moment depuis le bout de nos doigts. Nous voyons finalement le monde par l’action de nos doigts.
Il s’agit alors de trouver un mode de voir qui soit humainement supportable, afin d’éviter les effets d’une surcharge informationnelle. Une sorte d’harmonie (intérieure) est en jeu, et qui est toujours l’objet d’une quête fragile. Cela un peu comme en musique où, comme l’a écrit Richard Sennett, l’oreille travaille de pair avec le bout des doigts pour explorer : « le musicien touche la corde de diverses manières, entend toutes sortes d’effets, puis cherche le moyen de répéter et de reproduire le son qu’il désire3 ».
Dans l’écriture, où il n’est pas question de sons mais de signes, celui qui écrit est en prise constante avec les touches de son clavier, au point même parfois d’engendrer une sonorité qui devient peu à peu rassurante, à défaut d’être musicale : elle vient combler le silence du blanc de la page.
C’est une telle tension qui devient l’objet d’une attention particulière à l’égard d’une sonorité qui nous rappelle que notre interaction avec les machines est toujours matérielle et physique, qu’elle est donc tout sauf abstraite et numérale. Elle nous renvoie au fond à notre condition d’être prothétique qui est finalement toujours une invitation à explorer de nouveaux modes d’être au monde, de nouvelles manières de créer des formes. C’est à tout le moins ce que nous ne cesserons sans doute jamais d’hériter des expériences du bricolage et de l’artisanat, en nous incitant ainsi à prendre le dessus sur des impositions d’utilisations qui émaneraient de concepteurs informaticiens anonymes.
D’une certaine manière, plus les systèmes techniques se disséminent dans notre quotidienneté, avec leurs lots d’injonctions et de prescriptions implicites, plus nous devons en appeler à une esthétique de l’existence, au travers de laquelle il nous revient d’affirmer notre préférence pour le savoir-faire. L’expérience digitale devient alors une métaphore de notre condition d’être manuel (et interprétant). Ce travail de la métaphore nous convie à un changement de regard, voire de paradigme. Car si le 238numérique définit objectivement nos machines, ces dernières ne peuvent subjectivement se réduire à cette dimension qui tend à figer le regard que nous portons sur elles. En somme, tant qu’il y aura des subjectivités qui sauront assumer leur corporéité (leur condition d’être manuel), il y aura des interactions créatrices entre des hommes et des machines.
Pierre-Antoine Chardel
Institut Mines
– Telecom Business School
IIAC - UMR8177 CNRS/EHESS
1 Martin Heidegger, Qu’appelle-t-on penser ?, Traduit de l’allemand par Aloys Becker et Gérard Granel, Quadridge / PUF, 1992.
2 Mikel Dufrenne, « L’éco-éthique comme éthique de l’oikos », in Pierre-Antoine Chardel, Bernard Reber et Peter Kemp (dir.), L’éco-éthique de Tomonobu Imamichi, Paris, Éditions du Sandre, 2009, p. 42.
3 Richard Sennett, Ce que sait la main. La culture de l’artisanat, Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Albin Michel, p. 215.