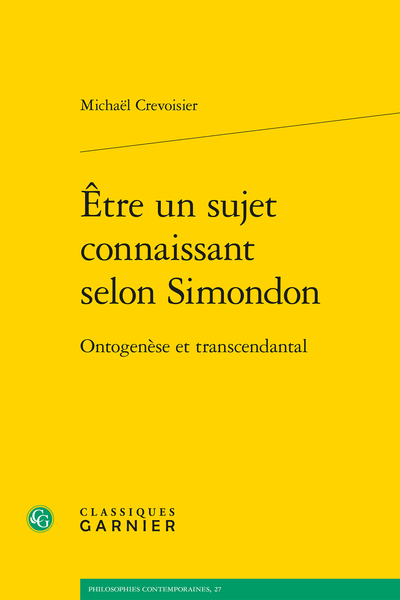
Avant-propos
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Être un sujet connaissant selon Simondon. Ontogenèse et transcendantal
- Pages : 9 à 13
- Collection : Philosophies contemporaines, n° 27
- Thème CLIL : 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN : 9782406151371
- ISBN : 978-2-406-15137-1
- ISSN : 2427-8092
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15137-1.p.0009
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 20/09/2023
- Langue : Français
Avant-propos
Si la lecture de Kant demeure nécessaire c’est en un sens très précis : nous devons savoir d’où nous partons1.
Alexis Philonenko
La question à l’origine de cet ouvrage a été élaborée lors d’un travail de thèse de doctorat, soutenue à l’Université de Franche-Comté en novembre 2021 et intitulée Modifications du transcendantal : sociologie, phénoménologie et ontogenèse. Le texte qui suit est une version remaniée d’une partie de cette thèse, et s’il propose une lecture de l’œuvre de Gilbert Simondon à travers le prisme de sa théorie de la connaissance, il est aussi traversé par la question générale de cette thèse qui concerne l’avenir du concept kantien de transcendantal. Dans cette perspective, d’autres ouvrages sont à venir, notamment Penser avec les autres selon Durkheim : vie sociale et transcendantal et Exister autrement qu’une chose selon Sartre : réalité concrète et transcendantal. La remarque préliminaire qui suit a vocation à éclairer le lecteur sur le sens de ce questionnement, et plus spécifiquement vise à préciser le cadre conceptuel que nous mobilisons lorsque nous cherchons à faire dialoguer Simondon avec Kant.
De manière générale, nous associons le terme « transcendantal » au nom de Kant car, avec lui, « transcendantal » résonne comme la marque d’une époque de la philosophie, comme si ce terme véhiculait un sens possible de la philosophie elle-même, le sens que la révolution opérée par Kant lui aurait donné2. C’est dans cette optique que nous souhaitons poser la 10question suivante : cette époque est-elle encore la nôtre ? Le « transcendantal » kantien recèle-t-il encore un sens possible pour la philosophie d’aujourd’hui ? En raison de leur ampleur ces questions indiquent moins un objet qu’un horizon pour le travail philosophique, mais permettent de donner une tonalité à la lecture et un début d’orientation.
Plus précisément, si le concept kantien de transcendantal peut servir de boussole, c’est à la condition de le caractériser au sein de l’entreprise critique. Afin d’expliciter notre intention nous indiquons les grandes lignes de cette entreprise que nous retenons et qui nous paraissent utiles de rappeler pour comprendre le sens de ce concept. Kant établit une nouvelle manière de formuler le problème de la théorie de la connaissance, le concept de transcendantal permet de fixer un cadre à ce problème en déterminant d’une part les limites dans lesquelles il peut être traité, et d’autre part la méthode pour le résoudre. La « critique transcendantale » est le nom que Kant donne aux recherches devant permettre l’établissement de ce cadre et de cette méthode, en tant que ceux-ci doivent garantir à leur tour la possibilité de fonder la connaissance en général et la connaissance a priori en particulier3. Sachant que la connaissance a priori, Kant la définit en opposition à la connaissance issue de l’expérience, a posteriori. Sa méthode consiste à régresser de l’expérience vers ses conditions en suivant un principe : « il faut qu’on reconnaisse ces concepts comme conditions a priori de la possibilité de l’expérience4 ». Cette expression « conditions a priori de la possibilité de l’expérience » désigne donc ce dont la critique doit produire l’analyse et ce qui fonde la possibilité de la connaissance en tant qu’il s’agit là d’une seconde source de la connaissance, complémentaire de l’expérience. En effet, si l’expérience est ce qui fournit la matière des représentations, les 11conditions a priori en fournissent la forme. Ainsi, la révolution opérée par Kant consiste à déplacer le point de départ de la connaissance qui n’est plus quelque chose qui serait donnée, mais ce qui relève de notre pouvoir de donner forme à nos représentations. Bien entendu, il resterait possible d’affirmer que le pouvoir de connaître est donné, mais l’enjeu n’est plus celui de déduire la connaissance de ce donné (ce que Kant ressortit à ce qu’il appelle un usage dogmatique de la raison), l’enjeu devient celui, d’ordre critique donc, de « connaître entièrement son propre pouvoir vis-à-vis des objets qui peuvent lui être présentés dans l’expérience5 ». Ainsi, puisque le problème premier est celui de la fondation du pouvoir de connaître, il faut partir de cette question : comment la connaissance est-elle possible ? Et plus précisément : qu’est-ce qui en droit justifie que la connaissance soit a priori possible ?
La réponse de Kant consiste à analyser les conditions a priori de possibilité de la connaissance, en attribuant un statut juridique à l’a priori, au sens où les conditions a priori désignent, pour ainsi dire, la forme que doit avoir l’esprit pour que des connaissances soient possibles. En ce sens strictement gnoséologique, il n’y a de conditions a priori qu’en raison de la nécessité de fonder la connaissance, c’est-à-dire d’identifier des conditions de validité des jugements. Ces conditions sont le droit du fait de la connaissance scientifique. Ajoutons que la nécessité et l’universalité qui sont la marque de l’a priori, impliquent que la connaissance a priori soit purement indépendante de l’expérience, lieu du contingent, bien que la production de cette connaissance suppose une méthode d’analyse cadrée par l’expérience possible, méthode que Kant nomme Logique transcendantale. La démarche critique de Kant consiste donc à aller droit aux conditions a priori, au sens où la régression de l’expérience aux éléments a priori suit le fil direct de la réflexion remontant aux sources de nos représentations. Et c’est dans ce cadre méthodologique qu’il mobilise l’adjectif « transcendantal », pour qualifier d’une part les moyens pour analyser les conditions a priori et d’autre par les éléments constituant la structure de ces conditions.
Notre questionnement porte sur la modification du concept kantien de transcendantal, notamment en ce qu’elle trouve sa nécessité dans deux difficultés propres à la manière dont Kant procède pour mener son analyser des conditions a priori. La première difficulté concerne le 12statut qu’il donne à l’a priori : ni inné, ni acquis, il n’a de sens que juridiquement. Or, l’opposition stricte entre l’a priori et l’a posteriori que cela suppose est difficile à tenir car cela implique de refuser que le progrès notamment des sciences, des arts et des techniques ait une quelconque conséquence sur l’analyse à mener. Et en un sens il suffirait d’en douter, de ne plus croire nécessaire de tenir une telle opposition, pour qu’en quelque sorte l’empirique réduise le transcendantal à néant. Comment penser la possibilité d’une variation des conditions a priori sans abandonner le transcendantal6 ? Quelle autre articulation entre l’a priori et l’a posteriori est envisageable ? La seconde difficulté réside dans l’idée que doit poser Kant au départ de son entreprise et que cristallise son concept d’expérience : tout ce dont il y a expérience est nécessairement réductible à une synthèse subjective et donc aux éléments transcendantaux. Autrement dit, ce dont il est possible de faire l’expérience ressortit nécessairement à la forme de la subjectivité telle qu’elle se trouve transcendantalement constituée et idéalement unifiée. Cet idéalisme transcendantal est ce qui garantit à la méthode critique à la fois sa réussite et son achèvement. Il suppose que les expériences possibles sont a priori et donc déjà totalement déterminées. Or, que penser de l’avènement d’expériences inédites ? Comment prendre en compte la nouveauté de l’expérience, impliquant une ouverture du possible au-delà de sa détermination a priori ?
Ainsi, notre intérêt se porte sur les œuvres qui explorent les voies ouvertes par ces questions. Des auteurs qui, en marge de l’héritage kantien, continuent de formuler le problème de la théorie de la connaissance dans ces termes, en cherchant à identifier des conditions a priori de possibilité de l’expérience, afin de penser le fondement de l’universalité en droit de la connaissance, mais en proposant d’autres méthodes pour les analyser, d’autres perspectives de réflexion prenant en considération des types 13d’expériences ignorées ou déniées par Kant et d’autres manières de penser la différence entre l’a priori et l’a posteriori. Notre méthode consiste en une lecture internaliste des systèmes, et en ce sens nous ne cherchons pas à les expliquer par leur contexte historique ou socio-culturel, néanmoins nous ne négligeons pas que notre question concerne bien une histoire, celle de la modification du concept kantien de transcendantal. Par conséquent, notre lecture internaliste n’a pas une vocation exégétique, elle consiste à interroger une œuvre à partir d’une question qui dans cette perspective historique lui est extérieure, bien que nous pensons qu’elle s’y trouve structurante. En ce sens, nous pratiquons une histoire philosophante de la philosophie dont l’implication principale réside dans le souci de remarquer deux éléments. Premièrement, l’héritage du problème de la théorie de la connaissance et des concepts permettant de le formuler, en mettant en lumière les dialogues à partir desquels les systèmes prennent forme et, notamment, donc, les dialogues avec Kant. Et deuxièmement, la manière dont, à travers ou au sortir de ces dialogues, d’autres conceptions des conditions a priori apparaissent et avec elles d’autres déterminations de la différence entre l’empirique et le transcendantal.
Ainsi, ce qui nous intéresse dans l’œuvre de Simondon ce sont ce que nous pourrions appeler les conditions ontogénétiques a priori de l’expérience correspondant à la manière dont sa méthode l’amène à penser le transcendantal dans le mouvement empirique de l’individuation duquel naît, à un moment, le sujet connaissant. En mobilisant l’ensemble de l’œuvre publiée, nous proposons une lecture qui, en suivant l’élaboration et l’application de sa méthode analogique, met en évidence comment celle-ci lui permet de sortir des oppositions qui structurent les concepts fondamentaux de la philosophie, sans pour autant que leurs termes soient totalement abandonnés, et notamment la différence entre le transcendantal et l’empirique. Par là, nous suivrons le mouvement de réforme de la conceptualité philosophique qui caractérise la pensée philosophique de Simondon jusqu’au point où il deviendra possible de se demander dans quelle mesure la voie qu’ouvre la théorie de l’ontogenèse débouche sur une nouvelle manière de formuler le problème de la théorie de la connaissance telle qu’avec ce nouveau problème, c’est une nouvelle époque qui s’annonce, notamment une époque où l’existence des objets techniques et leur évolution s’avère participer au mouvement d’individuation des concepts et à la transformation du transcendantal.
1 Philonenko, Alexis, L’œuvre de Kant. La philosophie critique, t. 1, La philosophie précritique et la Critique de la raison pure, Paris, Vrin, 1969, p. 336.
2 C’est en cela que Michaël Fœssel par exemple, a proposé de dire qu’avec la philosophie kantienne se joue un « tournant transcendantal » dans l’histoire de la philosophie (Fœssel, Michaël, « Les Temps modernes et le tournant transcendantal. Blumenberg, Kant et la question du monde », Revue de métaphysique et de morale, vol. 73, no 1, 2012, p. 95-109). Notons également que N. Hinske affirme que « son histoire [du concept de transcendantal] révèle toujours quelque chose du destin changeant de la philosophie elle-même […]. » (Hinske,Norbert, « transcendantal », Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel, Schwabe Verlag, éd. DVDROM, 2007 – nous traduisons)
3 « Cette recherche, que nous pouvons proprement nommer, non pas doctrine, mais seulement critique transcendantale, parce qu’elle […] doit fournir la pierre de touche de la valeur ou de l’absence de valeur de toutes les connaissances a priori, est ce dont nous nous préoccupons désormais. » (CRPure, p. 111 [Ak. iii, 43-44])
4 « La déduction transcendantale de tous les concepts a priori possède donc un principe sur lequel il faut que toute la recherche se règle : ils doivent être reconnus comme conditions a priori de la possibilité de l’expérience […]. » (CRPure, p. 175 [Ak. iii, 105])
5 CRPure, p. 109 [Ak. iii, 42].
6 Nous devons le point de départ de ce questionnement à Catherine Malabou, dont les travaux nous ont permis de clarifier nos intentions, notamment cette conférence : Malabou, Catherine, « Peut-on abandonner le transcendantal ? », Les trente ans du Collège International de Philosophie, Paris, Palais de Tokyo, le 10 juin 2013. Plus spécifiquement, concernant la mise en question chez Kant de la modification de l’a priori, nous renvoyons le lecteur à l’article déterminant de Bouveresse, Jacques, « Le problème de l’a priori et la conception évolutionniste des lois de la pensée », Revue de théologie et de philosophie, no 123, 1991, p. 353-368 ; et à l’interprétation de l’expression « système d’une épigénèse de la raison pure » que propose le livre de Malabou, Catherine, Avant demain. Épigenèse et rationalité, Paris, PUF, 2014.