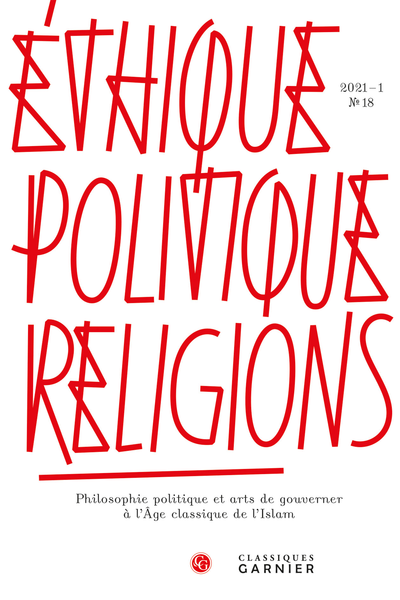
Introduction Les savoirs de gouvernement à l’Âge classique de l’Islam
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Éthique, politique, religions
2021 – 1, n° 18. Philosophie politique et arts de gouverner à l’Âge classique de l’Islam - Auteur : Abbès (Makram)
- Résumé : Ce dossier aborde les idées politiques développées par différents auteurs, et qui ont pris leur source dans le commentaire des textes hérités des Grecs, ou dans des savoirs de gouvernement élaborés au début de l’Islam. Il cherche à souligner la richesse de ces traditions intellectuelles, purement philosophiques, juridico-théologiques ou historico-littéraires, et propose d’en faire connaître les contenus aux lecteurs, en posant à nouveaux frais les thèmes et enjeux politiques qu’elles recèlent.
- Pages : 9 à 19
- Revue : Éthique, politique, religions
- Thème CLIL : 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN : 9782406115762
- ISBN : 978-2-406-11576-2
- ISSN : 2271-7234
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11576-2.p.0009
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 19/05/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Miroirs des princes, arts de gouverner, excellences humaines, Loi, pouvoir pastoral, souveraineté
Introduction
Les savoirs de gouvernement
à l’Âge classique de l’Islam
Consacré à la pensée politique de l’Islam classique (viie-xve siècles) et mobilisant de nombreux textes et auteurs pour en sonder les contenus et en maîtriser les enjeux, ce dossier a pour ambition de présenter les recherches les plus récentes dans ce domaine, et de les mettre à la disposition du public désireux de mieux connaître cette littérature. Il tente aussi, parallèlement, d’arracher les lecteurs contemporains à certains poncifs, favorisés et entretenus par le contexte actuel à propos de l’existence d’une essence politique de l’islam1, totalement engluée dans le religieux et incapable de s’en défaire. La consultation de l’histoire de l’Islam et la lecture des textes produits pendant plusieurs siècles témoignent, en effet, de la présence de réalités très différentes de ce qui est soutenu aujourd’hui dans certains discours, y compris académiques parfois. D’où l’intérêt de sortir de l’illusion de fermeture identitaire à laquelle est soumise actuellement l’approche de la pensée politique en Islam, en raison de l’omniprésence d’un discours qui rejette le renouvellement de cette pensée au nom de l’existence d’un modèle disponible, fondé au viie siècle avec l’avènement de la nouvelle religion. Un discours qui refuse, ensuite, de voir que les savoirs qui ont pu se mettre en place à partir de cette date se sont détachés petit à petit de la gangue religieuse qui les enveloppait du fait de l’expérience de la révélation prophétique, et qui cherche, enfin, à dénier le caractère profane et séculier inhérent au développement de nombreuses disciplines, y compris celles qui sont très liées aux textes sacrés tel que le droit.
En réalité, ce modèle politique de l’islam – à supposer qu’il existe un modèle propre à cette civilisation, et qui en reflèterait l’identité – est 10d’abord pluriel, comme en témoigne ce dossier qui présente de nombreux savoirs de gouvernements provenant de disciplines et de traditions textuelles assez distinctes les unes des autres : histoire, philosophie, belles-lettres et droit. Par ailleurs, l’expérience politique des premiers musulmans, y compris le Califat des bien guidés2 qui fut érigé dans l’imaginaire collectif comme l’incarnation d’une certaine norme de gouvernement, n’était qu’un gouvernement mondain qui s’était certes inspiré des préceptes de la morale religieuse et des valeurs de justice et d’égalité prônées par Loi mais il ne relevait en aucun cas, à cette période, de la promotion d’un système politique particulier, ni d’un gouvernement religieux ou théocratique. C’est pour cette raison que ce qui est mis en avant aujourd’hui dans le cadre de l’islam politique est, au mieux, une construction idéologisée et fétichisée de certains éléments de cet héritage, triés parmi tant d’autres et mobilisés avec beaucoup de transformations non élucidées ou non assumées, afin de servir des enjeux éminemment modernes tout en postulant, à tort, que le modèle proposé actuellement est celui qui fut institué dès le début de l’islam par le Prophète et ses compagnons.
L’examen rapide de l’attitude des premiers musulmans à l’égard de la culture politique des Anciens montre qu’ils étaient très ouverts à leurs savoirs, et qu’ils ne les rejetaient pas au nom de la religion ni de l’existence d’un modèle exclusivement « islamique » qui aurait été présent et disponible dans les textes sacrés. Outre les savoirs pratiques de gouvernement d’origine grecque ou perse utilisés par les premiers califes (comme le deuxième calife ‘Umar ibn al- Ḫaṭṭāb qui s’inspire des Perses pour fonder les offices de son administration ou dīwān) ou de ceux qui furent transmis directement grâce à l’arabisation de l’administration sous le califat omeyyade de ‘Abd al-Malik ibn Marwān (m. 705), la période allant de la fin du viie jusqu’au début du viiie siècle voit l’émergence d’un grand intérêt pour la traduction de textes portant sur la conduite des affaires politiques. Pratiquement un siècle avant le début du grand mouvement de traduction des textes scientifiques et philosophiques grecs en langue arabe, on a traduit vers le viiie siècle une littérature politique d’origine grecque, indienne et perse qui sera intégrée dans le fond islamique et même 11antéislamique afin de constituer progressivement la base des futurs traités de gouvernement3.
Trois textes majeurs, qui sont à l’origine de cette tradition pluriséculaire, ont été traduits au début du viiie siècle. Tout d’abord les Lettres d’Aristote à Alexandre, du Pseudo-Aristote, qui vont nourrir la tradition des Miroirs des princes, d’abord par leurs maximes et réflexions sur la guerre et la paix, ensuite par l’élucidation du lien entre le savoir (incarné par la figure d’Aristote) et le pouvoir (représenté par Alexandre le Grand), enfin à propos de l’éthique du prince et de la construction d’un modèle parfait de la souveraineté.
Le deuxième texte qui a fortement contribué à la constitution des traités de gouvernement est Kalila et Dimna, fables d’origine indienne attribuées au philosophe Bidpaï (iiie siècle). Cet ouvrage expose une certaine vision de ce que doivent être, idéalement, les relations entre savoir et pouvoir. Comme dans le texte précédent, le savoir est incarné par le philosophe qui doit éduquer le prince et lui expliquer les devoirs d’un bon chef d’État. On doit aussi à ce texte une forte réflexion sur les passions humaines qui déterminent l’anthropologie politique, et une abondante conceptualisation du thème de gouvernement de soi en tant que fondement du gouvernement des autres. Ces fables ont beaucoup circulé dans la tradition arabe et elles ont été traduites en latin ainsi que dans d’autres langues pendant le Moyen Âge.
Le troisième texte est le Testament d’Ardašīr, roi perse du iiie siècle dont l’action fut déterminante sur le plan politique puisqu’il a unifié la Perse en fondant l’Empire Sassanide. Après les conquêtes d’Alexandre, l’empire perse était disloqué, et plusieurs royaumes ont coexisté pendant des siècles. Ardašīr met fin à ce contexte de fragmentation politique en unifiant le royaume sous une seule autorité, en neutralisant les dissensions et en centralisant le commandement contre les princes et seigneurs locaux (les rois des taifas ou mulūk al- ṭawā’if dans la tradition historique arabe). En plus des maximes portant sur la guerre, la division politique ou le rapport gouvernants/gouvernés, le point fort du texte concerne la question de la religion : Ardašīr a été le contemporain de l’ébullition de la pensée religieuse en Perse, qui conduira plus tard à la prédication 12de Mani, fondateur du manichéisme à partir du mazdéisme et d’autres emprunts à des religions comme le christianisme. Le Testament d’Ardašīr s’en fait l’écho, notamment dans les réflexions sur la place des doctrines religieuses dans l’empire, et à propos de la nécessité, pour un pouvoir souverain, de contenir l’influence des clercs et de ceux qui parlent au nom de la religion. L’enseignement majeur de ce texte est qu’il ne faut pas que le pouvoir politique cède la place à des acteurs religieux car, tôt ou tard, ils finiront par l’engloutir.
Ces textes qui sont appris aux jeunes princes, transformés en manuels pour certains d’entre eux, cités dans les différentes cours, et discutés dans les cénacles et les salons vont irriguer les réflexions des auteurs postérieurs, et conduire à la maturation de ce genre politique majeur, assimilé à juste titre au genre universel des conseils aux princes (Fürstenspiegel). En prenant le titre de « naṣīḥat al-mulūk » (conseils aux rois), d’adab al-mulūk (les règles de la conduite des rois) ou d’ādāb sulṭāniyya, les règles de la conduite du pouvoir politique), ces textes s’imposent comme l’équivalent des Miroirs des princes présents dans plusieurs cultures antiques et médiévales comme la Chine et l’Europe. Pour le cas de l’Islam, à partir du xe-xie siècles, les traités politiques sont mieux structurés que les textes cités plus haut, divisés en parties et sous-parties, cherchant à la fois la démonstration théorique des idées, et leurs illustrations sensibles à travers les anecdotes historiques et les maximes de sagesse. Vers la fin de l’Âge classique de l’Islam (xve siècle), on assiste à la naissance des grandes synthèses d’Ibn Khaldūn (1332-1406), d’al-Qalqašandī (1355-1418) ou d’Ibn al-Azraq (1427-1491) mais le genre continue jusqu’à l’époque contemporaine d’être le dépositaire de la science politique, comme en témoigne la dédicace d’un Miroir au sultan ottoman Abdulhamid II (1842-1918) au début du xxe siècle4.
L’intérêt de cette tradition des arts de gouverner réside, entre autres, dans la richesse de son contenu qui intègre la philosophie (réflexions théoriques sur la politique, et sur les règles de la conduite des princes et la direction de l’État), l’histoire (connaissance des biographies des grands souverains) et les belles-lettres (utilisation de nombreuses formes comme 13le testament, la maxime, et les poésies). Ce caractère pluridisciplinaire du genre fait qu’il est tantôt assimilé à la philosophie populaire (par opposition à une philosophie savante accessible seulement à une élite restreinte), tantôt à la littérature historique (parce qu’il s’appuie sur les exempla), et le plus souvent aux belles-lettres (en raison du soin accordé au style et à l’art d’écrire d’une manière générale). Il n’en reste pas moins que son inscription dans le genre de l’adab qui cherche d’abord à former l’homme et à le doter des outils intellectuels permettant d’avoir une vie réussie, explique la présence d’un invariant qui sous-tend le genre, à savoir les maximes de sagesse et les récits historiques portant sur les grands souverains. Aussi le rapport entre l’art de gouverner et l’histoire est-il problématisé d’une manière étonnamment moderne, comme on le voit chez Miskawayh qui, dans l’introduction de son livre l’Expérience des nations, affirme que la méditation des événements historiques fournit à l’homme politique les moyens de tirer des leçons profitables sur la naissance des États, les dysfonctionnements qui peuvent les affecter, la manière de réformer la mauvaise situation et de dépasser la crise, la voie pour atteindre la prospérité, unir le peuple, maîtriser les ruses de guerre et connaître la manière de conduire la conduite des responsables politiques comme les ministres, les généraux de l’armée ou les agents de l’État5.
Cette fonction assignée aux exempla repose sur une conception cyclique de l’histoire, dans laquelle les événements politiques du passé doivent ressembler à ceux du présent, vu que les passions qui animent les hommes sont toujours les mêmes. L’interférence entre les deux régimes temporels transforme le passé en paradigme que le prince, loin de chercher à le reproduire servilement, doit assimiler pour pouvoir s’en inspirer dans l’action qu’il engage vis-à-vis de sa population, de ses collaborateurs ou ses ennemis. La notion d’expérience (taǧriba) à laquelle renvoie la somme historique de Miskawayh s’étend de la sorte aux événements que le prince n’a pas vécus personnellement, mais dont il peut s’approprier l’esprit grâce à la méditation du contexte de leur émergence : « Tous les événements que l’homme garde en mémoire deviennent, affirme Miskawayh, des expériences qui lui appartiennent en propre, dans lesquelles il est propulsé et desquelles il tire une sagesse confirmée, 14comme s’il avait vécu tout ce temps passé, et qu’il avait eu affaire lui-même à ces événements6 ». Loin de conduire à idéaliser le passé ou à le transformer en un poids qui écrase de toute sa force le présent, le rapport que l’homme politique doit entretenir avec lui en fait un instrument permettant de prévoir l’avenir et de deviner les fins dernières bien avant l’accomplissement des choses. Cette conception unissant la politique et l’histoire est au cœur du concept même de tadbīr qui signifie gouvernement, direction et qui est le plus souvent interchangeable avec siyāsa (politique, conduite). Le tadbīr est le fait de prévoir, dans et par la pensée, la fin dernière des choses, ce qui en fait une notion gouvernée par une temporalité toujours rivée sur les conséquences ultimes d’une action non encore engagée.
Cette dimension ressort clairement du travail de Rémy Gareil qui montre comment la discipline historique, abordée à partir de l’œuvre d’al-Mas‘ūdī, a pu forger des modèles politiques érigés en outils de légitimation de l’exercice du métier du prince au xe siècle. Sans être auteur d’un Miroir des princes, un historien et polygraphe comme al-Mas‘ūdī témoigne ainsi de la constitution de normes politiques qui circulaient à son époque, ce qui illustre la manière dont se négociaient les rapports entre savoir et pouvoir. Les figures universelles du bon gouvernement deviennent de la sorte les instruments de la légitimation du pouvoir dans un contexte marqué par l’exacerbation des compétitions des seigneurs de la guerre pour s’emparer des territoires d’un califat affaibli par les tensions internes et les dynamiques d’autonomisation des pouvoirs des provinces par rapport à la capitale Bagdad. L’insistance sur l’histoire en tant que source de la connaissance de l’action politique montre que la tradition des arts de gouverner en Islam prend un chemin marqué par le réalisme et la positivité, et qu’elle suit aussi une voie fidèle d’abord à l’étude de l’homme tel qu’il est. C’est cet ancrage dans une anthropologie politique réaliste qui donne à ces textes un accent étonnamment moderne, et qui montre comment la discipline historique n’était pas seulement fréquentée comme un simple agrément et divertissement, mais aussi comme moyen d’imiter les grands hommes ou, pour reprendre l’expression machiavélienne, comme « maîtresse de nos actions7 ».
15Mais cette littérature des arts de gouverner (ādāb sulṭāniyya), centrée sur la conduite du prince (l’éthique) et le gouvernement de l’État (la politique), peut contenir parfois des ouvertures sur les aspects juridico-institutionnels (droit public et administratif) ou proprement scientifiques (définition de la philosophie pratique, comparaisons entre la politique et la médecine, étude des constitutions, et notamment du régime parfait). C’est ce qu’on observe dans quelques ouvrages comme celui d’al-Ṭūsī, l’Éthique nasirienne, dont la version arabe, faite à partir du persan, a été réalisée au xive siècle par al-Ǧurǧānī8. Ce texte qui suit la division de la science politique en gouvernement de soi, gouvernement domestique et gouvernement de la cité (c’est la subdivision de la science pratique qu’on trouve dans la plupart des courtes épîtres portant sur le sujet) conjugue les éléments rigoureusement philosophiques qui remontent à Platon, Aristote, Miskawayh et al-Fārābī (étude théorique des vertus, des raisons qui poussent à l’association civile, et des types de constitutions politiques), avec les analyses provenant des ādāb sulṭāniyya tels que la manière de servir dans une administration, ou les préceptes qu’il faut suivre pour bien se conduire en société.
Un autre exemple témoigne de la fusion des éléments philosophiques, historiques et littéraires au sein de cette tradition des arts de gouverner. Il s’agit des traités, épîtres ou chapitres qui tentent de définir le statut épistémologique de la science politique à partir de sa division en trois sphères dont l’origine est attribuée à Aristote. Généralement intitulés « De la politique » (Kitāb al-siyāsa ou Risāla fi l-siyāsa), ces textes montrent que la politique est la véritable science architectonique dans le domaine de la philosophie pratique, après le gouvernement de soi (l’éthique) et le gouvernement domestique (l’économique). Ils tentent aussi de préciser le rapport entre ces trois sphères et d’analyser la continuité entre les tâches les concernant ou, au contraire, les spécificités qui les caractérisent. Gouverner un empire engage-t-il les mêmes techniques et exige-t-il les mêmes compétences que le gouvernement de soi ou d’une maisosnnée ? Le présent dossier en livre un exemple à partir de la traduction inédite en français d’une épître d’al-Maġribī par Mohamed 16Ben Mansour, accompagnée d’une analyse approfondie des thèmes et des enjeux contenus dans le texte, notamment la question de la conservation du corps du prince. Cette littérature d’inspiration aristotélicienne à la base va se nourrir, dans le cadre de la civilisation classique de l’Islam, d’apports galéniques (sur la nature des vertus éthiques et le lien qu’elles entretiennent avec les humeurs du corps) ainsi que de certaines influences néo-pythagoriciennes ou stoïciennes, contenues dans quelques textes, dont le traité de Bryson sur le gouvernement domestique9.
Malgré la présence d’éléments philosophiques ou juridiques dans les Miroirs des princes, il n’en demeure pas moins qu’il est utile de les distinguer de la tradition des juristes comme de celle des philosophes. Les ādāb sulṭāniyya doivent être ramenés, à strictement parler, à la volonté d’apprendre au prince les types de rationalité (éthique, politique, économique, administrative ou guerrière) qui sont au cœur de l’exercice du pouvoir. Les leçons de l’histoire (les exempla) et les enseignements des sages et des hommes politiques du passé (les maximes) constituent en définitive les deux piliers sur lesquels repose textuellement ce genre des arts de gouverner, et qui fournissent des critères permettant de le distinguer des autres approches de la politique, faites par les juristes ou les purs philosophes. Ces derniers définissent la politique non pas en s’appuyant sur les biographies des princes et l’histoire des États qu’ils ont pu fonder, mais à partir d’une réflexion globale sur l’homme qui analyse ses facultés cognitives, examine son rang dans l’Être, et scrute sa destination terrestre et céleste. Inscrite dans la noétique et la cosmologie, cette réflexion est amenée par un axe éthico-politique centré sur la question du bonheur de l’homme. Il n’est pas étrange, dès lors, de voir que chez le plus éminent représentant de cette tradition en Islam qui est al-Fārābī, la science politique est la même chose que la science humaine. Et c’est parce que le thème de la fin suprême accessible à l’homme est fondamental dans cette approche que l’étude de la philosophie politique en Islam débouche sur des débats et des enjeux inhérents à l’étude de leurs textes, et relatifs à leurs orientations platoniciennes, aristotélicienne ou néoplatoniciennes. Ainsi, depuis les travaux pionniers de Leo Strauss sur certains auteurs médiévaux (notamment al-Fārābī et Maïmonide), d’excellentes études se sont penchées sur la place du philosophe dans la 17Cité, sur le rapport entre philosophie et politique, ainsi que sur le lien entre l’élite savante et la masse, la religion et le savoir philosophique ou encore sur le thème passionnant de l’art d’écrire des philosophes. Ce sont ces sujets qui, dans ce dossier, sont discutés par Makram Abbès, notamment à partir de l’analyse des influences exercées par les idées politiques d’Aristote sur les philosophes de l’Âge classique de l’Islam. De son côté, l’article d’Anoush Ganjipour montre les pérégrinations de ces débats jusqu’en Iran au xiie siècle, à travers l’œuvre d’al-Kāshānī qui illustre une nouvelle problématisation du lien entre métaphysique et politique, basée sur une vision particulière du statut du roi-philosophe, et de son rôle en tant guide vers le bonheur terrestre et céleste.
À la différence des philosophes, les juristes ne procèdent pas d’une normativité fondée sur les sciences et visant la certitude, mais s’attèlent à définir les règles qui permettent d’atteindre la bonne marche de l’administration, et le respect des institutions. Le discours sur le politique prend ici une direction marquée par la recherche sur la norme et l’exception, la règle et son contournement, l’intérêt général et l’intérêt particulier. Bien que cette tradition ne soit véritablement codifiée qu’avec le livre magistral d’al-Māwardī (974-1058), Les Statuts gouvernementaux, il faut rappeler que les règles de droit administratif et public ont fait l’objet, dès le début de l’Islam, d’une codification partielle, notamment à propos de la perception des impôts ou de l’office de la judicature. Les juristes abordent les thèmes politiques à partir de la notion fondamentale d’aḥkām (règles juridiques), et étudient les problèmes selon des angles d’approche rarement croisés dans la tradition des Miroirs des princes ou celle des philosophes politique. C’est ce qu’on observe à travers l’étude du fondement de l’autorité (légale ou rationnelle), de l’énumération des compétences et des conditions requises pour l’accès à une fonction (celle de chef, de ministre ou de juge), les protocoles de l’investiture ou de la déposition, ainsi que le traitement des relations de pouvoirs en termes d’obligations, de droits et de devoirs.
Certes, de tels développements peuvent s’appuyer sur les principes contenus dans le texte coranique ou s’autoriser de la conduite du prophète ou des fondateurs de l’Islam, et c’est dans ce sens d’ailleurs que les juristes parlent d’un fondement religieux de la politique ou qu’ils cherchent à soumettre cette dernière à des pratiques respectueuses des moments fondateurs. Mais comme en témoigne l’article de 18Sophia Mouttalib à propos de la codification des règles juridiques et l’autonomisation des principes relatifs à la constitution, la référence à la religion en tant qu’ensemble de valeurs morales ou fondement légal des pratiques institutionnelles ne signifie pas que ces règles furent sacrées ou théologisées. La sacralisation peut même concerner des normes qui n’ont rien à voir avec la religion comme le montre l’exemple du voile à l’heure actuelle. C’est donc l’articulation du social, du politique, de l’économique et de l’individuel qui peut expliquer la construction, dans des contextes historiques précis, d’enjeux orthodoxiques ou théologiques qui prennent la forme d’un religieux en apparence irréductible aux véritables causes qui en motivent la formation. Il suffirait donc de déconstruire ces différents enjeux pour comprendre les véritables causes de leur sacralisation par les individus et les groupes. Cet aspect est on ne peut plus visible aujourd’hui à propos de notions comme le jihad, la shari‘a ou le califat qui ne furent pas soumises, à l’Âge classique de l’Islam, à un traitement aussi théologisé ou sacralisé, alors qu’elles le sont fortement à l’heure actuelle.
La valorisation du caractère séculier de la littérature politique, qu’elle soit due aux Miroirs des princes, aux travaux des philosophes ou aux traités des juristes, ne signifie pas toutefois l’absence de tout intérêt pour la religion dans ces textes, ni leur volonté de construire un discours antireligieux en abordant la politique. Nombreux sont, en effet, les emplois de références religieuses, ou les développements sur la conduite du Prophète et de ses compagnons. Toutefois, leurs fonctions se distinguent nettement des finalités assignées à aux mêmes références dans la littérature purement théologique, qui aborde la politique en liaison avec la définition du dogme en Islam et avec les schismes qu’il a connu lors de la Grande discorde (Fitna) au viie siècle. De surcroît, nous estimons que les textes des arts de gouverner contiennent une analyse approfondie de la religion en tant que lien moral entre les hommes. Cet aspect lié à la pensée des conditions même de l’association civile se décèle à travers la présence, chez al- Māwardī, al-‘Abbāsī (m. 1310) ou Ibn al-Ṭiqṭaqā (1262-1309), de fortes réflexions sur le statut de la religion au sein de la Cité et sur les attitudes que les princes doivent adopter à l’égard des doctrines religieuses, des divisions qu’elles génèrent, et des problèmes concrets qu’elles posent à leurs gouvernements. Cette dimension relative au statut social et politique de la religion constitue un axe de réflexion 19majeur dans ces savoirs de gouvernement, qu’ils relèvent des rationalités scientifiques des philosophes, institutionnelles des juristes ou historico-littéraires des Miroirs de princes. Elle permet de connecter ou de déconstruire de nombreux enjeux anciens et contemporains à propos de la relation entre politique et religion en Islam, et de voir comment on a pu penser le lien entre les dogmes et les conduites individuelles et collectives, le rapport entre croyances religieuses et actions mondaines, bref les différents points qui nourrissent les enjeux complexes et toujours renouvelés du problème théologico-politique.
Makram Abbès
ENS Lyon / TRIANGLE
1 Conformément à l’usage académique, le mot « islam » en minuscule renvoie à la religion, alors qu’avec la majuscule, il renvoie à la civilisation.
2 Premier gouvernement des quatre successeurs immédiats du Prophète, qui s’arrête avec la Discorde (Fitna) et la prise du pouvoir par les Omeyyades en 661.
3 Voir sur ce point Dimitri Gutas, Pensée grecque, culture arabe. Le mouvement de traduction gréco-arabe à Bagdad et la société abbasside primitive (iie-ive/viiie-xesiècles), trad. Abdesselam Cheddadi, Paris, Aubier, 2005, p. 45-60.
4 Voir, à propos des Miroirs composés au début du xxe siècle, Annie K. S. Lambton, “Islamic Mirrors for Princes”, La Persia nel Medioevo, Rome, Anlquad, 1971, p. 419-442, et J. Dakhlia, « Les miroirs des princes islamiques : une modernité sourde ? », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2002-5 – 57e année, p. 1193.
5 Miskawayh, Taǧārib al-umam (L’Expérience des nations), Beyrouth, Dār al-kutub al-‘ilmiyya, 2003, vol. 1, p. 59-60.
6 Ibid., p. 59.
7 Machiavel, De la manière de traiter les populations du Val di Chiana révoltées, dans Œuvres, trad. Christian Bec, Paris, Robert Laffont, p. 35.
8 Voir Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī, The Nasirean Ethics, traduit du persan en anglais par G. M. Wickens, London, George Allen & Unwin LTD, 1964. Pour la version arabe du texte, voir Joep Lameer, The Arabic Version of Ṭūsī’s Nasirean Ethics, Leiden. Boston, Brill, 2015.
9 Voir Penser l’Économique, textes de Bryson et d’Ibn Sînâ, édités et traduits par Y. Seddik et Y Essid, Tunis, Media Com, 1995.