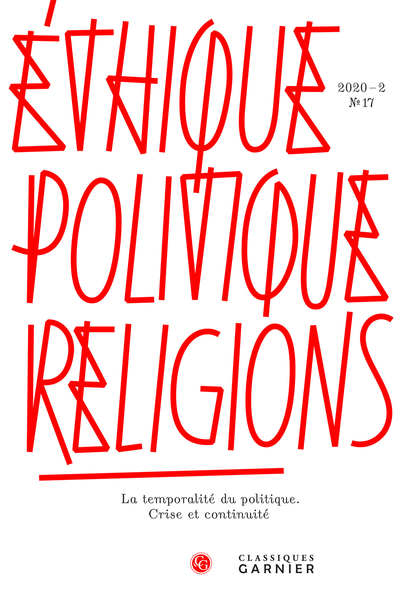
La « Sattelzeit » Genèse et contours d’un concept d’époque
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Éthique, politique, religions
2020 – 2, n° 17. La temporalité du politique. Crise et continuité - Auteur : Escudier (Alexandre)
- Résumé : La notion de Sattelzeit a connu une immense fortune. L’article revient sur la genèse du concept chez Koselleck. Il montre, d’une part, la précocité (1963) des schèmes interprétatifs centraux de Koselleck et, d’autre part, une sur-accentuation ultérieure de la thématique de « l’accélération ». C’est cette transformation analytique interne qui explique la fortune continuée de Koselleck mais qui en révèle également les fragilités quant à la question des structures constitutives de la modernité.
- Pages : 115 à 136
- Revue : Éthique, politique, religions
- Thème CLIL : 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN : 9782406110972
- ISBN : 978-2-406-11097-2
- ISSN : 2271-7234
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11097-2.p.0115
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 01/02/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Sattelzeit, Koselleck, sémantique historique, accélération, modernité
La « Sattelzeit »
Genèse et contours d’un concept d’époque
« Sattelzeit » : rarement un mot-valise aura connu une si longue fortune1. « Der Sattel », la selle de cheval, ce mot associé au concept générique de « temps » (Zeit) renvoie à une image, celle d’un point de basculement, d’un point de transition, d’un versant vers un autre. Un col, un passage de crête, un seuil haut placé en somme (Bergsattel). « Schwellenzeit », « époque-seuil » sera souvent employé ailleurs, plus tard, par d’autres – en lieu et place de « Sattelzeit2 ». Comme d’ordinaire en ces matières, c’est la métaphorisation par l’espace qui tient lieu de thématisation du temps ; la temporalité et la simultanéité empruntent la voix de la figuration spatiale, et l’image de la succession, soit le mouvement d’un point discret vers un autre. Depuis Aristote Physique IV du reste. Rien de nouveau sous le soleil ; la leçon d’Heidegger a porté.
« Sattelzeit3 », que l’on peut traduire par « époque-charnière », n’est pas un « concept » du même ordre que les 130 « concepts fondamentaux » (Grundbegriffe) pris pour objets d’investigation par le trio éditeur O. Brunner / W. Conze / R. Koselleck dans leur dictionnaire éponyme en 8 volumes (1972-1997). Il s’agit avant tout d’une métaphore, spatiale, désignant du même mouvement trois choses dissemblables : a) une époque de longue transition (1750-1850), b) un objet d’enquête pour ainsi dire matérialisé (le langage socio-politique allemand d’alors, considéré dans sa genèse, différenciation et stabilisation longue) et c) une thèse historique (soit l’idée d’une mutation radicale et durable, 116uniment sémantique et morpho-dynamique, du vocabulaire socio-politique allemand moderne).
La question de recherche présidant à l’identification de cette « époque-charnière » est clairement énoncée en 1972 : étudier la dissolution du monde ancien, et l’apparition du monde moderne, à travers le prisme évolutif de ses langages socio-politiques et reconfigurations conceptuelles motrices. Le lien est d’ordre généalogique : il s’agit, d’une manière explicitement assumée, d’éclairer non pas la totalité du vocabulaire socio-politique contemporain mais ces pans précis de langage étant nés de la double révolution politique et industrielle moderne entre 1750 et 18504.
Ici, l’hypothèse heuristique (heuristischer Vorgriff) équivaut à une thèse historique massive5 : après les grandes reconfigurations sémantiques de 1750-1850, les langages socio-politiques nous seraient devenus immédiatement compréhensibles, pour ainsi dire homogènes aux nôtres, alors que ce qui est antérieur nous demeurerait sémantiquement étranger, et nécessiterait d’être retraduit pour être compris selon les significations et conditions d’efficace socio-politique d’alors. Ce faisant, Koselleck déplace de fait les frontières ordinaires entre les époques ; il scinde les temps modernes en deux moments distincts (1500-1750 ; 1750-1850). Auparavant, c’est la coupure entre la Renaissance et la Réforme qui était censée inaugurer les temps modernes, via donc l’éclatement de la chrétienté, les guerres civiles confessionnelles subséquentes et l’apparition des États absolutistes garants de la paix civile sur leurs territoires. C’est d’ailleurs encore le point de départ adopté par Koselleck lui-même en 1954/1959 dans sa thèse de doctorat Kritik und Krise6.
À partir des propositions heuristiques sur la « Sattelzeit », une seconde phase des « temps modernes » se dégage, i. e. notre modernité proprement dite, caractérisée par une mutation radicale des langages socio-politiques. 117Une mutation longue, entre 1750 et 1850, au gré d’une double révolution aux effets conjugués : une révolution durable des principes de la légitimité politique et une révolution structurelle de l’organisation socio-économique (fin de la « ständische Verfassung », uniment sociale et politique, fin de la société d’ordres et de statuts). Selon Koselleck, ces deux séries de mutations nous auraient fait entrer de plain-pied dans notre époque en ce sens que les noyaux fondamentaux de notre vocabulaire socio-politique s’en seraient dégagés, de même que les dynamiques durables via lesquelles les groupes sociaux formuleraient désormais les fins ultimes du bon ordre politique et les moyens sémantiques de leurs luttes.
La thèse est robuste, et – même si elle n’est énoncée que cursivement – il convient d’en prendre toute la mesure, sauf à succomber inconsidéremment aux charmes de son magnétisme. « L’époque-charnière » autour de 1800 est-elle véritablement toujours la nôtre, en termes de matrices conceptuelles englobantes ? Et cette question-clef ne doit-elle pas être dédoublée de la manière suivante. Premièrement : est-il historiquement avéré que les concepts de la politique moderne sont nés de cette « époque-charnière », selon la morphologie que Koselleck pense pouvoir identifier (soit donc des concepts démocratisés, temporalisés, idéologisés et politisés) ? En second lieu : entériner cette thèse par l’affirmative n’équivaut-il pas à occulter tous les autres langages politiques concomitants, et toujours réactivables comme nôtres, de la modernité (soit donc des discours proprement politiques autour des questions pérennes de la juste dévolution du pouvoir, des sources de l’obligation politique, des équilibres de richesse internes à la « polis », des règles de limitation et de bonne régulation entre et dans les sphères respectives du politique, de l’économique, du social, de l’éthique, du religieux, etc.) ? Pour heuristique qu’elle soit, ou a pu l’être, l’hypothèse de la « Sattelzeit » ne devrait-elle pas être aujourd’hui révisée, complétée, voire pour partie rejetée afin d’accéder à une appréciation plus juste de la multiplicité concrète des processus ayant présidé à l’avènement de « notre » modernité politique ? C’est cette sorte de scepticisme postkoselleckien, à l’évidence éminemment endetté intellectuellement auprès de Koselleck lui-même, que j’aimerais développer ci-après, non sans avoir rappelé la genèse ainsi que les acquis fondamentaux de sa Begriffsgeschichte.
118Avant la « Sattelzeit »
De « Kritik und Krise » à
« Preußen zwischen Reform und Revolution »
L’hypothèse de la « Sattelzeit » intervient à un moment précis du parcours intellectuel de Koselleck. Elle correspond à un infléchissement partiel de sa vision de la Modernité.
Son premier grand travail de 1954/1959 – Kritik und Krise – avait consisté à repartir de la fin des guerres civiles confessionnelles du xvie siècle via la construction des États absolutistes. Si la paix civile avait ainsi pu être rétablie, cela avait été au prix d’une scission entre le « sujet » (du Roi absolutiste) et le « for intérieur » de l’individu. Du même mouvement, aussi bien les confessions que la morale privée avaient été, pour ainsi dire, ex-communiées de l’ordre pacifié du politique. Pour un bref moment seulement, car – en conduisant une « critique » illimitée des normes établies (normes civiles et religieuses) – les Lumières des xviie et xviiie siècles ont eu tôt fait de remoraliser l’espace du politique, de remettre en selle les « justes causes » propices à la reprise des armes de la « stasis », depuis la « société » contre « l’État absolutiste », et de relancer pour ce faire les motifs d’opposition radicale entre les groupes sociaux. Pour le jeune Koselleck de 1954-1959, cette remoralisation du politique via la politisation des Lumières n’était rien d’autre que la pure et simple négation (« hypocrite ») de toute ontologie politique avérée et viable : bref, une politique anti-politique puisqu’il y a toujours, il doit toujours y avoir, comme condition de possibilité de l’ordre socio-politique, du « haut » et du « bas », de « l’intérieur » et de « l’extérieur », du « secret » et du « public », bref un reste irrésorbable de domination, d’adversité et de non transparence7.
C’est pour ce premier Koselleck le genre discursif de la « philosophie de l’histoire » qui en vient à prendre en charge cette offensive moralisante 119des Lumières contre les conditions de possibilité minimales de toute politique viable (celle de l’État absolutiste, non interrogé par Koselleck du même coup comme accélérateur de troubles, et non pas « katechon », parce qu’il bloque de fait tout dialogue politique, pourtant requis par l’ampleur des évolutions matérielles et sociales au xviiie siècle, en France à tout le moins). Dans Kritik und Krise, de l’émergence à la profusion du genre de la « philosophie de l’histoire », on passe directement à l’effectivité politique de la « Krise » de 1789, moyennant une thèse intermédiaire : à savoir l’idée d’un pré-apprentissage de la pratique révolutionnaire via l’exercice de la critique philosophique et de la liberté égalitaire au sein des loges franc-maçonnes.
Le séquençage de la thèse générale instruite dans Kritik und Krise est alors limpide : 1) crise inaugurale de la chrétienté pluralisée au xvie siècle, 2) construction de l’État absolutiste à fonction katéchontique (limiter la guerre civile, i. e. retenir le mal des « justes causes » religieuses), 3) apparition puis politisation des Lumières philosophiques en tant que source de contestation de la normativité du Léviathan neutralisateur, 4) retraduction des axiologies contestatrices dans le langage des philosophies de l’histoire (i. e. justice non pas sotériologique extra-mondaine mais temporalisée intra-mondaine), 5) émergence d’un habitus philosophique critique et d’une pratique pré-révolutionnaire égalitariste au sein des loges maçonniques et 6) ouverture de la grande « Krise » du monde moderne avec le cycle révolutionnaire américain mais surtout français – un cycle long dont nous ne serions pas encore sortis en 1954-1959 au sens de sémantiques politiques dualistes (Gegenbegriffe) s’affrontant jusqu’aux extrêmes (i. e. jusqu’à la possible explosion pantoclastique nucléaire entre les USA et l’URSS d’alors). Voilà la première grande proposition koselleckienne sur la Modernité ; elle s’enracine dans les inquiétudes post-Hiroshima de la guerre froide, lesquelles inquiétudes surdéterminent la reconstruction historique proposée par Kritik und Krise.
Lorsque Koselleck passe, pour des raisons académiques circonstancielles8, du commerce intellectuel pluriel avec C. Schmitt, K. Löwith, J. Kühn, H.-G. Gadamer, etc., à la fréquentation assidue de Werner Conze et de son « Arbeitskreis für Sozialgeschichte » de Heidelberg, il infléchit son approche de la Modernité en direction de l’histoire sociale 120(versus la seule histoire des idées/doctrines) et de l’histoire institutionnelle (Verfassungsgeschichte). En vue de la thèse d’habilitation, il engage alors un long travail sur la Prusse entre réformes et révolution (1791-1848)9.
Le corpus analysé (juridique, administratif, et relatif aux mouvements sociaux) change du tout au tout. Les seuls motifs schmittiens (stasis, Leviathan, jus publicum europaeum) et löwithiens (philosophie de l’histoire, sécularisation) ne sont plus directement opérant, et se trouvent pour partie secondarisés. Ce sont désormais bien plutôt les règles du jeu juridique, administratif et économique qui sont mises au centre de l’analyse du « mouvement historique ». Encore marginale dans Kritik und Krise10, l’attention portée à l’évolution du lexique socio-politique devient majeure. Empruntant résolument la voie de l’histoire sociale mais en faisant d’emblée un pas de côté, Koselleck s’emploie à cerner, selon son évolution et efficace propres, le medium langagier dans l’élément duquel s’affrontent les intérêts matériels, les hégémonies politiques, les médiations bureaucratiques et les mouvements sociaux d’alors.
Au-delà des raisons trivialement psychologiques de cette inflexion certaine (Koselleck s’ennuie tout simplement à cet exercice de pure histoire sociale)11, deux considérations de fond apparaissent à l’occasion du travail sur la Prusse ; elles feront partie du socle fondamental de sa réflexion ultérieure. La première consiste à faire de l’histoire des concepts le passage obligé de toute histoire sociale bien fondée en ce sens que le langage socio-politique est ce par quoi l’historien est en mesure de reconstruire l’histoire effective mais aussi ce au travers de quoi le mouvement historique lui-même s’effectue. Pour Koselleck en effet, et l’introduction générale des Geschichtliche Grundbegriffe fixera le point en 1972 en définissant les concepts comme à la fois « indicateurs » et « facteurs » d’histoire12, les acteurs du moment n’appréhendent leur réalité, n’imaginent des transformations possibles, ne mobilisent leurs 121troupes et ne désignent des cibles pratiques qu’au travers d’un lexique socio-politique historiquement stabilisé et partagé mais toujours transformable au gré des antagonismes pragmatiques ad hoc.
Formulée dès l’enquête sur la Prusse – et davantage encore marquée dans la préface à la réédition modifiée de 1975 (à l’encontre de l’histoire sociale de Bielefeld incarnée par Jürgen Kocka et Hans-Ulrich Wehler) –, la seconde considération consiste à affirmer que seule une théorie des temporalités historiques (i. e. adéquate à la structure feuilletée du « mouvement historique » même) peut asseoir épistémologiquement la science historique comme discipline consistante. La théorie des « temporalités » entend ici destituer celle des seules déterminations matérielles et sociales. Le point est capital. Dès sa thèse d’habilitation en effet, sans qu’il ne l’explicite encore réellement13, Koselleck remplace le problème de la « causalité » (le fait de rapporter des discours à des groupes sociaux qui en expliqueraient intégralement l’efficacité historique) par celui de la « temporalité », à savoir les tensions temporelles qui se dégageraient toujours de la non contemporanéité de différents phénomènes concocomitants. Concrètement, Koselleck analyse le rôle joué par la « bureaucratie » prussienne suite aux réformes juridiques et économiques de la Prusse d’Ancien Régime après 1791 ; le thèse ultime consiste à réapprécier le rôle modérateur, médiateur, modernisateur, pour ainsi dire katéchontique (versus Révolution) de la bureaucratie prussienne14 une fois amorcé le cycle révolutionnaire moderne. Distinguant entre bureaucratie centrale/ministérielle et périphérique/provinciale, Koselleck analyse la logique propre de (et les interactions entre) trois domaines distincts : les statuts juridiques (Rechtsverfassung), l’administration (Verwaltung) et 122les couches sociales (soziale Schichten). Ce faisant, il vise moins à produire une explication causale des réformes de ce temps et des couches sociales qui en auraient été les substrats, qu’à rendre compte d’une intégration temporelle complexe de différents niveaux de la dialectique de l’État, de l’administration et de la société d’alors15.
La « Sattelzeit », une matrice interprétative
et une thèse magnétique
Le travail d’habilitation sur la Prusse a considérablement déplacé le questionnaire koselleckien en direction de l’histoire des concepts et des temporalités, articulées à une histoire sociale exigeante mais in fine subordonnée à la réflexivité interprétative ex post de l’historien. C’est à partir de ce grand déplacement que Koselleck va reprendre et reformuler, au travers du schème général de la « Sattelzeit », ce que Kritik und Krise avait permis de repérer, au xviiie siècle, à savoir la montée du genre de la « philosophie de l’histoire » ainsi qu’un processus de sécularisation intra-mondain des agendas critiques de justice socio-politique. Cette grande thématique se trouve donc reprise mais à la faveur d’inflexions propres au nouveau champ d’investigation du langage socio-politique allemand moderne, en ses « concepts fondamentaux16 ». Rédigée dès l’automne 1963, publiée selon une première version en 196717, l’introduction générale (1972) 123au grand dictionnaire des Geschichtliche Grundbegriffe fixe durablement le programme de la « Begriffsgeschichte » et le questionnaire englobant de la « Sattelzeit ». La transformation de ce texte entre 1963/67 et 1972 n’a jamais été analysée de près ; elle s’avère pourtant fort instructive.
Le mot de « Sattel-zeit », puis « Sattelzeit », apparaît tout d’abord dès la version de 1963-196718 ; il est ordonné à une « hypothèse heuristique » déjà bien stabilisée, et équivalente à la version de 197219. C’est le « début du monde moderne » (Beginn der Neuzeit)20 qu’il s’agit d’identifier, au fil de ses mutations conceptuelles, lesquelles sont les indices de changements politiques, socio-économiques et expérientiels. Une double révolution, politique et industrielle, engage alors une transformation profonde21, et rapide, du monde hiérarchique hérité des statuts, « ordres » et « états » (Stände). C’est ainsi que se serait durablement ouverte la grande alternative dynamique de la « Tradition » et de la « Révolution », jusqu’à l’orée de notre « présent » politique22. Le dispositif interprétatif de 1963/67 est limpide : le passé de la société d’ordres (qui requiert d’être « traduit », explicité pour nous selon ses concepts constitutifs révolus) se trouve durablement reconfiguré, au fil de la « Sattelzeit » (1750-1850), via l’agonistique sémantique de la « Tradition » et de la « Révolution », jusqu’à ce que se stabilisent les cadres conceptuels de la société présente (pour nous immédiatement intelligibles, sans interprétation-traduction conceptuelle).
124Cette première version de la « Sattel-zeit » comporte tout ce sur quoi Koselleck reviendra par la suite. Ceux qu’il appelle encore des « Zentralbegriffe23 » deviendront en 1972 des « Grundbegriffe », à savoir non pas de simples « mots » (Wörter), mais des notions socio-politiques plurivoques, condensant en elles des enjeux sociétaux si polysémiques qu’ils demeurent investissables par de nombreux groupes sociaux et porte-paroles antagoniques. La dimension non pas seulement « sémantique » mais pragmatique des jeux de discours (en situation, dans des contextes spécifiques), cette dimension essentielle non idéaliste est d’emblée posée au travers de la question cardinale du « cui bono ? ». Autrement dit, à qui s’adresse telle ou telle prise de parole, en provenance de qui, de quel groupe social, selon quelles notions inclusives ou bien exclusives, voire stigmatisantes, selon quels intérêts matériels et quelles visées tactiques, à quel niveau infrastructurel précis de l’espace public du moment, selon quels effets et rayonnement spécifiques, etc.24 ? Tous ces requisits de contextualisation des discours sont posés dès 1963-1967, et seront réitérés comme tels chroniquement par la suite, en dépit des lectures tronquées et délibérément polémiques de certains – faute de pouvoir se nourrir méthodologiquement d’autre chose que de caricatures anti-koselleckiennes25.
La question des principes de sélection des concepts fondamentaux (Auswahl)26 ; celle de la double méthode « sémasiologique » (recenser toutes les significations d’un même mot) et « onomasiologique » (suivre tous les mots dissemblables visant un même enjeu)27 ; le problème du passage des langages anciens aux vernaculaires nationaux dès le xvie siècle28 ; 125le principe de présentation « alphabétique » (versus thématique) des « concepts fondamentaux », et selon les trois volets diachroniques de leur émergence passée (Vorspann), transformation moderne (Hauptteil durant la « Sattelzeit ») et pérennité stabilisée présente (Schlußteil)29 ; tous ces problèmes sont d’emblée aperçus, et circonscrits à la manière du dictionnaire ultérieur.
Plusieurs thèmes, par contre, ne sont encore qu’en gestation. Désignant le double statut épistémologique des concepts socio-politiques (à la fois trace-fossile et cause morpho-dynamique sui generis), le couple « indicateurs »/« facteurs » d’histoire n’est pas avancé nettement30. Koselleck mettra bien davantage l’accent, par la suite, sur l’efficace propre de la plasticité linguistique, « factrice » d’histoire. Les notions d’« horizon d’attente » (Erwartungshorizont)31 et d’« horizon d’expérience » (Erfahrungshorizont)32 sont d’ores et déjà avancées, mais « expérience » et « attente » y sont encore conceptuellement interchangeables33, et phénoménologiquement sous-déterminées34.
Mais, plus fondamentalement, les quatre questions heuristiques de l’hypothèse générale de la « Sattelzeit » ne sont encore qu’esquissées35. 126En 1972, en effet, Koselleck avance quatre clefs de lecture possibles du passage de l’ancien régime au monde moderne. Premièrement, un mouvement de « démocratisation » (Demokratisierung) des concepts socio-politiques36, soit donc le fait que le langage politique en soit venu à inclure beaucoup plus d’acteurs et de réalités sociales que les vieilles catégories de la société d’ordres (Stände) ne permettaient d’en impliquer. Dans le programme de 1963/67, Koselleck ne saisit ce premier grand processus de transformation sémantique qu’au travers de l’agonistique centrale « Tradition »/« Révolution37 ».
Le second grand processus de changement pointé en 1972 relève de la catégorie de « temporalisation » (Verzeitlichung)38, soit donc l’idée que les grandes catégories modernes du politique intègreraient désormais des éléments de philosophie de l’histoire allant bien au-delà des langages passés de la domination socio-politique spatialisée (e. g. « Emanzipation » versus « Herrschaft »). Ce processus-là n’est encore qu’effleuré en 1963-1967 par des remarques adventices sur « l’accélération » (Beschleunigung) et l’apparition de concepts perspectivistes temporalisés partisans (parteigebundene, geschichtsphilosophische Perspektivbegriffe)39. Par rapport à Kritik und Krise, cela constitue néanmoins, pour Koselleck, un déplacement notable en direction des sémantiques temporalisées modernes (en lieu et place de sa première critique, moins sémantique que doctrinale, voire idéologique, de la « Kritik » moderne en tant que factrice de « Krise » de l’État absolutiste pacificateur).
La troisième série de transformation sémantique avancée en 1972 souligne le degré croissant d’« idéologisation » possible des langages socio-politiques modernes (Ideologisierbarkeit)40. C’est sur ce point où la continuité est la plus forte avec le pré-programme de 1963-1967. Dans un cas comme dans l’autre, Koselleck souligne le « degré d’abstraction » montant des sémantiques à l’œuvre, leur caractère de plus en plus évidé, aveugle aux concrétudes expérientielles, ainsi que leur caractère manipulable41. Déjà au cœur de Kritik und Krise, le soupçon d’inflation 127sémantique, crisogène, de la modernité est ici encore très fort mais désormais rapporté à la morphologie même (infra-sémantique) des langages politiques modernes. Et c’est justement la force magnétique de l’argument koselleckien que de porter sur la « forme », et non sur le « contenu » signifiant des discours. Ce que l’introduction générale de 1972 au Lexikon ajoute à cet argument de 1963-1967, c’est la notion de « singuliers collectifs » (Kollektivsingulare), soit donc l’idée que des concepts processuels existant auparavant au pluriel auraient été de plus en plus mobilisés au singulier majusculé (le Progrès, l’Histoire, la Liberté, etc.)42.
La quatrième et dernière transformation englobante énoncée en 1972 est celle d’une « politisation » (Politisierung) sémantique généralisée, à savoir l’idée d’une augmentation drastique, lors du passage à la modernité, des modes de désignation polémiques, polarisés, non seulement des enjeux mais des positions groupales (soi/ les siens versus les autres) au travers de mots-slogans (p. ex. « Aristocrates » versus « Démocrates », « Réactionnaires » versus « Révolutionnaires », etc.)43. On retrouve ici la question des « dualismes » et « Gegenbegriffe » (concepts antagoniques, relationnels) déjà omniprésente dans Kritik und Krise ; elle n’est toutefois plus circonscrite aux discours des Lumières, des loges-maçonniques et des philosophes de l’histoire ; elle devient une des grandes matrices interprétatives de la morpho-sémantique moderne. « Politisation » agonistique partout donc en 1972. Le pré-programme de 1963/67 thématise déjà le point, mais moyennant la notion de « Polemisierung » (et de « Gegenbegriffe »)44. Cette notion intermédiaire ne change toutefois rien à la continuité de la visée heuristique et du diagnostic.
Quant à sa plus-value cognitive et pratique enfin, la « Begriffsgeschichte » koselleckienne revendique une triple utilité45 : tout d’abord, une fonction d’information ancillaire pour les sciences sociales et les sciences du langage modernes ; ensuite, une fonction interprétative quant aux changements qualitatifs assurant le passage à la modernité présente via la longue transition de la « Sattelzeit » ; enfin, une fonction d’aiguisement du jugement historique et de clarification politique au sein du monde contemporain. Autrement dit, quant à ce dernier point, c’est la « Begriffsgeschichte » 128elle-même qui, à la fois comme méthode d’investigation spécifique et relativisation cognitive des inflations idéologiques passées, en vient à prendre en charge la fonction katéchontique entrée en déshérence au gré de plusieurs vagues – l’éclatement de l’Eglise augustinienne, la ruine de l’État absolutiste par les Lumières, l’échec de la bureaucratie prussienne réformatrice au xixe siècle, etc.
Après le lancement du Lexikon en 1972, on peut repérer une ultime inflexion durable de la pensée de Koselleck, à savoir une sur-accentuation manifeste de la thématique de la « temporalisation » et de l’« accélération ». Cela permet à Koselleck de maintenir une double thèse : 1) tout d’abord, celle de la « Sattelzeit » en tant que grand basculement moderne (révolution politique, révolution industrielle et mutations des vieux répertoires métaphoriques de l’attente hérités de l’apocalyptique chrétienne) ; 2) ensuite, la thèse d’une accélération matérielle inédite de la modernité. Cette seconde proposition se décline en deux arguments distincts, et cela jusqu’aux derniers textes et interventions publiques de Koselleck. D’une part, il y a l’idée que l’accélération matérielle moderne pousse jusqu’à son point de possible rupture la gouvernabilité politique des sociétés à l’heure de la mondialisation économique et de la crise climatique globale – de l’anthropocène ou du capitalocène dirions-nous aujourd’hui. D’autre part, il y a l’idée d’une synchronicité inédite ubiquitaire des images et des affects politiques à l’heure du village global médiatique ; c’est ce que Koselleck appelle la convergence de « l’image » et de « l’événement » depuis 2001, suite au second crash (sur la seconde tour) du World Trade Center le 11 septembre. Il s’agit bien évidemment ici d’une variation sur le thème méta-politique fondateur de KuK : soit le diagnostic d’une opinion publique internationale en tant que scène globale de nouvelles « justes causes » (i. e. le djihadisme contemporain), remoralisant l’espace neutre du politique et enclenchant un nouveau cycle, dèsormais transnational, de « guerre civile » (stasis).
Depuis les premiers travaux de Kritik und Kritik, les thèses fondamentales de Koselleck sur la Modernité ont tour à tour été reformulées autour de quelques gros noyaux sémantiques aisément identifiables : « Kritik », « Geschichtsphilosophie », « Krise », « Bürgerkrieg », « Revolution », « Geschichte schlechthin », « Verzeitlichung », et « Beschleunigung ». C’est la sur-accentuation ultime de l’une des quatre matrices interprétatives de « l’époque-charnière » (1750-1850), à savoir le processus 129multicausal (matériel/sémantique) de « temporalisation »/« accélération » qui est à mon sens le ressort – infiniment ductile – de la grande fortune de Koselleck jusqu’à nous (i. e. l’anthropocène/capitalocène).
Le consensus postkoselleckien contemporain : « Begriffsgeschichte » versus « Sattelzeit »
À parcourir la littérature secondaire sur la « Sattelzeit », on repère de nombreuses critiques convergentes quant à la non-pertinence de ce concept d’époque. Si elles maintiennent, pour la plupart, les acquis méthodologiques de « l’histoire des concepts », elles invitent à toute une série de déplacements de la focale.
L’argument le plus largement partagé consiste à affirmer que la notion de « Sattelzeit » est trop discontinuiste pour être aujourd’hui reconduite. Le passage à la modernité socio-politique aurait été bien plus complexe, et temporellement diffracté, que cette « hypothèse heuristique » et ses quatre questions-guides ne le suggéraient dès 1963-1967 et surtout 1972. Le concept d’« époque-charnière » ne vaudrait ainsi même pas pour l’espace germanique seul (son référent empirique originaire), a fortiori pour les autres aires linguistiques et trajectoires politiques collectives. Il n’y aurait donc pas une seule mais « des » transitions vers la modernité, dissemblables d’un lexique socio-politique à l’autre, en fonction des dynamiques politiques et des constructions étatiques diachroniquement et territorialement différenciées selon les espaces (du reste non partout stato-nationaux). Pour l’Angleterre, par exemple, le long xviie siècle aurait ainsi été bien plus décisif que les années 1750-1850, de même que le langage politique de l’« ancienne constitution » parlementaire (versus l’exécutif absolutiste)46, et non pas tel ou tel singulier collectif dont Koselleck aurait sur-accentué le rôle en tant que « facteur » d’histoire. La pertinence de la « Begriffsgeschichte » comme méthodologie et champ 130d’investigation demeurerait toutefois entière, à cette condition expresse d’être radicalement dissociée des schèmes interprétatifs inauguraux de la « Sattelzeit47 ». Il n’est d’ailleurs nullement exclu de penser que c’était là la position à laquelle Koselleck était lui-même parvenu en fin de parcours en insistant sur les hétérochronies, la « simultanéité du non contemporain48 », et l’enchevêtrement complexe, partout observable, des « strates temporelles » (Zeitschichten) de la vie collective.
La critique des conditions d’émergence des « singuliers collectifs » majusculés (« Histoire », « Progrès », etc.) est connexe à celle, générale, de la « Sattelzeit ». Elle a pu revêtir ici ou là l’armure impénétrable de l’érudition philologique, en renvoyant notamment au problème de l’anté-datation du singulier majusculé « Histoire » (« Geschichte » / « Historie ») dès le xviie siècle en français (versus 1770 en allemand, selon Koselleck). De telles corrections ont assurément fait avancer notre appréhension des mutations sémantiques longues de l’époque49. Mieux documentées en tant qu’« histoire des mots » (Wortgeschichte), ces critiques érudites peinent toutefois à atteindre la « Sattelzeit » comme cadre interprétatif global et concept d’époque dès lors qu’elles n’affrontent pas les quatre questions-guides sous-jacentes ainsi que la dialectique proprement moderne de l’expérience et de l’attente. En re-pluralisant les concepts fondamentaux de 1750-1850, de telles démarches tendent en outre à perdre de vue que l’hypothèse de la « Sattelzeit » portait, en tout premier lieu, sur le lexique socio-politique (et non sur tous les types imaginables de discours, à travers tous les champs d’activité, arts et disciplines de la période)50.
Ce qui est problématique dans l’heuristique de la « Sattelzeit » me semble tenir à plusieurs aspects tout différents. Premièrement, continuer d’affirmer que nos langages socio-politiques sont pour l’essentiel 131homogènes à ceux qui se seraient stabilisés vers 1750-1850 au travers d’un quadruple processus de « démocratisation », « temporalisation », « idéologisation » et « politisation », une telle affirmation ne peut que porter au scepticisme. Autrement dit, elle nous empêche de penser ce qui a pu radicalement changer depuis en termes de processus englobants du politique (processus tour à tour sémantiques, pragmatiques, institutionnels et matériels de tous ordres)51. En second lieu, les propositions initiales, fortes, de Koselleck fondant « l’histoire des concepts » conduisent à sur-estimer la dynamique propre, factrice d’histoire, des langages socio-politiques. Il y a là une sur-accentuation causale à laquelle il convient de résister. Et il s’agit de surcroît d’une contradiction interne à la pensée de Koselleck lui-même, qui a par ailleurs constamment affirmé que l’effectivité historique ne se résorbait nullement dans le seul langage des acteurs mais renvoyait toujours à des structures anté-prédicatives et à des conditions de possibilité extra-langagières52.
Mais surtout – en troisième et dernier lieu –, c’est la sur-accentuation du schème interprétatif de la « temporalisation »/« accélération » qui pose problème. À lui seul, il ne saurait suffire à penser la modernité dans ce qui fait sa spécificité normative, factrice d’histoire, à savoir : le long cycle de démocratisation qui s’est ouvert à partir de la révolution américaine (1776), française (1789) puis transatlantique. Des plus complexe et prégnant, ce cycle n’est nullement réduisible aux seules mutations sémantiques des concepts fondamentaux53, et il ne saurait être secondarisé par le processus de « temporalisation »/« accélération ». C’est pourtant bien cette secondarisation qui a conduit au re-phrasage contemporain, par la théorie sociologique (H. Rosa), du diagnostic koselleckien de l’accélération jusqu’à en faire un nouveau concept-d’époque, substitut appauvri à la « Sattelzeit54 ».
132Le problème subséquent à cette inflexion du débat, depuis H. Rosa et sa fortune universelle, n’est pas tellement que les thèses de Koselleck aient été intégralement aspirées par une certaine sociologie. Le problème ne vient pas non plus du fait que ce réinvestissement verbal ait permis de hisser une certaine théorie sociologique au rang de « théorie critique » englobante, prétendant au magistère politique contemporain en même temps qu’à la thématisation de ses remèdes dans le mal (via de la « résonance » tous azimuts, ultime avatar-pharmacon germanique de la « Kulturkritik » moderne depuis Rousseau)55. La difficulté dirimante, à mon sens, vient bien davantage de ce que H. Rosa (et ses épigones) développe sa thèse générale de la modernité comme accélération générale en faisant complètement l’impasse sur les processus proprement politiques et idéologico-sémantiques depuis le xviiie siècle. Il en résulte un grand écart, peu plausible, entre d’un côté des phénomènes d’accélération proprement matériels (mobilisation en capitaux, processus de production, de transports et communication accélérés) et de l’autre des phénomènes trivialement psychologiques, sauf à les ressaisir comme le stade avancé du capitalisme et de l’individuation modernes (baisse de l’attention par hyperconnexion numérique, multi-tasking, burn out et identités situatives liquides).
La démocratie en son sens extensif (régime uniment politique, juridique, social et économique) et la question de ses conditions de stabilisation se sont ainsi évanouies dans le trou noir de la thèse de « l’accélération56 » ; les médiations sémantico-pragmatiques ont été du même coup escamotées, et nous héritons de fait, sans que cela soit dit, de la sur-accentuation koselleckienne ultime de « l’accélération » mais sans structures politiques, ni sémantiques, ni anthropologiques, et encore moins socio-économiques : bref, nous héritons d’une théorie sociologique écartelée entre matérialités accélérées et résilience (ou non) psychologisante. Soit donc, à la fin des fins, non du tout une éthique de la vertu mais une esthétique de la vie supportable en modernité matériellement accélérée. Avec la théorie du remède dans le mal de l’accélération (la « résonance »), le succès d’estrade est assuré auprès des innombrables individus-atomes entreprenoriaux (ou académiques), numériquement interconnectés et « managés » dans 133la globalisation. Avec la théorie de la « résonance » – faisant suite à la sur-accentuation koselleckienne de la thématique de « l’accélération », queue de comète de la « Sattelzeit » –, nous avons bien affaire à une énième variante d’une micro-politique (en fait un simple perfectionnisme moral) qui a démissionné des leviers macro-structurels de toute grande politique : rien d’autre, finalement, qu’un énième symptôme de crise au sein de nos États modernes complexes – jadis stratèges, redistributeurs et maîtres des horloges, mais aujourd’hui toujours plus incapacités par les flux globaux et les acteurs transnationaux. Mieux vaudrait désormais collectivement tirer à la ligne. Hic Rhodus !
Alexandre Escudier
Centre d’études politiques de Sciences Po (CEVIPOF)
134Références bibliographiques
Bödeker, Hans Erich et Hinrichs, Ernst, « Alteuropa – Frühe Neuzeit – Moderne Welt ? Perspektiven der Forschung », in id., éd., Alteuropa – Ancien Régime – Frühe Neuzeit. Probleme und Methoden der Forschung, Stuttgart / Bad Cannstatt, Frommann / Holzboog, 1991.
Bödeker, Hans Erich (éd.), Begriffsgeschichte, Diskursgeschichte, Metapherngeschichte, Göttingen, Wallstein, 2002.
Bödeker, Hans Erich, « ‘Aufklärung über Aufklärung ?’ Reinhart Kosellecks Interpretation der Aufklärung », in Carsten Dutt et Reinhard Laube (éd.), Zwischen Sprache und Geschichte. Zum Werk Reinhart Kosellecks, Göttingen, Wallstein, 2013.
Escudier, Alexandre, « “Temporalisation” et modernité politique : penser avec Reinhart Koselleck », in Annales H. S. S., 64e année, no 6, novembre-décembre 2009.
Decultot, Elisabeth et Fulda, Daniel (dir.), Sattelzeit. Historiographiegeschichtliche Revisionen, Berlin, Oldenburg, 2016.
Koselleck, Reinhart, « Richtlinien für das ‘Lexikon Politisch-sozialer Begriffe der Neuzeit’ », in Archiv für Begriffsgeschichte, vol. 11, Bonn, Bouvier, 1967.
Koselleck, Reinhart, « Wozu noch Historie », in Historische Zeitschrift, no 212, 1971.
Koselleck, Reinhart, « Einleitung », in Otto Brunner, Werner Conze et Reinhart Koselleck dir., Geschichtliche Grundbegriffe : historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, vol. 1, Stuttgart, Klett-Cotta, 1972.
Koselleck, Reinhart, Kritik und Krise : eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt, [1954] Fribourg/Brisgau-Munich, Alber, 1959 ; édition modifiée définitive, Francfort/Main, Suhrkamp, 1973.
Koselleck, Reinhart, Preußen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848, [= thèse d’habilitation, sous la direction de Werner Conze, soutenue en 1965] Stuttgart, Klett (Coll. « Industrielle Welt » de l’Arbeitskreis für moderne Sozialgeschichte, dirigée par Werner Conze, vol. 7), 1967 ; 2e édition révisée, Stuttgart, Klett, 1975.
Koselleck, Reinhart, « ‘Erfahrungsraum’ und ‘Erwartungshorizont’ – zwei historische Kategorien », in Ulrich Engelhardt, Volker Sellin et Horst Stuke (éd.), Soziale Bewegung und politische Verfassung. Beiträge zur Geschichte der modernen Welt. Werner Conze zum 31. Dezember 1975 [= Industrielle Welt, Sonderband], Stuttgart, Klett-Cotta, 1976.
135Koselleck, Reinhart, Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeit, Francfort/Main, Suhrkamp, 1979.
Koselleck, Reinhart, « Théorie de l’histoire et herméneutique » [« Historik und Hermeneutik », 1985], in id., L’Expérience de l’histoire, Paris, Le Seuil / Gallimard, 1997.
Koselleck, Reinhart, « Begriffsgeschichte, Sozialgeschichte, begriffene Geschichte », entretien avec Christof Dipper, in Neue Politische Literatur, 43e année, 1998, no 2.
Koselleck, Reinhart, Zeitschichten. Studien zur Historik, Francfort/Main, Suhrkamp, 2000.
Koselleck, Reinhart, et Schmitt, Carl, Der Briefwechsel (1953-1983), Berlin, Suhrkamp, 2019.
Leonhard, Jörn, « Erfahrungsgeschichten der Moderne : Von der komparativen Semantik zur Temporalisierung europäischer Sattelzeiten », in Hans Joas et Peter Vogt (éd.), Begriffene Geschichte. Beiträge zum Werk Reinhart Kosellecks, Berlin, Suhrkamp, 2011.
Olsen, Niklas, History in the plural : an introduction to the work of Reinhart Koselleck, New York, Berghahn Books, 2012.
Pocock, John. G. A., « Concepts and Discourses : A Difference in Culture ? Comment on a Paper by M. Richter », in Hartmut Lehmann et Melvin Richter eds., The Meaning of Historical Terms and Concepts. New Studies on Begriffsgeschichte, Washington D. C., German Historical Institute, Occasional Paper no 15, 1996.
Pocock, John. G. A., L’ancienne constitution et le droit féodal, Paris, PUF, 2000.
Rosa, Hartmut, « Bewegung und Beharrung. Überlegungen zu einer sozialen Theorie der Beschleunigung », in Leviathan. Zeitschrift für Sozialwissenschaft, 27e année, 1999.
Rosa, Hartmut, Accélération. Une critique sociale du temps [2005], Paris, La Découverte, 2010.
Rosa, Hartmut, Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive [2010], Paris, La Découverte, 2012.
Sawilla, Jan Marco, « ‘Geschichte’ : ein Produkt der deutschen Aufklärung ? Eine Kritik an Reinhart Kosellecks Begriff des ‘Kollektivsingulars Geschichte’ », in Zeitschrift für Historische Forschung, vol. 31, no 3, 2004.
Sawilla, Jan Marco, « Geschichte und Geschichten zwischen Providenz und Machbarkeit. Überlegungen zu Reinhart Kosellecks Semantik historischer Zeiten », in Hans Joas et Peter Vogt (éd.), Begriffene Geschichte. Beiträge zum Werk Reinhart Kosellecks, Berlin, Suhrkamp, 2011.
Scheuerman, William E., « Liberal Democracy and the Empire of Speed », in Polity, vol. 34, no 1, automne 2001.
136Scheuerman, William E., « Speed, States, and Social Theory : A Response to Hartmut Rosa », in Constellations. An international journal of critical and democratic theory, vol. 10, no 1, mars 2003.
Scheuerman, William E., Liberal Democracy and the Social Acceleration of Time, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2004.
Stefan, Jordan, « Die Sattelzeit. Transformation des Denkens oder revolutionärer Paradigmenwechsel ? », in Achim Landwehr (éd.), Frühe Neue Zeiten. Zeitwissen zwischen Reformation und Revolution, Bielefeld, Transcript, 2012.
Jordan, Stefan, Geschichtstheorie in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Schwellenzeit zwischen Pragmatismus und Klassischem Historismus, Francfort/Main, Campus, 1999.
Steinmetz, Willibald, « Multiple Transformations : Temporal Frameworks for a European Conceptual History », in id., Michael Freeden et Javier Fernandez-Sebastián (éd.), Conceptual History in the European Space, New York / Oxford, Berghahn, 2017.
Stockhorst, Stefanie, « Novus ordo temporum. Reinhart Kosellecks These von der Verzeitlichung des Geschichtsbewußtseins durch die Aufklärungshistoriographie in methodenkritischer Perspektive », in Hans Joas et Peter Vogt (éd.), Begriffene Geschichte. Beiträge zum Werk Reinhart Kosellecks, Berlin, Suhrkamp, 2011.
1 Koselleck, 1972, p. xv.
2 Jordan, 1999.
3 En 1998, R. Koselleck a relativisé le choix même du vocable de « Sattelzeit », à l’occasion d’une demande circonstantielle de subvention à la recherche, cf. Koselleck, 1998, p. 195 (« Sattelzeit » : « ein komisches Wort », « ein Kunstgriff », i. e. un artifice verbal, « das sich dann als theorieträchtiges, aber doch semantisch als etwas schwaches oder metaphorisch arg anreicherbares Etwas erwiesen hat »).
4 Koselleck, 1972, p. xiv.
5 Koselleck, 1972, p. xv : « Der heuristische Vorgriff der Lexikonarbeit besteht in der Vermutung, daß sich seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts ein tiefgreifender Bedeutungswandel klassischer topoi vollzogen, daß alte Worte neue Sinngehalte gewonnen haben, die mit Annäherung an unsere Gegenwart keiner Übersetzung mehr bedürftig sind. Der heuristische Vorgriff führt sozusagen eine ‘Sattelzeit’ ein, in der sich die Herkunft zu unserer Präsenz wandelt. Entsprechende Begriffe tragen ein Janusgesicht : rückwärtsgewandt meinen sie soziale und politische Sachverhalte, die uns ohne kritischen Kommentar nicht mehr verständlich sind, vorwärts und uns zugewandt haben sie Bedeutungen gewonnen, die zwar erläutert werden können, die aber auch unmittelbar verständlich zu sein scheinen. Begrifflichkeit und Begreifbarkeit fallen seitdem für uns zusammen ».
6 Koselleck, 1973.
7 Ces trois couples d’opposition, complétés ultérieurement par Koselleck dans ses textes, cursifs, d’anthropologie quasi-transcendantale, sont avancés comme catégories fondamentales de toute « ontologie historique » dès le 21 janvier 1953 dans une longue lettre à Carl Schmitt et dès Kritik und Krise en 1954/59. Sur ce point, voir Olsen, 2012, p. 58 sq. et désormais la correspondance entre K. Koselleck et C. Schmitt, 2019, p. 9-13.
8 Olsen, 2012.
9 Koselleck, 1975.
10 Cf. les longues notes infrapaginales sur quelques concepts-clefs dans Kritik und Krise, des notes d’histoire conceptuelle qui sont considérablement allongées dans la réédition chez Suhrkamp en 1973 (faite sur l’édition de 1959 et non de 1973, la traduction française renvoie ces longues notes en annexe : Le Règne de la critique, Paris, Minuit, 1979. Les notes traduites en français sont donc moins complètes que celles, révisées, de l’édition Suhrkamp de 1973).
11 Olsen, 2012.
12 Koselleck, 1972, p. xiv.
13 Koselleck reviendra régulièrement, et frontalement, sur ces questions à partir de « Wozu noch Historie » (Koselleck, 1971). Ses (quatre) volumes-recueils d’articles à partir de Vergangene Zukunft (1979) sont parsemés de cette continue remise sur le métier de l’exigence d’une théorie des temporalités historiques en tant que question épistémologique englobante de l’histoire. Cette notion, proprement épistémologique, de « temporalité » n’a rien à voir avec les langages et imaginaires passés relatifs aux « temporalités » de l’histoire du côté des acteurs et de leurs discours (i. e. les régimes d’attente). Le concept épistémologique de « temporalité » (versus « causalité ») doit donc être nettement distingué, chez Koselleck, d’un concept empirique-discursif de « temporalité » (concept « indicateur » / « facteur » d’histoire, « horizon d’attente »).
14 À l’encontre de la stigmatisation, proto-autoritaire, dont cette bureaucratie fait l’objet après 1945, afin d’expliquer la catastrophe nazie et l’exceptionnalité historique allemande en termes de modernisation avortée.
15 En 1975, Koselleck prend directement position contre une critique de J. Kocka dans la préface à la seconde édition révisée de l’ouvrage : « Die theoretische Leitfrage zielt immer wieder auf zeitliche Verlaufsweisen und auf zeitliche Differenzen, die sich aus den wechselseitigen Beziehungen der verschiedenen Handlungseinheiten und Sachverhalte ergeben » (Koselleck, 1975, p. 6 non paginée). Dans le même sens encore : « Die sachlichen Prioritäten gewinnen dann zeitlichen Vorsprung. Sie stiften Ablaufzwänge, die unumkehrbar, Folgelasten, die unaufhebbar werden. So engt sich der Handlungsspielraum mit dem Zeitablauf immer mehr ein. Provisorien gewinnen Dauer. Nur im Medium solcher zeitlichen Strukturen erhalten die empirischen Daten geschichtliche Qualität » (ibid.). Une introduction théorique de 50 pages à cet ouvrage n’a jamais été imprimée. Il conviendrait d’aller voir si l’épistémologie ultérieurement stabilisée s’y trouve dès l’époque énoncée, mais nous y renonçons ici tout à fait.
16 Pour une présentation générale de la « Sattelzeit », voir Stefan, 2012.
17 Koselleck, 1967. Une première version de ce texte a circulé dès 1963 au sein de l’Arbeitskreis für Sozialgeschichte, d’où la double datation « 1963/67 ».
18 Koselleck, 1967, p. 82, 91 et 95 (pour « Sattel-zeit ») et p. 96 et 99 (pour « Sattelzeit ») ; comparer à la version de 1972, dans Koselleck, 1972, p. xv et xxvi.
19 Koselleck, 1967, p. 81-82 : « Es geht darum, den Begriffswandel aus vorrevolutionärer Zeit über die revolutionären Ereignisse und Wand-/lungen hinweg bis in unseren Sprachraum hinein zu verfolgen. Das heuristische Prinzip dabei ist, daß bei gleichen Worten erst seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts der heutige Bedeutungsgehalt soweit feststeht, daß er keiner “Übersetzung” mehr bedarf. Der heuristische Vorgriff führt sozusagen eine ‘Sattel-zeit’ ein, in der sich die Herkunft zu unserer Präsenz wandelt. Begriffe dieser Zeit tragen ein Janusgesicht : rückwärtsgewandt meinen sie soziale und politische Sachverhalte, die uns ohne Übersetzung und Deutung der Worte nicht mehr verständlich sind, vorwärts und uns zugewandt haben sie Bedeutungen gewonnen, die einer Übersetzung nicht mehr bedürftig sind. Begrifflichkeit und Begreifbarkeit fallen seitdem zusammen » (comparer mot pour mot à Koselleck, 1972, p. xv).
20 Koselleck, 1967, p. 91, également p. 84 (comparer à Koselleck, 1972, p. xv pour « Beginn der ‘Neuzeit’ », p. xix pour « Entstehung der Neuzeit » ainsi que « Umwandlungsprozeß zur Moderne » et p. xxiv pour « Strukturwandel der Geschichte »).
21 La notion de « Wandel » (ailleurs « Umbruch ») est récurrente, cf. Koselleck, 1967, p. 82, 84, 86, 91, 99.
22 Koselleck, 1967, p. 91 et 99.
23 Koselleck, 1967, p. 89.
24 Koselleck, 1967, p. 87-88 (comparer à Koselleck, 1972 GG, I, p. xx). La question des « sources » discursives mobilisables (Quellen) recoupe cette question du « cui bono » pragmatique, et Koselleck distingue d’emblée entre un niveau « moyen », « haut » et « bas » relativement à l’échelle matérielle concrète et littéraire-philosophante (ou pas) de l’espace public (Koselleck, 1967, p. 97-98, à comparer à Koselleck, 1972, p. xxiv-xxv).
25 Partiel autant que partial, caricature mal informée autant que désinformante, le dialogue de sourds avec Quentin Skinner et John Pocock est à cet égard désarmant, autant que stratégiquement révélateur. C’est sans doute parce que toute cette tradition de recherche, et leurs légions d’épigones contemporains académiquement employables, n’a jamais eu qu’un rapport tout littéraire, de pure érudition intertextuelle, aux structures d’action du politique, de l’économique, du social et du religieux.
26 Koselleck, 1967, p. 82.
27 Koselleck, 1967, p. 84 (comparer à Koselleck, 1972, p. xxi-xxii).
28 Koselleck, 1967, p. 96-97.
29 Koselleck, 1967, p. 95 (comparer à Koselleck, 1972, p. xxvi).
30 Koselleck, 1967, p. 89 et 93 (comparer à Koselleck, 1972, p. xiv).
31 Koselleck, 1967, p. 85 (comparer à Koselleck, 1972, p. xxiv).
32 Koselleck, 1967, p. 91, 92, 93 (comparer à Koselleck, 1972, p. xv : « Erfahrungswandel » et « Erfahrungshorizont » y apparaissent).
33 Outre une première approche du problème dans l’étude séminale de 1967 sur la fin du topos « Historia magistra vitae » (Koselleck, 1979, p. 46), ce n’est qu’en 1975/76 que Koselleck affinera ces deux catégories de l’expérience et de l’attente, cf. Koselleck, 1976, (repris dans Koselleck, 1979).
34 J’ai défendu ailleurs, et maintiens ici, la thèse qu’en dépit de leur fortune (désormais décorative, en tant qu’armature théorique obligée plutôt que démontrée) les catégories ultérieures de « champ d’expérience » et « horizon d’attente » requièrent une description phénoménologique bien plus fine que tout ce que Koselleck a pu esquisser. Voir Escudier, 2009, en particulier p. 1275 et 1280 sq.
35 La formule-clef ramassant les différents processus aperçus en 1963-1967 est la suivante : « Die Begriffe sind also nach dem jeweiligen Erfahrungshorizont aufzuschlüsseln : inwieweit dieser “geschichtsphilosophisch”, “ideologisch”, “abstrakt” ist, kann nur die Einzelanalyse ergeben » (Koselleck, 1967, p. 93). Le résumé symétrique, stabilisé, de 1972 s’énonce ainsi : « Alle genannten Kriterien, die Demokratisierung, die Verzeitlichung, die Ideologisierbarkeit und die Politisierung bleiben unter sich aufeinander verwiesen. Ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit behalten sie heuristischen Charakter, um den Gebrauch neuzeitlicher Terminologie gegen deren vorrevolutionären Zusammenhänge abgrenzbar zu machen. Aus dem heuristischen Vorgriff folgt nun keineswegs, daß ihn die Geschichte jedes Begriffs bestätigen müßte » (Koselleck, 1972, p. xviii).
36 Koselleck, 1972, p. xvi.
37 Koselleck, 1967, p. 91 et 99.
38 Koselleck, 1972, p. xvi-xvii.
39 Koselleck, 1967, p. 88, 91, 92 et 93.
40 Koselleck, 1972, p. xvii-xviii.
41 Koselleck, 1967, p. 91 (« Ideologisierung »), p. 92 (« Abstraktionsgrad » ; « Manipulierbarkeit ») et p. 93 (« abstrakt »).
42 Koselleck, 1972, p. xvii.
43 Koselleck, 1972, p. xviii.
44 Koselleck, 1967, p. 88 et 92.
45 Koselleck, 1967, p. 83 (comparer à Koselleck, 1972, p. xix).
46 On reconnaît là les premiers travaux et la critique expresse de John Pocock (Pocock, 2000). Ce dernier a radicalement critiqué par ailleurs la forme d’exposition même du « Lexikon », en tant qu’inadéquate à la reconstruction des paradigmes langagiers organisant les dynamiques politiques sous-jacentes (Pocock, 1996).
47 Sur cette ligne convergente de contestation du concept d’« époque-charnière » moyennant la reconduction de la méthodologie générale, cf. entre autres textes et auteurs : Bödeker – Hinrichs, 1991 ; Bödeker, 2002 ; Bödeker, 2013 ; Steinmetz, 2017 ; Leonhard, 2011.
48 Koselleck, 1972, p. xxi : « Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ». Sauf à en escamoter la pointe interprétative, il me semble qu’il convient de toujours traduire cette formule récurrente (renversable en « Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen ») en distinguant nettement le « simultané » (temps calendaire quantitatif) du « contemporain » (temps qualitatif de l’historicité).
49 Sawilla, 2004 et Sawilla, 2011. Voir également Stockhorst, 2011.
50 En réinjectant dans le débat tous les types de textes et de pratiques, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’on trouve à l’arrivée la diffraction plurielle qu’on y a mise au départ de sorte à se mettre en position d’argumenter la critique souhaitée, cf. par exemple Decultot – Fulda, 2016.
51 Voir les propositions faites en ce sens, en forme de topique comparatiste, dans Escudier 2009, p. 1292 sq.
52 C’est bien évidemment l’argument-massue contre Gadamer visant à subordonner l’herméneutique (et toute la tradition philologique depuis August Boeckh et le xixe siècle) à la théorie de l’histoire, cf. Koselleck, 1985, in Koselleck, 1997 ; Koselleck, 2000, p. 15.
53 Le processus sémantique de « Demokratisierung » pointé par Koselleck n’épuise, à mon sens, en aucune manière le processus sociétal moderne de « démocratisation », dont nous sommes bien encore les contemporains, mais des contemporains toujours déçus par construction (relativement aux exigences inhérentes à la promesse même).
54 Rosa, 1999 ; Rosa, 2010 ; Rosa, 2012.
55 Rosa, 2018.
56 Ce qui n’est nullement le cas chez un interlocuteur trop peu discuté de H. Rosa, cf. Scheuerman, 2001, p. 41-67 ; Scheuermann, 2003, p. 42-48 ; Scheuermann, 2004.