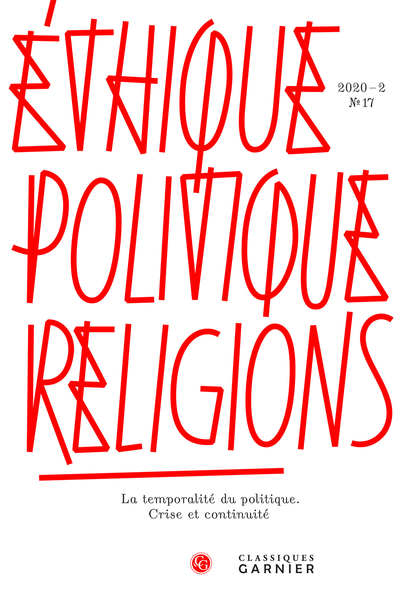
Ernst Kantorowicz et le problème de la continuité
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Éthique, politique, religions
2020 – 2, n° 17. La temporalité du politique. Crise et continuité - Auteur : Godefroy (Bruno)
- Résumé : Cet article analyse, dans l’œuvre de Ernst Kantorowicz, le « problème de la continuité », c’est-à-dire comment est théorisée la permanence de l’ordre politique au-delà des ruptures menaçant sa stabilité. Ce thème est central dans Les Deux Corps du roi, mais cette étude montre qu’il s’agit d’un des fils directeurs de toute l’œuvre de Kantorowicz. Trouvant son origine dans un débat marqué par le contexte politique des années 1930, il mêle dès l’origine des enjeux tant historiques que politiques.
- Pages : 97 à 114
- Revue : Éthique, politique, religions
- Thème CLIL : 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN : 9782406110972
- ISBN : 978-2-406-11097-2
- ISSN : 2271-7234
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11097-2.p.0097
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 01/02/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Kantorowicz, Stefan George, continuité, institutions, deux corps du roi
Ernst Kantorowicz et le problème
de la continuité
Les Deux Corps du roi, publié aux États-Unis en 1957, est un ouvrage fondamental pour comprendre l’émergence de l’idée d’une continuité des institutions et son rapport avec la genèse de l’État moderne1. Selon son auteur, l’historien allemand Ernst Kantorowicz, le xiiie siècle voit apparaître une nouvelle expérience du temps qui se manifeste notamment, dans les débats scolastiques, à travers un regain d’intérêt pour les catégories temporelles aristotéliciennes. L’idée principale développée par Kantorowicz, en particulier dans le chapitre vi consacré à la continuité et les corporations, est que la conception moderne de l’État comme une institution perpétuelle indépendante des personnes qui la composent et l’incarnent prendrait naissance au Moyen Âge, précisément dans ce changement d’attitude par rapport au temps. L’État serait alors moins défini par sa continuité spatiale que par sa continuité temporelle, ce que permet d’assurer la métaphore des deux corps du roi en affirmant la persistance d’un corps immatériel au-delà de la mortalité du souverain. L’importance du « problème de la continuité » (Kantorowicz, 1981, p. 273) dans l’œuvre de Kantorowicz a déjà été soulignée dans la réception. Un excellent ouvrage consacré au cercle de Stefan George, dont Kantorowicz faisait partie, remarque l’importance de cette problématique temporelle dans toute l’œuvre de Kantorowicz, mais sans toutefois approfondir ses enjeux théoriques2. Robert E. Lerner, 98auteur d’une biographie de référence, s’est également penché sur le problème de la continuité, mais son principal objectif est avant tout de retracer l’évolution de ce thème dans les différents manuscrits non publiés du vivant de Kantorowicz3. Ceux-ci sont en effet des témoins importants pour comprendre l’apparition de cette question dans son œuvre, mais la seule étude philologique de cette évolution ne permet pas d’en souligner tous les enjeux. En particulier, si elle permet de montrer comment cette question évolue dans l’œuvre de Kantorowicz, il est nécessaire d’aller plus loin pour comprendre non pas comment, mais pourquoi Kantorowicz s’est autant intéressé au problème de la continuité. L’objectif de cet article est donc, en reconstruisant le problème de la continuité à la fois chez Kantorowicz et dans le contexte intellectuel dans lequel son œuvre se développe, d’apporter une vision plus précise du problème lui-même, c’est-à-dire de sa conception chez Kantorowicz, mais en lien avec un contexte plus large. Il s’agit pour ce faire de procéder à une double reconstruction historique : retracer et expliciter d’une part la genèse du problème telle que Kantorowicz la présente, mais également d’autre part la genèse du problème chez Kantorowicz lui-même.
Le problème de la continuité
selon Kantorowicz
Le problème de la continuité, interprété plus largement dans le cadre d’un « problème du Temps » (ibid., p. 271)4, joue un rôle central dans son œuvre en tant que question inhérente à l’ordre politique dans son rapport au temps. Le problème de la continuité prend sa source dans un fait évident, la mortalité du souverain qui représente et dirige la société. La continuité en question renvoie donc d’une part à l’exercice du pouvoir par l’instance souveraine mais également, plus généralement, à la continuité de l’ordre et à la cohésion de la société dans le temps, 99dans la mesure où le souverain en est le représentant. La mort du souverain pose non seulement la question de la continuité de l’exercice du pouvoir, mais également du maintien de l’existence de l’ordre politique dans l’interrègne et de la continuité entre la période qui s’achève et celle qui lui succède.
La formulation explicite du problème de la continuité et son articulation théorique vont de pair avec un changement de « sentiment du temps » (Zeitgefühl) que Kantorowicz situe, en Europe, à partir du milieu du xiiie siècle : « quelque chose qui était stable et établi était devenu instable et changeant – ou même contestable – et […] quelque changement sérieux était en train de se produire à l’intérieur du domaine du Temps, et dans la relation de l’homme au Temps » (ibid., p. 274). Les causes de ce changement majeur, qui « touche presque tous les secteurs de la vie » (ibid., p. 283), ne sont pas claires, et Kantorowicz se borne à constater, sans déterminer de causalité, l’apparition simultanée d’une réflexion philosophique sur le temps et l’éternité et de manifestations de ce même problème dans d’autres domaines, en particulier dans la sphère politico-légale, où émergent des « tendances vers la “continuité” » (ibid., p. 273). Les évolutions dans le discours philosophique s’opposent au dualisme augustinien traditionnel entre temps et éternité atemporelle. Pour Kantorowicz, la séparation stricte entre le temps éphémère et passager des affaires humaines et l’éternité atemporelle de Dieu entraîne une « dégradation morale » du temps (ibid., p. 275). Il est le symbole de l’éphémère, du passager, puisqu’il a été créé en même temps que le monde et que les différentes créatures qui l’habitent et est destiné à disparaître avec elles au Jugement dernier. C’est pourquoi les catégories du temps – tempus, temporalis et saecularis – se limitent à l’expression de la brièveté de la création et de l’importance seulement relative de la vie en ce monde. Cette dépréciation du temps est la conséquence de la valorisation parallèle de l’éternité comme sphère atemporelle réservée à Dieu, où tout est instantanément présent.
Dans la polémique de Heidegger contre cette conception augustinienne de l’éternité comme « présence constante » (Heidegger, 2006, n. 1, p. 427), comme nunc stans, comme « maintenant » absolu extrait de la suite des moments qui constituent le temps, ce dernier affirme qu’une compréhension véritable de l’éternité devrait au contraire s’orienter vers une « temporalité plus originelle et “infinie” (unendlich) » (ibid.). 100Or c’est précisément vers cette compréhension de l’éternité que tend l’intermédiaire entre temps et éternité qui se développe dans la philosophie médiévale comme réponse à la crise du rapport au temps. Le temps n’est, dans cette nouvelle conception, plus synonyme de finitude et de corruption. Au nouveau « sentiment du temps » répond une conception de l’éternité du monde comme continuité intra-temporelle, donc comme une durée sans fin, qui donne sens à la réussite ici-bas, laquelle n’est plus dénigrée pour son caractère éphémère et vain mais acquiert au contraire une valeur intrinsèque. Si le temps et le monde durent, il en va de même des réalisations humaines dans le temps. Cette nouvelle attitude vis-à-vis du temps – avant même l’apparition de l’« éthique protestante » – transforma et énergisa profondément la pensée occidentale (cf. Kantorowicz, 1981, p. 274). Le concept correspondant à cette nouvelle expérience du temps apparaît dans le cadre d’une redécouverte de la philosophie d’Aristote, en particulier de la doctrine de l’éternité du monde. Selon cette conception, le temps est infini, il est une « durée sans fin », il est « le symbole de l’éternelle continuité et de l’immortalité du grand collectif appelé la race humaine » (ibid., p. 277), reprenant ainsi l’immortalité des espèces postulée par Aristote. Mais l’idée de « continuité éternelle » diffère profondément de l’éternité uniquement réservée à Dieu dans le schéma augustinien, la « continuité » indiquant que cette éternité est bien temporelle, dans le temps, et réunit donc les deux contraires. Il ne s’agit ni complètement de tempus, ni d’aeternitas mais d’une troisième catégorie, que l’on trouvait déjà dans le christianisme primitif : l’aevum, translittération du grec ancien aiôn. Ce terme redécouvert par la philosophie scolastique reprend la signification qu’il a dans les écrits néotestamentaires. Il est selon les termes de Kantorowicz « une sorte d’infinité et de durée dotée de mouvement et donc d’un passé et d’un futur, une sempiternité [sempiternity] […] infinie [endless] » (ibid., p. 279). L’aevum se distingue de l’éternité dans la mesure où il ne coexiste pas au temps en l’excédant à l’infini – comme l’éternité –, car il est aussi fini et créé, comme le temps. On parle d’une éternité « participée », car elle participe à la fois de l’éternité et du temps sans coïncider avec eux, mais reprend des caractéristiques propres à chacun. Comme l’éternité, l’aevum est doté de l’immobilité de nature mais reste soumis, comme le temps, à la succession de l’avant et de l’après. Pour la théologie, l’aevum n’est donc ni la durée de Dieu ni celle des hommes, 101mais notamment celle des anges ainsi que des corps ressuscités après le Jugement dernier5.
C’est précisément cette notion d’aevum qui, comme le montre Kantorowicz, vient casser le dualisme augustinien et apporte l’intermédiaire entre temps et éternité préfiguré dans le changement de l’expérience du temps, puis traduit dans le débat philosophique6. Or c’est justement cette catégorie temporelle qui entrera dans le domaine politique par l’intermédiaire des fictions des juristes, qui l’adoptent comme une solution à leur recherche d’une catégorie temporelle permettant de désigner la pérennité des institutions7.
La force et l’originalité de la pensée de Kantorowicz résident dans sa capacité à lier la « grande crise dans le rapport de l’homme au Temps » à la question de la continuité de l’ordre politique. Ce faisant, il cherche à rendre visible un processus d’interaction entre le discours philosophique et la théorie juridique. Pour Kantorowicz, s’il y eut une « sécularisation », c’est une sécularisation qui se concentre sur cette notion d’aevum, dans la mesure où cette temporalité attribuée aux anges devient la temporalité de l’ordre politique8.
L’aevum entre dans le champ politique par l’intermédiaire des spéculations des juristes, auxquels Kantorowicz attribue un rôle crucial dans la transformation des notions théologiques et philosophiques en concepts politiques. Les catégories temporelles issues du débat philosophique interviennent dans le cadre du développement, également au xiiie siècle, d’une « doctrine de l’identité perpétuelle d’une communauté malgré 102le changement » (ibid., p. 302), appliquée aux communautés, villes et royaumes. Ces personnifications, les « fictions » juridiques, sont bien entendu elles aussi une réponse au problème de la continuité, mais se démarquent selon Kantorowicz des réponses pratiques et symboliques plus anciennes, notamment des personnifications issues de l’Antiquité. Ces représentations antiques reposent en effet sur un « anthropomorphisme » (ibid., p. 303) dans la mesure où la perpétuité et l’immortalité de ces figures était liées au fait qu’elles sont associées à des déesses. Cet aspect cultuel disparaît dans les fictions des juristes – d’où la « sécularisation » –, lesquelles établissent une réponse moderne, rationalisée au problème de la continuité et, surtout, universellement applicable car elle repose sur un modèle théorique indépendant des situations particulières. Issu de la spéculation philosophique, ce modèle n’est plus fondé sur une personnification anthropomorphique mais il attribue aux fictions juridiques un corps « invisible », immortel et perpétuel (ibid., p. 304). Il s’agit alors de personnifications qualifiées d’« angélomorphiques » car elles prennent pour modèle tant le corps invisible des anges que, bien entendu, la temporalité qui leur est caractéristique : l’aevum.
Le terme utilisé pour désigner ces fictions juridiques provient du droit romain. L’universitas, dans ce nouvel emploi, désigne le « collectif corporatif en général » comme une « conjonction ou collection d’une pluralité de personnes dans un corps », applicable tant à un royaume qu’à un peuple, voire au monde entier. À nouveau, le développement de l’universitas s’inscrit dans le « problème de la continuité » (ibid., p. 307). Tandis que la notion d’aevum, désignant la sempiternité, constituait une réponse à ce problème dans le domaine philosophique, la notion d’universitas devient son pendant, par l’intermédiaire des juristes, dans le domaine politique. Concevoir un groupe comme universitas permet de préserver son unité malgré les changements, car l’universitas n’est pas une personne réelle, mais une personne intellectuelle et immortelle. L’universitas se définit en effet non comme le groupe d’individus immédiatement présents mais comme la « succession de ses membres », c’est-à-dire comme l’unité de ses membres passés, présents et futurs ; « grâce à son auto-régénération successive, l’universitas ne meurt pas et est perpétuelle » (ibid., p. 308). Elle est à ce titre comparable à la notion de « corps mystique » développée par Thomas d’Aquin, « composé non seulement de ceux qui vivent simultanément dans l’oikumene ecclésiastique 103et à l’intérieur de l’Espace universel, mais qui comprenait aussi tous les membres passés et futurs, actuels et potentiels, qui se suivaient successivement dans un Temps universel » (ibid., p. 309). Davantage que la pluralité dans l’espace, c’est la pluralité dans le temps, la succession, qui est le caractère essentiel des corps collectifs, qu’ils soient désignés comme universitas ou corpus mysticum, garantissant ainsi leur sempiternité.
C’est en mettant l’accent sur l’importance de la continuité des corps collectifs que Kantorowicz revient au « mythe de l’État » qu’il évoque, en référence à Cassirer, dans la préface de The King’s Two Bodies9. La mise en lumière du rôle des catégories temporelles dans la formation des fictions juridiques associées aux corps collectifs lui permet en effet d’affirmer la nécessité de mettre l’élément temporel au premier plan de la théorie de l’État. La question des structures temporelles de l’ordre politique se trouve ainsi effectivement transférée dans un cadre théorique qui dépasse la seule étude historiographique, dans la mesure où Kantorowicz souligne un « défaut » dans la conception purement organologique de l’État, qui considère ses membres « principalement comme ils sont représentés à un moment donné, mais sans se projeter au-delà du Maintenant dans le Passé et le Futur » (ibid., p. 311). Il manque à cette conception organologique la dimension temporelle, qui prend en compte le problème de la continuité au-delà de l’instant présent, au-delà de la communauté des vivants qui sont présents en même temps. Cette conception n’est pas en mesure d’assurer la perpétuité de l’État. Le changement qui intervient entre le xiiie et le xive siècle à la suite du nouvel intérêt pour les catégories temporelles marque au contraire pour Kantorowicz la naissance de l’État moderne. Avec la notion d’universitas, l’idée d’une continuité « verticale » plus qu’« horizontale » (ibid., p. 312), l’État acquiert la capacité de se projeter dans le passé et dans le futur, la 104préservation de l’identité malgré les changements et enfin l’immortalité juridique. L’étude de la fiction des deux corps du roi s’inscrit dans le cadre plus large de cette réflexion sur le rôle de la perpétuité des corps corporatifs dans la théorie moderne de l’État. Comme on le voit, cette référence au « mythe de l’État » constitue un des points où il devient difficile de discerner si Kantorowicz parle du xiiie ou du xxe siècle, dans la mesure où l’étude historique est aussi une intervention dans un contexte contemporain. Si l’on veut donc comprendre l’intention qui motive cette genèse du problème de la continuité chez Kantorowicz – et ce faisant également comprendre comment il conçoit le « problème de la continuité » au xxe siècle –, il est nécessaire de discerner de quoi il est implicitement question : c’est-à-dire de se concentrer non uniquement sur le texte de Kantorowicz, mais de le remettre dans son contexte afin de comprendre dans quel débat il intervient et comment il s’y situe.
Le problème de la continuité
dans l’œuvre de Kantorowicz
Les études historiques de Kantorowicz ne peuvent être totalement séparées du contexte dans lesquelles elles sont rédigées, dans la mesure où leur auteur parle constamment, à travers les phénomènes historiques passés, de son présent. Ainsi, bien que Kantorowicz cherche à retracer l’apparition du problème de la continuité dans l’histoire des idées, l’intérêt qu’il porte à ce problème tout au long de son œuvre n’est pas purement historique. Au contraire, la continuité représente aussi un enjeu politique, comme le montre l’histoire de son développement dans son œuvre.
Une formule de Kantorowicz résume bien l’importance de la question du temps pour sa conception d’une théorie de l’État. Il s’agit d’une note écrite à la main en marge d’un manuscrit non publié, écrit probablement entre 1935 et 1937, mentionnant en quelques mots l’intuition qui guide son œuvre : « déplacement de l’État de l’espace vers le temps10 ! ». 105Dans ce texte largement repris dans le chapitre vi des Deux Corps du roi, Kantorowicz met déjà en lumière un changement de rapport au temps intervenant au xiiie siècle comme étant à l’origine d’une réflexion théorique sur les structures temporelles de la souveraineté et qui conduirait, en particulier, à l’articulation du problème de la continuité. Ce texte, à travers la clarté avec laquelle il discerne le problème, marque un tournant dans son œuvre, mais on retrouve déjà la question de la continuité dans ses ouvrages plus anciens. Ce problème se manifeste en effet dès la biographie à succès de l’empereur Frédéric II, publiée en 1927 et assidûment révisée par Stefan George11. Cette problématique joue alors avant tout un rôle dans le cadre de la création d’un mythe nationaliste. Le problème de la continuité n’y apparaît en effet que de manière implicite, en tant qu’il donne son sens à la construction du mythe de l’empereur, comme réponse à la vacance du pouvoir et à l’« absence de continuité du cours de l’histoire allemande ». Kantorowicz rapporte ainsi que, à la mort de Frédéric II, une prophétesse prononça ces mots : « Er lebt und er lebt nicht » (Il vit et ne vit pas), faisant ainsi écho au mythe qui se forma autour de l’empereur, qui devint après sa mort une figure messianique, sommeillant dans les montagnes du Kyffhäuser avant qu’il ne se réveille pour rétablir le Saint Empire romain germanique12. Ce faisant, la prophétesse concentre en une seule formule la question présente comme un fil rouge dans toute l’œuvre de Kantorowicz, celle de la continuité devant être assurée lors de l’interrègne, suite à la mort du souverain13. Mais, à la dernière ligne de sa biographie, Kantorowicz 106s’éloigne du mythe traditionnel et le transforme. Non l’empereur, mais le peuple allemand serait celui qui « vit et ne vit pas », le porteur de la continuité annoncé par la sibylle. Durant la situation d’interrègne qu’était, à ses yeux, la République de Weimar – les unkaiserliche Zeiten dont parle Kantorowicz14 –, cette interprétation prend elle-même valeur d’évocation d’une continuité oubliée, qui doit être remémorée afin de surmonter la situation présente. C’est précisément cette évocation implicite d’un mythe nationaliste – des rumeurs invérifiables affirment que Hitler avait beaucoup apprécié le livre15 – qui mènera Kantorowicz à refuser une réédition de cet ouvrage après la guerre, jusqu’en 1963, montrant ainsi qu’il considère bien cette strate de sens comme un élément important de Kaiser Friedrich der Zweite16. Le « mythopoète » Kantorowicz, le créateur de mythes17, est encore à l’œuvre dans le cours magistral qu’il consacre à « l’Allemagne secrète » (das geheime Deutschland) en 1933, son dernier cours à Francfort avant son départ forcé d’Allemagne. Kantorowicz reprend dans ce texte un thème cher à Stefan George et 107à son cercle, l’« Allemagne secrète », sorte de noblesse traversant les âges, composée de la « communauté secrète des poètes et des sages, des héros et des saints, des sacrificateurs et des sacrifiés que l’Allemagne a engendrés et qui se sont donnés à l’Allemagne » (Kantorowicz, 1933, p. 80). Bien que Stefan George n’ait pas pris position vis-à-vis de la « nouvelle Allemagne » d’alors, Kantorowicz présente l’« Allemagne secrète » comme un contre-modèle élitaire. À cette occasion réapparaît son attention particulière à la question de la continuité, dans la mesure où l’« Allemagne secrète » repose précisément sur une continuité spécifique, qui fait écho aux dernières pages de Friedrich der Zweite. Elle est « à la fois présente et absente » (da und nicht da), « à la fois temporelle [zeitlich] et éternelle [ewig] », car elle ne se limite pas à un groupe d’hommes vivant à un instant précis. Elle est au contraire la communauté de ses membres passés, présents et futurs, c’est-à-dire, dans la terminologie des Deux Corps du roi, une continuité « verticale » temporelle et non « horizontale » et spatiale (Kantorowicz, 1981, p. 312). Cependant, Kantorowicz se concentre alors avant tout – ce pour quoi il fut par la suite critiqué – sur la création de cette continuité sur laquelle repose le mythe, mais il insiste également sur des éléments qui conserveront indéniablement une place de première importance dans les analyses plus scientifiques de son œuvre tardive.
L’omniprésence du problème de la continuité dans l’œuvre de Kantorowicz s’explique donc tout d’abord par sa volonté, dans ses premiers textes (avant son départ d’Allemagne en 1938), d’élaborer un mythe nationaliste à partir des fondements intellectuels du cercle de Stefan George. Cela n’est en soi pas une surprise ; Kantorowicz, qui fut à dix-neuf ans engagé volontaire dans l’armée lors de la Première guerre mondiale puis participa, en tant que membre d’un corps franc, à des combats de rue contre des groupes communistes, notamment lors de la répression sanglante de la République des conseils de Bavière, fait ainsi passer son engagement politique dans ses travaux scientifiques18. Mais pourquoi cette traduction s’articule-t-elle autour de nul autre problème que celui de la continuité ? Pourquoi ce problème est-il un enjeu ? On peut bien entendu souligner que l’histoire allemande, marquée par la création tardive d’un État unifié, entretient un rapport forcément 108problématique avec cette notion. Cependant, ce simple constat général est insuffisant. L’intérêt que porte Kantorowicz à ce problème à cette époque reste en effet difficilement compréhensible s’il n’est pas vu comme une intervention dans une discussion qui animait alors les sciences historiques19. Or c’est aussi dans ce contexte que le sens politique que prend le problème de la continuité, au-delà de l’œuvre de Kantorowicz, devient particulièrement net.
Si, comme le rappelle l’ethnologue Hermann Bausinger, la notion de continuité est désormais « neutralisée » et n’est plus que le « caractère distinctif d’une tradition longue et ininterrompue » (Bausinger, 1969, p. 11), si elle a fait l’objet d’une « déproblématisation » (Brückner, 1969, p. 37), il n’en a pas toujours été ainsi. Dans l’Allemagne de l’entre-deux-guerres, le problème de la continuité n’est pas insignifiant et la continuité est alors reconnue dans les sciences historiques comme une notion essentielle au cœur d’une querelle majeure, plus précise que l’habituel cliché sur le problème de continuité de l’histoire allemande. Le débat est initié en 1918 par l’historien autrichien Alfons Dopsch, qui introduit la notion de continuité en l’appliquant principalement à la transition entre l’Antiquité et le Moyen Âge. Dopsch, contrairement à l’opinion alors dominante, ne considère pas la période des « invasions barbares » comme une rupture, mais comme une transition progressive, préservant la continuité entre Antiquité et Moyen Âge. C’est autour de cette interprétation que le problème de la continuité devient un thème classique20. Il dépasse cependant rapidement le seul cadre des sciences historiques et prend une tonalité ouvertement politique avec la thèse de la « continuité germanique », lancée par l’historien Otto Höfler en 1937, qui donne au « problème de la continuité » une tournure particulière au sein de laquelle la démarche de Kantorowicz – dont le texte précédemment évoqué date de la même époque – devient compréhensible. Höfler, qui est un acteur influent de la propagation de l’idéologie nationale-socialiste dans les sciences historiques, reformule le problème de 109la continuité et le situe à la transition entre l’Antiquité germanique et romaine et le Moyen Âge germanique21. Affirmant ouvertement l’actualité de son propos, qui doit avoir des conséquences pour la « conscience historique » de son époque, Höfler développe un projet cherchant clairement à casser l’idée d’une « continuité romaine » ayant recouvert l’héritage germanique. On pourrait au contraire selon lui parler d’une « continuité germanique » ininterrompue, fondement de l’Allemagne jusqu’à aujourd’hui. Höfler, dont la méthode mettant surtout l’accent sur la signification des symboles se rapproche de celle de Kantorowicz – ou encore du médiéviste Percy Ernst Schramm – construit sa thèse de la continuité à partir d’un exemple particulier. Comme la couronne dans Les Deux Corps du roi, la démonstration de Höfler est centrée sur un objet emblématique du Saint Empire, la « sainte lance », dite également lance de Longinus, un des insignes impériaux. Selon une tradition répandue, la lance aurait été offerte par Rodolphe II de Bourgogne à l’empereur Heinrich Ier, qui l’intégra aux insignes impériaux, la lance tenant sa valeur exceptionnelle d’un fragment de la croix du Christ qui y serait enchâssé et de son précédent possesseur, l’empereur Constantin. Si on suit cette tradition, « la continuité de la sacralité de l’Empire apparaît donc étroitement liée au Sud et à l’Est » (Höfler, 1938, p. 7), une thèse que Höfler n’apprécie manifestement pas. C’est donc avec un indéniable souci du détail qu’il cherche à défendre une thèse alternative, en lisant ce problème apparemment purement historique comme un problème – c’est bien, en 1937, tout l’enjeu – « politico-historique » (ibid., p. 13). Pour Höfler, la lance est représentative d’une continuité différente de la simple histoire de la transmission de l’objet, une continuité symbolique prenant sa source non au Sud et à l’Est, mais au Nord. La lance comme symbole du pouvoir du souverain serait en effet issue d’une tradition pluriséculaire germanique, dont la source ne serait nulle autre que la lance brandie par Odin, modèle germanique du dieu-roi. À partir de l’exemple de la lance, la thèse de la continuité germanique prend la 110forme d’une mythologie politique englobante, rejetant la conception purement rationnelle et moderne du politique, qui reste aveugle à sa dimension symbolique et donc à la profonde continuité traversant les siècles, et dont la redécouverte doit permettre à l’Allemagne de renouveler l’« affirmation de sa propre existence » (ibid., p. 26).
En rattachant ainsi la source de la dimension symbolique du pouvoir à une tradition germanique et nordique, Höfler lance indirectement une attaque massive contre toute idée de continuité romaine, qui est précisément celle défendue par le cercle de Stefan George, en particulier par Kantorowicz. Il n’est donc pas étonnant que la thèse de la continuité germanique se double, chez Höfler, d’une violente polémique dirigée directement contre le cercle de Stefan George, en particulier contre Kantorowicz et Friedrich Gundolf, tous deux juifs, mais également contre le modèle de continuité alternatif qu’est l’« Allemagne secrète », qu’il mentionne directement22. Cette polémique révèle clairement la structure du « problème de la continuité » dans les années 1930 et pourquoi Kantorowicz prend pour acquis ce problème dont les enjeux nous semblent aujourd’hui obscurs. C’est dans « Deutsches Papsttum », un texte peu connu écrit en 1933, diffusé à la radio en 1935 mais seulement publié – sans l’accord de l’auteur – en 1953, que Kantorowicz prend nettement position par rapport au problème de la continuité germanique23. À travers l’étrange conception d’une « papauté allemande », Kantorowicz cherche à mettre en avant les tensions entre l’identité allemande des papes allemands et leur exercice du pouvoir papal, c’est-à-dire principalement la tension entre provincialisme et universalisme. C’est par l’intermédiaire de ce second 111niveau de lecture que Kantorowicz réintroduit la continuité romaine porteuse d’universalisme face au provincialisme allemand, bien que la situation d’alors transparaisse dans ses remarques désabusées24. Qu’il se situe clairement du côté « romain », « méditerranéen », Kantorowicz l’avait encore plus clairement exprimé dans sa dernière lettre à Stefan George, datée du 26 novembre 1933, dans laquelle il affirme son allégeance à une « Allemagne secrète » romaine, héritière de l’empire des Hohenstaufen (et donc de Frederic II) et préservée, en attendant son réveil, dans le cercle de Stefan George25.
Dans le « problème de la continuité » se joue donc un débat éminemment politique au sein du symbolisme nationaliste allemand, où le mythe « romain » fait face au mythe völkisch, le nationalisme impérialiste d’intégration – un point important pour le cercle de Stefan George, dont de nombreux membres sont juifs – au nationalisme raciste d’exclusion26. Ce débat au sein de l’extrême droite allemande montre pourquoi la contribution de Kantorowicz à l’étude du problème de la continuité doit être comprise à deux niveaux : comme une étude scientifique, mais aussi comme une intervention indissociable de son contexte. C’est là la source de son intérêt pour ce problème, lequel passe toutefois dans son œuvre, progressivement, du statut d’intervention politique à celui de 112problème théorique. L’œuvre de Kantorowicz reproduit d’une certaine manière le processus qu’il décrit dans Les Deux Corps du roi : d’un problème politique de circonstance, le problème de la continuité devient un problème théorique essentiel.
Bruno Godefroy
Université Panthéon-Assas (Paris II)
113Références bibliographiques
Aubin, Hermann, « Zur Frage der historischen Kontinuität im Allgemeinen », Historische Zeitschrift, no 168, 1943.
Augustin, Cité de Dieu, t. 2, Paris, Seuil, 1994.
Bausinger, Hermann, « Zur Algebra der Kontinuität », in Hermann Bausinger et Wolfgang Brückner (éd.), Kontinuität ? Geschichtlichkeit und Dauer als volkskundliches Problem, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 1969.
Brückner, Wolfgang, « Kontinuitätsproblem und Kulturbegriff in der Volkskunde », in Hermann Bausinger et Wolfgang Brückner (éd.), Kontinuität ? Geschichtlichkeit und Dauer als volkskundliches Problem, Berlin, Erich Schmidt Verlag, 1969.
Delumeau, Jean, Mille ans de bonheur. Une histoire du paradis, Paris, Fayard, 1995.
Grünewald, Eckhart, Ernst Kantorowicz und Stefan George. Beiträge zur Biographie des Historikers bis zum Jahre 1938 und zu seinem Jugendwerk « Kaiser Friedrich der Zweite », Wiesbaden, Steiner, 1982.
Heidegger, Martin, Sein und Zeit, Tübingen, Niemeyer, 2006.
Höfler, Otto, « Das germanische Kontinuitätsproblem », Historische Zeitschrift, no 157, 1938.
Höfler, Otto, « Friedrich Gundolf und das Judentum in der Literaturwissenschaft », Forschungen zur Judenfrage. Schriften des Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschlands, vol. 4, Hamburg, Hanseatischer Verlagsanstalt, 1940.
Kantorowicz, Ernst, « Das Geheime Deutschland » (1933), Robert L. Benson et Johannes Fried (éd.), Ernst Kantorowicz. Erträge der Doppeltagung, Institute for Advanced Study, Princeton – Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt, Stuttgart, Steiner, 1997.
Kantorowicz, Ernst, The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology, Princeton, Princeton University Press, 1981.
Kantorowicz, Ernst, Götter in Uniform. Studien zur Entwicklung des abendländischen Königtums, Eckhart Grünewald et Ulrich Raulff (éd.), Stuttgart, Klett-Cotta, 1998.
Kantorowicz, Ernst, Kaiser Friedrich der Zweite, Stuttgart, Klett-Cotta, 2010.
Lerner, Robert E., « Kantorowicz and Continuity », Robert L. Benson et Johannes Fried (éd.), Ernst Kantorowicz. Erträge der Doppeltagung. Institute for Advanced Study, Princeton – Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt, Stuttgart, Steiner, 1997.
Lerner, Robert E., Ernst Kantorowicz. Une vie d’historien, Paris, Gallimard, 2019.
Losemann, Volker, Nationalsozialismus und Antike. Studien zur Entwicklung des Faches Alte Geschichte 1933-1945, Hamburg, Hoffmann und Campe, 1977.
114Raulff, Ulrich, Kreis ohne Meister. Stefan Georges Nachleben, Munich, Beck, 2010.
Raulff, Ulrich, « Der letzte Abend des Ernst Kantorowicz. Von der Würde, die nicht stirbt : Lebensfragen eines Historikers », Rechtshistorisches Journal, no 18, 1999.
Schmitt, Carl, Verfassungslehre, Berlin, Duncker & Humblot, 2003.
Schöttler, Peter, « Ernst Kantorowicz en France », Éthique, Politique, Religions, vol. 2, no 5, 2014.
Strauss, Leo, Gesammelte Schriften, vol. 3, Hobbes’ politische Wissenschaft und zugehörige Schriften – Briefe, Stuttgart, J. B. Metzler, 2008.
1 Selon Robert E. Lerner, auteur de la biographie de référence de Kantorowicz, il ne serait en aucune façon question de l’État moderne dans Les Deux Corps du roi, que Lerner présente comme un travail purement historique (Lerner, 2019, p. 556 sq.). Outre le fait que cette affirmation est peut-être volontairement exagérée, ne serait-que la référence au « mythe de l’État » et à Ernst Cassirer dans Les Deux Corps du roi, sur laquelle je reviendrai par la suite, montre que le thème de l’État moderne est aussi présent à l’arrière-plan. Cette biographie n’en reste pas moins nettement supérieure aux autres ouvrages disponibles en français. Sur la réception française et ses faiblesses, voir Schöttler, 2014.
2 Voir Raulff, 2010. S’agissant d’une étude d’histoire des idées, il est compréhensible que Raulff ne cherche pas à étudier en profondeur des problèmes théoriques. L’importance du temps et de la continuité pour Kantorowicz y est toutefois clairement remarquée, de même que la persistance de cette problématique tout au long de son œuvre. Voir en particulier p. 326 sq.
3 Voir Lerner, 1997.
4 L’usage particulier des majuscules par Kantorowicz a été respecté.
5 Voir A. Michel, « Éternité », Dictionnaire de théologie catholique, V : 1, col. 914. Kantorowicz fait brièvement référence à cet article dans The King’s Two Bodies, op. cit., n. 14, p. 280.
6 Bien qu’Augustin semble accorder une temporalité particulière aux anges, proches de l’aiôn, il n’abandonne toutefois pas le dualisme entre temps et éternité. Augustin s’attarde longuement sur la difficile question de la temporalité des anges, qui sont à la fois créés et immortels. Ils sont, selon Augustin, « de tout temps », car ils ont été créés par Dieu en même temps que le temps. Ce faisant, ils ne sont donc pas « coéternels » au Dieu créateur qui ignore toute durée séparant ce qui a été de ce qui sera. Les anges sont au contraire dans une durée infinie, mais qui est dans le temps. Voir Augustin, 1994, livre XII, chap. xv, p. 81-85.
7 La proximité entre la temporalité des fictions des juristes et celle des anges – l’aevum – n’est pas seulement remarquée par Kantorowicz. Selon lui, les juristes eux-mêmes étaient conscients de cette proximité et de la nécessité d’établir une distinction entre l’éternité et la temporalité propre aux abstractions juridiques. Voir Kantorowicz, 1981, n. 18 p. 282.
8 Il s’agit donc d’un usage beaucoup plus restreint et précis du schème de la sécularisation que dans la Théologie politique de Carl Schmitt.
9 Voir Kantorowicz, 1981, p. ix : « Dans la mesure où cette étude isole un seul élément d’une texture très compliquée, l’auteur ne peut prétendre avoir traité in extenso le problème qui fut appelé “le mythe de l’État” (Ernst Cassirer). Cependant, cette étude peut être une contribution à ce problème plus large bien qu’elle se limite à une seule idée directrice, la fiction des deux corps du roi, à ses transformations, implications et à son rayonnement ». Bien qu’il mentionne le livre de Cassirer, Kantorowicz s’en écarte largement. Alors que Cassirer oppose au mythe de l’État une politique rationnelle, Kantorowicz s’emploie à reconstruire ce « mythe » à travers la question de la continuité. Bien que, contrairement à ces premières œuvres, cette reconstruction soit également une déconstruction, il ne prend pas face au mythe de l’État une position rationaliste, comme le fait Cassirer.
10 Voir le texte non publié qu’Ernst Kantorowicz consacre au changement du « sentiment du temps » (Zeitgefühl), conservé au Leo Baeck Institute New York et disponible en ligne à l’adresse https://archive.org/details/ernstkantorowicz (consulté le 01/08/2020). Cette formule se trouve au feuillet numéroté 150 au cours de la numérisation. Pour la datation du texte – dont il existe deux versions –, voir Lerner, 1997.
11 Stefan George non seulement relut le texte, mais il assura aussi la publication de l’œuvre et prit en charge les négociations avec l’éditeur, persuadé que l’ouvrage de Kantorowicz rencontrerait un grand succès, ce qui se révéla exact. Avant le début de la Deuxième guerre mondiale, 12 200 exemplaires de Kaiser Friedrich der Zweite sont vendus, ce qui représente pour un ouvrage scientifique un succès exceptionnel. L’histoire de la publication de l’ouvrage et le rôle déterminant de George sont retracés dans Grünewald, 1982, p. 149-157.
12 Voir Delumeau, 1995, p. 74 sq.
13 Le thème de l’interrègne constitue précisément l’élément de liaison entre Kaiser Friedrich der Zweite et The King’s Two Bodies dans l’œuvre de Kantorowicz. Comme le précise Lerner, Kantorowicz évoque un projet de livre intitulé Interregnum dans une lettre à Stefan George datée du 22 mai 1932, un projet dont il souligne par ailleurs la résonnance avec la situation d’alors. Par manque de temps, le projet n’aboutira pas, mais Lerner suppose que le texte consacré au « changement du sentiment du temps », qui préfigure le thème central de The King’s Two Bodies, aurait dû servir d’introduction à cet ouvrage. Voir Lerner, 2019, p. 251 sq. et p. 316 sq.
14 Les premières éditions du livre paraissent avec une « remarque préliminaire » marquante, que Kantorowicz fit supprimer lors de la réédition d’après-guerre et ne se trouve pas dans l’édition française : « Lorsqu’en mai 1924 le royaume d’Italie fêta le septième centenaire de la fondation de l’Université de Naples, une création de Frédéric II de Hohenstaufen, une couronne de fleurs reposait au pied du sarcophage de l’Empereur, dans la cathédrale de Palerme, ornée de l’inscription : À SES EMPEREURS ET SES HÉROS L’ALLEMAGNE SECRÈTE [Das geheime Deutschland] Cela ne veut pas dire que la présente histoire de la vie de Frédéric II aurait été inspirée par cet événement […], mais celui-ci peut très bien être compris comme un signe que, même dans des cercles autres qu’érudits, une participation aux grandes figures de souverains allemands commence à s’éveiller – précisément en ces temps non impériaux [unkaiserlich] ». Voir Grünewald, 1982, p. 74-80, qui voit aussi dans cette remarque un indice du message très actuel que Kantorowicz voulait faire passer à travers la biographie de Frédéric II. La couronne de fleurs avait bien entendu été déposée par des membres du cercle de George, dont Kantorowicz, venus à cette occasion.
15 Voir Lerner, 2019, p. 188.
16 Voir Grünewald, 1982, p. 158-167. Après la parution de la nouvelle édition, Kantorowicz voit ses craintes confirmées par la première lettre de félicitations qu’il reçoit, dont l’auteur, Hans Speidel, est un ancien général de la Wehrmacht. Kantorowicz ignorait cependant que Speidel fut emprisonné de 1944 à la fin de la guerre pour ses liens avec le mouvement de résistance au sein de l’armée ayant conduit à l’attentat du 20 juillet 1944. Dans une lettre à son éditeur, Kantorowicz fulmine : « C’est exactement la clique à cause de laquelle j’ai si longtemps empêché une réimpression. Un livre qui était sur la table de nuit de Himmler et que Göring a offert, avec une dédicace, à Mussolini devrait simplement être condamné à l’oubli » (Ibid., p. 165).
17 Raulff, 1999, p. 180.
18 Sur les expériences guerrières de Kantorowicz, voir Lerner, 2019, p. 45-71.
19 Le problème de la continuité possède aussi un volet juridique s’inscrivant dans le même contexte, bien mis en valeur chez Schmitt, 2003, « § 10 Folgerungen aus der Lehre von der verfassunggebenden Gewalt, insbesondere der verfassunggebenden Gewalt des Volkes », p. 91-99.
20 Bausinger, 1969, p. 9 sq. L’ouvrage de Dopsch en question est Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Caesar bis auf Karl den Großen, 2 vol., Wien, Seidel, 1918 et 1920.
21 Il ne faudrait cependant pas transférer cette querelle académique dans le champ politique sans précaution. Si Höfler est le tenant d’une « continuité germanique », les dirigeants nationaux-socialistes n’étaient pas pour autant tous dans ce camp, certains préférant la « continuité romaine ». Le rapport à l’Antiquité n’est pas homogène : tandis qu’Alfred Rosenberg et Heinrich Himmler visaient à créer un culte de l’héritage germanique, Hitler semblait plus impressionné par Rome et la Grèce antique. Sur le rapport du national-socialisme à l’Antiquité, voir l’ouvrage classique de Losemann, 1977, ici p. 17-26.
22 Voir Höfler, 1940, p. 115-133. Dans ce texte radicalement antisémite, Höfler s’attaque à certains juifs allemands dont les positions nationalistes et antidémocratiques posent une difficulté certaine à l’idéologie nationale-socialiste. C’est notamment le cas de Friedrich Gundolf, professeur de littérature, poète et membre éminent du cercle de Stefan George. Höfler s’en prend également au « juif polonais Kantorowicz » (p. 120), et relève précisément la remarque préliminaire de Kaiser Friedrich der Zweite, proclamant l’« Allemagne secrète », comme étant le signe de l’aspiration du cercle au pouvoir politique. Höfler met à nouveau au pilori la « romanité » et le « catholicisme » dont se réclame Gundolf, mais c’est surtout l’élitisme des élus, ignorant la puissance vitale du peuple, qui constitue le principal objet de sa critique et lui permet de réussir à associer Gundolf à un cliché antisémite, celui du juif décomposant l’unité du peuple.
23 Voir l’introduction de Johannes Fried dans Kantorowicz, 1998, ici p. 32 sq. « Deutsches Papsttum » fut publié en 1953 dans CASTRVM PEREGRINI (no 12), un journal fondé aux Pays-Bas après la guerre par d’anciens membres du cercle de Stefan George. Sur l’histoire du texte, voir Grünewald, 1982, p. 131 sq.
24 Voir en particulier p. 9 : « En effet, l’Allemagne a déjà une fois été “romaine”, c’est-à-dire universelle et dans le monde [welthaltig] » et p. 20 : « Heinrich III ne pouvait pas savoir qu’absolument aucune papauté allemande universelle n’était possible, pour la simple raison que les Allemands ne sont eux-mêmes que dans les plus rares instants ou à travers leurs plus rares représentants à la fois allemands et universels, à la fois allemands et européens ».
25 Cité dans Grünewald, 1982, p. 127.
26 Notons cependant que, au sein même de la mouvance nationale-socialiste, la « continuité germanique » défendue par Höfler ne fait pas l’unanimité. Voir en particulier Aubin, 1943, p. 229-262. Cette opposition entre « romain » et völkisch au sein de l’extrême droite allemande me semble être aussi le cadre dans lequel la fameuse lettre de Leo Strauss à Karl Löwith, datée du 19 mai 1933, doit être comprise. Voir Strauss, 2008, p. 625 : « Et, en ce qui concerne le problème : le fait que l’Allemagne passée à l’extrême droite ne nous tolère pas ne signifie absolument rien quant aux principes d’extrême droite. Au contraire : ce n’est qu’à partir de ces principes, les principes fascistes, autoritaires, impériaux, que l’on peut protester avec honneur contre le fléau mesquin, sans faire ce ridicule et geignard appel aux droit imprescriptibles de l’homme [en français dans le texte]. […] Il n’y a aucune raison de ramper vers la croix pour la rémission de nos erreurs, pas même vers la croix du libéralisme, tant qu’une étincelle de la pensée romaine brille encore quelque part dans le monde ». La traduction française, ici profondément modifiée, est parue dans Cités, no 8, 2004/1, p. 173-227 (ici p. 194). Certaines lettres ont été tronquées, si bien qu’il n’existe pas encore d’édition française entièrement fiable de la correspondance.