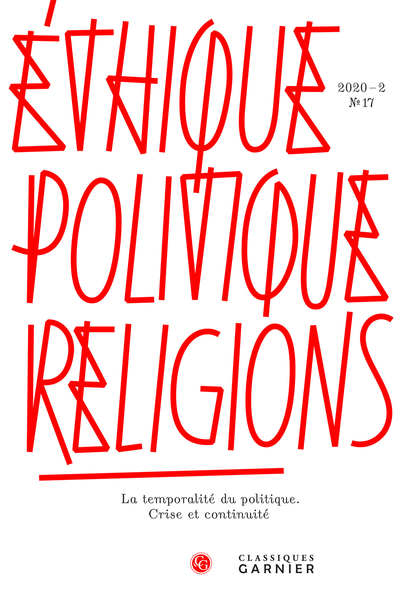
La dictature et le spectre de la répétition Continuité et discontinuité juridico-politique à l’ombre de la répétition historique
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Éthique, politique, religions
2020 – 2, n° 17. La temporalité du politique. Crise et continuité - Auteur : Goupy (Marie)
- Résumé : Cet article analyse la conception de l’histoire qui assoie le concept de dictature forgé par Carl Schmitt. Il montre que si la catégorie de dictature est un opérateur de continuité juridique, elle est aussi porteuse d’une conception de l’histoire hantée par le spectre de la révolution, ou plutôt par celui de la répétition de la révolution. Le concept de répétition révèle les formes paradoxales de continuité historique développées, ou masquées, derrière le discours juridique de la dictature.
- Pages : 75 à 95
- Revue : Éthique, politique, religions
- Thème CLIL : 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN : 9782406110972
- ISBN : 978-2-406-11097-2
- ISSN : 2271-7234
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11097-2.p.0075
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 01/02/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Dictature, révolution, spectre, continuité-discontinuité, histoire, passé
La dictature et le spectre
de la répétition
Continuité et discontinuité juridico-politique
à l’ombre de la répétition historique
Peu de concepts semblent aborder aussi directement le problème de la continuité et de la discontinuité politique que celui de dictature. Dans une tradition juridique que l’on pourrait qualifier de classique, au moins parce qu’on la fait remonter au droit romain, la dictature désigne l’institution provisoire créée afin de surmonter les situations de crise d’une gravité telle que l’existence de l’État se trouve menacée. En laissant de côté ici le statut juridique d’une telle institution – à l’intérieur ou à l’extérieur du droit, selon la formule de Giorgio Agamben (Agamben, 2003, p. 61) –, on remarquera seulement que du point de vue juridique, le rapport de la dictature à la temporalité politique est a priori relativement simple : la crise constitue une rupture dans la continuité juridico-politique et la dictature un sparadrap douloureux, mais transitoire, visant à la rétablir. Pour être plus exact, on dira que la dictature apparaît comme une figure double de la discontinuité et de la continuité, puisqu’elle rompt l’application ordinaire du droit tout en s’efforçant d’en garantir la sauvegarde dans la durée. Dans la plupart des théories juridiques de la dictature, la pensée de la (dis)continuité s’arrête plus ou moins là. La crise elle-même est assez généralement considérée comme un fait, objectivable ou exigeant au contraire une décision politique, mais demeurant quoiqu’il en soit à la frontière du droit. La théorie de la dictature de Carl Schmitt, telle qu’elle s’expose dans un livre éponyme de 1921 (Schmitt, 2000), illustre pleinement cette tradition de pensée, qu’il a d’ailleurs largement contribué à installer dans le champ juridique au xxe siècle. Les deux concepts de dictature de commissaire et de dictature souveraine, grâce auxquels le juriste soumet la tradition juridique de la dictature constitutionnelle et la tradition politique de 76la dictature révolutionnaire au cadre homogène de la théorie du droit, traduisent ainsi une vision schématique de la sauvegarde-continuité du droit et de la rupture-refondation, où la crise radicale se trouve instituée en fait historique indépassable que la pensée juridique doit affronter et résoudre. En réalité, le récit un peu confus de La Dictature laisse apparaître un rapport beaucoup plus complexe au problème de la continuité, en raison de la charge historique de l’ouvrage. Publié en 1921, le livre vise en effet très directement la possibilité d’une révolution prolétarienne en Allemagne, qui justifie au regard de Schmitt de revoir le concept de dictature. Plus profondément, le concept schmittien engage une conception de l’histoire appelée à jouer un rôle déterminant pour la compréhension du concept de dictature au xxe siècle.
C’est donc la conception de l’histoire qui assoie la construction du concept schmittien de dictature que cet article voudrait examiner, en montrant que derrière l’opérateur de continuité juridique que constitue la dictature, se masque une conception de l’histoire hantée par le spectre de la révolution, ou, plus exactement, par celui de la répétition de la révolution. Le concept de répétition invitera alors à penser les formes paradoxales de continuité historique qui se mettent en discours – et se masquent – derrière le discours juridique de la dictature.
La Dictature : du droit à l’histoire
En 1921, lorsque la Dictature paraît, la situation de l’Allemagne est on ne peut plus chaotique. Il est vrai qu’après l’adoption d’une nouvelle constitution le 11 août 1919, la République de Weimar semble pouvoir se stabiliser. Mais le régime, qui s’installe sur les décombres de l’Empire allemand et qui nait d’une révolution portée par des forces hétérogènes ne parvient guère, jusqu’en 1924, à sortir d’une situation de semi-guerre civile. Depuis la fin de la guerre, la République fait en réalité face à une pluralité de crise – crises économiques, crises institutionnelles et politiques, largement liées à l’après-guerre et à l’effondrement du Reich – que la théorie juridique aborde sous le vocabulaire opaque et sobre de la crise ou de l’urgence (Kervégan, 2002, p. 10). Derrière ce 77vocabulaire se dresse néanmoins un théâtre d’ombres qui projettent sur la république la possibilité d’un échec ou d’un renversement : le spectre d’une révolution socialiste d’un côté, qui hante l’Allemagne (et une large partie de l’Europe) dans l’après-guerre et que l’écrasement violent de la révolte spartakiste et de la République des conseils de Bavière contribue à radicaliser dans les esprits plutôt qu’à étouffer complètement ; la menace d’un coup d’État ou d’un coup militaire de l’autre, que la tentative du putsch de Kapp en mars 1920 ancre dans les représentations politiques des années qui suivront. Et si l’on ajoute que le putsch a été mis en échec par une grève générale appelée par les syndicats et les partis de gauche, c’est bien le portrait d’une société traversée par une sorte de lutte, réelle et fantasmée, entre deux courants révolutionnaire et contre-révolutionnaire échappant largement au contrôle du nouveau régime qui se dessine au début des années 201.
Publiée dans ce contexte, la Dictature ne masque qu’à moitié ses intentions politiques. L’ouvrage s’inscrit, il est vrai, dans une tradition juridique qui peut encore se réclamer du concept de dictature issu du droit romain. Pour bien des juristes de l’époque, la dictature constitue effectivement un terme générique visant à désigner les formes juridiques encadrées de l’exercice des pouvoirs exceptionnels permettant à un État constitutionnel d’affronter des situations de crise qui mettent en péril son existence. On parle même couramment, dans le milieu juridique, des pouvoirs dictatoriaux du président du Reich pour désigner les pouvoirs exceptionnels détenus par le chef de l’exécutif en vertu de l’article 48 de la Constitution de Weimar. Mais Schmitt n’écrit pas un ouvrage doctrinal d’interprétation juridique2. L’ouvrage se présente bien d’avantage comme une grande fresque historique dont l’État moderne et la dictature sont les figures héroïques, et dont la Révolution Française 78constitue le cœur et la clef. La Dictature propose en effet une sorte d’histoire articulée de l’État constitutionnel moderne et de la dictature, comprise comme institution garante de la construction et de la continuité de l’ordre juridique. Cette histoire vise bien sûr à montrer d’abord que l’État constitutionnel s’étant installé grâce à un exercice contrôlé de la dictature, il ne saurait se passer définitivement d’une telle institution, sauf à adopter une position suicidaire – ce qui est clairement, pour Schmitt, l’attitude des libéraux partisans de l’État de droit et d’un strict respect du principe de légalité3. Mais Schmitt ne s’en tient pas là. La fresque de la Dictature s’ordonne entièrement autour du tournant opéré par la Révolution Française, qui permet au juriste de poser deux thèses centrales : d’une part, si la Révolution a constitué un tournant dans l’histoire de l’État constitutionnel moderne en Europe, c’est parce qu’elle a inscrit au cœur du droit étatique même la possibilité d’une dictature non plus conservatrice mais fondatrice de droit, qui fixe dans sa structure juridique de l’État constitutionnel la possibilité même de son renversement – ou de la discontinuité juridique donc. D’autre part, l’ère des révolutions ouverte par la Révolution Française ne s’est pas refermée : elle est même bien plutôt à son acmé, au bord d’un dénouement qui peut faire basculer intégralement l’histoire de l’État constitutionnel vers sa fin.
Par ces deux thèses, La Dictature quitte le terrain strictement juridique pour entrer dans celui de la théorie de l’histoire. Et ce glissement vers une forme de pensée historique et philosophique du droit se situe d’abord directement dans les pas de la tradition de la Contre-Révolution.
79L’héritage contre-révolutionnaire :
la dictature contre le chaos de la refondation
L’héritage de la pensée contre-révolutionnaire n’est pas explicite dans La Dictature, comme il le sera dans Théologie politique4. Il éclaire pourtant assez bien la théorie schmittienne, ainsi que toute la structure du livre de 1921. Car si l’ouvrage ne se limite pas à proposer une interprétation ultra-large des pouvoirs de crise inscrits dans la Constitution de Weimar, il ne réalise pas non plus une histoire de la dictature sous la forme d’une description juridique des différentes formes de dictature ayant existé depuis l’antiquité romaine, comme on se plait encore à le faire aujourd’hui dans certains travaux d’histoire du droit. L’histoire articulée de la dictature et de l’État moderne traduit bien plutôt le projet d’exposer la signification historique de la dictature, c’est-à-dire d’abord, d’asseoir sa théorie juridique de la dictature sur une véritable conscience historique qui fait à ses yeux défaut dans la théorie juridique dominante de l’après-guerre (Schmitt, 2000, p. 11). C’est cette conscience historique qui a animé d’emblée, à ses yeux, la pensée contre-révolutionnaire de la dictature.
De Maistre comme Donoso Cortés ont en effet également construit leurs théories de la dictature en les adossant à une compréhension générale de l’histoire traumatisée par la Révolution. Pour les deux penseurs, la Révolution ne se résume pas effectivement au simple renversement de l’État absolutiste. Elle constitue plus radicalement un tournant historique marqué par la négation de tout ordre fondé sur la transcendance du pouvoir et légitimé par la tradition5 – un ordre qui a assuré la continuité sociale et politique jusqu’au xviiie siècle. La Révolution française est ainsi d’abord l’aboutissement du rationalisme de l’Aufklärung, dominé par une véritable foi dans l’autonomie de la raison, qui a pour corrélat d’admettre la possibilité de l’auto-fondation 80radicale6 – ou de la table-rase – que l’événement révolutionnaire fait sortir des brumes de la pensée hypothético-méthodologique – celle du contrat social – pour en faire une véritable possibilité historique. Mais elle inaugure ensuite, pour les deux penseurs, une gigantesque lutte de dimension historique globale entre deux conceptions de l’ordre, l’une fondée sur la croyance et l’autre sur la Raison auto-fondatrice, l’une sur la religion et l’autre sur la révolution, ou dans les termes de Donoso Cortés, une lutte entre le catholicisme et le socialisme, ou entre le Bien et le Mal (Donoso Cortés, 1859). Une telle conception de l’histoire est en réalité relativement statique. La lutte de ces deux principes n’est pas perçue comme un moteur historique, comme elle l’est en revanche dans l’idée de lutte des races telle que la développe Montlosier à peu près à la même époque (Montlosier, 1814)7. Elle se présente plutôt, selon les termes de Schmitt, comme « la conscience que l’époque réclame une décision, et c’est avec une énergie qui s’enfle jusqu’aux limites du possible entre les deux révolutions de 1789 et de 1848 que la notion de décision vient au centre de la pensée » (Schmitt, 1988, p. 62). Autrement dit, la théorie contre-révolutionnaire de la dictature repose sur l’idée que l’histoire de l’Europe est à un tournant décisif qui oppose deux conceptions de l’ordre possibles, en donnant à la dictature une portée qui excède largement la tradition juridique de la dictature romaine.
Mais la description de la conscience historique qui assoie la pensée contre-révolutionnaire de la dictature ne serait pas complète sans tenir compte de la dimension apocalyptique qu’elle reçoit chez Donoso Cortés. Pour De Maistre encore, l’ordre révolutionnaire qu’il combat se fonde sur le principe de la souveraineté du peuple, qui n’est pas seulement illégitime à ses yeux, mais surtout contradictoire et voué à l’échec (Maistre, 1992, p. 91-92). La dictature maistrienne s’érige donc d’abord en rempart contre le désordre8. Mais De Maistre, qui écrit dans le contexte de la Révolution Française même, croit encore à la restauration possible 81de la légitimité traditionnelle. C’est pourquoi, bien qu’elle ne soit plus à proprement parler une catégorie juridique, mais bien une catégorie historico-politique, la dictature qu’il appelle de ses vœux demeure transitoire9. Donoso Cortés en revanche voit s’éloigner la possibilité d’une restauration de la légitimité traditionnelle avec les révolutions de 1848 (Donoso Cortés, 1850, p. 79-80)10. Selon les termes de Schmitt, dès « que Donoso Cortés reconnut que le temps de la monarchie avait pris fin parce qu’il n’y avait plus de rois et qu’aucun d’eux n’aurait plus le courage d’être roi si ce n’est en passant par la volonté du peuple, il alla jusqu’au bout de son décisionnisme, c’est-à-dire qu’il réclama une dictature politique » (Schmitt, 1988, p. 74. Nous soulignons). Une telle dictature politique perd évidemment tout caractère transitoire. Elle est une forme de gouvernement posée comme un rempart ultime contre le chaos : « Donoso était persuadé que l’heure de l’ultime combat était venue ; face au mal radical, il n’y a que la dictature, et l’idée légitimiste de la succession héréditaire devient, à cette heure, arguties vides » (Schmitt, Ibid.). De Maistre à Donoso Cortés, on passe donc pour Schmitt « de la légitimité à la dictature » (Schmitt, 1988, p. 65).
La conscience historique caractéristique des penseurs de la Contre-Révolution ne se résume donc pas, pour Schmitt, à l’imminence d’une révolution ; elle réside bien plutôt dans l’idée qu’il existe une lutte historique globale entre deux conceptions de l’ordre. Cette lutte historique, ouverte avec la Révolution, ne s’est pas refermée selon le juriste : elle continue de constituer l’arrière-plan de toute théorie sérieuse de la dictature. Contre Donoso Cortés néanmoins, il récuse le glissement de la dictature comme institution dictatoriale transitoire vers une dictature politique permanente, issu à ses yeux de l’abandon de l’idée de légitimité par le marquis espagnol. Mais plus profondément, c’est bien la conscience historique qui assoie la théorie de la dictature qui est en jeu. Pour Donoso Cortés, si l’heure n’est plus au choix entre la liberté et la dictature, c’est que l’ordre classique fondé sur la légitimité est déjà perdu, en jetant l’histoire de la civilisation catholique au bord de l’abîme. Le moment historique dans lequel il situe sa pensée est donc proprement apocalyptique, et l’ambigüité de la dictature va bien au-delà 82d’une confusion entre dictature transitoire et dictature permanente, car si l’histoire se rapproche du déluge, constitué en véritable épreuve divine, « il ne sert à rien de se rebeller contre la Providence, contre la Raison, et contre l’histoire11 ». Autrement dit, avec Donoso Cortés, la dictature ne perd pas seulement son caractère transitoire faute de penser la possible restauration de l’ordre existant, mais elle risque surtout de n’avoir plus aucune nécessité dans le cadre d’une pensée de l’histoire pessimiste marquée par une téléologie apocalyptique (Paredes Goicochea, 2014, p. 61-71). Si Donoso Cortés a donc bien eu le mérite de soulever les véritables enjeux historiques d’une théorie de la dictature après le tournant révolutionnaire et jusqu’aux années 20, sa pensée demeure aporétique au regard de Schmitt, en raison de sa dimension apocalyptique qui le rend incapable de penser la dictature comme un véritable outil de sauvegarde de la continuité historique. C’est l’éclaircissement de la signification historique de la dictature depuis la Révolution qui va conduire le juriste à discuter, de façon plus ou moins explicite, avec la tradition marxiste.
Une dette ambiguë à l’égard
de la tradition marxiste :
dictature et dialectique historique
Comment interpréter la signification historique de la dictature, alors qu’à l’évidence l’histoire de la lutte entre la révolution et les forces de la contre-révolution (la religion, la tradition, et, en dernière instance, la dictature) n’a pas mené à l’apocalypse annoncé par Donoso Cortés, et alors que cette lutte semble mouvoir encore l’histoire à l’aube des années 20 ? Cette question ne signifie plus seulement pour Schmitt que la théorie de la dictature doive reposer sur une conscience historique des enjeux du présent. Plus profondément, elle suggère que le tournant de la Révolution Française a incrusté la dictature au cœur de l’histoire moderne d’une façon nouvelle, et qu’elle en éclaire le déroulement au 83xixe siècle. Cette dernière idée est nourrie, dans La Dictature, par une réception ambivalente et polémique, de la pensée marxiste. En effet, l’histoire dans laquelle la dictature prend place n’est pas l’histoire apocalyptique de Donoso Cortés, qui n’a pas perçu la dynamique historique de la lutte entre révolution et contre-révolution, que les marxistes, eux, ont parfaitement perçue12. Le dernier chapitre de La Dictature consacré à la « dictature dans l’ordre de l’État de droit existant » se présente effectivement comme l’exposé des formes de dictature, et plus précisément de ses formes légales dans l’État de droit naissant (la Loi Martiale, la suspension de l’empire de la Constitution du 22 frimaire an VII, l’état de siège13), telles qu’elles ont été mises en œuvre contre les émeutes révolutionnaires qui font hoqueter l’histoire depuis 1789 (celles de 1830, de 1848, de la Commune de Paris). L’histoire que propose Schmitt dans ce chapitre confus se construit donc autour d’une sorte de lutte – jamais rendue complètement explicite – de la révolution et de la dictature, ou, plus exactement, de la révolution et du droit intégrant, dans le cadre légal, les moyens de sa conservation. Et en assumant l’idée qu’une telle lutte de la révolution et du droit (appuyé par les formes légales de la dictature) ait joué un rôle moteur dans l’histoire européenne, Schmitt esquisse bien les traits d’une histoire dialectique de la révolution et de la contre-révolution (juridique), qui mime et déforme la pensée historique marxiste.
En mimant le modèle d’une pensée dialectique de l’histoire comme cadre conceptuel à partir duquel construire un concept moderne de dictature, Schmitt entend d’abord situer sa propre théorie : selon lui, à la différence des libéraux ou des marxistes révisionnistes, seuls les communistes opposés au révisionnisme sont véritablement capables de voir la portée proprement historique du concept de dictature. C’est d’ailleurs cette conscience prononcée dont les bolcheviques ont fait montre à ses 84yeux dans le débat qui les a opposés à certains acteurs de la révolution allemande – un débat dans lequel Schmitt prend ironiquement position en faveur des bolcheviques (Schmitt, 2000, p. 17 et 18). En 1918 en effet14, le marxiste allemand Karl Kautsky, qui participe l’année précédente à la fondation de l’USPD, publie une brochure intitulée La Dictature du prolétariat, au sein de laquelle il dénonce le virage centraliste et autoritaire de la conception bolchevique de la dictature. Contre celle-ci, Kautksy défend que la dictature prolétarienne ne peut jamais signifier la suppression de la démocratie, et, renonçant à l’idée que la dictature rompe nécessairement avec le droit de l’État bourgeois, il propose de la comprendre comme « l’état de chose, qui doit nécessairement se produire partout où le prolétariat a conquis le pouvoir politique15 » – une définition qui n’écarte donc pas l’idée que la dictature du prolétariat puisse s’exercer par les moyens de la conquête légale du pouvoir. Dans deux textes publiés en réponse au texte de Kautsky, Lénine et Trotski s’attaquent violemment à cette définition, qui finit par opposer implicitement selon eux dictature et démocratie (ou dictature démocratique et dictature non démocratique) en recouvrant la véritable opposition de la dictature bourgeoise et de la dictature prolétarienne (Lénine, 1971, p. 14)16. Mais de cette réponse cinglante, Schmitt retient surtout l’importance que les acteurs de la révolution bolchévique accordent au caractère transitoire de la dictature (Schmitt, 2000, p. 15), qui suppose une claire conscience de ce à quoi la dictature « fait exception » et de ce qu’elle prétend atteindre (Schmitt, 2000, p. 16). Car la dictature prolétarienne ne fait pas seulement exception à l’ordre juridique existant, mais elle en constitue la négation ; et elle ne prétend pas restaurer l’ordre juridique antérieur, pas plus qu’un nouveau régime, elle prétend établir un nouveau rapport social qui mette un terme à la lutte des classes, c’est-à-dire aussi à l’histoire dont elle a constitué le moteur et à l’État qui en a constitué la superstructure. En d’autres termes, la catégorie de dictature du prolétariat ne peut être comprise sur un simple plan juridico-institutionnel : elle n’est pas un outil juridique permettant d’assurer une domination de classe, mais un moyen permettant de passer d’un rapport 85social dominant à un autre rapport social. Elle est un outil de transition historique radical qui engage une conception globale de l’histoire, ce qui en fait aussi « une catégorie de la philosophie de l’histoire » (Schmitt, 2000, p. 17). C’est à ce niveau que Schmitt situe son propre concept de dictature, en ouvrant alors une double discussion polémique avec la pensée marxiste (non « révisionniste »). D’un côté, le juriste va s’efforcer de relire la dialectique matérialiste de l’histoire de la révolution et de la contre-révolution dans des termes juridiques. De l’autre, il entend prouver dans ce cadre que la dictature du prolétariat est vouée à un échec potentiellement ravageur, qui prétend évidemment justifier que la dictature conservatrice de droit qu’il défend puisse utiliser tous les moyens de la puissance étatique pour la contrer.
En effet, la structure même de La Dictature s’organise autour d’une thèse centrale, dont la portée systématique n’est pas toujours relevée : la proclamation du principe de la souveraineté du peuple par laquelle la révolution française a inscrit au cœur de l’État constitutionnel même la possibilité de son renversement sous la forme d’une dictature souveraine17. Le concept de dictature souveraine, que Schmitt distingue de celui de la dictature de commissaire, ne vise pas alors la simple possibilité d’une révolution populaire qui renverserait un régime, mais bien celle d’un usage de la puissance de l’État au service de son propre renversement et de la fondation d’un nouvel ordre juridico-politique. Mais surtout, Schmitt veut indiquer qu’une telle forme de dictature souveraine est en quelque sorte inscrite dans la structure même de l’État constitutionnel et de son droit, qui, parce qu’il se fonde sur le principe de souveraineté du peuple, s’organise autour d’une domination de l’Assemblée devenue le nouvel organe d’une possible dictature souveraine légale. De façon tout à fait concrète, Schmitt insinue, sans en tirer explicitement les conséquences, que dans l’État constitutionnel désormais marqué par l’affirmation du principe de souveraineté du peuple, le danger ne vient pas d’une dictature exécutive, mais d’une dictature de l’Assemblée qui tomberait dans les mains d’une majorité révolutionnaire18. Schmitt met ainsi en contraste l’effort de l’Assemblée 86Nationale pour encadrer l’exercice des pouvoirs militaires mis en œuvre dans la répression des émeutes révolutionnaires, en particulier durant les terribles journées de juin 1848, et le caractère illimité des pouvoirs de l’Assemblée constituante elle-même, qui lui ont permis de fixer le cadre d’un pouvoir répressif sans garanties constitutionnelles (Schmitt, 2000, p. 199). Mais plus largement, Schmitt esquisse les principaux traits d’une interprétation juridique de la dialectique historique dans laquelle il situe sa théorie de la dictature. Car si l’affirmation d’après laquelle le principe de la souveraineté du peuple a mis en péril la stabilité de l’ordre étatique classique n’est évidemment guère originale dans une tradition de pensée juridique conservatrice19, ce qui l’est d’avantage en revanche, c’est l’idée qu’un tel principe pourrait constituer le moteur d’un conflit entre les forces révolutionnaires et les forces conservatrices autour du droit. Plus exactement, l’État constitutionnel, désormais structuré autour du principe de souveraineté du peuple, semble devenu dans La Dictature le vecteur d’une sorte de lutte du droit (pour sa conservation) et de la révolution – les forces révolutionnaires étant toujours plus conscientes que la maitrise du droit et de l’État constitue désormais le véritable outil d’une dictature révolutionnaire à même de renverser l’ordre existant. Et cette possibilité désormais inscrite dans l’édifice étatique lui-même semblerait alors expliquer implicitement les hoquets de l’histoire.
On peut alors penser que La Dictature dialogue autant avec Marx lui-même qu’avec la littérature bolchevique –, et en particulier avec les écrits consacrés à l’histoire française du xixe siècle20. Conformément aux indications données par Engels dans la préface des Luttes des classes en France, ces écrits peuvent être lus comme une application de la méthode matérialiste à la lecture des événements révolutionnaires – et contre-révolutionnaires – du siècle, en s’efforçant donc de « réduire les événements politiques aux effets de causes, en dernière analyse, économiques21 ». Or, en proposant 87de voir dans l’inscription du principe de la souveraineté du peuple au cœur du droit ce qui menace continuellement de faire vaciller l’édifice plusieurs fois centenaire de l’État constitutionnel, Schmitt esquisse une lecture non matérialiste de la dialectique historique de la révolution et de la contre-révolution : une lecture juridique, dans laquelle c’est bien la bataille autour du droit qui constitue le moteur de l’histoire. Pour Schmitt en effet, la dictature du prolétariat demeure bien une catégorie juridique, « parce que, en tant qu’exception, [la dictature du prolétariat] continue d’être placée sous la dépendance fonctionnelle de ce qu’elle nie », c’est-à-dire, l’ordre constitutionnel lui-même (Schmitt, 2000, p. 17). Autrement dit, la dictature du prolétariat n’est une dictature que parce qu’elle prétend renverser l’ordre constitutionnel existant, qui constitue donc la cible – et le moteur – de son action. Certes, la dictature du prolétariat n’entend plus fonder un nouvel ordre juridique mais bien renverser l’ordre du droit lui-même, c’est-à-dire toute organisation sociale dont le droit constitue à la fois la forme et le langage22. De telle sorte que la dictature du prolétariat ne signifie plus alors seulement une rupture dans l’ordre constitutionnel – de la monarchie à la République, et de la République à l’Empire –, mais bien la fin de l’histoire de l’État constitutionnel lui-même. Mais la question est alors de savoir, pour Schmitt, si en exploitant les outils offerts par la légalité dans l’objectif de renverser le système constitutionnel, la dictature peut bien sortir du droit, ou si elle n’est pas plutôt destinée à devenir purement et simplement une forme de dictature souveraine légale permanente23 ? En clair, Schmitt conteste que la dictature du prolétariat permette de « sortir de l’histoire » précisément parce que la dictature demeure un outil juridique, qui ne pourra jamais se « supprimer » lui-même.
C’est dans le cadre de cette histoire dialectique de nature juridique que Schmitt situe sa propre théorie de la dictature ; c’est elle qui justifie sa conception musclée de la dictature de commissaire érigée en rempart contre la dictature souveraine prolétarienne menaçant de faire basculer 88l’histoire dans le chaos. À première vue, la dictature schmittienne est simplement conservatrice, aussi bien sur un plan juridique que sur un plan historique : elle vise à garantir la restauration du droit et à garantir la continuité historique de l’État constitutionnel. En réalité, Schmitt ne fait pas seulement de la dictature un moyen de maintenir la continuité du droit et de l’État, mais en même temps un instrument susceptible de mettre un point final à la dialectique de la révolution et du droit, de la dictature révolutionnaire et de la dictature contre-révolutionnaire. Cette dimension « messianique » n’est jamais explicite dans La Dictature, ni dans Théologie politique. Elle structure pourtant selon nous la construction même de l’ouvrage de 1921, ainsi que dans la lecture qu’il rend en 1922 de la pensée de la Contre-Révolution.
Dictature messianique et spectre de la répétition dans la pensée contre-révolutionnaire
De Donoso Cortés à Schmitt
Le concept de dictature se situe ainsi sur deux plans différents, sources d’une véritable ambiguïté de la théorie schmittienne. Sur un premier plan, la dictature constitue une catégorie juridique, lestée par la conscience historique du moment critique que l’État constitutionnel doit affronter – une situation révolutionnaire supposée qui menace de le renverser. Sur un second plan en revanche, la dictature est un concept relevant de la philosophie de l’histoire : elle vise à mettre un terme à la dialectique de la révolution et du droit, qui a conduit à une sorte de répétition de la révolution à laquelle il s’agit de mettre un terme. Cette idée de répétition historique n’est pas présente en tant que telle chez Schmitt. On fera l’hypothèse ici que le spectre d’une répétition désormais toujours possible de la révolution constitue précisément l’un des traits structurants de la pensée contre-révolutionnaire, au moins à partir de Donoso Cortés, qui fait justement l’expérience de la répétition.
Il est notable en effet que la célèbre « théorie » de la dictature de Donoso Cortés se réfère généralement d’abord à un discours lapidaire que le marquis et député prononce le 4 janvier 1849 devant les Cortès 89espagnoles, en réponse au discours du chef de l’opposition progressiste à l’encontre du ministère du général Narváez, accusé d’avoir abusé des pleins pouvoirs qui lui avaient été cédés par l’Assemblée pour réprimer les agitations révolutionnaires de l’année 1848 en Espagne24. La pensée de Donoso Cortés n’a effectivement pas toujours été aussi violemment contre-révolutionnaire25. L’expérience des révolutions de 1848 constitue bien plutôt l’un des événements centraux qui contribuent à la radicalisation, sinon au bouleversement de sa pensée26. Et l’on peut penser sans risque de trop extrapoler qu’elle affecte sensiblement la conception de l’histoire qu’il construit à la même époque en recevant l’héritage des penseurs de la Contre-Révolution (Demesley, 2016). La répétition de l’événement révolutionnaire modifie en particulier la perception du danger que représente le principe révolutionnaire, qui n’est plus, comme chez De Maistre, le risque d’une refondation ou d’une tabula-rasa radicale (déjà dramatique pour de Maistre), mais celui d’une refondation toujours possible qui ruine définitivement tout ordre légitime stable. Autrement dit, alors que pour De Maistre, l’heure est à la lutte historique de la foi contre la Raison, chez Donoso Cortés, la révolution s’est incrustée dans la pensée historique sous la forme d’une répétition toujours possible de la refondation (et de la révolution) qui met fin à toute idée de continuité politique fondée sur la tradition, voire sur la légitimité. La dictature dont se revendique Donoso Cortés n’est donc pas seulement opposée à la révolution : elle vise à sortir du chaos historique né du principe révolutionnaire de la refondation 90toujours possible. C’est aussi pourquoi, sans l’expliciter d’ailleurs outre mesure, Donoso Cortés défend une dictature du gouvernement non pas contre des émeutes révolutionnaires, mais bien contre une dictature de l’insurrection, dont on peut penser qu’elle constitue le strict pendant de la première : l’exercice d’un pouvoir illimité et centralisé visant à permettre une victoire définitive de la révolution27. La dictature contre-révolutionnaire de Donoso Cortés reçoit ainsi un statut apocalyptique28 : elle est celle qui doit permettre de sortir de la répétition révolutionnaire qui menace de conduire au chaos. Et elle se situe au bord de l’abîme, là où la fin de l’histoire menace d’advenir. Et ceci explique l’ambivalence du concept de dictature de Donoso, puisque si d’un côté la dictature apparaît comme ce qui permet de sauver l’ordre catholique en le maintenant dans l’histoire, d’un autre côté, elle inaugure bien plutôt une situation de fin de l’histoire, qui s’achève dans le combat apocalyptique du Bien contre le Mal (Donoso Cortés, 1970, p. 325 sq.). Mais quoiqu’il en soit de cette ambiguïté, le concept de dictature inaugure une conception de l’histoire dont l’éternelle répétition de la révolution constitue le spectre et dont elle incarne la fin – qu’il s’agisse de sortir de la répétition, ou qu’il s’agisse, de façon ambiguë donc, de sortir de l’histoire.
Schmitt perçoit clairement les limites de la dimension apocalyptique de l’histoire de Donoso Cortés, qui le conduit à défendre une dictature politique incapable de viser la restauration d’un ordre juridique. Mais il n’examine pas véritablement la complexité de la conception postrévolutionnaire de l’histoire du marquis espagnol, qui ne se distingue pas seulement par l’abandon de l’idée de légitimité, mais qui, en amont, pense l’histoire à partir du spectre de la révolution, né de l’expérience (traumatique) de sa répétition. Cette expérience anime la conscience historique de Donoso Cortés, qui intègre l’idée que la révolution peut toujours être recommencée, c’est-à-dire que son spectre continuera de planer sur l’histoire européenne.
91La théorie schmittienne de la dictature repose encore selon nous sur cette conscience historique29, qu’il systématise sous la forme d’une conception de l’histoire structurée par la lutte de la révolution et du droit. Cette histoire, saccadée par les répétitions des évènements révolutionnaires à chaque fois contrés par les formes légales de la dictature, est menacée par la perspective d’une dictature révolutionnaire légale : une dictature de l’Assemblée, c’est-à-dire, une forme de dictature souveraine visant néanmoins une sortie de l’histoire de l’État constitutionnel et de son ordre légal. La dictature conservatrice que réclame Schmitt n’a donc pas seulement pour objectif d’empêcher une révolution à la suite d’autres révolutions ; elle n’a pas non plus pour finalité de freiner le basculement de l’histoire dans le chaos – à la manière de Donoso Cortès. Elle vise à mettre un terme à la dialectique historique de la révolution et de la contre-révolution, c’est-à-dire à mettre un terme à la répétition de la révolution pour rétablir la continuité de l’histoire. La dictature schmittienne possède donc une dimension « katékhontique », mais peut-être même messianique – car il ne s’agit peut-être plus alors implicitement de retenir le déchainement du mal, mais plus radicalement de briser la répétition de l’histoire en « sortant » d’une histoire hantée par la répétition. La portée de la conception de l’histoire qui assoie la dictature n’est ni aboutie, ni pleinement développée dans La Dictature ; elle demeure à l’état de conscience historique hantée par un spectre : celui de la répétition. Car, à la différence de Marx, Schmitt ne semble pas remarquer que la répétition est d’abord un spectre30, c’est-à-dire qu’elle est fantasmée autant que réelle. Et cette dimension spectrale charge la théorie de la dictature d’une très profonde ambiguïté, mais peut-être aussi d’une ambivalence : une dictature contre-révolutionnaire qui vise à empêcher une révolution souveraine risquant de faire basculer le monde dans le chaos pourrait avoir à se maintenir autant que dure (et se répète) le spectre de la révolution ; une dictature visant à mettre un terme définitif à la répétition révolutionnaire pourrait devenir elle-même révolutionnaire, et viser elle-même une sortie de l’histoire.
92On connaît la célèbre phrase qui ouvre Le 18 Brumaire de Louis Napoléon Bonaparte : « Hegel remarque quelque part que tous les grands événements et les grands personnages de l’histoire universelle adviennent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d’ajouter ; la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce (…) » (Marx, 2007, p. 49). Tout Le 18 Brumaire, qui s’efforce de produire une analyse matérialiste des événements historiques qui vont de 1848 à 1852, s’efforce en même temps de donner un sens à cette apparente répétition historique des événements, qui tourne en 1852 à la farce tragique31. On peut lire La Dictature de Schmitt en partie comme une réponse à la lecture matérialiste de la dialectique historique de la révolution et de la contre-révolution : une réponse juridique très conservatrice, qui fait de l’inscription du principe de la souveraineté du peuple au cœur de l’État constitutionnel l’origine de sa déstabilisation. Mais cette réponse, qui se construit à partir d’un héritage de la pensée contre-révolutionnaire, ne perçoit pas, elle, la portée de l’idée de répétition qui habite la conception de l’histoire des penseurs de la contre-révolution. Car si Schmitt a bien lu Le 18 Brumaire, il n’a manifestement pas relevé la dimension idéologique du fantasme de la répétition chez Marx, qui ne réduit pas la répétition historique à n’être que le produit de rapports matériels (Assoun, 1999). De ce point de vue, là où Marx pense en même temps les dynamiques économiques qui conduisent les révolutions à se répéter et à échouer de nouveau et le rôle que jouent les représentations dans cette répétition, Schmitt lui reste proprement hanté par le spectre de la révolution32, sans jamais percevoir le rôle qu’il joue dans sa propre théorie (et qu’il sera amené à jouer dans la pensée juridique de la dictature au xxe siècle). En construisant son concept de dictature non pas seulement contre la révolution, mais contre une répétition historique de la révolution, Schmitt a manqué de 93percevoir la dimension fantasmée ou pour mieux dire spectrale33 de cette répétition révolutionnaire, qui risque de rendre les limites temporelles de la dictature conservatrice de droit qu’il réclame particulièrement incertaines. Plus largement, cette étude portant sur la manière dont le concept de dictature se construit à partir du milieu du xixe siècle en s’articulant avec une nouvelle pensée de l’histoire, exigerait alors de penser les formes multiples et complexes de représentation de la continuité qu’un tel concept vient charrier. En particulier, comment derrière l’idée de lutte contre la discontinuité juridico-politique contenue dans le concept très formel de dictature se cache une représentation de l’histoire hantée par une autre forme de continuité plus ou moins consciente et plus ou moins fantasmée : celle d’une possible répétition de la révolution, qui semble faire, jusqu’à l’aube du xxe siècle, hoqueter l’histoire.
Marie Goupy
Institut catholique de Paris
94Références Bibliographiques
Agamben, Giorgio, État d’exception, Homo Sacer, Paris, Seuil, 2003.
Assoun, Paul-Laurent, Marx et la répétition historique, Paris, PUF, 1999.
Benjamin, Walter, Critique de la violence (1921), in Œuvres, t. 1, Paris, Gallimard, 2000.
Balakrishnan, Gopal, L’ennemi. Un portrait intellectuel de Carl Schmitt, Éditions Amsterdam, Paris, 2006.
Demeslay, Benjamin, « Donoso Cortés à Paris (1847-1853) : la sociabilité d’un « diplomate catholique », Chrétiens et sociétés [En ligne], 22, 2015, mis en ligne le 25 avril 2016. URL : http://journals.openedition.org/chretienssocietes/3901 (consulté le 01/08/2020) ; DOI : 10.4000/chretienssocietes.3901
Derrida, Jacques, Spectres de Marx, Paris, Galilée, 1993.
Donoso Cortés, Juan, « Discours sur la situation générale de l’Europe », in Lettres et discours de M. Donoso Cortés, Paris, Jacques Lecoffre et Cie, 1850, p. 67-83.
Donoso Cortés, Juan, Essai sur le catholicisme, le libéralisme et le socialisme considérés dans leurs principes fondamentaux (1851), publié dans Œuvres de Donoso Cortés, Tome troisième, Paris, Librairie d’Auguste Vaton, 1859.
Donoso Cortés, Juan, Obras completas de Juan Donoso Cortés, t. 2, Madrid, Editorial católica, 1970.
Engels, Friedrich, Introduction à La Lutte des classes en France, 1848-1850, Paris, Les classiques des sciences sociales : http://classiques.uqac.ca/classiques/Marx_karl/luttes_de_classes_france/luttes_de_classes_france.html (consulté le 25/08/2020)
Foucault, Michel, Il faut défendre la société, Cours au Collège de France, 1976, Paris, EHESS, Gallimard, Seuil, 1997.
Goupy, Marie, « Les enjeux politiques de la critique du formalisme positiviste : retour sur le rôle de l’interprétation doctrinale des lois d’habilitation dans l’avènement d’une potentielle « dictature légale » sous la République de Weimar », Droits, no 57, mai 2014, p. 211-260.
Hamel, Jean-François, Revenances de l’histoire, Répétition, narrativité, modernité, Paris, Les Éditions de Minuit, 2006.
Hauriou, Maurice, Précis élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Recueil Sirey, 1930.
Kervégan, Jean-François (dir.), Crise et pensée de la crise en droit. Weimar, sa République et ses juristes, Paris, ENS Éditions, 2002.
Lénine, Vladimir Ilitch, La Révolution prolétarienne et le renégat Kautsky, Paris, Moscou, Éditions sociales, Éditions du progrès, 1971.
95Maistre, Joseph de, De la souveraineté du peuple, Un anti-contrat social (1770), Paris, PUF, 1992.
Maistre, Joseph de, Du pape, Genève, Librairie Droz, 1966.
Marx, Karl, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Paris, Flammarion, 2007.
Marx, Karl et Engels, Friedrich, Manifeste du parti communiste, Paris, Librairie générale française, 1973.
Montlosier, F. de Reynaud comte de, De la monarchie française, depuis son établissement jusqu’à nos jours, Paris, 1814.
Paredes Goicochea, Diego, “La dictadura y la radicalización del catolicismo dogmático en Donoso Cortés”, Cuadernos de Filosofía Latino-Americana, vol. 35, no 110, 2014, p. 61-71.
Peukert, Detlev J. K., La république de Weimar, Paris, Aubier, 1995.
Pranchère, Jean-Yves, L’autorité contre les lumières. La philosophie de Joseph de Maistre, Genève, Droz, 2004.
Radjavi, Kazem, La dictature du prolétariat et le dépérissement de l’État de Marx à Lénine, Paris, Éditions Anthropos, 1975.
Rosa De Gea, Belén, “El enviado del cielo : el pensamiento contrarrevolucionario de Donoso Cortés”, Elementos, no 59, 2004, vol. 1, p. 45 et sq.
Schmitt, Carl, La Dictature, Paris, Seuil, 2000.
Schmitt, Carl, Théologie politique, Paris, Gallimard, 1988.
Trotski, Léon, Terrorisme et communisme (L’anti-Kautsky), Petrograd, Édition de l’Internationale communiste, 1920.
1 Detlev Peukert souligne néanmoins la faiblesse réelle des mouvements « bolcheviks » et « spartakistes » que la masse grossissante des organisations contre-révolutionnaires prétend combattre, en relativisant fortement l’idée même de lutte entre révolution et contre-révolution. Sur ce point, voir Peukert, 1995, p. 79 et sq.
2 L’article « La dictature du président du Reich d’après l’article 48 de la Constitution de Weimar », issu de l’intervention de Schmitt au congrès de l’Association allemande des professeurs de droit public à Iéna en avril 1924, constitue le volet strictement juridique de la réflexion schmittienne sur la dictature « appliquée » à l’interprétation de l’article 48 de la Constitution de Weimar. Cet article sera publié en 1927 en annexe de La Dictature (Carl Schmitt, 2000, p. 207-259).
3 La critique de la conception libérale de l’exception n’est pas centrale dans La Dictature, à l’exclusion de la Préface de 1927. Elle se développera bien plus directement dans Théologie politique, publiée un an après La Dictature, en 1922.
4 Voir le chapitre iv de Théologie politique, « La philosophie de l’État dans la contre-révolution (De Maistre, Bonald, Donoso Cortés) ».
5 C’est-à-dire de l’ordre théologico-politique qui a accompagné le développement de l’État moderne jusqu’à la crise du xviiie, selon Schmitt. Théologie politique radicalisera l’idée d’un conflit entre une forme de pensée rationaliste et immanente, et une forme de pensée théologico-politique.
6 C’est cette idée d’auto-fondation que De Maistre entend écarter dans son pamphlet virulent contre le Contrat Social de Rousseau (Maistre, 1992). Sur cette question chez De Maistre voir en particulier Pranchère, 2004.
7 Sur l’importance de cette conception de l’histoire en termes de lutte et son histoire, voir Foucault, 1997.
8 Cette fonction historique explique la nature de la dictature chez De Maistre, en tant qu’expression d’une décision infaillible et transcendante seule à même de (re)créer un ordre concret sur le modèle la décision divine (Maistre, 1966).
9 En réalité, comme le montre Jean-Yves Pranchère, le caractère transitoire de la dictature maistrienne est lui-même discutable (Pranchère, 2004, p. 180).
10 Voir également Schmitt, 1988, p. 60.
11 Juan Donoso Cortés, Obras completas, vol. 2, 1946, Madrid, Editorial Católica, p. 221. Cité dans Paredes Goicochea, 2014, p. 70.
12 Si la dette de la pensée schmittienne de la dictature à l’égard de la théorie de Lénine est effectivement manifeste et souvent commentée, l’écho rendu par le dernier chapitre de l’ouvrage de 1921 aux analyses que Marx consacre à l’histoire française du xixe siècle, en particulier dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, est de son côté peu relevé. L’histoire qui s’esquisse dans le dernier chapitre du livre de 1921 se trouve pourtant largement éclairée à la lumière des analyses marxistes. Cf. néanmoins sur ce point Balakrishnan, 2006, p. 125.
13 Voir La Dictature, chap. 6, « La dictature dans l’ordre de l’État de droit existant (l’état de siège) ». Schmitt, 2000, p. 172-205.
14 En réalité, ce conflit trouve son origine dans les discussions et les scissions qui éclatent dès la seconde internationale. Sur ce point, voir Radjavi, 1975, p. 33 et sq.
15 Cité dans Lénine, 1971, p. 13.
16 Voir également Trotski, 1920, p. 19 et sq.
17 Ce point est néanmoins très clairement analysé par Gopal Balakrishnan (Balakrishnan, 2006, p. 62).
18 Ce qui justifie évidemment dans La Dictature une interprétation illimitée de l’article 48 de la Constitution de Weimar, permettant de donner au président du Reich les moyens de lutter contre une dictature prolétarienne, y compris contre une dictature prolétarienne légale passant par la domination des forces révolutionnaires à l’Assemblée (Goupy, 2014).
19 Le juriste catholique Maurice Hauriou, qui constitue l’une des grandes sources de Schmitt, voit également dans le principe de souveraineté du peuple qui fonde la domination de l’Assemblée le fondement d’une potentielle dictature de l’Assemblée (Hauriou, 1930, p. 88).
20 Il s’agit des trois célèbres écrits de Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Les luttes de classes en France et La guerre civile en France.
21 Engels, p. 7.
22 C’est évidemment Walter Benjamin qui, en réponse à La Dictature, souligne le plus nettement la différence entre les violences fondatrice ou conservatrice de droit, et la violence pure, qui rompt purement et simplement avec la violence du droit. Et on peut penser que Benjamin perçoit déjà dans La Dictature la hantise d’une « fin de l’histoire » révolutionnaire à laquelle il répond ironiquement. Cf. Benjamin, 2000, p. 215 sq.
23 Sur ce point, voir Balakrishnan, 2006, p. 62 sq.
24 Notons que ce sont les événements révolutionnaires de l’année 1848 en France qui conduisent les Cortès à attribuer des pouvoirs extraordinaires à l’exécutif en vertu de la loi du 13 mars 1848. Sur ces pouvoirs, voir Rosa de Gea, 2004, p. 8-11.
25 Donoso Cortés a effectivement été d’abord favorable à un certain libéralisme qui s’incarne à ses yeux dans la Révolution Française et il se tourne seulement à la fin des années 1840 vers des positions ultra-conservatrices et vers un catholicisme doctrinaire, pétri de théologie et influencé par la lecture des contre-révolutionnaires français. Cette conversion assez brutale accompagne deux événements marquants, dans la vie de Donoso : les révolutions de 1848 bien sûr, mais aussi la mort de son frère, qui joue un rôle biographique déterminant dans les lectures de l’œuvre de Donoso. Il est notable que ce dernier événement traumatique pour Donoso Cortés a permis à un certain nombre d’interprètes de Donoso de relativiser l’importance des révolutions de 1848 sur cette conversion. Voir par exemple, Demeslay, 2016.
26 L’impact des révolutions de 1848 sur la conversion ultra-radicale de Donoso vers un conservatisme et un catholicisme doctrinaire n’est effectivement guère contestable dans l’œuvre de Donoso (Paredes Goicochea, 2014, p. 68).
27 « Il s’agit de choisir entre la dictature qui vient d’en bas et la dictature qui vient d’en haut : je choisis celle qui vient d’en haut, parce qu’elle vient de régions plus limpides et plus sereines ; il s’agit de choisir enfin, entre la dictature du poignard et celle du sabre : je choisis la dictature du sabre, parce qu’elle est plus noble ». Donoso Cortés, 1970, p. 323. Nous traduisons.
28 Sur le fondement métaphysique et politique du concept de dictature de Donoso Cortés, voir en particulier Rosa de Gea, 2004, p. 45-50.
29 L’idée de conscience historique devrait être confrontée ici à la notion plus large de régime moderne d’historicité, telle que Jean-François Hamel la développe dans son excellent ouvrage. Hamel, 2006.
30 Je fais évidemment référence ici à la première phrase du Manifeste du parti communiste : « Un spectre hante l’Europe – le spectre du communisme ». Marx et Engels, 1973, p. 49.
31 Saisir le caractère spectral omniprésent de la révolution au xixe siècle ne présente aucune difficulté, sinon celle posé par l’ampleur démesurée des recherches que cela implique : chaque révolution est si évidemment hantée par celle qui la précède (celle de 1830 par celle de 1789, celle de 1848 par celle de 1830, la Commune par celle de 1848, et toutes, par la grande Révolution de 1789), qu’il est assez difficile de ne pas la voir partout. En revanche, tenter de comprendre la nature de cette spectralité et la manière dont elle agit est bien plus complexe. Ce travail constitue une ébauche de cette réflexion.
32 Selon les termes de Gopal Balakrishnan, le « problème qui préoccupait Schmittt – et qu’il pensait avoir résolu en 1924 – était celui des moyens d’exorciser définitivement les spectres les plus radicaux de la souveraineté populaire » (Balakrishnan, 2006, p. 66).
33 On doit surtout à Derrida d’avoir longuement travaillé sur ce caractère spectral du communisme, depuis en gros les révolutions de 1848 jusqu’aux années 1990 dans Spectres de Marx, qui reproduit deux interventions publiques données à l’Université de Californie en 1993. On ne résistera pas ici au plaisir de restituer le commentaire subtil et drôle de Derrida concernant à la fois Le Manifeste et sa réception : « Dans le Manifeste, l’alliance des conjurés angoissés rassemble, plus ou moins secrètement, une noblesse et un clergé – dans le vieux château de l’Europe, pour une incroyable expédition contre ce qui aura hanté la nuit de ces maitres. Au crépuscule, avant ou après une nuit de cauchemar, à la fin présumée de l’histoire, c’est une sainte chasse à courre contre le spectre » (Derrida, 1993, p. 72).