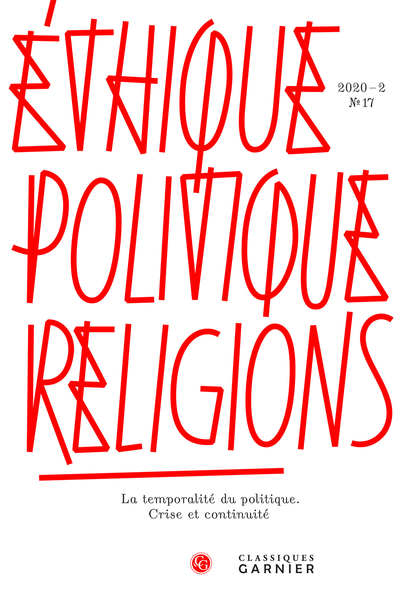
L’état d’exception peut-il être dit permanent ?
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Éthique, politique, religions
2020 – 2, n° 17. La temporalité du politique. Crise et continuité - Auteur : Saint-Bonnet (François)
- Résumé : L’expression « état d’exception permanent », étonnant oxymore, poursuit un objectif plus polémique que rationnel. Elle défie la logique car l’exception dépend de la règle, elle ne peut s’y substituer. Elle ne résiste pas à l’analyse historique. Obéissant à une logique spatiale et donc limitée, l’état d’exception ne peut être que borné dans le temps. Les évolutions qui affectent nos démocraties en proie à des menaces non territoriales – terrorisme, pandémie – doivent être analysées autrement.
- Pages : 21 à 40
- Revue : Éthique, politique, religions
- Thème CLIL : 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN : 9782406110972
- ISBN : 978-2-406-11097-2
- ISSN : 2271-7234
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-11097-2.p.0021
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 01/02/2021
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : État d’exception, histoire du droit, pandémie, terrorisme, sécurité
L’état d’exception peut-il
être dit permanent ?
Les mesures de confinement obligatoire et de distanciation sociale adoptées par une écrasante majorité d’États dans le monde pour faire face à la pandémie de COVID-19 montrent-elles que l’état d’exception est devenu une façon normale de gouverner, notamment dans les démocraties libérales ? Les raisons qui ont pu être invoquées sont d’une part que les atteintes aux libertés ne sont pas proportionnées au risque encouru par les citoyens, d’autre part que les sociétés vivent dans un climat de peur constant qui les conduit à éprouver un besoin réel de paniques collectives1. On notera à ce stade qu’en s’alarmant de l’état d’alarme permanent des populations, on ne contribue pas nécessairement à les apaiser.
On établit en outre un lien entre ces mesures et celles qui avait été retenues pour lutter naguère contre le terrorisme. En France, l’état d’urgence a été mis en œuvre sans discontinuer entre le 14 novembre 2015 et le 30 octobre 2017, date à laquelle les principaux moyens d’actions permis par ce dispositif sont entrés, sous de nouvelles dénominations, dans le droit commun en vertu de la loi dite SILT (Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme) du 30 octobre 2017. D’autres mécanismes ont renforcé cette armure, en particulier le recours au renseignement dont le visage « légal » est dessiné par la loi du 24 juillet 2015.
Mesures pérennes de restrictions des libertés et craintes continues des populations formeraient ce cocktail désastreux qui aurait fait basculer, depuis le début du IIIe millénaire, les démocraties libérales soucieuses des droits des citoyens dans des régimes sombres et oppressifs, se nourrissant de l’infantilisation de masses tourmentées. Cette présentation me semble doublement erronée. Sur le plan théorique, la notion d’état 22d’exception permanent relève de l’oxymore, ce qui conduit immanquablement à donner à cette expression un contenu aux visées essentiellement polémiques (I). Du point de vue opérationnel, les mesures doivent être analysées à raison de leur adaptation à l’objectif qu’elles poursuivent. Or l’état d’exception renvoie à un type de menace territoriale et éphémère de nature essentiellement politique : tel n’est pas le cas du péril terroriste dont les acteurs cherchent, dans une logique eschatologique, à convertir des âmes et non à conquérir des terres ou à renverser des institutions ; pas davantage du danger épidémique car un minuscule virus ne saurait être considéré comme un « ennemi » aspirant à détruire ou à déstabiliser la totalité des habitants de notre planète (II). Les gouvernants remédient à ces épreuves – terroriste et pandémique – en agissant de manière ciblée et adaptée et en restreignant le périmètre de certaines libertés, ce qui exige des contre-pouvoirs et des citoyens un surcroît de vigilance, de discernement, d’esprit critique. Le danger vient plus de ceux – sentinelles de la société et institutions de contrôle – qui se laissent subjuguer ou assoupir que des dirigeants politiques qui auraient fait de l’état d’exception le nouveau paradigme de leur art de gouverner.
La dépendance théorique
de l’exception à la règle
La formule « état d’exception permanent » sonne comme un cri d’alarme, un appel au réveil de sujets assoupis, une injonction à s’insurger contre une dérive abominable dont les gouvernants seraient les froids instigateurs, ayant profité, comme par surprise, de situations anodines pour satisfaire leurs bas instincts dictatoriaux. Telle est la dimension performative de l’expression. Sa puissance évocatrice provient du fait qu’elle véhicule un certain mystère, une forme d’opacité due à la contradiction qu’elle renferme. Si l’on associe à la règle une certaine stabilité – certaines lois des rois de la fin du Moyen Âge étaient désignées établissements (stabilimenta) renvoyant à l’idée de fixité, d’immuabilité, de permanence – l’exception vient nécessairement la rompre, la déchirer. Tel le parasite, 23elle vit aux dépens de la norme, celle-ci venant à s’éclipser, celle-là disparaîtrait. Si les mesures pour faire face à un péril quelconque sont pérennes, elles se métamorphosent en nouvelle règle, à laquelle il peut toutefois être dérogé en offrant – si un calme extraordinaire le rendait possible – des libertés et une latitude supplémentaire aux gouvernés.
On a pu assister à ce phénomène de renversement de la règle par l’exception entre la fin du Moyen Âge et les Temps modernes. Le roi médiéval, essentiellement limité dans son action par les droits divin et naturel, pouvait s’en affranchir toutefois à condition qu’il en aille de la survie de la communauté politique : en cas de guerre, de famine ou d’épidémie, on lui reconnaissait le pouvoir de légiférer sur l’ensemble du royaume, de lever des impôts sans le consentement des sujets, voire de s’emparer du bien d’autrui. Telle est la présentation qu’en fait, par exemple, Philippe de Beaumanoir à la fin du xiiie siècle2. Mais les monarques successifs invoquant de plus en plus fréquemment l’impérieuse nécessité de la sauvegarde du royaume, ce qui était l’exception devint la règle au point que leur pouvoir fut présenté comme absolu (ab solutus, sans lien). Rien ne les empêchait, à partir de la fin du xvie siècle, de consulter leurs sujets avant de légiférer, de prélever des taxes ou de réquisitionner, mais ils n’en avaient plus l’obligation : la règle était devenue exception. Bodin explique très bien que, pour éviter d’avoir à recourir, parfois, à un dictateur comme le faisait les Romains à l’époque républicaine, il est beaucoup plus logique d’accorder tous les pouvoirs au souverain qui a toutefois le loisir, quand les circonstances le lui permettent, de gouverner avec douceur et magnanimité3. Entre temps, la monarchie limitée médiévale a été supplantée par l’absolutisme moderne.
Si l’état d’exception est devenu permanent, ne serait-il pas préférable d’appeler les démocraties regardées comme « sécuritaires » par leur nom ? Dictatures, tyrannies, régimes totalitaires, autocratiques, autoritaires, etc. Cela suppose d’assumer de décrire un tel régime en le rapprochant effectivement de ceux dans lesquels la liberté est reléguée loin derrière le principe d’ordre. Tel n’est nullement le principe qui s’impose dans les démocraties occidentales au sein lesquelles, en effet, l’ordre public permet de réduire le périmètre des libertés, mais de manière ni générale, ni absolue, non sans justification et non sans le contrôle d’un juge. 24Relégation toute relative ou, pour mieux dire, balance – certes fragile et incertaine – entre impératifs contradictoires.
S’il faut à l’état d’exception une véritable « exception », ce que l’idée de permanence exclut, il faut également qu’il s’agisse d’un état, comme on parlerait d’un état second, d’un état de nécessité ou d’un triste état. Sans doute n’y a-t-il aucune fatalité à voir cette notion connotée par la brièveté, la fugacité, la soudaineté ; le latin status a donné État au sens de l’institution stable et pérenne qui structure une communauté politique. Mais ce terme – qui n’a d’ailleurs pas beaucoup prospéré en Angleterre – est une réduction de la formule médiévale status regni ou status rei publicae, qui désigne la manière d’être du royaume ou de la chose publique, comme on parlerait de l’état de santé – fatalement variable – de la couronne ou de la communauté politique4. L’état, sans majuscule, s’analyse comme la manière d’être précaire ou mouvante de ce qu’elle désigne. S’il se rapporte à l’exception (de ex capere, ce qui est « hors de prise »), il s’agit de décrire la forme de ce qui est essentiellement insaisissable, instable, fuyant. Autrement dit, ce qui ne saurait être permanent.
Comment expliquer, dans ces conditions, que des États modernes puissent mettre en œuvre de manière durable des législations d’exception, normes qui affranchissent l’administration du rets du « droit commun » ? Ainsi, le Général de Gaulle plaça la France sous le régime de l’article 16 d’avril à octobre 1961 alors que le putsch des généraux fut maitrisé en quelques semaines. De même, le gouvernement français maintint l’état d’urgence entre novembre 2015 et octobre 2017 alors que dès janvier 2016, les mesures prises en vertu de ce dispositif (perquisitions administratives, assignations à résidence) étaient devenues rares5. À plus forte raison, il a versé dans un « nouveau » droit commun – la loi SILT6 – les principales possibilités offertes par l’état d’urgence, en les recentrant toutefois sur la seule lutte contre le terrorisme, et le privant du trop lâche « péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public7 » qui couvrait davantage d’hypothèses.
25Il faut introduire ici une distinction entre mise en œuvre de législations d’exception et état d’exception proprement dit. En déclenchant l’application de pouvoirs spéciaux, le gouvernement se donne les moyens d’agir en restreignant certaines libertés et/ou certains contre-pouvoirs pour faire face à une menace imminente ou présente. S’il maintient en vigueur cette « potentialité » sans l’utiliser après le moment critique, la réalité du droit qui s’applique est le droit commun comme lors du paisible été 1961 ou des années 2016 et 2017 au cours desquelles les Français vivaient normalement, sans la peur au ventre, se montrant de plus en plus résilients ou fatalistes quand la foudre s’abattait à nouveau (comme lors de l’attentat de Nice le 14 juillet 2016). Si, au contraire, ces législations demeurant en vigueur sont utilisées, si l’on peut s’exprimer ainsi, à plein régime alors il faut se résoudre à considérer que le gouvernement n’est plus libéral mais autoritaire, comme on l’a vu plus haut. L’état d’exception, lui, désigne précisément un moment de bascule qui réunit trois éléments : une menace immédiate ou un péril actuel de nature à déstabiliser très gravement voire détruire l’État, une inadéquation des moyens juridiques dont dispose le pouvoir pour y faire face, le sentiment partagé qu’il est évidemment nécessaire de s’affranchir momentanément du droit des circonstances « normales » pour sauvegarder la communauté politique. Il est accompagné d’une prise de parole – message à la nation, déclaration solennelle – par laquelle le chef politique fait corps avec son peuple pour communier dans une douleur et montrer sa résolution, laquelle passe en général par l’annonce de la mise en œuvre de telle ou telle législation d’exception8. L’état d’exception dure le temps, nécessairement bref, de réaction qui se traduit par des mesures de haute intensité, pour écarter le danger vital. Celui-ci écarté, toute menace n’a pas nécessairement disparu. On entre alors dans une nouvelle phase, celle d’un combat normal, d’autant plus réfléchi, coordonné et efficace que l’on connaît mieux les réactions et manières d’opérer de l’ennemi9 : il n’est plus question d’état d’exception mais de conduite d’une politique de longue haleine, comme la lutte contre la criminalité organisée, le 26trafic de drogue ou le commerce illégal d’armes. Il arrive parfois – et de manière assurément abusive – que des gouvernements maintiennent en vigueur des dispositifs conçus pour les périodes de péril extrême, comme une sorte de réserve de pouvoir dont on pourrait se servir en cas de besoin. Il ne faut pas négliger non plus une forme d’attente des citoyens qui, aujourd’hui en particulier, se sentent paradoxalement « rassuré » lorsqu’un mécanisme tel que l’état d’urgence demeure en vigueur. Magie du substantif « urgence », tout à la fois anxiogène (pour l’atteinte possible aux libertés qu’il recèle) et rassurant (par l’impression qu’il laisse que le pouvoir agit) : les gouvernants qui y mettraient fin seraient perçus comme ayant abandonné la lutte !
L’état d’exception ne se confond donc pas avec les périodes de mise en œuvre de législations d’exception ou, plus précisément, de législations dérogatoires au droit commun – car elles tentent de saisir par un droit « autre » ce qui n’est donc pas « hors de prise » (exceptionnel). C’est précisément ce hiatus qui fait tout le danger, repéré et discuté depuis l’époque de la dictature romaine qui ne devait excéder six mois10, des législations d’exception qui demeurent en application lorsque le péril est écarté, c’est-à-dire quand l’état d’exception a disparu.
S’il importe au plus haut point de se montrer vigilant afin que le péril d’un excès du pouvoir ne vienne se substituer à celui qu’encourt la communauté politique, il y a sans doute plus de motifs polémiques à parler d’état d’exception permanent que de raisons logiques.
La dépendance opérationnelle
des mesures au péril
L’expression état d’exception renvoie toujours à l’idée que le droit des circonstances normales ne permet pas aux gouvernants de mettre fin à un immense danger. Toutefois, la nature du péril varie d’une époque ou d’une région à une autre. Qu’y a-t-il de commun entre l’agression d’une armée étrangère à la quête de territoires, le soulèvement de séditieux à l’assaut de l’ordre constitutionnel, l’attaque de partisans 27marxistes qui espèrent une dictature du prolétariat subjuguant l’État bourgeois capitaliste, des attentats d’anarchistes hostiles à tout pouvoir institutionnel ou de djihadistes visant à faire du monde une gigantesque oumma de convertis… et la propagation d’un virus, dénommé COVID-19 par les scientifiques, qui n’aspire à rien du tout ? Certains ont des ambitions territoriales, d’autres constitutionnelles, idéologiques ou encore eschatologiques quand le dernier n’en a aucunes. À chaque type de péril, sa réplique et son train de mesures de court et de long terme ; à chaque menace, le sentiment (ou non) de vivre un état d’exception. On évoquera quatre hypothèses : pour les périodes plus anciennes, la guerre étrangère, l’insurrection politique ; plus près de nous, le recours au djihad, la pandémie.
Au xviie siècle, la sécurité des particuliers n’est plus assurée par les forteresses de seigneurs accueillant leurs féaux en échange de services (corvées) et de droits (taxes), ou par les remparts des villes à condition que les bourgeois participent aux tours de guet, mais par des frontières – la « ceinture de fer » de Vauban – à l’ombre desquelles ils peuvent s’abriter. À l’approche de ces zones, règne une insécurité presque structurelle, quasi normale : le « son du canon » et les chants de marche y sont monnaie courante. Les guerres de cette époque – bien éloignée de celles menées contre le terrorisme ou contre la pandémie – sont affaires essentiellement territoriales. Quand le conflit éclate, un régime juridique spécial accorde aux gouverneurs des places (citadelles, forteresses) des pouvoirs variant avec l’intensité du péril11. Après la Révolution, la loi des 8-10 juillet 1791 distingue état de paix, état de guerre (guerre déclarée mais sans combat effectif sur la place considérée) et état de siège (échange de tirs12). Dans la première hypothèse, le chef militaire ne commande que l’intérieur de la forteresse ; dans la deuxième, il peut agir dans ses environs, aux dépens des autorités locales ; dans la dernière, il commande l’ensemble de la zone alentour. Cette loi peut être 28considérée comme une législation d’exception pour le gouvernement du pays car, sans sa mise en application, l’invasion s’avère presque certaine. (Toutefois, à l’intérieur de ces « zones frontières », le conflit ne déroge à rien, il actualise une possibilité.) L’état d’exception, dans ce contexte, dure le temps de la prise de conscience du danger et de la bataille. Au contraire, si la paix étant conclue l’état de guerre s’achève, si le calme étant revenu on ne lève pas l’état de siège ou si la situation militaire étant figée on le maintient, on sort de cette forme de suspension du temps qui caractérise l’état d’exception. La loi de 1791 fut incorporée dans celle – toujours en vigueur – du 9 août 1849 relative à l’état de siège.
Pour les juristes de l’époque, la présence effective de l’ennemi déterminait les modifications des règles applicables ; on ne basculait dans l’état d’exception qu’en raison de considérations spatiales telles que la perte de territoires, de villes, de forteresses. Elles ne pesaient évidemment que la durée de la crise : quelques jours, quelques semaines, au maximum quelques mois, le temps que se dessinent la victoire ou la défaite, puis la paix. La Grande Guerre marque un tournant du fait de sa durée, de l’étendue de son front et de ses phases interminables d’enlisement. Pour la première fois, le gouvernement va placer des zones non directement concernées par les combats en état de siège, pour une durée indéterminée13. Ce régime dérogatoire devient le régime normal du « temps de guerre14 ». La France ne fut en état d’exception qu’au cours de l’été 1914, au moment de la mobilisation générale, de la réorganisation de l’armée et de toute l’économie du pays ; ensuite, vint, sinon la routine, une nouvelle vie faite d’efforts, de sacrifices, de libertés atrophiées15.
Une autre menace politique, venue du dedans celle-là, allait peser sur le destin des États modernes : l’insurrection d’une partie du peuple contre le gouvernement établi. Droit de résistance à l’oppression pour les insurgents en 1776 ou les révolutionnaires en 1789, droit à l’insurrection pour les jacobins après 179216, le « juste » recours à la force fut un monopole étatique contesté, avec quelques succès d’ailleurs. En France, 29la valse des régimes est presque incessante au xixe siècle, leur espérance de vie n’excédant pas les deux décennies avant la IIIe République.
Les « ennemis » de l’intérieur multipliaient les « foyers séditieux » – expression chère à la presse du xixe siècle pour désigner des quartiers, des hameaux, des maquis à partir desquels on s’organisait (réunions secrètes, répartition des rôles, documents de propagande, dépôts d’armes). Pour les soumettre, les gouvernements eurent recours à la stratégie du contrôle de zone : bouclage du secteur par l’extérieur, avancée progressive jusqu’à la découverte de la « planque ». Par mimétisme avec la guerre extérieure, on parla d’« état de siège » ; un rapprochement paradoxal car les forces loyalistes assiègent plus qu’elles ne sont assiégées.
Pour donner quelque apparence de légalité à ce type d’actions, on interpréta de manière extensive la loi de juillet 179117, complétée par un arrêté du 30 messidor an III (18 juillet 1795)18, puis on légiféra le 10 fructidor an V (27 août 1797) en permettant explicitement le placement d’une ville de l’intérieur sous le régime de l’état de guerre et de l’état de siège. Ces textes accordent au commandant militaire la totalité des pouvoirs de police ; les séditieux assimilés à des ennemis peuvent être traduits devant des conseils de guerre y compris pour des crimes et des délits de droit commun19. Il faut attendre l’été 1849 pour qu’ait lieu un débat public – de grande qualité d’ailleurs – sur l’ampleur des pouvoirs abandonnés aux militaires lors des états de siège « politiques » : la loi du 9 août en résulte. On comptait leur durée en semaine ou en mois, en fonction de la configuration de la zone, de sa topographie, de la détermination des factieux20. Il était rare que le pouvoir maintienne 30les législations d’exception en vigueur au-delà des états d’exception proprement dits, l’objectif étant clair – arrêter les rebelles21 – on pouvait aisément tracer la frontière entre le normal et ce qui ne l’était pas.
Un siècle plus tard, la panoplie des législations d’exception reposant sur la logique du contrôle de zone22 allait être enrichie de la loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence. Ce mécanisme, lui, n’implique aucun transfert des pouvoirs de l’autorité civile aux militaires car, à cette époque, on répugnait à parler de « guerre » d’Algérie23, connotation fatale quand il est question de siège et de pouvoir militaire. Ce régime fut maintenu en vigueur pendant presque tout le conflit parce que les dangers étaient plus diffus et les objectifs assez incetains. Est-ce à dire que l’on puisse parler d’état d’exception quasi permanent entre 1955 et 1962 ? Nullement, la guérilla, à l’intensité variable, était devenue la norme. En revanche, le putsch de 1961 qui, en faisant trembler le pouvoir gaullien, provoqua la mise en œuvre de l’article 16, en rassemble toutes les caractéristiques.
Le concept d’état d’exception conçu comme la réaction à une menace qui provoque la mise en œuvre de mesures renforcées limitées dans le temps a été pensé dans un contexte fortement spatialisé, dans lequel l’objectif – la reconquête, la maîtrise du territoire – peut être défini, faute de pouvoir être intégralement réalisé, sinon à un prix excessif en termes de libertés. Qu’en est-il dans un « monde mondialisé » où une partie de l’humanité s’efforce de vivre selon un modèle soucieux des libertés et que se dresse face à elle une nébuleuse – infiniment moins nombreux mais déterminés – de djihadistes qui entendent profiter de ses points faibles – des frontières étatiques poreuses, des égards pour les 31droits fondamentaux – et qui visent, non des territoires ou des butins, mais la conversion de tous à un salafisme rigoureux ? Les organisations terroristes en effet, Daech y compris, poursuivent des objectifs eschatologiques et non spatiaux ou vénaux – la terre et l’argent n’étant pour eux que des moyens.
Pour faire face aux attentats du 13 novembre 2015 (et non de ceux du 7 janvier, la précision est d’importance), la France a eu recours à la loi de 195524. Deuxième moment d’effroi collectif en quelques mois qui appelait une réaction forte de l’exécutif, attendue par une société sidérée ; une panique d’autant plus vive que les attaques touchaient non plus des cibles présentées comme hostiles comme en janvier (un journal satirique, un hypermarché cachère) mais des citoyens dans leur vie quotidienne (un apéritif, un concert). Sur le moment, il y eut bien un état d’exception : le sentiment qu’il était évidemment nécessaire d’agir avec vigueur, fût-ce en dépit du « droit commun », pour sauvegarder la communauté. La vague intense de perquisitions administratives (3 000 en cinq semaines25) et d’assignations à résidence (le pic des 300 atteint mi-janvier 2016) qui s’ensuivit marque une réaction massive des services de l’État. Après janvier 2016 toutefois, le nombre d’opération fléchit considérablement même si l’état d’urgence demeure en vigueur : cela traduit l’entrée dans une nouvelle phase de lutte sur le long terme contre le terrorisme au cours de laquelle les mesures permises par l’état d’urgence occupent une place accessoire. En effet, face à des organisations qui disséminent leurs forces, le « contrôle de zone » présente un intérêt mineur.
Les autres mesures prennent la forme de lois pénales renforçant, pour tous les temps, la répression d’actes terroristes et du recours au renseignement. Les unes et les autres rognent les libertés : dans le premier cas, par des infractions dites « obstacles » qui répriment avant le passage à l’acte26 ; dans le second, en faisant bon marché de la vie privée de certains individus et de leur entourage. Ces dispositifs n’ont pas été considérés comme portant une atteinte disproportionnée aux droits et 32libertés constitutionnellement garantis27 : il s’est donc agi de conduire, en modifiant durablement la législation sécuritaire, une politique visant à prévenir la survenance de nouveaux attentats meurtriers. Concernant ces lois, il ne s’agit pas de savoir si elles instaurent un état d’exception permanent, car elles n’exceptent rien, mais si elles sont adaptées et idoines : la question comporte un volet politique (les moyens sont-ils efficaces ?) et un autre juridique (portent-ils une atteinte excessive à des libertés ?), elle relève d’une action aussi pérenne et continue que l’est la menace, c’est-à-dire d’une nouvelle normalité.
La phase d’état d’exception (de novembre 2015 à janvier 2016) n’a pas permis de vaincre dans cette « guerre contre le terrorisme » (G. W. Bush, F. Hollande), mais peut-on gagner contre un procédé ? On eut châtié un ennemi ou un adversaire, non une façon d’agir, fût-elle abjecte. Le fait que la menace persiste explique que des moyens supplémentaires soient mis en œuvre, encore faut-il qu’ils soient les bons. Le débat sur ces questions, qui est malheureusement réservé à un cénacle de spécialistes et réduit à des arguments d’autorité d’autant plus assénés qu’ils agitent des peurs, devrait relever de la controverse démocratique apaisée. En cela, la formule « état d’exception permanent » peut être regardée comme conçue pour alarmer les défenseurs sincères des droits comme son pendant « la sécurité est la première des libertés » pour justifier les atteintes aux principes les plus solidement établis. La première manque de cohérence, la seconde feint d’ignorer que le mépris des libertés est très insécurisant pour chacun.
33La loi 23 avril 2020 a autorisé l’instauration d’un « état d’urgence sanitaire » pour faire face à l’épidémie de COVID-19. Députés et sénateurs l’ont prorogé, au moment où ces lignes sont écrites, jusqu’en juillet. S’agit-il d’un nouvel indice d’état d’exception permanent ?
Pour décrire cette crise sanitaire, les gouvernants ont utilisé, dans un premier temps, un discours martial. Le 16 mars 2020, le Président Macron s’est emparé de l’anaphore « Nous sommes en guerre » pour la marteler à six reprises en une vingtaine de minutes dans son « Adresse aux Français ». Il y était question d’un ennemi – d’autant plus dangereux qu’il progressait de façon « invisible », « insaisissable » – que seule une « mobilisation générale » permettrait de vaincre. On a parlé de soignants combattant sur le « front », de personnels de supermarchés en « deuxième ligne », de télétravailleurs œuvrant « à l’arrière ». Des maires ont qualifié les mesures interdisant la circulation vespérale d’arrêtés de « couvre-feu », rappelant aux plus anciens les heures sombres de l’Occupation. Alarmantes, mobilisatrices, compassionnelles, graves, solennelles, de telles harangues ont des vertus incontestablement performatives ; par des mots et des phrases, elles feraient basculer dans un nouvel état d’exception. Cette rhétorique permet soudain de percevoir comme évidemment nécessaires les mesures venant rogner des libertés, à commencer par celle d’aller et venir.
Pourtant, le vocabulaire administrativo-juridique ne suit pas : on ne parle pas d’assignation à résidence massive mais de confinement, non d’attroupement plus ou moins séditieux mais de nécessaire distanciation sociale, nul n’envisage la moindre perquisition administrative, au contraire, le domicile apparaît comme le sanctuaire protégeant contre toute agression virale ; quant au tracking, il est présenté comme une mesure technique visant à « sauver des vies », non comme le moyen de débusquer un quelconque malfaiteur ou ennemi en faisant fi de sa vie privée. Rien d’inacceptable donc : les Français ont adhéré majoritairement à ces mesures dictées par des exigences épidémiologiques.
Comment expliquer un tel hiatus entre d’un côté le sentiment de vivre en état d’exception avec ce que cela comporte de concentration et de dilatation des moyens de l’État et, de l’autre, une société civile plutôt digne, consciente des enjeux, prête à jouer le jeu sans que la force publique n’ait à montrer ses muscles, drôle et souvent enjouée sur les réseaux sociaux ? L’ambiance de sidération propre à l’époque de la vague 34terroriste de 2015 tout comme l’atmosphère irrespirable de la période de contestation des Gilets Jaunes de 2018-2019 semblent bien lointaines.
Dans les états d’exception décrits plus haut, les gouvernants ont dû faire face à des ennemis : extérieurs, intérieurs ou hybrides28. Mais un virus peut-il y être assimilé ? Indépendamment du fait que leur écrasante majorité n’est nullement pathogène, va-t-on prêter à ces organismes minuscules des intentions guerrières, une volonté d’affaiblir ou de tuer ? Le COVID-19 n’est pas plus une « vengeance » d’une planète meurtrie, comme le suggèrent certains écologistes zélés, qu’elle n’était une punition divine comme on le pensait au Moyen Âge. Le virus appartient à une nature qui, grâce aux chercheurs, nous est moins obscure. La connaissance a pris le dessus : soit la science sait, soit elle sait qu’elle ne sait pas mais qu’elle saura à plus ou moins longue échéance. Il manque donc à la crise sanitaire de 2020 le caractère de péril que ferait courir une organisation hostile qui mettrait en place des stratégies, les modifierait, les adapterait, « ferait mouvement » comme disent les militaires. Chaque société des régions du monde confrontées à ce virus se bat en quelque sorte contre elle-même. Ou plutôt, elle ne se bat pas : elle tente de mettre en place des traitements curatifs pour les malades, de sauver ceux qui risquent de mourir, de rechercher le fameux vaccin qui permettra de prévenir l’infection. Pour cela, les chercheurs du monde entier s’entraident, collaborent, échangent des données afin, non d’éliminer ou de détruire le virus – la chose n’est pas possible – mais de faire en sorte que ses effets sur l’homme puissent être maitrisés.
Sans ennemi, pas de menace ; et sans menace, pas d’état d’exception. Il y aura un nombre de morts à cinq chiffre en France : un total très élevé dans l’absolu, relativement limité rapporté à la population, et infiniment plus élevé qu’en cas de vague d’attaques terroristes. Pour autant, les frontières ne seront pas transpercées, les institutions en danger, la nation au bord du précipice.
Il importe de rappeler que, dans l’histoire, les épidémies et épizooties n’ont jamais été rapprochées de situations comparables à un état d’exception. Sous l’Antiquité comme au Moyen Âge, la question n’avait rien de politique. Le grand Périclès fut vraisemblablement l’une 35des victimes de l’épidémie – dont on ne connaît pas avec certitude la nature – qui affligea sa cité entre 430 et 426 avant notre ère. Dans le récit qu’en donne Thucydide, le premier à le faire avec tant de précision, on rencontre l’horreur d’une mort qui frappe implacablement, l’incompréhension d’un phénomène qu’en bon lecteur d’Hippocrate, il s’efforce de décrire méthodiquement, les scènes de lâcheté comme les actes de bravoure propres à ces moments où la nature humaine se révèle à nu, l’imputation de ces fléaux à quelque punition divine ou à quelque perfidie ennemie. Mais rien sur des mesures de police, sur une prise en main de la société par l’État. Quand Périclès exhorte les Athéniens au courage, ce n’est pas face à la maladie mais contre cet ennemi bien réel que sont les Lacédémoniens : « Supportez donc avec résignation les maux qui nous viennent des dieux et avec courage ceux qui nous viennent des hommes29. » Quand la guerre est une affaire toute politique, la situation sanitaire demeure une question essentiellement « sociale » : nulle mesure de police, de confinement, de couvre-feu, mais un appel à la résilience. Puisque la notion de « contagion » n’est pas conçue par les médecins de l’antiquité qui pensent que les lieux sont pestilentiels, non les hommes : l’action étatique ne peut même pas être envisagée car l’on ne saurait que faire. Au vie siècle après Jésus-Christ, près d’un millénaire plus tard, Procope de Césarée rapporte que quand les habitants de Constantinople, affligés par une atroce épidémie en 542, annoncent au général Bélisaire qu’ils préfèrent s’exposer au combat plutôt que de supporter passivement la mort de la peste et la famine, il leur répond que la guerre étant réservée aux hommes entrainés, il faut attendre du renfort. Les habitants de la ville sont livrés à eux-mêmes ; l’épidémie échappe au politique30. Au Moyen Âge, on considérera les « pestes » – terme générique qui embrasse tout phénomène épidémique – comme des interventions divines : les raisons de leurs apparitions comme de leurs disparitions sont si impénétrables qu’elles ne peuvent être que la manifestation de la volonté de Dieu de punir, puis d’estimer le châtiment suffisant. Un tel fléau étant sacré, il serait impie de vouloir lutter contre les desseins du Tout-Puissant. Les pestiférés se voient donc chassés – on y assimile souvent les juifs –, privés de contacts avec autrui 36car ils incarnent le mal, le péché. Ce cantonnement forcé a eu, presque par hasard, un effet prophylactique bénéfique : limiter une contagion que l’on croyait démoniaque et qui n’était que virale. L’homme étant impuissant à lutter contre l’Au-Delà, le politique ne le serait pas moins.
Il faut donc attendre le xvie siècle pour que les épidémies soient pensées comme ayant des causes humaines : médecins et autorités peuvent donc œuvrer à les combattre, en les prévenant par une meilleure hygiène ou en les contenant au moyen de quarantaines. Les « pestes » sont dorénavant perçues comme des produits d’origine « étrangère » (spécialement du Levant) ; on en rend également fautifs les miséreux. Les plus aisés, mieux informés, s’en sortent en fuyant à temps. Les autorités locales, au plus proche de l’information, interviennent par des mesures de contrôle des populations (quarantaine des équipages des vaisseaux à leur arrivée dans les ports méditerranéens, lazarets, « cordons sanitaires31 », etc.). Consuls, échevins, parlements puis intendants développent des normes qui tendent à s’harmoniser à mesure que les échanges de « bonnes pratiques » progressent. Normes extraordinaires, intermittentes, mais convergentes et stables compte tenu de l’expérience acquise : la littérature juridique n’évoque nullement à leur propos d’état d’exception. La Révolution ne met pas en cause la prédilection pour le local : quand l’épidémie est présente, les maires agissent en vertu de leurs pouvoirs de police générale (loi de 1790 puis de 1884). Des commissions et des intendances d’hygiène dans chaque préfecture coordonnent la prévention et la répression (jusqu’à la peine de mort prévue par une loi de 1822). Pour autant, toujours pas de trace d’état d’exception dans les débats, alors que la question est fréquemment débattue32 en ce siècle de révolutions et de contre-révolutions.
Bien qu’elles ne soient déployées que sur des périmètres restreints, peut-on expliquer que des mesures portant gravement atteinte à des libertés essentielles comme celle de se déplacer, ne fassent pas l’objet de contestations juridiques33 ? Au milieu du xixe siècle, le rédacteur du 37Répertoire Dalloz se contente de noter qu’en cas d’épidémie ou d’épizootie, l’autorité municipale « doit respecter le plus possible la propriété, les droits acquis, surtout quand il s’agit de mesures qui ne sont pas de nature à produire des effets immédiats34 ». Il ne mentionne nulle part la liberté d’aller et venir pourtant directement concernée par les mesures de quarantaines ou de confinement. La première raison est certainement sociale : devant une menace immédiate ou une épidémie déclarée, nul ne doute de la nécessité de se protéger en s’abstenant de relations sociales : pas de respirateurs artificiels ou d’équipes de réanimation, on ne plaisante pas avec ces maladies-là car il n’y a pas de seconde chance. L’effort semble dérisoire au regard du bénéfice d’échapper à la mort. La seconde raison est plus juridique : jusque dans les années 1980, les voies d’action des citoyens contre l’administration ne permettaient pas d’invoquer des droits fondamentaux. On considérait alors que les libertés étaient garanties par les lois, non contre elles : les droits, résiduels, en dépendaient. Le fameux test de proportionnalité – la mesure réduisant telle liberté est-elle adaptée, nécessaire, proportionnée à l’intérêt général qu’elle vise à protéger ? – n’est couramment répandu que depuis quelques décennies. En l’absence d’assignation possible des pouvoirs publics qui méconnaitraient les droits et libertés des citoyens, le canal de contestation privilégié était celui de la politique ; mais, en matière sanitaire, son flux fut quasiment nul.
Notons qu’aujourd’hui, la première ordonnance qu’a dû rendre le Conseil d’État en référé résultait de la plainte d’une association d’internes des hôpitaux qui déploraient que les mesures de confinement ne fussent pas plus sévères, non qu’elles portassent une atteinte excessives à des droits et à des libertés35.
Au xxie siècle, compte tenu de la vitesse de la propagation des virus – un peu moins de 1 000 km/h en avion, plus de 300 km/h par TGV – l’approche locale s’avèrerait parfaitement inadaptée. L’échelle se doit donc d’être a minima nationale ; elle devrait sans doute être – pour certains aspects – continentale ou mondiale. Il est indubitable, 38en outre, que les progrès récents de l’accès à des juridictions en matière d’atteinte aux droits fondamentaux ont conduit le législateur et le gouvernement à devoir « consolider » juridiquement les mesures réduisant les libertés. Tel est l’objet de la loi du 23 mars 2020 qui autorise le gouvernement à confiner les citoyens, à réquisitionner, etc. Pour autant, était-il besoin d’inviter les deux chambres à s’auto-congédier pendant plusieurs demains en laissant au gouvernement les mains libres – politiquement s’entend36 – en vertu de l’état d’urgence sanitaire et de la possibilité de légiférer par ordonnances37 ? Si cette loi a pu être adoptée, c’est précisément parce que le parlement s’est réuni pendant trois jours38, en désignant ceux qui seraient présents dans les hémicycles en se conformant aux mesures barrières ; il n’était donc pas empêché. En contrepartie de cette vacance « volontaire », l’Assemblée nationale a pu mettre en place une « mission d’information » afin d’assurer un « suivi renforcé » des mesures adoptées, chaque mercredi après-midi et largement en visio-conférence39. Information et suivi sans conséquences car ces « missions » ne disposent quasiment d’aucun pouvoir, sinon celui de rédiger un rapport… Si l’état d’exception justifie de « décider » sans le parlement, comme en cas de mise en œuvre de l’article 16 (pouvoirs exceptionnels du Président), alors l’adoption de cette loi dans les formes et la mise en place d’une mission d’information n’ont pas de sens40. Puisque les chambres pouvaient se réunir, il suffisait de ne pas réduire leur pouvoir de législateur, de contrôleur du gouvernement et d’évaluateur des politiques publiques tout en adaptant leur manière de travailler, comme l’ont fait des centaines d’entreprises dans le pays, à la demande de ce même gouvernement. L’exécutif en eût-il été moins en mesure de lutter contre l’épidémie ? Rien ne permet de le penser. Au contraire, il n’est pas interdit de supposer que le fonctionnement normal 39de nos institutions aurait permis de renforcer la résilience, la patience, la confiance des citoyens. C’est sans doute la raison pour laquelle, fin avril 2020, le gouvernement a rectifié le tir en sollicitant l’avis du parlement, notamment sur la stratégie de déconfinement41.
De même, la quasi-vacance du Conseil constitutionnel jusqu’au 30 juin en matière de « Questions Prioritaires de Constitutionnalité » (loi organique du 23 mars) est-elle justifiée alors que les professions juridiques sont de celles que l’on peut aisément pratiquer grâce à des moyens informatiques ?
L’État s’est organisé, dans les premières semaines, comme si nous étions en état d’exception alors que la société ne le ressentait guère – l’humour des confinés sur les réseaux sociaux montrent que nous étions loin de la sidération qui le caractérise, malgré les efforts de chaines d’information continue alarmistes – une facilité à laquelle il eût été heureux de résister afin que nul n’accrédite l’idée de normalisation de l’exceptionnel.
François Saint-Bonnet
Université Panthéon-Assas (Paris II)
40Références bibliographiques
De Beaumanoir, Philippe, Coutumes du Beauvaisis, Paris, éd. Salmon, Picard, 1970.
Le Gal, Sébastien, « Origines de l’état de siège en France », Thèse de l’Université Lyon 3, 2011.
Post, Gaines, « Ratio publicae utilitatis, ratio status et “raison d’État” (1100-1300) », dans Christian Lazzeri (éd.), Le Pouvoir de la raison d’État, Paris, PUF, 1992.
Saint-Bonnet, François, L’État d’exception, Paris, PUF, 2001.
Saint-Bonnet, François, « La dictature à l’époque moderne. La fascination pour une incompréhensible vertu », Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, vol. 41, no 1, 2015.
Saint-Bonnet, François, « L’abnégation des hommes, le sacrifice de la légalité. La Grande Guerre et l’impossible naissance d’un droit administratif d’exception », dans Jus politicum, revue de droit politique, vol. 8, 2016.
Saint-Bonnet, François, À l’épreuve du terrorisme. Les pouvoirs de l’État, Paris, Gallimard, 2017.
Thénault, Sylvie, « L’état d’urgence (1955-2005). De l’Algérie coloniale à la France contemporaine : destin d’une loi », Le Mouvement Social, 2007-1 (no 218).
1 C’est notamment ce qu’affirme Giorgio Agamben dans un entretien au journal Le Monde (20 mars 2020) à la suite d’une tribune publiée en Italie dans Il Manifesto (« Coronavirus et état d’exception », 26 février 2020).
2 Beaumanoir, 1970, chapitre xlix, § 1510, t. II, p. 261.
3 Saint-Bonnet, 2015, p. 43-63.
4 Post, 1992, p. 13-90.
5 Voir le rapport No 4281 des députés Dominique Raimbourg et Jean-Frédéric Poisson : http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/rap-info/i4281/#P414_83901 (consulté le 01/08/2020).
6 Voir supra.
7 Art. 1er de la loi de 1955 relative à l’état d’urgence.
8 Le discours du 23 avril 1961 de Charles de Gaulle, revêtant son uniforme de général de division malgré sa qualité de président de la république, est un modèle du genre.
9 Ce furent souvent les rebelles et séditieux au xixe siècle, les armées étrangères dont on s’efforçait de repousser les attaques jusqu’au milieu du xxe siècle, les terroristes anarchistes dans les années 1890 ou djihadistes depuis le IIIe millénaire, etc.
10 Voir Saint-Bonnet, 2001.
11 Sous l’Ancien Régime, la question est réglée par trois ordonnances au xviiie siècle : une première du 1er août 1733 concernant le commandement et le service des places, une deuxième du 25 juin 1750 concernant les gouverneurs & lieutenants généraux des provinces, les gouverneurs & états-majors des places & le service dans lesdites places, une troisième du 1er mars 1768 pour régler le service dans les places & dans les quartiers.
12 Plus précisément : rupture de toutes communications avec l’arrière à une distance de 1 800 toises (3 508 mètres) – la portée d’un gros canon – du chemin couvert qui en borde l’extérieur.
13 « Toute la durée de la guerre » (Loi du 5 août 1914, prorogeant le décret pris trois jours auparavant).
14 Voir les différents articles publiées dans le Revue du droit public et de la science politique de 1915 à 1917 par Joseph Barthélémy intitulés « Le droit public en temps de guerre ».
15 Voir sur ce point Saint-Bonnet, 2016, p. 87-105.
16 Déclaration d’indépendance de 1776, article 2 de la Déclaration de 1789, article 35 de la Déclaration de 1793.
17 Voir sur ce point les analyses de Sébastien Le Gal qui cite notamment Jourdan confessant en fructidor an V : « nous savons tous que quantité de communes qui ne sont pas portées sur le tableau annexé au décret du 10 juillet 1791, ont été mises non seulement en état de guerre, mais en état de siège… » (Le Gal, 2011, p. 277).
18 Qui prévoit en particulier qu’en cas d’état de siège dans une ville de l’intérieur, les armées ne peuvent appliquer que les dispositions de la loi de 1791 relatives au maintien de l’ordre public et à la police, non celles qui concernent les tours de garde, les sentinelles, la surveillance des portes ou des entrées de la ville.
19 Toutefois, dans un arrêt Geoffroy du 29 juin 1832, la Cour de cassation avait estimé que le décret de 1811 était inconciliable avec la Charte qui assure à chacun le droit d’être traduit devant ses « juges naturels », car les conseils de guerre devaient être regardés comme des « tribunaux extraordinaires » quand ils jugeaient des crimes commis par des civils, quand bien même il aurait été accusé, ce qui était le cas, de rébellion à main armée.
20 Deux exceptions notables : la Mayenne et la Vendée qui demeurent sous ce régime entre novembre 1799 et novembre 1801, le temps de réduire la « troisième chouannerie ».
21 La brièveté de l’état de siège peut s’expliquer aussi par l’échec de la reprise en main de la zone : Paris est placé sous ce régime le 28 juillet 1830, Charles X n’en fut pas moins contraint à l’exil dès le surlendemain.
22 Les régimes de l’état de siège ou de l’état d’urgence permettent aux forces de l’ordre de reprendre le contrôle de territoires qui leur échappent du fait de la violence ambiante et de la prolifération des opposants. Il s’agit 1 – de discipliner les citoyens dans l’espace public (manifestations interdites, couvre-feux, fouilles de personnes), 2 – de s’immiscer dans la sphère privée de ceux que l’on soupçonne (perquisitions administratives, assignations à résidence, mesures d’éloignement des indésirables, confiscation des armes légalement détenues), 3 – de surveiller l’espace communicationnel (censure de journaux, interdiction des réunions, fermeture de cinémas, de théâtres, voire de débits de boissons) et 4 – de juger rapidement ceux qui se rendraient coupables de crimes ou de délits (compétence des juridictions militaires).
23 Thénault, 2007, p. 63-78.
24 Celle-ci a fait l’objet de plusieurs modifications : les lois des 20 novembre 2015, 21 juillet 2016, 28 février 2017, 11 juillet 2017 et la Décision QPC du Conseil constitutionnel du 16 mars 2017.
25 Rapport No 4281 des députés Dominique Raimbourg et Jean-Frédéric Poisson, op. cit., p. 36.
26 Ainsi par exemple le financement du terrorisme (article 421-2-2 du code pénal) ou l’association de malfaiteurs terroristes (article 421-6 du même code).
27 L’État de droit suppose que tous les organes constitutionnels respectent des normes – constitutionnelles ou conventionnelles (telle que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de 1950) visant à limiter leur pouvoir (séparation des fonctions entre organes, garantie des droits). Mais il n’implique pas que ces règles doivent s’appliquer de manière fixe, immuable, invariable. D’une part, parce que l’étendue des droits de chacun varie en fonction de ceux d’autrui (art. 4 de la déclaration de 1789) comme de l’exigence d’un minimum d’ordre (Ce sont les références constantes à « l’ordre public établi par la loi » de la Déclaration de 1789). D’autre part, parce que la protection des droits fondamentaux n’a aucun sens si elle ne se traduit pas dans la réalité concrète, qui fluctue au gré des situations infiniment variées : la Cour européenne des droits de l’homme considère en effet que la « convention a pour but de protéger des droits non théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs » (CEDH, 9 octobre 1979, Airey c. Irlande). Une même règle constitutionnelle, une même convention internationale de protection de droits de l’homme – tout invariable que soit son texte – s’applique valablement de façon différente selon les temps, les lieux et les circonstances sans pour autant que l’on verse dans un quelconque état d’exception.
28 Les terroristes djihadistes étaient souvent de nationalité française tout en étant au service d’une organisation « apatride », aux intentions d’ailleurs plus eschatologiques que territoriales ou politiques. Voir sur ce point Saint-Bonnet, 2017.
29 La Guerre du Péloponnèse, L. II, chap. 64.
30 Les Guerres de Justinien, L. II, chap. 3.
31 Un corps de troupe chargé d’empêcher que des individus en provenance d’une région « pestiférée » ne pénètre dans une autre qui ne l’est pas.
32 Notamment à propos de la grande loi du 9 août 1849 relative à l’état de siège.
33 Flaubert, en quarantaine, se lamente en ces termes : « en suspicion de choléra », « nous sommes claquemurés dans une presqu’île et gardés à vue. […] Il n’y a rien de plus drôle que de voir nos gardiens qui communiquent avec nous à l’aide d’une perche, font des sauts de mouton pour nous éviter quand nous nous approchons, et reçoivent notre argent dans une écuelle remplie d’eau » (Lettre de Flaubert à Olympe Bonenfant, Du Lazaret de Beyrouth, 23 juillet 1850).
34 Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Paris, 1848, t. IX, p. 581.
35 Conseil d’État, Ordonnance du 22 mars 2020, No 439674, Syndicat Jeunes médecins.
36 Les voies de recours devant le juge administratif demeurent possibles.
37 Mécanisme constitutionnel prévu par l’article 38 en vertu duquel le parlement autorise le gouvernement à adopter des lois (et non des décrets) sans débat dans les hémicycles. Les ordonnances peuvent ensuite être « ratifiées » par les chambres.
38 Les 19, 21 et 22 mars 2020.
39 Le 1er avril 2020, audition du Premier ministre (M. Édouard Philippe) et du ministre des solidarités et de la santé (M. Olivier Véran), le 8 avril 2020, audition de la ministre de la Justice, garde des Sceaux (Mme Nicole Belloubet).
40 En cas de mise en œuvre de l’article 16, le parlement se réunit de plein droit hors session mais sans ordre du jour. Il peut aussi, comme aujourd’hui, suspendre ses travaux, comme il le fit le 22 juillet 1961 (JO 1961, Débats parlementaires, p. 2013).
41 Par l’utilisation de l’art. 50-1 de la constitution (déclaration suivie d’un vote sans engagement de la responsabilité) les 28 avril 2020 devant l’Assemblée et 4 mai 2020 devant le Sénat.