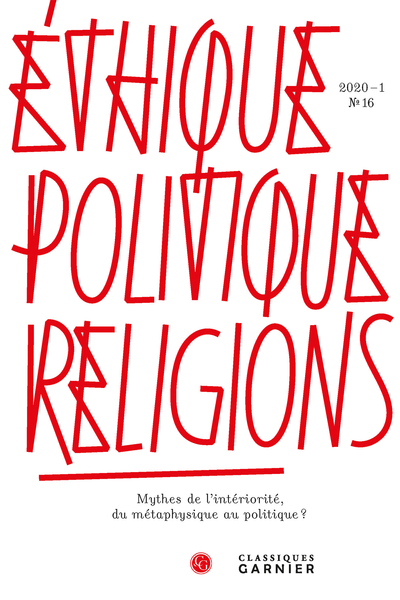
Group, rule, and politics Reflections
- Publication type: Journal article
- Journal: Éthique, politique, religions
2020 – 1, n° 16. Mythes de l'intériorité, du métaphysique au politique ? - Author: Gnassounou (Bruno)
- Abstract: Can a parallel be drawn between the weaknesses of a certain Cartesian conception of human individuals’ interiority, on the one hand, and the problems facing a “holistic” conception of political groups, viewed as “collective individuals” and as possessors of group interiority, on the other hand? The answer is no. In the context of the debate surrounding cosmopolitanism, this article argues that in political philosophy, one cannot do without the intertwined modern ideas of Nation and Sovereignty.
- Pages: 109 to 122
- Journal: Ethics, Politics, Religions
- CLIL theme: 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN: 9782406105732
- ISBN: 978-2-406-10573-2
- ISSN: 2271-7234
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-10573-2.p.0109
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 06-08-2020
- Periodicity: Biannual
- Language: French
- Keyword: Institutions, collective individuals, rules, contract, authority
Groupe, règle et politique
Réflexions
Est-il pertinent d’établir un rapprochement formel entre d’une part les faiblesses, sinon les incohérences, d’une certaine conception de l’intériorité des individus humains et d’autre part les critiques susceptibles d’être portées à l’encontre d’une conception, qu’on peut, pour aller vite, qualifier de « holiste », des groupes sociaux, notamment politiques, érigés en « individus collectifs1 » ? Ce dernier point de vue sur les groupes, en légitimant l’existence d’une intériorité collective, adouberait la séparation entre ce qui est chez nous (et même ce qui est « bien de chez nous ») et ce qui est au dehors (en dehors du groupe, au-delà des frontières de son territoire, extérieur à la nation que ce groupe éventuellement forme), et justifierait indûment certaines formes de repli sur soi et, pour tout dire, de protectionnisme et de patriotisme désormais désuètes. Ulrich Beck dans l’introït de son ouvrage sur le cosmopolitisme explique doctement que ce dernier n’est plus un idéal, comme il l’était encore au xixe siècle, mais un fait idéologique, puisque nous vivons une époque où la mondialisation du politique, des relations économiques, des flux monétaires, de la culture et de la communication a déjà considérablement affaibli le sentiment patriotique chez les citoyens ordinaires et devrait, comme l’appelle de ses vœux Ulrich Beck lui-même, entraîner une révolution dans les catégories sociologiques en substituant une « vision cosmopolitique » au « nationalisme méthodologique » qui infecte encore les sciences humaines2. Qu’est-ce qu’une telle « vision cosmopolitique » ? Un certain sens de la « mondialité », dit Ulrich Beck, qui est « un sens de l’absence de frontière3 ». Ce sentiment d’absence a bien sûr été produit 110par une première vague de dérégulations nationales et l’individualisation croissante qu’elles ont entraînée chez les membres des classes moyennes des pays riches, mais la prise de conscience chez les individus des effets bénéfiques, mais aussi délétères, notamment sur un plan écologique, de ces dérégulations demande une seconde vague de « re-régulations transnationales » et une « une démocratisation cosmopolitique4 ». Il s’agit d’acter l’obsolescence de cette notion éphémère qui fut celle de l’État-nation en lui substituant, au moins comme perspective, celle d’un mode de gouvernement sans frontière.
Il est alors tentant de suggérer que celui qui défendrait, de nos jours, l’inévitabilité de la souveraineté de l’État-nation succomberait à un « mythe de l’intériorité politique », parallèle au « mythe de l’intériorité », dont Jacques Bouveresse, dans son grand livre sur Wittgenstein5, a voulu montrer qu’il gouvernait une certaine conception moderne (cartésienne, pour le dire rapidement) du sujet. D’une certaine façon, le refus du cosmopolitisme serait le pendant politique du rejet, en philosophie de l’esprit, des avancées conceptuelles qu’a autorisées le tournant linguistique, en particulier dans la version qui s’est épanouie dans l’œuvre de Wittgenstein, lorsqu’il s’est agi de critiquer le sujet cartésien.
Pourtant, ce parallèle paraît mal établi. C’est qu’en effet, bien des contempteurs des frontières, à commencer par Ulrich Beck lui-même6, se réclament de façon tout à fait habituelle de l’apparition du sujet cartésien ou kantien pour trouver un « fondement » à la fois historique et philosophique à la modernité. Ce récit légendaire veut que l’avènement du sujet cartésien non seulement coïncide avec l’individualisme social, juridique et politique (celui des jusnaturalistes modernes, et de Hobbes et Locke), mais en constitue la justification dernière : le sujet cartésien met tout en doute pour tout fonder sur lui-même, ce qui veut dire qu’il met aussi en doute, ajoute-t-on, même si ce n’est pas dans la lettre des méditations de Descartes, les traditions dont il hérite. Par ailleurs, en tant que pur sujet, rien ne le distingue d’un autre sujet. Du coup, deux des caractéristiques principales de la modernité sociale y trouvent leur 111justification : 1) ce qui est premier ce sont les individus singuliers, 2) il existe une stricte égalité, découlant de leur homogénéité de principe (l’autre individu est comme moi, ego, c’est-à-dire est un alter ego), entre tous les individus. Je dis bien tous les individus, quelle que soit leur race ou religion, quelles que soient les traditions dont ils sont porteurs, les communautés, en particulier nationales, auxquelles ils croient appartenir. Le retour vers l’intériorité (en soi-même), étant à disposition de tous, est universel et justifie une forme de cosmopolitisme : seule une façon de gouverner la totalité des hommes en tant qu’ils sont détachés de communautés particulières (ce qu’ils sont en réalité, même s’ils ne le savent pas) est à proprement parler politique. Les politiques nationales (qui se pensent comme nationales) ne doivent se comprendre que comme des approximations ou des succédanés de ce mode de gouvernement global qui est toujours à l’horizon et qui en constitue l’achèvement.
La conception de soi comme tribunal intérieur autonome, seule source de légitimité épistémique et politique, n’implique pas le nationalisme, loin de là, selon cette conception du sujet moderne. Bien plus, du point de vue de ce cartésianisme légendaire, les tentatives de destituer le sujet de l’autorité épistémique sur lui-même, en s’appuyant notamment sur le caractère public des règles de langage, comme on pourrait le trouver dans l’argument contre le langage privé de Wittgenstein, risquent au contraire de déboucher sur une réhabilitation des contextes culturels dans lesquels les sujets sont nés et d’où proviennent ces règles, c’est-à-dire des traditions. Les critiques du sujet cartésien peuvent donc apparaître comme consubstantiellement communautariennes, et par conséquent anti-cosmopolites.
Il me faut noter que, dans cette critique individualiste des frontières, on se situe bien loin du cosmopolitisme grec. Lorsque Diogène le Cynique, en réponse à Alexandre qui lui demande de quelle cité il vient, répond, rapporte-t-on, qu’il est « un citoyen du monde (kosmopolites) » (Diogenes Laertius VI 63), il veut dire que l’individu singulier échappe à l’emprise de toute institution, notamment à celle de la Cité (polis). Lorsque les Stoïciens se déclarent cosmopolites, il s’agit avant tout de signifier que la nature présente l’ordonnancement le plus parfait et le plus englobant (par analogie avec la Cité, qui englobe de façon ordonnée toutes les autres institutions), mais il ne leur serait pas venu à l’idée d’affirmer que le politique se joue à un autre niveau que la cité : bien 112plus, la nature demande que nous nous comportions en bon citoyen, c’est-à-dire en citoyen de la cité d’où nous venons. Vivre en cosmopolite cela signifie non pas vivre dans le cadre d’une cité mondiale, mais être capable de se détacher, intérieurement, de toute engagement politique, fut-il, par impossible, mondial. Le cosmopolitisme se surimpose à la vie politique, il ne s’y substitue pas.
Peut-on se passer, en philosophie politique, de l’idée moderne de nation et de celle de souveraineté qui lui est liée ? Il n’est pas question ici d’apporter une solution à cet immense problème. Néanmoins, je me propose de présenter de façon rapide et donc dogmatique quelques éléments propres à étayer la thèse suivante : bien que le tournant linguistique anticartésien ne nous autorise pas à inférer d’une thèse quelconque sur la nature de l’intériorité une conclusion sur le politique, il existe néanmoins un aspect présent dans la version wittgensteinienne de ce tournant, à savoir la notion d’institution (ou de coutume), qui permet de trancher la question de la cohérence de la notion de groupe et de la trancher dans le sens d’un refus du cosmopolitisme. Ce qui guide les réflexions qui suivent, c’est une idée un peu audacieuse : il faut peut-être une philosophie sociale préalable pour aborder des problèmes relevant de la philosophie politique et leur trouver une solution.
Il serait, somme toute, bien extraordinaire que l’on puisse tirer d’une thèse aussi métaphysique que la critique du sujet cartésien une quelconque conclusion sur la nature du politique.
Le mieux est de partir de Wittgenstein lui-même au paragraphe § 411 des Recherches philosophiques :
Considérez la manière dont on pourrait faire une application de ces questions et comment on pourrait décider des réponses à y apporter :
(1) « Ces livres sont-ils mes livres ? »
(2) « Est-ce que ce pied est mon pied ? »
(3) « Est-ce que ce corps est mon corps »
(4) « Est-ce que cette sensation est ma sensation7 ? »
Wittgenstein établit dans ce texte une gradation entre diverses manières de distinguer ce qui m’est propre de ce qui m’est étranger. Je 113peux désigner du doigt un exemplaire de la République de Platon et me poser la question de savoir si c’est le mien, c’est-à-dire si j’en suis propriétaire ou le possesseur, ce qui suppose que je pourrais ne pas l’être. La question de l’identité du possédant est tout à fait sensée et il est toujours possible que je me trompe sur cette identité, en croyant qu’un objet est le mien, alors qu’il ne l’est pas, et inversement. En revanche, si j’éprouve du chagrin, il est exclu que je puisse me demande si ce chagrin est le mien ou si c’est celui de quelqu’un d’autre : il n’y a pas d’abord identification de la sensation, puis ensuite identification de son porteur. Les jugements de sensations en première personne sont immunisés contre les erreurs d’identification de leur porteur. Une manière de le dire est donc d’affirmer 1) qu’il est illusoire de croire que les auto-attributions d’états psychologiques reposent sur des actes d’ostensions internes pour assurer la référence du sujet d’attribution (moi) 2) que nous avons besoin de désigner les états psychologiques par ostension. Ici, il n’est besoin de la reconnaissance d’aucune personne. Entre ces deux extrêmes, viennent les attributions de membres et de son propre corps : dans les circonstances normales, la question ne se pose pas, mais elle le peut dans des circonstances rares, comme celles où j’aperçois quelqu’un dans un miroir dont je ne sais pas si le corps que je vois est vraiment le mien. En revanche, si je pointe mon doigt non plus sur une image de mon corps, mais sur mon corps lui-même, alors, en disant : « Ceci est mon corps », je ne me transmets à moi-même aucune information permettant de répondre à la question : « Est-ce bien mon corps ? ». Tout au plus, j’apprends à quelqu’un l’usage de l’expression « mon corps ».
Je tire de ce texte la conclusion que toute tentative de tirer d’une analyse de la subjectivité des conclusions sur la nature des institutions (en l’occurrence juridiques) provient, comme dirait un wittgensteinien, d’une « confusion grammaticale. » Wittgenstein veut sans doute critiquer ici l’assimilation, typique de certaines philosophies de la conscience de soi, de la sensation à un objet, qui se distinguerait des objets publics par le fait qu’il est purement privé (cela à un double titre : quand j’ai mal, je suis le seul porteur de la sensation et je suis par ailleurs le seul à savoir que j’ai mal). Mais il accepte par ailleurs la conclusion cartésienne (à vrai dire, c’est là, à ses yeux, le principal apport de Descartes) selon laquelle il existe une distinction de principe, mal comprise certes par le cartésien, entre les états psychologiques (tous identifiés par le cartésien 114à des vécus) et les objets physiques. La question de savoir comment on conçoit le caractère privé des sensations et leur rôle dans l’institution du langage, à la manière cartésienne ou non cartésienne, n’a donc aucune incidence sur les réflexions que l’on peut mener par ailleurs sur le droit et le politique. Le cas intermédiaire du corps (celui, plus concret encore, des organes, aussi) est parlant : « Ce corps est-il mon corps ? ». Au sens organique et proprioceptif, il l’est, sans aliénation possible, mais il n’a pas encore été décidé par-là, si, en un autre sens du mot « mien », ce corps était le mien : si j’en suis propriétaire. Il se peut ou non, en fait ou principe, que quelqu’un ait une autorité sur lui (un dominium), comme le maître l’a sur ses esclaves, mais dans tous les cas, si cette personne, moi-même ou un autre, a une telle autorité, elle « n’aura » pas ce corps, comme elle est dite l’avoir au sens organique. Les deux dimensions de la propriété sont orthogonales l’une à l’autre.
Wittgenstein ne nous dit rien sur la nature de la propriété au sens juridique. Il nous invite simplement à distinguer l’individu comme sujet de sensations, et plus largement le sujet d’états psychologiques, et l’individu comme porteur de titres de propriété, c’est-à-dire porteur de certains droits. Or il existe ici bel et bien un débat vénérable entre une conception individualiste de la propriété et une conception que l’on pourrait appeler « institutionnaliste » de la propriété. Ce débat a pu se formuler en termes de droits subjectifs : faut-il concevoir les relations réglées entre des individus comme fondées sur des qualités (normatives ou non) naturellement attachées à la personne, comme dit Grotius, ou au contraire n’y a-t-il de sens à attribuer des droits et des devoirs de justice à un individu que dans le cadre d’une institution ? Ici le qualificatif de « subjectif » ne signifie en rien une propriété psychologique portée par le sujet cartésien, mais caractérise certaines prérogatives normatives portées par un individu humain8.
Or, de ce point de vue, ce n’est pas la notion de langage, comme telle, qui est importante, c’est la notion d’institution. Je comprends le propos de Wittgenstein contre le langage privé comme pouvant se formuler en deux thèses : 1) la signification des termes de notre langage, 115y compris des termes de sensation, n’est pas fondé sur les expériences privées, car tout langage est une institution (une pratique gouvernée par des règles) ; 2) et une institution, étant reçue comme instituée par celui qui s’y conforme, est sociale : elle est préétablie et donc n’a sa source dans aucune décision individuelle, ni dans aucune agrégation de décisions individuelles (dans ce qu’on appelle aujourd’hui une intention collective). La question est de savoir comment on doit penser la socialité des règles (institutions) : sont-elles des prérogatives individuelles ? Une théorie institutionnaliste nie qu’elles le soient.
Prenons les exemples du commerce, du troc ou du contrat, ceux-là même que des doctrines individualistes ont voulu mettre au fondement des sociétés civiles. Supposons donc deux individus qui commercent, qui troquent, qui contractent. Premier point : cela est impossible s’il n’existe aucune règle du commerce, du troc, ou de l’échange. Deux considérations sont importantes, la première concerne la dimension normative de l’acte troquer ou de contracter, et l’autre son caractère intégral. Commençons par la première. Supposons que je laisse simplement un objet avec l’intention qu’un autre le prenne et qu’il me livre quelque chose à son tour. On ne trouvera aucune dimension normative dans ce qui se passe : s’attendre à ce que quelqu’un laisse quelque chose pour moi, alors que j’ai laissé quelque chose pour lui n’implique pas du tout que j’ai droit à ce qu’il me laisse quelque chose. « Mon attente est déçue » ne peut pas signifier « j’ai droit à ce qu’il me laisse quelque chose en retour et il ne l’a pas respecté ». Pourquoi ne serait-il pas permis à quelqu’un de décevoir mon attente ? Il y a un saut logique entre les deux propositions (entre les deux notions de « laisser pour qu’on me laisse » et « avoir droit qu’on me laisse en échange de ce que j’ai laissé ») que rien de naturel, que ce soit des considérations naturelles externes ou internes (psychologiques), ne peut combler naturellement.
Par ailleurs, il faut une pratique du troc, sous peine de n’avoir affaire qu’à une série de gestes qui n’ont pas de lien entre eux, sinon celui, naturel, de leur succession : l’un laisse quelque chose, l’autre le prend ; ce dernier laisse à son tour quelque chose qui est pris par le premier. Dans cette configuration, on ne comprendrait pas comment ces deux actions ne sont que des parties d’une seule et même action commune, celle d’effectuer un troc : comment elles sont intégrées pour que l’une et l’autre ne soient que des parties d’une unique action. L’acte de l’un est 116déjà en quelque sorte l’acte de l’autre : il y a une seule action dont la réalisation et l’achèvement réclament l’intervention des deux agents. Il faut qu’il soit préétabli que ces actes comptent comme une seule et même opération, celle d’un unique troc (cela ne peut pas se découvrir après coup), et c’est nécessairement parce que les individus sont familiarisés dès avant le troc particulier avec l’idée même du troc.
Pour que cette succession de gestes soit la réalisation d’un troc, suffit-il d’ajouter que les agents les accomplissent avec en tête l’idée qu’il s’agit d’un troc ? En d’autres termes, si l’unité de l’action ne peut se réduire à une identité matérielle, suffit-il de soutenir qu’elle est psychologique : uniquement due à ce qui passe par la tête des agents, pris l’un à part l’autre ? Il y aurait échange, partout où les individus penseraient que leur action est une action d’échanger. Pourtant, ajouter des états mentaux individuels à des actions individuelles matérielles ne nous sera d’aucune aide.
Supposons, en effet, que les éléments qu’il faille ajouter pour que deux nos opérations n’en forment qu’une, soient identifiés à des éléments mentaux mutuellement indépendants présents dans la tête des agents. Il faut qu’ils accomplissent leur acte de dépôt en pensant, chacun à part soi, qu’ils troquent. C’est le fait que chacun d’entre eux soit dans un état mental dont le contenu est « Je troque (avec cette personne) » qui ferait que leurs opérations constituent une seule opération de troquer. Pourtant, la simple coprésence chez l’un et l’autre agent d’une telle pensée ne pourra jamais engendrer un troc réel. Tout d’abord le fait que je pense que je troque ne saurait pas plus engendrer d’obligation pour moi de ne pas reprendre ce que j’ai déposé que l’acte même du dépôt : oui, j’ai pensé être obligé, mais pourquoi serais-je, de ce simple fait, obligé réellement ? Il serait trop facile d’obtenir un statut (celui de créancier ou de débiteur) s’il suffisait de penser qu’on l’a. Ensuite, tout le monde sera d’accord pour dire que si un seul des individus pense participer à un troc et que l’autre ne le pense pas, il n’y a pas de troc. Or, cela est vrai aussi, si, par une extraordinaire coïncidence, deux individus ont cette pensée chacun à part de l’autre. Il ne suffit pas que je croie être le propriétaire d’une maison et que vous croyiez que je le suis aussi pour que je sois réellement détenteur d’un droit sur la chose et vous sujet d’une obligation corrélative de respecter ce droit. Il faut un titre de propriété, extérieur à nos pensées, et auquel par principe le 117propriétaire du bien et ceux qui ne le sont pas acceptent de se soumettre comme ayant une autorité sur eux et ce qu’ils peuvent penser. Il faut donc présupposer une institution de la propriété extérieure aux agents pour que la relation de propriété à propriétaire puisse être instaurée. Il en va exactement de même pour le troc : il faut l’institution préalable du troc particulier soit possible et que les intentions des agents comptent comme des intentions d’opérer un troc.
La conclusion qu’il faut en tirer ici est qu’il est illusoire de penser que des individus cartésiens puissent rendre compte des relations sociales les plus élémentaires. Une société est plus qu’une somme d’individus pourvus de capacité réflexive.
Néanmoins toutes ces considérations sur la socialité des règles ont peut-être un impact sur la conception des institutions et des droits, mais aucun sur la conception du politique. On ne peut en déduire quoi que ce soit sur l’existence d’un individu collectif. L’institution du troc ou du contrat peut parfaitement être transmise dans le cadre de société sans identité collective. On pourrait même considérer qu’elle est universelle et justifier une anthropologie comparatiste universaliste : partout on troque, partout on commerce, partout on se marie, partout on contracte, etc., même si ces institutions communes se manifestent sous des formes particulières, et expliquer ainsi pourquoi il n’est pas si difficile de traiter avec un étranger.
Pourtant, je crois que nous ferons un premier pas vers la notion de totalité collective si nous regardons de plus près l’exemple du contrat. Nous avons jusqu’à maintenant distingué entre 1) l’institution du contrat (bilatéral) d’un côté et 2) le contrat particulier qui est en train d’être passé et montré que chaque acte particulier d’échanger contractuellement présupposait la familiarité des parties avec l’institution. Reste à savoir comment exactement se crée le lien de droit entre ces parties.
1) Une première lecture veut en effet que chacune des prestations constitue une obligation pour chacun des individus qui contractent, individus qui sont alors considérés distributivement. Chacun d’entre eux s’impose une obligation, et la communique ensuite à autrui (qui l’accepte ou non). La question est alors de savoir comment un individu peut ainsi se créer une loi pour lui-même.
Or, il est naturel de penser, comme l’affirme le Digeste (livre XLV, titre 1, leg. 108), que nulla promissio consistere potest, quae ex voluntate 118promittentis statum capit : aucune promesse qui repose sur la volonté de celui qui promet ne peut avoir de consistance. Soit, en effet, une action donnée. Si un individu décide de l’accomplir, il lui est toujours loisible (c’est-à-dire logiquement possible) de revenir sur sa décision (ce que je veux, je peux cesser de le vouloir). S’il décide d’aller écouter un concert demain, il est toujours possible de décider de ne plus y aller demain. Il en irait de même s’il décidait non plus simplement d’aller au concert demain, mais de s’obliger à aller un concert demain : il pourrait toujours décider d’abandonner cette décision de s’obliger. Mais une obligation qui est telle qu’elle n’oblige que tant que l’on veut qu’elle oblige n’est pas une obligation. Par conséquent, il était impossible, en premier lieu, d’avoir voulu s’obliger. Si l’acte a eu lieu (par exemple intérieurement), ce n’était qu’une vaine cérémonie. On ne peut pas s’obliger tout seul : si une obligation s’impose à quelqu’un, elle provient nécessairement d’un autre que lui. Toute obligation nécessite au moins deux personnes distinctes pour être constituée.
2) On pourrait soutenir plutôt que, lorsque des individus formulent une loi pour eux-mêmes, ils doivent être considérés collectivement. Les deux parties dans la transaction forment un groupe et ce groupe se donne comme loi celle qui consiste dans la conjonction des formulations des engagements de chaque membre et qui attribue à l’un et l’autre une tâche dans l’exercice de la loi (chacun doit faire sa part). Mais on objectera aisément que, là encore, on a affaire à une seule entité, certes collective, mais une entité tout de même, qui s’imposerait toujours et encore à elle-même une loi. Or, ce qui vaut pour un individu concret, vaut peut-être encore plus pour une entité collective, car, de plus, cette entité semble avoir l’inconvénient d’être fictive : dans la réalité, il n’y a que des individus.
La solution à ce problème est donnée par Rousseau dans sa fameuse formule du contrat social, mais que l’on doit étendre à toute forme de contrat. Elle repose sur le fait que nous avons affaire à un groupe, mais un groupe composé d’individus, ou, pour le dire selon la réciproque, à des individus, certes, mais considérés comme membres d’un groupe :
On voit, par cette formule, que l’acte d’association renferme un engagement réciproque du public avec les particuliers, et que chaque individu, contractant pour ainsi dire avec lui-même, se trouve engagé sous un double rapport : savoir, comme membre du souverain envers les particuliers, et comme membre de 119l’état envers le souverain. Mais on ne peut appliquer ici la maxime du droit civil, que nul n’est tenu aux engagements pris avec lui-même ; car il y a bien de la différence entre s’obliger envers soi ou envers un tout dont on fait partie9.
Un groupe, pris comme un bloc, ne peut pas s’imposer de loi à lui-même. Il ne peut y avoir d’engagement du public à l’égard du public, pas plus qu’il ne peut y avoir d’engagement d’un individu humain à l’égard de lui-même. Le public, à l’égard de lui-même, ne peut tout au plus que prendre des décisions, sur lesquelles il lui est toujours loisible de revenir. C’est pourquoi Rousseau rappelle que nul n’est tenu aux engagements pris avec lui-même.
La solution de Rousseau consiste à concevoir la communauté (ici politique, mais c’est la formule générale qui nous importe) comme une totalité hiérarchique. Si nous voulons comprendre comment des lois peuvent exister (tout particulièrement dans une démocratie où le peuple semble se donner à lui-même des lois), il faut penser que le groupe est structuré de façon interne. Il y a d’une part le groupe et d’autre part, non pas exactement les individus, qui, en tant que tels, ne forment qu’une multitude, mais ses parties. Inversement, les individus peuvent s’engager envers le groupe, mais à condition de le faire en tant que parties du groupe. C’est à cette condition que l’acte de donner une loi peut être considéré non pas comme un simple agrégat de deux opérations (celle d’un souverain séparé de la multitude et celle de l’acceptation par cette multitude la décision du souverain, mais comme un seul acte), mais comme une unique opération, tout en respectant la distinction des personnes nécessaire pour qu’une telle obligation puisse se constituer.
Nous avons donc un premier résultat : impossible de comprendre comment deux individus peuvent échanger sans supposer qu’ils forment un groupe.
A-t-on alors un modèle pour une communauté politique ? Certainement pas. C’est qu’il y a groupe et groupe. Nous sommes encore loin d’une société civile (de citoyens). Mais nous y arriverons peut-être en notant les points suivants. D’abord, le groupe des contractants est éphémère, transitoire : il cessera d’exister dès que les parties se seront exécutées. Il manque une profondeur historique à ce groupe pour former une 120communauté : le troc, le commerce, les échanges, des contrats (traités) de tous ordres peuvent se faire inter gentes, entre communautés ou entre membres de diverses communautés sans que ni elles, ni leurs membres, ne forment une seule et même entité politique. Les communautés qui font alliance, comme les individus qui contractent, forment des groupes bien réels, mais « informels ». Pourtant, second point, qui est crucial, quelque chose est commun à tout type de groupe : un ensemble d’individus ne forme groupe qu’à la condition que chacun fasse la différence entre ce qui se passe à l’intérieur du groupe et ce qui est extérieur au groupe. Même pour ce sujet collectif éphémère que constituent les parties contractantes, il existe, comme on dit, un « effet relatif du contrat » (privacy of contract) : la relation contractuelle que nous avons établie nous concerne nous, et non eux. Un groupe ne peut se constituer que par contraste avec d’autres groupes. Il n’y a pas de groupe avec une structuration interne, s’il n’y a pas de distinction du groupe par rapport à quelque chose d’extérieur vis-à-vis duquel il forme un individu collectif.
Nous avons alors trois des éléments importants pour qu’un ensemble d’individus commence à être politique : il faut 1) un groupe, comme le présuppose toute relation sociale, donc au fond un bien commun aux membres du groupe ; 2) ce bien est celui de ce groupe et susceptible de s’opposer à ceux d’autres groupes (comme le bien d’un individu humain peut s’opposer au bien d’un autre) ; il n’est pas interdit de penser que cette différence se donne sous la forme d’un frontière (comme le pensait Maine) ; 3) le bien d’un groupe politique présuppose une forme de permanence ou d’histoire. Il manque un dernier élément pour que le politique puisse commencer à avoir une réalité.
Pour l’identifier, il nous faut être au clair sur la distinction entre point de vue moral et point de vue politique lorsque nous abordons les affaires humaines, comme dit Aristote. La question morale sera : si une personne me porte préjudice (« porte atteinte à mon intégrité » physique, ne respecte pas sa parole, s’empare des fruits de mon labeur, etc.), une correction doit-elle s’appliquer et, si oui, de quelle nature est-elle ? Cette personne mérite-t-elle une peine ? Ai-je droit à des dommages ? etc. Tout cela relève de cette vertu morale qu’est la justice, en l’occurrence sous sa forme correctrice. La question politique sera très différente : étant donné qu’une correction est moralement appropriée, qui a autorité pour l’appliquer ? Celui qui a subi le préjudice ou non ? Une communauté 121commence à être politique lorsque cette question a reçu une réponse et où une instance a le pouvoir de la faire respecter. C’est la question, non pas de la justice (qui constitue éventuellement le contenu de codes), mais de l’administration de la justice, de la nature du système judiciaire et de l’autorité qui en garantie le bon fonctionnement.
Lorsqu’une communauté historique, nécessairement une parmi d’autres, se dote en outre d’une autorité de faire respecter les lois et de protéger les citoyens de ceux qui pâtissent éventuellement des dommages que peuvent leur imposer les autres, elle est en plus une communauté politique.
Tout ceci ne fait qu’exclure de la sphère politique un cosmopolitisme de droit : une communauté qui, de jure, n’a pas d’extérieur est une communauté morale, non une communauté politique. Moralement, l’étranger est mon prochain, comme le montre la parabole du bon samaritain, en d’autres termes, il n’y a aucune différence à faire entre l’autre et moi-même. Politiquement, l’étranger est, par définition, un étranger, et donc se pose inévitablement la question des formes de l’accueil des étrangers (les réponses pouvant être de tous ordres) dans sa communauté et sur son territoire. Peut-il y avoir un cosmopolitisme de fait : un rassemblement de toutes les nations existantes ici et maintenant sous une seule autorité ? En principe rien ne l’exclut s’il répond aux critères susdits, mais en réalité, les conditions de sa réalisation sont si contraignantes qu’il ne peut constituer, là encore, qu’un idéal, sublime en théorie, mais irréalisable en pratique, parce que les intérêts des nations existantes divergent de fait. Marcel Mauss l’avait déjà noté au sortir de la première guerre mondiale :
Nous proposons de réserver le nom de cosmopolitisme à la première. C’est un courant d’idées et de faits mêmes qui tendent réellement à la destruction des nations, à la création d’une morale où elles ne seraient plus les autorités souveraines, créatrices de la loi, ni les buts suprêmes dignes des sacrifices consacrés dorénavant a une meilleure cause, celle de l’humanité […] Ces idées n’ont ni plus ni moins de chances de devenir des idées-forces que toutes les Utopies. Car elles ne sont que cela. Elles ne correspondent à aucune réalité du temps présent ; elles ne sont le fait d’aucun groupe naturel d’hommes ; elles ne sont l’expression d’aucun intérêt défini. Elles ne sont que le dernier aboutissant de l’individualisme pur, religieux et chrétien, ou métaphysique. Cette politique de « l’homme citoyen du monde » n’est que la conséquence d’une théorie éthérée de l’homme monade partout identique, agent d’une 122morale transcendante aux réalités de la vie sociale ; d’une morale ne concevant d’autre patrie que l’humanité d’autres lois que les naturelles (Socrate, d’après Plutarque, de Exilio, V). Toutes idées qui sont peut-être vraies à la limite, mais qui ne sont pas des motifs d’action, ni pour 1’immense majorité des hommes, ni pour aucune des sociétés existantes10.
Lorsque des entités politiques plus vastes veulent se constituer à partir de communautés politiques préexistantes, il est inévitable que s’opposent les « souverainistes » et les « fédéralistes ». Le débat est légitime, mais notez que même les fédéralistes voudraient que l’entité politique à constituer se pensent comme une nation : avec un territoire, une armée, une juridiction commune, une autorité. En d’autres termes, ils n’abolissent pas la souveraineté dans les faits (bien qu’ils puissent le faire en paroles), bien au contraire, mais estiment qu’elle doit se situer à un échelon supérieur. Quelle raison aurions-nous de constituer une telle entité de niveau supérieur, si nous ne présupposions un intérêt commun à tous ses membres, c’est-à-dire si nous ne reconnaissions implicitement qu’il existe d’autres entités parmi lesquelles elle doit prendre sa place et contre lesquelles, inévitablement, elle aura, éventuellement, à protéger ses propres intérêts ?
Bruno Gnassounou
Centre Atlantique de philosophie
1 J’emprunte cette expression à Vincent Descombes, « Les individus collectifs », Revue du Mauss, 2001/2 no 18, p. 305-337.
2 Ulrich Beck, The Cosmopolitan Vision, trad. de l’allemand C. Cronin, Cambridge, Polity, 2006 (éd. allemande 2004), p. 2.
3 Op. cit., p. 3.
4 Ulrich Beck, World Risk Society, Cambridge, Polity Press, p. 15.
5 Jacques Bouveresse, Le Mythe de l’intériorité, Paris, Les Éditions de Minuit, 1976.
6 Voir par exemple Ulrich Beck, Wolfgang Bonss et Christoph Lau, « The Theory of Reflexive Modernization », Theory, Culture and Society, 2003, vol. 20, p. 1-33. Les auteurs insistent néanmoins sur le fait que ce sujet cartésien n’a plus beaucoup de temps pour la réflexion, devant choisir sans cesse dans l’urgence (voir p. 23). C’est un détail.
7 « Überlege : Wie können diese Fragen angewendet, und wie entschieden werden : 1) “Sind diese Bücher meine Bücher ?” 2) “Ist dieser Fuß mein Fuß ?” 3) “Ist dieser Körper mein Körper ?” 4) “Ist diese Empfindung meine Empfindung ?” »
8 La question du caractère naturel ou non des droits ne doit pas être confondue avec celle de la prééminence des droits subjectifs sur le droit objectif. La même question (naturel ou institutionnel ?) se poserait à quiconque soutiendrait (comme Kelsen par exemple) que le droit objectif précède les droits subjectifs.
9 Rousseau, Le Contrat social, in Œuvres complètes, Tome III, Paris, Gallimard, coll. La Pléïade, 1964, livre I, ch. 7.
10 p. 246-247 des Proceedings of the Aristotelian Society, 1920 et p. 394-396 du texte édité dans le recueil : Marcel Mauss, La Nation ou le sens du social, PUF, Paris, 2013.