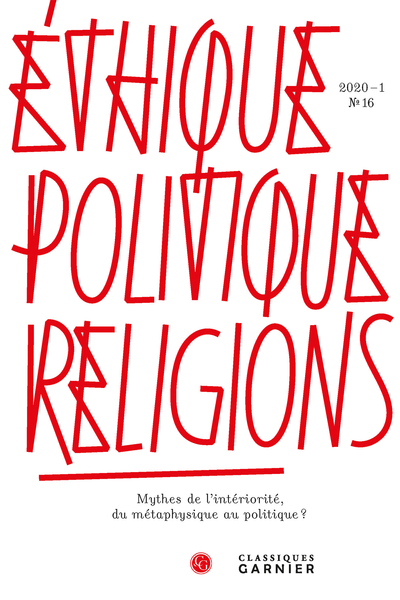
Dialogue avec Jacques Bouveresse
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Éthique, politique, religions
2020 – 1, n° 16. Mythes de l'intériorité, du métaphysique au politique ? - Auteurs : Delpla (Isabelle), Pasquier (Emmanuel), Frouville (Olivier de), Gnassounou (Bruno), Bourcier (Benjamin), Bouveresse (Jacques)
- Résumé : Quelles sont les implications politiques et juridiques du Mythe de l’intériorité ? Jacques Bouveresse revient sur le silence de Wittgenstein à ce sujet, et le rapport des philosophes –souvent désastreux – à la politique. Il analyse l’analogie entre mythes de l’intériorité épistémique et politique et l’apport de Kraus à la critique du solipsisme national. On envisage ensuite un parallèle entre Wittgenstein et Kelsen dans sa critique du solipsisme étatique et la critique du solipsisme par Musil.
- Pages : 25 à 70
- Revue : Éthique, politique, religions
- Thème CLIL : 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN : 9782406105732
- ISBN : 978-2-406-10573-2
- ISSN : 2271-7234
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-10573-2.p.0025
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 08/06/2020
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : Mythe de l’intériorité, solipsisme, nationalisme, droit international, Wittgenstein, Hans Kelsen, Robert Musil
Dialogue avec Jacques Bouveresse
Isabelle Delpla : Merci beaucoup d’avoir accepté cette invitation. Nous vous poserons d’abord des questions à partir de Wittgenstein sur les possibles implications politiques de sa critique du mythe de l’intériorité linguistique. Ces questions porteront aussi sur votre dernier ouvrage Les premiers jours de l’inhumanité, Karl Kraus et la guerre (chez Hors d’Atteinte, collection « Faits et idées », paru fin 2019) qui traite notamment de la critique par Kraus du solipsisme nationaliste et, de manière plus originale, du solipsisme juridique. Emmanuel Pasquier poursuivra sur Kelsen pour voir dans quelle mesure on peut rapprocher la critique du solipsisme par Kelsen – du solipsisme étatique – et la critique du solipsisme individuel par Wittgenstein. Nous finirons par des questions de Benjamin Bourcier sur vos travaux consacrés à Musil.
Je voudrais commencer par une première question très générale. Quelles implications politiques pensez-vous que l’on peut tirer, ou que Wittgenstein ou vous-même pouvez tirer de vos analyses du mythe de l’intériorité ? Et dans quelle mesure Wittgenstein peut-il ou non apporter un appui à la critique du solipsisme nationaliste par Kraus ? Pour préciser ma question, quelle analogie pourrait-on établir entre ces deux mythes de l’intériorité, métaphysique et politique ? Et quel en est l’intérêt ? On pourrait certainement reprendre les métaphores de Wittgenstein et les transposer au domaine politique et international ; comme celle du journal intime, du journal du matin acheté plusieurs fois, du don d’une main à une autre, de la chambre privée ou du manomètre. Mais ne pourrait-on pas objecter au rapprochement entre ces deux mythes – et là je me réfère à votre conférence inaugurale au collège de France1 – que l’un métaphysique, le solipsisme subjectif, porte sur la croyance en des entités métaphysiques et sur l’opposition entre l’apparence 26et la réalité, ce qui n’est pas forcément le cas – ou seulement de manière dérivée – du solipsisme politique, ou du mythe de l’intériorité politique, où l’opposition est d’abord entre eux et nous, entre amis et ennemis, et moins directement entre la réalité et l’apparence, même si bien sûr il peut aussi y avoir des illusions.
Ou bien faut-il considérer que la proximité entre les deux mythes tient à ce qu’il y a aussi une réalité métaphysique dans le mythe de l’intériorité politique, celle notamment que Kraus analyse quand il critique le langage nazi, c’est-à-dire la croyance en une « race pure », en une patrie au-dessus de tout et au-dessus de l’humanité ? Est-ce que ce serait cela des réalités métaphysiques que l’analyse du langage pourrait évacuer ?
La deuxième différence importante, me semble-t-il, tient à ce qu’on peut attendre de l’analyse du langage. Dans le mythe de l’intériorité métaphysique, on attend de l’analyse du langage qu’elle nous défasse d’une fausse réalité, qu’elle dénoue un certain nombre de crampes métaphysiques et nous permette un retour à l’ordinaire qui a une fonction thérapeutique. En l’occurrence, je ne suis pas sûre que le retour au langage ordinaire nous défasse des crampes politiques et que le retour à l’ordinaire ne nous enracine pas, au contraire, dans des visions nationales. Est-ce que l’on pourrait avoir un ordinaire de l’international, que justement l’analyse du langage nous permettrait de voir – en montrant que le droit international tisse aussi la vie quotidienne nationale.
De plus, je m’étais déjà posée une question en lisant Le mythe de l’intériorité, et plus récemment votre texte sur Kraus – à titre de possibilité, et non d’implication toujours valide –, est ce qu’on ne peut pas tirer un internationalisme fort de votre lecture de Wittgenstein et de Kraus sur l’idée de suivre une règle ? Dans la critique du langage privé, je ne peux pas avoir un langage seul, parce que seul, je ne peux pas faire la différence entre suivre une règle et ne pas la suivre, donc j’ai une illusion de langage : tout ce qui me semble vrai sera vrai. Donc il faut une communauté de correction possible, pour que je puisse appliquer véritablement la règle. Est-ce que l’on peut monter d’un cran, et appliquer ce raisonnement au sujet étatique ? Une première étape serait de dire l’État n’existe que par l’ordre juridique international, ce serait la version Kelsen. Mais allons plus loin avec Kraus : ne pourrait-on pas considérer que sans droit international, il n’y a pas non plus de droit national, car 27tout ce qui semblera juste sera juste et le droit sombrera en tant que droit dans la subjectivité des intérêts politiques ? La critique de Kraus de la politisation du droit par le nazisme et sa critique de l’abolition de toute autonomie du droit par rapport à la politique, pourrait ouvrir la voie non pas nécessairement d’une réfutation du solipsisme politique, mais tout au moins du solipsisme juridique. C’est-à-dire : sans droit international, et sans la correction que le droit international peut donner à nos illusions de suivre une règle juridique, on ne suit finalement que les intérêts de la nation tels qu’un certain nombre de personnes les ont écrits subjectivement ; sans droit international, on n’a pas plus de droit national que le solipsiste n’avait de langage privé.
C’est la question que je voudrais vous poser sur la philosophie du langage. On peut prendre la critique du langage en un sens assez général : Klemperer l’a fait, Kraus le fait, c’est-à-dire qu’il y a une critique du langage nazi, de leur usage du langage – la critique de la propagande –, qui est utile politiquement, mais qui ne requiert pas nécessairement des outils conceptuels extrêmement élaborés. Un certain bon sens et une honnêteté minimale suffisent. En revanche, les outils de Wittgenstein pour la critique du langage privé sont relativement sophistiqués. Donc, pour critiquer ce langage trompeur en politique, a-t-on besoin d’une philosophie du langage, relevant finalement du bon sens et de l’honnêteté ? Jusqu’à quel point les critiques de Wittgenstein avec leur sophistication peuvent porter plus loin une critique du solipsisme juridique, voire du solipsisme politique ?
Jacques Bouveresse : Oui, cela fait beaucoup de questions ! Des questions difficiles. Avant tout, je vous remercie de m’avoir fait l’honneur de m’inviter, et de m’avoir donné l’impression que le travail que j’avais consacré à la rédaction du « Mythe de l’intériorité » avait pu être utile, et qui plus est utile dans un domaine auquel je ne m’attendais pas tellement à ce qu’il le soit, à savoir celui de la réflexion sur le droit et la politique. Honnêtement, je dois vous dire que quand j’ai écrit le livre, je ne pensais pas tellement à une application de ce genre – cela m’est peut-être venu à l’esprit, mais vraiment de façon très lointaine et très indirecte. Donc je suis vraiment agréablement surpris de tout le travail qui a déjà été fait par vous et par les gens qui vous entourent dans ce domaine qui me semble du plus haut intérêt.
28Cela dit, il y a effectivement une question de principe, une question primordiale qui se pose : jusqu’à quel point peut-on aller dans l’usage de cette analogie entre le mythe de l’intériorité, ce que vous avez appelé le mythe de l’intériorité sémantique, et le mythe de l’intériorité politique ? Il va sans dire qu’il ne peut s’agir, dans le meilleur des cas, que d’une analogie, pour des raisons qui ont été soulignées d’ailleurs de différentes façons ce matin ; et la question avec une analogie, c’est toujours : jusqu’à quel point est-elle utile et éclairante ? À partir de quel moment devient-elle nuisible ? C’est ce que Wittgenstein dit et répète, puisqu’on a affaire, généralement, avec l’analogie, à un instrument qui peut se révéler partiellement et temporairement utile, mais qui peut rapidement devenir néfaste en philosophie toutes les fois que l’analogie est utilisée de façon complètement générale et pour ainsi dire absolue. Donc il y a cette difficulté. D’ailleurs, à ce propos-là, comme je me suis permis de photocopier les dernières pages de la Théorie pure du droit de Kelsen, on voit, simplement en lisant le début, en quoi consiste la difficulté : si vous me permettez de citer juste quelques lignes « il existe un parallélisme frappant entre l’antithèse qui oppose les deux constructions monistes du rapport entre droit international et droit étatique, c’est-à-dire les deux voies qui aboutissent l’une comme l’autre à l’unité sur le plan de la connaissance de tout droit valable ». Donc vous voyez que Kelsen se situe clairement sur le plan cognitif. Je le cite :
De même que les conceptions du monde subjectiviste partent du moi propre posé comme souverain pour saisir et concevoir le monde extérieur et que par suite elles ne conçoivent pas celui-ci en réalité comme un monde extérieur mais bien comme un monde purement intérieur au sujet – donc le monde extérieur est intériorisé au sujet comme une représentation et une volonté du moi [il n’est, comme vous le voyez, rien de plus que cela et n’a donc pas d’extériorité ni de réalité dans cette mesure-là] –, de même, la construction que nous avons appelé primauté de l’ordre juridique étatique part de l’État national du juriste posé comme souverain pour saisir le monde juridique extérieur, le droit international et les autres ordres juridiques étatiques, et par suite, elle ne peut concevoir ce droit extérieur que comme un droit interne, comme une partie de l’ordre juridique national d’où elle est partie (Théorie pure du droit, p. 459-450 de la traduction française).
C’est donc bien essentiellement comme un problème de connaissance qu’est envisagée la question de l’intériorité et de l’extériorité. Dans ce cas, il y a au moins les deux problèmes qu’a rappelés notre ami Bruno 29Gnassounou dans son exposé, c’est-à-dire qu’il y a la question du caractère privé de la possession, et celle du caractère privé de la connaissance, qui ne sont pas nécessairement identiques. Déjà, de ce point de vue-là, il se pourrait qu’il y ait un problème si on tenait à établir un rapport absolument étroit et complet entre ces deux choses.
Il y a encore une chose que je voulais dire, pour justifier la référence que vous avez faites à Karl Kraus : une chose qui m’a frappé après coup, à propos des « Premiers jours de l’inhumanité », et dont j’avais peut-être sous-estimé l’importance, est l’omniprésence du droit et de la question du droit chez Kraus (c’est un point qui a été souligné notamment par Walter Benjamin). Presque toute la réflexion de Kraus est de nature juridique au sens large, c’est-à-dire que la question qu’il pose, c’est toujours « de quel droit ? », est-ce qu’il n’y a pas eu à un moment quelconque un droit qui a été violé, donc un abus qui a été commis et qui devrait être sanctionné ? Cela n’est pas moins vrai dans l’usage que l’on fait du langage – qui a en quelque sorte, lui aussi, sa propre légalité et ses droits qui doivent être respectés, un point auquel Kraus accorde une importance particulière – que dans n’importe quel autre domaine. Je signale à ce propos une remarque de Walter Benjamin, qui date de mars 1931, dans un article qui a été publié par la Frankfurter Zeitung : « On ne comprend rien de cet homme tant qu’on ne reconnaît pas que tout, sans exception, le langage et la cause à défendre (Sprache und Sache) se passe nécessairement pour lui dans la sphère du droit. » J’ai l’impression que Benjamin a retiré de la lecture de Kraus l’impression qu’il y a, chez lui une espèce de juridicisation, si on peut s’exprimer ainsi, de tous les problèmes vraiment sérieux – en tout cas des problèmes auxquels il s’attaque lui-même. Et en tant que satiriste, ce qui semble l’avoir préoccupé jusqu’à l’obsession, c’est cette idée du droit et de la justice qui doit être respectée à tout prix aussi bien dans ce que l’on dit que dans ce que l’on fait.
[Wittgenstein et la politique] Concernant la question d’une éventuelle application de ce que dit Wittgenstein au traitement de questions politiques, j’ai toujours été pour le moins sceptique dans ce domaine. Néanmoins, j’éprouve une certaine sympathie pour tous ceux qui prennent le risque de s’attaquer à ce type de problèmes. Dans les années 1970, il est paru un livre d’Anna Fenichel Pitkin sur Wittgenstein et la politique : Wittgenstein and Justice (University of California Press, Berkeley, 1972 ; ce 30devait être à peu près le premier du genre), qui avait analysé de près la possibilité d’une transposition, d’une application plus ou moins directe, de ce que Wittgenstein dit au traitement des questions politiques, et depuis, il y a eu une multitude de tentatives dans ce genre, qui me laissent généralement très dubitatif (c’est particulièrement vrai de ce que font à présent avec Wittgenstein des philosophes comme Chantal Mouffe, qui me donnent l’impression de ne pas l’avoir lu ou de n’avoir pas compris grand-chose à ce qu’il dit). Je reviendrai tout à l’heure sur la question de l’ordinaire. En ce qui concerne Wittgenstein lui-même, il y a une chose qui évidemment est frappante, c’est son refus à peu près absolu de parler de politique. C’est un domaine dans lequel il n’intervient jamais, au moins directement. Il a dit une fois dans un cours – c’est tout à fait étonnant – « il faudra que je fasse un jour une leçon pour expliquer pourquoi je ne parle pas de politique ». Mais malheureusement il ne l’a jamais fait … Sur ce point, l’éthique, bien qu’il en ait très peu parlé, se distingue tout de même de la politique. Il a fini par donner une « Leçon sur l’éthique », qui est à peu près le seul texte véritablement rédigé et suivi qu’il ait produit sur l’éthique. Et comme par hasard, elle n’était pas du tout destinée à un public de philosophes ! Mais à un public composé de gens tout à fait ordinaires. Il pensait que, s’il se décidait à parler de l’éthique c’est devant des gens de cette sorte qu’un philosophe dans son genre se devait de le faire. Il aurait peut-être dit la même chose de la politique, pour parler de laquelle il était certainement encore beaucoup moins motivé et, en tout cas, il aurait à coup sûr probablement évité d’en parler devant un public constitué principalement de philosophes politiques. Il vaut mieux à coup sûr ne pas penser à ce qu’il aurait pu dire de l’espèce de politisation systématique, radicale et obligatoire de la philosophie qui a été pendant des décennies une des caractéristiques distinctives de la philosophie française contemporaine.
J’essaie de donner maintenant un commencement de réponse à la troisième des questions que vous m’avez posées : une difficulté à laquelle on se heurte ici est ce que Wittgenstein dit à un moment donné à propos de la réflexion et du travail philosophiques, à savoir qu’ils permettent quelquefois de savoir ce qu’il ne faut pas dire, mais à peu près jamais de savoir réellement ce qu’il faut dire. Je me suis dit souvent que l’on aurait peut-être intérêt à appliquer aussi ce principe à d’autres domaines, et tout particulièrement à la politique. Cela veut dire en gros : en utilisant ce 31que Wittgenstein nous dit en tant que philosophe, on peut peut-être espérer au moins comprendre un peu mieux ce qu’il ne faut pas dire et pourquoi, mais pas nécessairement beaucoup plus que cela. Je dois avouer que, personnellement, le rapport que j’ai avec la politique est tel que j’éprouve le sentiment que presque tout ce que j’entends en politique – plus que jamais, du reste, en ce moment – fait partie des choses qu’il faudrait plutôt éviter de dire ! Pour une multitude de raisons, la première d’entre elles étant que c’est en général complètement creux, et parfois à peu près dénué de sens. Mais cela n’est malheureusement pas la seule, il y a des défauts beaucoup plus graves, comme par exemple la tolérance apparemment à peu près illimitée du discours politique au mensonge, y compris les plus grossiers, qui semblent d’ailleurs réussir assez souvent à se faire accepter plus facilement que les petits. Je voulais simplement rappeler que Wittgenstein lui-même n’attendait sans doute pas qu’on tire des conséquences plus ou moins précises de ce qu’il a essayé de faire en philosophie pour ce qui concerne la pensée et l’action politiques proprement dites, en dehors de ce que l’on pourrait appeler un effet « thérapeutique », que l’on aurait, il est vrai, tout à fait tort de considérer comme négligeable.
C’est une chose qui est à mettre en rapport avec ce dont on a pris conscience de façon relativement tardive (et sur quoi depuis on a commencé à insister de façon beaucoup trop unilatérale et même parfois exclusive) : Wittgenstein souligne que la philosophie est d’abord un travail que l’on effectue sur soi-même et qui vise à une transformation de soi-même. Par conséquent, à ses yeux, la philosophie devrait avoir principalement des effets individuels. Il n’est pas du tout évident qu’on puisse en attendre énormément pour la transformation de la société elle-même. Pour la transformation de l’individu : oui. Et d’une certaine manière, il pense que chaque individu doit reprendre les choses complètement à zéro en ce qui le concerne. Il ne suffit pas, pour effectuer sur soi-même le genre de transformation souhaitable, de lire simplement les grands philosophes. Il faut en quelque sorte accepter de faire l’effort de philosopher réellement par soi-même. Et cela vaut, bien entendu, en premier lieu pour l’utilisation que l’on peut faire de ce qu’il dit lui-même …
Sur ce point, Wittgenstein fait une distinction qui à ses yeux est absolument cruciale entre ce qui constitue un matériau pour la philosophie et ce qui est véritablement de la philosophie. Par exemple il n’avait 32pas beaucoup d’estime pour le genre de philosophie que produisent la plupart du temps les mathématiciens sur leur discipline quand ils se décident à philosopher sur elle. Il considérait que ce qu’un mathématicien est enclin à dire quand il se met à faire de la philosophie sur son objet le plus proche, c’est-à-dire sur les mathématiques, est ce qu’il appelle « raw material », du matériau brut pour le travail philosophique. C’est seulement après qu’on peut commencer à faire de la philosophie en partant de ce matériau, puisqu’en philosophie, il faut toujours partir d’un matériau qui n’est pas seulement brut, mais qui est quelquefois constitué par de la sottise ou du non-sens. Wittgenstein dit effectivement : si vous avez envie de dire une chose qui est peut-être stupide, n’hésitez pas à la dire, cela peut toujours être utile, on peut commencer à réfléchir à partir de cela. Donc ce que j’appréhenderais si Wittgenstein se trouvait obligé de participer à une discussion avec des philosophes politiques, c’est qu’il dise d’eux un peu la même chose que ce qu’il dit à propos des mathématiciens.
Je ne voudrais pas me risquer à parler à sa place, mais je pense qu’il avait un problème avec la politique et peut-être encore plus avec la prétention qu’affiche fréquemment la philosophie de disposer d’une compétence tout à fait particulière sur ce genre de sujet. Cela ne signifie pas qu’il ait été apolitique ou qu’il se soit désintéressé complètement de la politique. Il a bel et bien fait à certains moments des choix politiques. Il n’était sûrement pas non plus, en politique, aussi conservateur qu’on le dit souvent, car dans ce cas il serait pour le moins difficile de comprendre la position qu’il a adoptée à l’égard de la Russie soviétique et le fait qu’il ait à un moment donné envisagé sérieusement d‘aller y vivre. Quand il était instituteur en Autriche, il a dit une fois du parti social-démocrate – qui, bien que Kraus lui ait reproché violemment d’avoir trahi ses idéaux au profit de la bourgeoisie, était tout de même probablement plus à gauche que la part des partis sociaux-démocrates actuels – que c’était le seul parti honnête et respectable. Et quand il était à Cambridge, le journal qu’il lisait, d’après Georg Henrik von Wright, c’était le New Statesman and Nation, qui était un journal de gauche. En outre, en 1945, il a voté contre Churchill, pour le parti travailliste. Mais il ne se sentait visiblement pas qualifié pour parler, en tant que philosophe, de la politique. C’est une chose qu’on peut avoir des difficultés à comprendre, parce qu’on a l’habitude de considérer qu’un 33(vrai) philosophe doit se considérer comme capable et comme tenu de s’exprimer à peu près sur n’importe espèce de sujet. Wittgenstein ne ressentait aucune obligation de cette sorte. Il y a un bon nombre de questions, jugées souvent primordiales en philosophie, sur lesquelles il s’est volontairement abstenu de parler, parce qu’il ne se sentait pas le droit de le faire et qu’il estimait, pour reprendre une formule qu’il a utilisée lui-même, qu’il y a des cas dans lesquels il est difficile de dire quelque chose qui soit aussi bon que : ne rien dire du tout. Je pense que la philosophie ne perdrait pas grand-chose si elle acceptait de temps à autre de regarder les choses de cette façon. Cela ne répond que très partiellement à votre question, puisqu’on peut tout à fait se sentir autorisé à faire malgré tout un usage politique de ce qu’il a dit en philosophie. Cela me semble tout à fait légitime, mais à la condition de commencer par le lire réellement et de ne pas s’empresser de lui faire dire essentiellement ce que l’on a envie d’entendre
[Apparence et réalité] Il y a deux aspects de la question que vous avez évoquée : il y a la question de la différence entre l’apparence et la réalité et puis il y a la question du retour à l’ordinaire. Sur le rapport entre l’apparence et la réalité, ce qui est en question, c’est exactement de savoir dans quelle mesure, entre les gens qui prennent des positions différentes et même opposées – par exemple les deux positions que distingue Kelsen – lequel parle de l’apparence et lequel parle de la réalité ? Est-ce que c’est à cela que vous pensez ou à quelque chose d’autre ? Parce qu’il y aurait ici un travail philosophique à faire, et même métaphysique pour le coup, dans la mesure où vous vous êtes servi à un moment donné de l’expression « réalité métaphysique ». Je ne pense pas que Wittgenstein aurait été enchanté de voir utiliser une expression de cette sorte, étant donné l’usage qu’il fait, de façon générale, du nom « Métaphysique » et du qualificatif « métaphysique ». Néanmoins, une question qui reste bel et bien posée est celle du rapport à la réalité, parce qu’à chaque fois, la question posée est bien : qu’est ce qui a le plus de réalité ? Ou : qu’est-ce qui devrait en avoir le plus ? Est-ce que c’est, par exemple, le droit international, qui du coup se trouverait pourvu de la capacité d’exercer éventuellement un contrôle sur l’usage qui est fait du droit interne – du droit étatique, au sens du droit qui est subordonné à et dépendant de la politique d’un État donné ? Autrement dit, est-ce que c’est le droit international qui est le plus réel, ou au contraire 34est-ce le droit étatique qui peut prétendre posséder le plus haut degré de réalité ou même, comme le pensent certains, être le seul à posséder une véritable réalité ? Et sur quoi repose au juste le sentiment que la réalité dont il est question n’est pas une création plus ou moins arbitraire et doit nécessairement comporter quelque chose d’objectif ?
Isabelle Delpla : Le terme « réalité métaphysique », sauf erreur de ma part, je l’avais pris dans votre leçon inaugurale au collège de France à propos des types d’illusion que peut créer le langage. Donc la question serait de savoir si, en matière politique, on a des pseudos entités, des réalités métaphysiques analogues, qu’une analyse du langage pourrait critiquer ; et effectivement, vous répondez par la question qui se pose : quel droit est le plus réel ? L’opposition que je peux avoir par exemple avec Bruno Gnassounou porte aussi sur l’effectivité et la réalité du droit international. Lui considère que c’est un droit secondaire qui ne vient qu’après le droit national, et avec Olivier de Frouville, nous avons tendance à penser que le droit international est toujours déjà là. Que sans droit international, de toute manière, il n’y a pas de reconnaissance des États, il n’y a pas de frontières reconnues, il n’y a pas d’État parce qu’il n’y a pas de territoire. L’État est déjà pris dans le droit international pour pouvoir exister. Donc vous répondez à la question, en disant qu’on peut traiter de la question du point de vue du degré de réalité, et donc effectivement du point de vue de l’apparence et de la réalité.
Jacques Bouveresse : D’accord. Je pense qu’on peut faire de même, quand il s’agit de dénoncer de pseudo-entités qui sont exclusivement le produit du langage et de l’usage rhétorique que l’on en fait, exercice dans lequel Wittgenstein excelle – là-dessus nous sommes du même avis, vous et moi. On est confronté constamment à ce type de problème, et d’ailleurs les représentants du monde politique pratiquent régulièrement ce genre d’exercice et s’accusent les uns les autres de parler de choses qui n’existent pas, ou à peu près pas. À commencer par l’Europe par exemple : il y a des gens pour qui l’Europe possède une certaine réalité – je reconnais qu’elle est, surtout en ce moment, plutôt exsangue – et ceux pour qui l’Europe n’a jamais possédé une réalité d’aucune sorte. Vous avez raison. Là, il y a une contribution tout à fait possible de la philosophie. C’est le genre d’exercice que j’aime bien personnellement, donc ce n’est pas moi qui vais contester l’idée de s’en servir à propos 35du langage politique. Si l’on en croit Jules Vuillemin, la distinction entre l’apparence et la réalité est justement la question fondamentale à laquelle les systèmes philosophiques, pour ce qui concerne la philosophie théorique en tout cas, donnent des réponses divergentes et souvent inconciliables. Mais s’il y a, comme il le pense, une pluralité irréductible des réponses, qui n’est pas accidentelle, mais intrinsèque, de quel secours peut être exactement la philosophie, quand il faut faire un choix, en l’occurrence un choix entre différentes façons de tracer la ligne de démarcation entre l’apparence et la réalité ? La réponse qui vient le plus naturellement à l’esprit est que la philosophie peut nous aider justement à choisir. Mais, d’une part, je ne trouve pas que les philosophes se soient, de façon générale, illustrés particulièrement par leur capacité de discernement dans les choix politiques qu’ils ont fait. D’autre part, si mieux choisir veut dire notamment choisir en fonction de (bonnes) raisons et sur la base d’arguments sérieux, il est pour le moins décourageant de constater que c’est plus que jamais l’émotion et la passion, et non la raison et les arguments, qui décident en politique et que même la notion de vérité semble avoir désormais (d’après ce que l’on entend dire en tout cas) perdu à peu près toute importance (il y a même des philosophes qui réussissent à considérer cela comme un progrès). On est tenté de dire, à ce sujet, dans le langage de Julien Benda, que les « clercs » cèdent malheureusement beaucoup trop facilement et trop fréquemment à la tentation de trahir leur mission en se laissant emporter eux-mêmes, à peu près comme tout le monde, essentiellement par l’émotion et la passion politiques, au lieu d’essayer justement de raisonner un peu plus. Il faudrait donc, pour pouvoir être réellement utiles, qu’ils commencent par effectuer un travail sérieux sur eux-mêmes et sur leur propre cas.
[Les philosophes et la politique] Ce que je crains, c’est qu’une fois qu’on a fait le travail philosophique qui était possible et nécessaire, les choix à faire restent à peu près toujours aussi difficiles, et la philosophie aussi peu susceptible d’aider réellement à choisir le meilleur. Elle semble bien être une activité qui peut s’exercer de façon relativement, et même fâcheusement neutre à l’égard de presque tous les types de discours politiques. Est-ce qu’elle donne réellement des moyens plus sérieux de choisir entre les différentes options qui se présentent, surtout si l’on doit considérer à peu près comme acquis que la raison et 36les arguments ne jouent, en l’occurrence, qu’un rôle pour le moins très secondaire, pour ne pas dire à peu près négligeable ? Autrement dit, si elle réussit à faire elle-même des choix qui pourraient être justifiés philosophiquement et par conséquent qualifiés de « philosophiques », quelles chances a-t-elle d’être écoutée si elle cherche à les proposer à d’autres ? Je ne suis, naturellement, pas en train de dire que les philosophes devraient s’abstenir de parler de politique, mais seulement qu’ils devraient, sur des questions comme celles dont il s’agit, essayer de faire preuve d’un peu plus de modestie et même d’humilité. Je suis donc tout à fait convaincu de l’utilité de la philosophie au sens où vous l’entendez, mais j’aurais tendance à m’en tenir à une idée plus modeste de ce que peut être exactement son rôle. Là, je reconnais que j’ai peut-être un point de vue très subjectif, parce que depuis les années 1960 – c’est le moment où j’ai commencé à faire de la philosophie sérieusement – j’ai entendu tellement de sottises et d’énormités, venues des philosophes, sur les questions politiques que j’hésite vraiment à les créditer d’une capacité spéciale d’intervention dans ce domaine. C’est d’ailleurs une chose qui m’étonne : qu’est ce qui permet aux philosophes d’être à ce point convaincus qu’ils sont plus compétents que les autres pour donner un avis sur les questions politiques ? Alors qu’ils donnent généralement ou en tout cas trop souvent l’exemple du contraire. Il m’arrive souvent d’être tenté de dire qu’ils tiennent en l’occurrence un discours qui se développe de façon parallèle à la réalité dont il est censé traiter et ne la rencontre presque jamais, sans que, apparemment, cela les gêne en aucune façon.
Et donc une question qu’on peut poser en réponse à votre propre question, c’est : pourquoi les philosophes (en France en tout cas, c’est loin d’être toujours aussi vrai ailleurs) considèrent-ils à ce point la politique comme un objet essentiel et primordial pour leur réflexion ? Parce que dans ma jeunesse, c’était vraiment un objet de cette sorte. Une philosophie se jugeait sur ses implications politiques, ce qui a produit souvent des résultats absolument extravagants. Althusser a même réussi à convaincre un bon nombre de gens de ma génération que la philosophie devait être considérée tout simplement comme de la « lutte de classe dans la théorie ». Déjà à cette époque-là, je me disais qu’il valait mieux ne pas penser à la façon dont auraient dû être traités des philosophes comme Heidegger et Nietzsche si l’on avait essayé de faire preuve d’un peu de 37cohérence et de sérieux. Donc la question demeure, parce qu’il subsiste encore aujourd’hui quelque chose de cela. Les philosophes continuent à être convaincus largement de disposer d’une compétence spéciale pour éclairer les gens ordinaires sur la façon dont ils devraient essayer de conduire leur vie, et par conséquent sur les choix moraux et politiques qu’ils devraient faire. Je n’ai jamais eu, je l’avoue, ce genre d’ambition et, sans être disposé à aller sur ce point aussi loin que Clément Rosset, qui se réfère du reste, lui aussi, à Wittgenstein, je pense que l’on peut également se rendre utile en essayant de clarifier et de dénoncer la confusion et le non-sens que les philosophes contribuent, eux aussi, à produire, notamment dans le discours qu’ils tiennent sur la politique …
Isabelle Delpla : Je reviens sur un point : si on joint la critique de Wittgenstein et celle de Kraus, on pourrait arriver à une critique du solipsisme juridique, c’est-à-dire à l’idée que finalement, sans droit international, il n’y a pas de droit national sur ce modèle : on n’a pas de langage parce qu’on ne peut pas suivre une règle, seul, et pour l’État, on ne peut pas avoir un droit national, seul, puisque sans le droit international, finalement, le droit interne devient trop facilement le jouet d’une politique subjective, comme Kraus le souligne … Je trouve que c’est une idée assez forte et intéressante. Est-ce que c’est une voie que vous défendriez ? Est-ce que, selon vous, Kraus la défend ? Pourrait-on la tirer de l’analogie entre la critique de Kraus et celle de Wittgenstein, ou est-ce que je vais trop loin ?
Jacques Bouveresse : [Karl Kraus et la propagande nazie] Non, je pense que vous avez tout à fait raison : dans le but que vous décrivez et que je partage, on peut tout à fait se servir de Wittgenstein, avec ou sans son accord – je ne suis pas sûr qu’il serait d’accord, parce qu’il n’avait aucune prétention et aucune envie d’être utilisé de façon politique, sauf peut-être éventuellement de la façon négative que j’ai essayé de caractériser – mais on n’a pas nécessairement à demander l’avis d’un philosophe pour utiliser ses œuvres – et cela vaut, bien entendu, également pour Kraus. Une différence entre Kraus et Wittgenstein, c’est que Kraus est un moraliste et un politique ; c’est quelqu’un qui n’éprouve aucune gêne dans le fait d’adopter un point de vue ouvertement moral – ce qui est du reste tout à fait normal pour un satiriste. Il est en outre, 38évidemment, bien plus politique que Wittgenstein. Il est même à certains moments très, très politique. Donc j’approuve entièrement votre idée, et du même coup le genre de travail que vous suggérez de faire. Mais je ne suis pas certain de pouvoir vous aider beaucoup, pour le moment du moins, car je viens malheureusement à peine de me replonger dans la philosophie du droit (en grande partie à cause de Kraus) – ce dont je vous prie de m’excuser – et tous ceux d’entre vous que j’ai écouté en savent manifestement beaucoup plus que moi sur ces sujets-là. Et même probablement, ils ont une connaissance plus précise du Mythe de l’intériorité que le souvenir que j’ai gardé de ce livre, écrit il y a maintenant plus de quarante ans !
Il y a une chose encore à laquelle je voulais faire allusion, brièvement si possible : il y a un moment où chez Kraus, on se rapproche assez nettement, bien que ce soit de façon indirecte, de ces problèmes du langage privé. C’est à propos de Carl Schmitt. Quand celui-ci parle de la distinction qu’il présente comme la distinction politique par excellence, celle de l’ami et de l’ennemi, il se rapproche sensiblement d’une espèce de privatisation du concept de l’ami et de l’ennemi. Il y a un passage où il dit : « la possibilité de connaître et de juger correctement et du même coup l’habilitation à parler avec les autres et à juger n’est donnée que par le fait d’avoir partie liée, et de participer ». Donc si vous voulez pouvoir parler avec ceux qui défendent à un moment donné une conception précise de « qui est l’ennemi, qui est l’ami », comme cela a été le cas en Allemagne, il faut participer. Seul celui qui participe peut comprendre de quoi il s’agit, parce que la décision comporte un caractère existentiel – je crois qu’il prononce ce terme.
Dans Troisième nuit de Walpurgis, il y a une critique en règle de ce que Kraus appelle les « Worthelfer der Gewalt » : ce sont les gens qui mettent la parole au service de la violence, qui ont choisi de mettre le discours au service de la force, et même de la violence pure et simple. Kraus procède d’une façon qui est assez étonnante, c’est-à-dire qu’il absout Nietzche et Wagner, envers lesquels il se montre, à mon avis, trop indulgent, surtout Wagner, étant donné son antisémitisme virulent ; mais Kraus a trouvé – dans la correspondance avec Louis II de Bavière – un passage où Wagner dit pis que pendre des Allemands, comme le fait Nietzsche aussi, et fréquemment, à partir d’un certain moment ; Kraus fait remarquer avec pertinence que des gloires nationales 39comme Nietzsche et Wagner, qui sont utilisés comme des références par les nazis, auraient à présent toutes les chances de se trouver du jour au lendemain dans un camp de concentration à cause de la façon dont ils se sont permis de parler des Allemands. Il n’avait d’ailleurs pas oublié non plus, à l’époque de la Première Guerre mondiale, de rappeler que Hölderlin lui-même s’était exprimé avec une sévérité particulière et de façon extrêmement négative sur l’Allemagne et les Allemands. Pour ce qui concerne Nietzsche, on peut constater effectivement qu’à partir d’un certain moment, il dit régulièrement du bien et parfois même, comme dans le cas de son traducteur danois, Georg Brandes, le plus grand bien des Juifs, ne serait-ce que par envie de provoquer les Allemands, mais il semble que dans sa jeunesse il ait été pour le moins un peu plus ambigu. Ce qui est intéressant, c’est la façon dont Kraus choisit les intellectuels à qui il impute une responsabilité véritable dans l’espèce de désastre absolu que représente pour lui le nazisme. Il y a Heidegger, il y a Spengler et il y a Gottfried Benn. Je passe sur ce qu’il dit de Heidegger et de Spengler, qui ne nous intéressent pas directement, mais en ce qui concerne Gottfried Benn, une chose qu’on ne sait généralement pas, c’est qu’il était très lié avec Carl Schmitt, et a été influencé fortement par lui.
Kraus s’en prend donc à Benn, parce qu’il a coopéré avec le nazisme – l’intéressé a reconnu du reste après coup que c’était une faute, à la différence de Heidegger, qui ne l’a jamais réellement fait –, mais pas seulement. Une des raisons les plus sérieuses pour lesquelles Kraus s’en prend à lui, c’est que Benn critique ouvertement l’attitude des émigrés, qu’il va jusqu’à qualifier de « fuyards » et presque de déserteurs, en soutenant que les seuls qui ont droit à la parole sont ceux qui sont restés. Ce qui était réellement difficile et courageux aurait été effectivement, soutient-il, de rester en Allemagne et d’accepter de participer à la révolution qui était en train de la transformer de façon radicale. Heidegger, qui est, lui aussi, assez proche de Schmitt et a d’ailleurs participé avec lui à une Commission sur le droit et la philosophie du droit qui a siégé de 1934 à 1943 et dont le président était Hans Frank – auquel Kraus, qui pour sa part, savait parfaitement à quoi s’en tenir sur ce qui était en train de se passer, a réservé un traitement spécial dans Troisième Nuit de Walpurgis – a tenu, lui aussi, un discours assez proche de celui de Benn quand il a essayé de se justifier. Si l’on pense, comme Schmitt, qu’un 40État doit disposer de la capacité et du droit de décider souverainement qui est son ami et qui est son ennemi et de traiter en conséquence les autres nations, il n’est pas surprenant que le principe en vienne très rapidement à être appliqué aussi quand c’est de l’« ennemi intérieur » qu’il est question. Benn dit ceci :
Je dois vous dire, d’abord, qu’on ne peut parler sur les processus allemands qu’avec ceux qui les vivent eux-mêmes à l’intérieur de l’Allemagne. Seuls ceux qui sont passés par les tensions de ces derniers mois […], avec tous ceux-là, on peut parler. Mais avec les fuyards, qui sont partis en voyage à l’étranger, on ne le peut pas. Ceux-ci ont en effet négligé l’occasion de sentir croître en eux, non pas intellectuellement, mais sous la forme de l’expérience vécue, non pas abstraitement, mais en eux, dans sa nature de poussée qui s’exerce, le concept qui leur est si étranger du peuple.
Là, pour le coup, vous avez cette idée qu’à partir d’un certain moment, il y a un langage qui se tient en Allemagne et que seuls peuvent comprendre réellement ceux qui sont restés. Les autres ne le peuvent pas, parce qu’ils sont privés de l’expérience vécue dont on a besoin pour cela, c’est-à-dire celle de l’émergence de la nouvelle Allemagne et de l’apparition simultanée d’un type d’homme nouveau qui en train de naître, peut-être effectivement dans la douleur, mais avec un avenir complètement transformé devant lui.
On comprend aisément l’indignation que suscite chez Kraus la façon dont Benn parle des émigrés qui, selon lui, « ont préféré la faim à Paris plutôt que la belle vie à Berlin » (c’est Kraus qui exprime et résume de cette façon la pensée de Benn). Mais je dois avouer que je trouve, pour ma part, à peu près aussi déshonorante, la façon dont Heidegger parle à un moment donné de Carnap comme de « l’américain Carnap », autrement dit, en suggérant implicitement qu’il était au fond normal que des gens comme lui soient obligés de quitter l’Allemagne, parce que ce n’étaient pas des vrais Allemands. Soit dit en passant, je crois aussi que Schmitt et Heidegger ont été, dans les faits, avant tout plus rusés et plus malins, mais sûrement pas moins coupables, que beaucoup d’autres intellectuels auxquels on ne pardonne tout simplement rien. On peut dire en tout cas que leur stratégie défensive a agi, surtout en ce qui concerne Heidegger, de façon remarquablement efficace sur leurs disciples français.
Dans des passages comme ceux de Benn que cite Kraus, on a un peu l’impression que le problème de la privatisation des concepts et du 41langage apparaît au moins implicitement. L’Allemagne nouvelle, celle de la révolution nationale, parle en quelque sorte un langage que ceux qui sont partis ne peuvent pas comprendre ou plus exactement qu’ils ne comprenaient déjà plus au moment où ils sont partis. C’étaient en fin de compte déjà des étrangers, dont il était, somme toute, logique qu’ils choisissent (contrairement à ce que l’on raconte, sans y être réellement contraints) de partir effectivement à l’étranger. Dans cet ordre d’idées, Kraus souligne également que Benn, quand il invoque le peuple, semble oublier que le mot « peuple » a aussi un pluriel. Il y a en réalité des peuples, qu’il vaudrait mieux encourager à essayer de se comprendre un peu mieux entre eux, au lieu de fortifier le désir qu’a plus ou moins chacun d’entre eux de se considérer comme le peuple élu, dont les membres ne peuvent se comprendre réellement qu’entre eux, sur la base d’une expérience vécue qu’ils ont en commun et qui est d’une espèce unique en son genre. Il peut être utile de rappeler à ce propos que, pour Wittgenstein, la signification n’est pas du tout de la nature d’une expérience psychologique et surtout pas d’une expérience privée. Ce n’est pas l’expérience vécue qui décide du sens.
À cela s’ajoute évidemment aussi la façon révoltante dont Benn suggère que les émigrés, qui ont renoncé délibérément à participer à une aventure exaltante, semblent avoir oublié qu’ils ne risquaient en réalité à peu près rien. C’est d’ailleurs le discours que tient Hitler lui-même : il serait évidemment content de voir les Juifs quitter volontairement l’Allemagne, mais s’ils tiennent à rester, ils peuvent être certains qu’ils seront bien traités. Prétendre le contraire relève tout simplement de la propagande mensongère des ennemis de l’Allemagne, À cela Kraus, comme on pouvait s’y attendre, répond de façon absolument féroce. Il souligne que Benn, étant donné qu’il est resté en Allemagne, aurait dû être le premier à se rendre compte que bon nombre de ceux qui sont partis, s’ils étaient restés un jour de plus, étaient certains soit d’être massacrés, soit au minimum de se retrouver en camp de concentration. J’ai aussi, dans ma jeunesse, travaillé d’un peu près sur Gottfried Benn et par conséquent j’avais eu l’occasion de regarder de près la façon dont il s’était comporté – qui est à la fois attristante, et même consternante, et (relativement) respectable, parce qu’il a eu, comme je l’ai dit, au moins la décence de reconnaître clairement qu’il avait commis une erreur majeure –, et il a mis en garde la jeunesse contre le risque de commettre 42à nouveau une erreur du même genre. Ce qui a quelque chose de monstrueux dans le nazisme, en plus de tout le reste, c’est l’aveuglement incroyable dont ont fait preuve les intellectuels à son sujet. Mais il faut dire que Kraus ne s’était jamais fait beaucoup d’illusions sur eux et j’ai tendance, je l’avoue, à considérer qu’il avait raison.
Bruno Gnassounou me pose la question de savoir si l’incompréhension que les philosophes sont capables de manifester quand ils parlent de la politique ne serait pas, tout compte fait, comparable à celles dont ils font preuve également, par exemple, l’égard des mathématiques, et le traitement philosophique qu’il convient de lui appliquer à peu près du même genre. Il y a au moins, me semble-t-il, une différence qui est importante. L’incompréhension philosophique, dans le premier cas et dans un bon nombre d’autres, est heureusement à peu près sans conséquences. Wittgenstein dit que le discours qu’il tient à propos des mathématiques n’a pas du tout pour but de changer quelque chose à la pratique des mathématiques et même pas non plus d’espoir réel de réussir à changer quelque chose à la façon dont les mathématiciens comprennent ce qu’ils font. La situation est évidemment bien différente dans le premier cas. L’incompréhension peut avoir évidemment des conséquences, et des conséquences qui sont parfois catastrophiques.
Emmanuel Pasquier : [Kelsen et le droit international] Je voudrais revenir sur le terrain du droit international, qui était un peu notre point de départ. C’était une discussion que nous avions eue en amont, en réfléchissant sur la notion d’« inter-souveraineté ». Dans la théorie du droit, on a parfois l’impression de la persistance du discours sur la souveraineté, ce concept très prégnant. Comme si ce qui était advenu en philosophie, dans la philosophie du sujet, en particulier avec le développement de la notion d’’intersubjectivité’, dans la phénoménologie, n’était pas advenu sur le terrain de la philosophie du droit, et en particulier pas dans la philosophie de l’État. On continue à considérer l’État comme un sujet réel, une « grande personne », et l’on a beaucoup de mal à le penser dans des termes plus complexes. Ce qui induit un certain nombre de conceptions et de représentations des relations internationales, comme relations nécessairement conflictuelles, toujours rapportées à un état de nature hobbesien. Ce serait intéressant de revenir, sous cet angle, sur la suggestion d’Isabelle Delpla, de réfléchir sur un parallèle entre Kelsen et Wittgenstein.
43Pour entamer cette réflexion, je me propose simplement de parler très brièvement de la conception de Kelsen, que vous avez vous-même évoqué, Jacques Bouveresse. Quelle est la particularité de la conception de Kelsen concernant le droit international ? Pour le rappeler très rapidement, pour les étudiants ici présents, Hans Kelsen (1881-1973) est l’auteur de la Théorie pure du droit2, qui est issu du mouvement du positivisme juridique, mais qui entretient un rapport critique avec celui-ci, précisément parce que le positivisme juridique – tel qu’il se développe au xixe siècle – est directement lié à une conception volontariste de l’État. Le positivisme juridique construit une conception conventionnaliste des traités, contre le jusnaturalisme, c’est-à-dire contre une conception naturaliste des États, une conception substantialiste des États, comme si ceux-ci étaient doués d’une volonté propre. Les positivistes juridiques disent : on va isoler l’État et le droit, on va considérer l’État strictement du point de vue du droit, en tant que sujet de production du droit. Kelsen prend ses distances par rapport à cela en disant que, dans le fond, cette conception est dangereuse parce qu’elle est directement liée au développement de la conception souverainiste, dans laquelle il n’est pas le seul à voir une responsabilité importante dans les discours bellicistes de la Première Guerre mondiale. C’est pourquoi, au lendemain de la Première guerre mondiale, en 1920, il écrit un gros livre qui s’appelle Das Problem der Souveränität3 – le problème de la souveraineté – dans lequel il dit littéralement : « Il faut en finir radicalement avec la notion de souveraineté ». Donc il veut vraiment dépasser cette notion de souveraineté. Cela l’amène à réfléchir sur le fondement du droit international, dans des problématiques qui sont liées aussi à la création de la SDN, et à l’espoir d’une entité juridique “supranationale”, ou au moins internationale, qui permette a minima une meilleure coordination entre les États. Dans la Théorie pure du droit, il propose trois hypothèses concernant la construction du droit international. Vous en avez rappelé deux ici, mais au départ il y en a trois. Il y a ce qu’il appelle le dualisme – (qui correspond à la doctrine de Heinrich Triepel) ; il y a le monisme avec primat du droit étatique, dont vous parliez tout à 44l’heure (qui correspond notamment à des doctrines néo-hégéliennes) ; mais il y a aussi le monisme avec primat du droit international, qui est celle qui a la préférence de Kelsen.
Le dualisme, c’est l’idée qu’il y a deux ordres juridiques qui coexistent : l’ordre du droit international et l’ordre du droit étatique, et qu’au fond, le fonctionnement du droit international advient dans une articulation entre l’un et l’autre. C’est-à-dire qu’il y a des normes de droit international qui sont issues de traités entre les États, et qui ensuite doivent être éventuellement incorporées dans le droit interne pour pouvoir être valides. Il ne suffit pas qu’elles soient inscrites dans un traité – je parle sous le contrôle de notre juriste internationaliste [Olivier de Frouville] – elles doivent être ensuite validées à l’intérieur même du droit interne de chaque État. C’est une conception très intéressante aussi, et dans le fond, dans une partie de ma thèse qui portait notamment sur le droit international chez Kelsen, il me semble que Triepel a gagné finalement dans les représentations dominantes du droit international – c’est-à-dire qu’aujourd’hui ce dualisme est encore le langage que l’on parle. Il y a bien, comme cela, des normes internationales, des normes internes de l’État, et il faut penser la redescente, ou l’intégration, du droit international dans le droit interne.
L’autre conception, c’est le monisme, dont vous parliez tout à l’heure. C’est une conception qui consiste à dire qu’en fait, on ne peut pas penser deux fondements du droit différents, hétérogènes l’un par rapport à l’autre. Ce n’est pas juste une question d’élégance systémique, mais c’est aussi une question de cohérence logique ; c’est-à-dire que si l’on parle d’un seul et même objet, qui est le droit, on ne peut pas dissocier un droit international et un droit étatique, qui serait hétérogènes l’un à l’autre – puisque, à ce moment-là, la question que pose Kelsen, c’est : si ces deux ordres sont hétérogènes, comment est-ce qu’ils peuvent communiquer l’un avec l’autre ? Donc au fond, pour Kelsen, le dualisme est illusoire et il n’est qu’une manière complexe d’exposer ce qui à un niveau logique plus cohérent, est en fait un monisme. Donc il y a un monisme juridique, il y a une même, ce qu’il appelle une même « norme fondamentale » de l’édifice juridique. Mais il y a deux options. Il y a l’option qui consiste à valoriser le droit de mon État, le droit d’un seul État – mais en général le mien. Ou alors il y a l’option qui consiste à dire : non, la norme originaire, c’est celle du droit international. 45Kelsen dit, au fond : le nationalisme prétend dire que mon État est la vraie et unique source du droit. Mais Kelsen objecte : c’est possible, d’un point de vue logique, dans la théorie pure du droit, mais il faut comprendre les conséquences juridiques et politiques que cela implique. Si l’on choisit cette option, cela veut dire que l’on place son propre État à l’origine de tout le droit. Par exemple, dans le contexte des années 1930, ce serait l’Allemagne impérialiste contaminant le droit mondial : C’est une conception conquérante du droit. C’est ce que dit Kelsen, il faut comprendre que ce monisme étatiste est un impérialisme radical. Je ne reconnais comme source du droit que mon propre droit, et donc c’est mon propre droit qui a vocation à devenir le droit mondial. On pourrait réfléchir aujourd’hui sur les États-Unis, sur la place du droit anglo-saxon, le primat d’une certaine conception du droit, et d’un certain impérialisme, « soft power », qui passerait par le contrôle ou le monopole des concepts juridiques. Je laisse cela de côté.
Troisième option, qui est celle que va défendre Kelsen : le monisme avec le primat du droit international. Mais cela suppose un certain nombre d’énoncés qui, eux aussi, ne vont pas sans paradoxe et ne vont pas sans choquer le sens commun, en particulier le sens commun des gens établis dans leur propre État nation. C’est dans cette doctrine qu’il y a vraiment, je crois, une théorie de ce que j’appellerais une inter-souveraineté, c’est-à-dire d’une souveraineté qui ne peut plus être pensée dans sa pureté celle, disons, d’un pouvoir qui n’admettrait vraiment aucun pouvoir au-dessus de lui-même, à part le pouvoir divin. Il y a une sorte d’effacement, non pas des frontières, mais des souverainetés, qui est assez frappante. Je vais, juste pour finir, proposer quelques passages de Kelsen, pour se demander si éventuellement on pourrait les confronter avec la critique de la philosophie du sujet chez Wittgenstein.
Un des éléments importants, pour Kelsen – ce que tu rappelais, Isabelle, tout à l’heure – c’est que le droit international fonde l’existence même des États : ce ne sont pas les États qui préexistent au droit international et qui se donnent, par traités, un droit international qui leur permettrait de se coordonner – cela concerne aussi une certaine ontologie des groupes, dont parlait tout à l’heure Bruno Gnassounou. C’est pour cela que je parlais tout à l’heure d’un fondement logico-transcendantal en employant le vocabulaire kelsénien. Pour Kelsen, il faut que le droit international existe déjà, en quelque sorte, pour que les États puissent se 46penser comme États, comme entités, y compris dans leur détermination territoriale, matérielle et temporelle. À titre d’exemple, je cite Kelsen : « L’énoncé selon lequel le droit international repose sur le consentement mutuel des États à ce que leurs relations réciproques soient régies par un corps de règles de droit, équivaut à une fiction ; dans la mesure où il est impossible de prouver l’existence de ce consentement mutuel. La théorie voulant que le droit international se fonde sur le consentement mutuel des États – sur une sorte de contrat, tacite, passé entre les États – est en tout point semblable à la doctrine du droit naturel relative au fondement des États ou de l’ordre juridique étatique ». Nous retrouvons ici la doctrine du contrat social, critiquée par Kelsen, qui ajoute : « Il ne fait aucun doute que les États sont considérés comme liés par le droit international malgré eux. Ou même contre leur volonté4 ». Entrer dans la famille des nations, c’est se donner un certain nombre de droits, mais aussi s’obliger, avoir un certain nombre de devoirs, au point que Kelsen va jusque défendre l’idée que l’on peut être lié par un traité que l’on n’a pas signé. Il y a une force obligatoire d’un certain nombre de conventions internationales, qui peuvent obliger les États qui n’y ont pas particulièrement souscrit.
Un des arguments donnés par Kelsen, qui n’est pas très convaincant mais qui a du sens dans le contexte de la SDN et de sa structure, c’est le vote à la majorité, la possibilité d’avoir des institutions internationales qui prennent des décisions collectives par vote à la majorité ; dès lors que l’on a consenti au principe du vote à la majorité, certaines décisions obligent des États, a posteriori sur des décisions auxquelles ils ne donneraient pas leur aval sur le moment, mais par lesquelles ils sont tenus quand même par le principe auquel ils ont souscrit dans un premier temps. Un autre exemple est celui de la création de nouveaux États : la reconnaissance elle-même n’est pas le critère décisif, mais un traité permettant l’avènement de nouveaux États, ou de nouvelles frontières par exemple, va avoir une force obligatoire, y compris pour des États qui n’ont pas particulièrement souscrit à ce nouveau découpage.
Il y a une cohésion structurelle des États les uns par rapport aux autres à partir du moment où le mot même d’« État » est partagé comme concept commun pour penser la communauté politique et 47son mode d’organisation. Le simple mot « État » induit des effets de coercition, même s’il n’y a pas une institution verticale qui imposerait des comportements avec des sanctions directes, sur le modèle étatique. Pour nuancer un peu, ce qui était dit tout à l’heure, à partir du moment même où il y a communauté internationale – ou, je vais aller plus loin, à partir du moment où il y a le simple mot « État » – le mot État lui-même, et le partage du nom « État », impliquent un certain découpage international, qui implique l’existence d’une forme de communauté internationale, fût-elle conflictuelle, qui déjà, d’une certaine manière, crée des effets possibles de coercition, d’ajustements, des nécessités d’alliances, etc. Ce qui est déjà de l’ordre d’une certaine forme de régulation ; cette « régulation » peut être difficile à distinguer du pur conflit, mais elle n’est pas réductible à un pur état de non droit. C’est ce que dit Kelsen, là aussi dans un texte des années 1920. Il ne dit pas qu’il existe un État mondial, mais reprend la formule de Wolff, parle de la « Civitas Maxima », et dit : elle est déjà là, elle existe déjà5, en quelque sorte, indépendamment même de la question de savoir s’il existe une organisation internationale comme organe supplémentaire de sa régulation.
Pour finir, je voudrais aller un peu plus loin encore sur le thème d’une « inter-souveraineté » – en suivant toujours le modèle de la sortie du solipsisme avec le concept d’« intersubjectivité ». Il me semble que cela va de pair aussi avec une réflexion sur la responsabilité des États. Là c’est un peu au-delà peut-être de Kelsen, mais il me semble intéressant de penser la responsabilité de chaque État pour la communauté internationale. Je ne parle pas d’une responsabilité juridique devant la communauté internationale – ce qui est important, bien sûr – mais plutôt d’une responsabilité éthique pour la communauté.
Dépasser le solipsisme étatique, dépasser le mythe de la souveraineté, ce serait dire que tous les États sont responsables du bon fonctionnement de la communauté internationale dans son ensemble. Pour reprendre la phrase de Dostoïevski, commentée par Levinas : « je suis responsable de 48tout devant tous et moi plus que les autres » : cela c’est Ivan Karamazov sur le plan individuel, mais je me demande si l’on ne pourrait pas penser une sorte de responsabilité des États, les uns pour les autres, et pas seulement les uns devant les autres.
Voilà, un certain nombre de suggestions que je voulais faire et que je vous soumets. En particulier, peut-être, dans la perspective d’une possible comparaison avec Wittgenstein …
Jacques Bouveresse : Merci de tout cœur pour votre intervention. Je vous suis très reconnaissant, parce que, comme je vous l’ai dit, si je n’ai pas réussi à lire jusqu’au bout votre livre6 avant d’arriver, c’est seulement faute de temps, et certainement pas parce que j’ai été déçu de ce que je lisais, bien au contraire. Cela m’a incité fortement à recommencer à lire Kelsen (j’avais commencé une première fois à le lire dans le milieu des années soixante et je m’étais déjà rendu compte que la position qu’il défend soulevait, elle aussi, un bon nombre de problèmes). J’ai eu, en lisant votre livre, une confirmation remarquablement bien documentée et argumentée de ce qui n’était guère chez moi, qu’un pressentiment assez confus. Une question cruciale qui se pose, quand on lit ou relit Kelsen, est effectivement celle de savoir si, pour réussir à défendre, comme vous avez montré qu’on peut avoir des raisons de le faire, une espèce de primauté du droit international, puisqu’il faut, semble-t-il, pour qu’il soit en mesure d’exister réellement, que son existence puisse préexister à celle des nations, Kelsen n’est pas obligé de se mettre à défendre également des positions jusnaturalistes, c’est-à-dire à réhabiliter implicitement l’idée de l’existence de droits naturels et de faire par conséquent une entorse sérieuse à ce que le positivisme juridique est censé affirmer ou en tout cas impliquer. Est-ce que cela ne serait pas finalement la seule façon sérieuse de donner une réalité à cette idée de droits internationaux dont il semblerait qu’ils doivent pouvoir reposer en dernier ressort sur une base naturelle qui leur permette d’être indépendants des États et des choix politiques « individuels » qu’ils font. Sans cela, on pourrait craindre fortement que l’existence des droits en question ne soit pour le moins précaire et constamment menacée, comme cela été effectivement souvent le cas, par la volonté des États d’adapter le droit lui-même 49aux exigences de leur politique. La mise en question de la réalité, de l’autonomie et de la continuité du droit par les détenteurs momentanés du pouvoir politique est ce que Kraus redoute et dénonce particulièrement. Ce qui se passe en Allemagne à partir de 1933 (et qui était déjà depuis un certain temps en préparation) est exactement ce à quoi on peut s’attendre « wenn Ungesetz gesetzlich waltet » (quand l’absence de loi règne légalement). Un autre point commun qu’il y a entre Kraus et Kelsen est la conviction qu’un état de droit, aussi imparfait et éloigné de la justice véritable qu’il puisse être, vaut toujours encore mieux que le simple règne de la force et de l’oppression. Mais, bien entendu, si on veut défendre l’autonomie du droit, il faut se donner les moyens de lui procurer un fondement et il ne va pas de soi que la réponse jusnaturaliste, aussi « naturelle » – si l’on peut dire – qu’elle puisse être, soit en mesure de satisfaire réellement cette demande.
Emmanuel Pasquier : Pour répondre juste sur ce point, Kelsen se garde bien de ce type de réponse, puisque sa construction, qui est plutôt d’ordre, on va dire, logiciste, est très nettement distincte d’une quelconque conception jusnaturaliste, parce que pour lui il n’y a pas d’existence naturelle des États. Il y a un ordre au-dessus des États, mais ce n’est pas un ordre « naturel » – puisque les États eux-mêmes ne sont pas des êtres naturels.
Jacques Bouveresse : Tout à fait. C’est sûr que c’est une solution à laquelle il ne peut pas recourir, mais du coup il est obligé, me semble-t-il, d’adopter ce qu’un philosophe appellerait une sorte de point de vue transcendantal, ou logico-transcendantal, qui explique d’ailleurs la révérence qu’il manifeste à l’égard de Kant et qui est encore un point qu’il a en commun avec Kraus. Ce qui, évidemment, dans ce qu’il propose, pourrait difficilement satisfaire Carl Schmitt.
Emmanuel Pasquier : Oui, on pourrait aller sur ce terrain-là aussi. Comme vous savez, cette confrontation entre Kelsen et Schmitt était l’objet de mon livre, De Genève à Nuremberg, et les lignes de fracture entre les deux ne sont pas toujours simples à identifier, car Schmitt aussi est critique du jusnaturalisme.
Mais je me permets de vous relancer sur Wittgenstein …
50Jacques Bouveresse : Disons que le parallèle de Kelsen avec Kant et la présence d’une influence kantienne me semblent plus évidents que le parallélisme avec Wittgenstein. À partir du moment où Kelsen a vécu aux États-Unis, il pourrait difficilement ne pas avoir entendu parler de Wittgenstein. Il en a sûrement entendu parler. Est ce qu’il l’a lu ? Est-ce qu’il aurait pu éventuellement s’en inspirer ? J’ai essayé de regarder cela d’un peu près avant de venir, mais pour le moment je n’ai pas réussi à trouver une réponse convaincante à cette question.
Bruno Gnassounou : Je voulais simplement préciser que je trouvais cela très intéressant. Je sais qu’il y a une théorie de la souveraineté anglaise, qui était très courante à une époque, qui se conformait une image moniste du droit international, qui disait qu’au fond, il y aurait une contradiction à ce qu’il y ait deux sources des normes, et donc l’Angleterre avait une autorité sur le monde entier. Dans ce cadre, si, à Paris, on prend telle décision, cela fait partie du droit anglais ! C’est tout à fait étonnant ! Cela me fait rebondir sur un autre point : tu parles beaucoup de Kelsen, mais je pensais à l’autre grand positiviste juridique qui est Hart. Et Hart, lui, a des rapports très étroits avec Wittgenstein, et toute sa philosophie du droit, il le dit lui-même : il est complètement influencé par Austin, d’une part, mais aussi par Wittgenstein, et peut-être que de ce côté-là, il y a des choses à creuser. La norme, que Hart n’appelle pas « norme fondamentale », mais « règle de reconnaissance », dans un État, n’est pas du tout une norme qui a un statut logico-transcendantal, ce qui paraît totalement abstrait, mais est en fait une coutume. Il y a des coutumes à l’intérieur des communautés, y compris de la communauté internationale. Il y a toute une réflexion sur le droit international, et Hart emprunte ce concept à la notion de « règle » de Wittgenstein – une règle qui d’abord doit avoir une fonction, en quelque sorte, pratique, qui doit être appliquée par des acteurs pour qu’elle soit en cours
Emmanuel Pasquier : Oui c’est très intéressant, et pas loin de la pensée de Kelsen. Car il y a des variations, chez Kelsen, sur le statut exact de la « norme fondamentale ». Et dans un ouvrage un peu plus tardif, la Théorie générale du droit et de l’État, il cite Austin d’une part, et par ailleurs, il revient sur le caractère un peu abstrait, kantien, logico-transcendantal de sa conception pour affirmer que, finalement, la norme fondamentale, 51c’est la coutume. Donc la norme qui fonde la coutume c’est : « les États doivent se conduire comme ils ont accoutumé de se conduire7 », voilà… Ce qui est un petit peu décevant, je trouve … Mais voilà, on finit sur cette tautologie.
Isabelle Delpla : Est-ce que cela pourrait être du décevant « wittgensteinien » ? Lorsque Wittgenstein en vient à dire « C’est comme cela qu’on fait » !
Jacques Bouveresse : Oui, c’est assez wittgensteinien, cette référence à la coutume, suivre une règle est une coutume … L’existence du droit, c’est l’existence de règles de droit, et les règles sont instituées, d’une certaine façon. Mais cela ne veut pas du tout dire qu’elles sont le produit de décisions subjectives et individuelles. Là, il faudrait peut-être réfléchir, un peu plus qu’on ne le fait d’ordinaire, sur le sens que Wittgenstein donne au mot « naturel », qu’il utilise assez souvent. C’est-à-dire que quand il parle de règles qui sont « naturelles », ce ne sont pas des règles qui sont des produits de la nature, pas du tout ! Ce serait, en ce qui concerne le droit, la position jusnaturaliste usuelle, qui consiste à dire : la nature nous fournit des règles, nous n’avons en quelque sorte qu’à les lire dans la nature elle-même, et à les appliquer ensuite. Quand Wittgenstein parle de règles « naturelles », c’est tout à fait autre chose. Une règle peut être plus ou moins naturelle, parce qu’il y a une quantité de règles différentes, y compris de règles bizarres ou même franchement aberrantes, que nous pourrions aussi très bien en théorie adopter à sa place, mais qui seraient sans intérêt, parce qu’elles seraient à peu près inapplicables, parce qu’elles comporteraient par exemple constamment des exceptions, qu’il faudrait trouver le moyen d’accommoder avec la règle, etc. Il y a en réalité relativement peu de règles dont on puisse dire qu’il n’y avait véritablement aucune raison de les adopter, de préférence à d’autres. Wittgenstein souligne que la nature a aussi son mot à dire ici, ne serait-ce qu’en ce sens que, s’il y avait, des changements qui se produisent constamment de façon imprévisible dans les faits de la nature, s’il y avait par exemple sans arrêt des objets qui disparaissent subitement, ou qui apparaissent subitement, on ne pourrait tout simplement plus avoir d’arithmétique, ou seulement une arithmétique qui 52serait suffisamment compliquée pour être complètement non naturelle. L’arithmétique perdrait toute utilité parce qu’elle deviendrait artificielle au dernier degré. Elle pourrait peut-être encore constituer un jeu, excitant ou non (même un jeu a besoin aussi de comporter quelque chose de « naturel »). Or, quand on applique cela au droit, ce que cela veut dire, c’est qu’il y a bel et bien des règles de droit qui sont plus ou moins naturelles, en ce sens-là. Et il ne faut pas oublier – Dieu sait si Kelsen le rappelle – que la normativité ne peut pas être séparée de l’efficacité : une règle de droit qui deviendrait inefficace et inapplicable n’aurait plus aucun caractère normatif.
Donc ce problème-là, chez Wittgenstein, est tout à fait présent. Il a une position qui est assez proche, sur certains points, de celle d’Aristote. C’est-à-dire : il n’y a pas uniquement deux choses, le nécessaire et l’accidentel, il y a le nécessaire, le naturel, et l’accidentel. Entre le nécessaire et l’accidentel, il y a un troisième terme important : le naturel, c’est-à-dire ce qui s’accorde davantage avec les faits, mais ne le fait pas forcément dans tous les cas. On pourrait dire en simplifiant un peu que la nature ne peut pas rendre les règles nécessaires, mais peut les rendre à la limite impossibles et a en tout cas le pouvoir de les rendre plus ou moins naturelles, au sens indiqué. La façon dont elle intervient dans le choix des règles que nous sommes amenés à adopter et contribue faire d’elles ce qu’elles sont est donc plus indirecte qu’on ne le croit souvent, mais elle n’en est pas moins bien réelle. Encore une fois, ce n’est parce que nous choisissons de conférer à une proposition le statut de règle que la nature n’est pour rien dans ce que nous faisons. Je ne sais pas si Kelsen serait disposé à s’exprimer lui-même exactement de cette façon. Mais il me semble qu’il pourrait au moins la trouver acceptable. Emmanuel Pasquier, cependant, en sait sûrement beaucoup plus que moi sur ce genre de question.
Emmanuel Pasquier : Cette catégorie intermédiaire, que vous évoquez ici, peut être comprise comme hybride entre le normatif et le factuel. C’est une articulation souple entre les deux. Ce n’est pas le strictement normatif, avec son exactitude, ni le factuel tel quel. Chez Kelsen, il y a un travail à ce sujet : ce qu’il appelle le « principe d’effectivité8 ». Au fond, cela va devenir juridique parce que c’est effectif ; mais en même 53temps, comme Kelsen passe son temps à dire que la norme n’est pas le fait, tout à coup lorsqu’il dit que c’est le principe d’effectivité qui sert de principe juridique pour fonder la norme, on ne sait plus très bien ce qu’il veut dire… Il faut comprendre, je crois, que le principe d’effectivité n’est pas un principe ontologique : il ne s’agit pas de dire que le fait devient la norme telle quelle. En revanche, c’est une analyse du discours des juristes, c’est-à-dire que Kelsen dit : lorsque les juristes valident, vont jusqu’à valider un état de fait, lui donnent la valeur d’une norme, ils peuvent se référer à quelque chose qui est l’effectivité. Donc cela devient à ce moment-là un principe normatif. Mais on est alors dans une catégorie intermédiaire, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de dire que c’est le fait lui-même qui devient la norme, mais que la référence à l’effectivité peut valoir comme principe de validation de la norme.
Selon d’autres modalités, Carl Schmitt également pense une catégorie intermédiaire entre le fait et la norme. Dans un héritage plutôt platonicien qu’aristotélicien, et augustinien que thomiste. Vous le rappelez dans votre livre sur Karl Kraus, que Carl Schmitt utilise ce concept de « nomos » qui signifie en grec « la loi », mais qui en même temps signifie « la loi concrète », c’est-à-dire la loi en tant qu’elle est un principe effectif de répartition du pouvoir. C’est le titre que Schmitt donne à son livre de droit international Le Nomos de la terre9 ; donc le nomos de la terre, si l’on traduit, cela veut dire au fond : la répartition du pouvoir politique sur la terre. Et c’est la répartition qui a elle-même sa force normative. Le modèle de Carl Schmitt, en fait, c’est l’équilibre des puissances après les traités d’Utrecht : l’Angleterre comme puissance maritime qui joue comme contrepoids dans l’affrontement entre les puissances continentales, en particulier la France et l’Espagne. Schmitt voit là le paradigme de ce qu’il appelle le « Jus publicum europaeum » (le droit public européen), dont il fait un modèle, idéalisé sans doute, d’un équilibre des puissances qui a fonctionné. Et pour Schmitt c’est vraiment l’expression d’un droit qui est une norme, mais une norme qui ne prend sa valeur de norme que parce qu’elle est fondée dans un équilibre réel des puissances. C’est pour cela qu’il attaque beaucoup Kelsen – à tort ou à raison – sur son « normativisme abstrait ». Il attaque au passage la SDN, puis l’ONU, en disant qu’il ne suffit pas d’écrire des normes pour qu’elles prennent une 54quelconque effectivité – et, inversement, si on les écrit, si elles sont trop en porte-à-faux avec la réalité politique, elles deviennent des instruments de manipulation politique qui ont des effets beaucoup plus délétères que des effets régulateurs. Donc il faut écrire des normes qui correspondent à un effet, qui correspondent à une réalité de la puissance. On voit bien comment, en même temps, cela se renverse, c’est tout le risque, puisque à ce moment-là on normalise et on donne force de droit à des situations de domination que précisément le droit éventuellement, guidé par un idéal de justice, devrait au contraire servir à empêcher. Donc c’est toute l’ambiguïté de cette catégorie intermédiaire du « nomos », comme catégorie hybride dans laquelle la norme et le fait sont censés coexister.
Olivier de Frouville : Une petite contribution du juriste internationaliste, pour essayer d’avancer peut-être, ou de défendre la thèse – mais avec beaucoup de prudence parce que je ne suis pas du tout connaisseur de Wittgenstein – de la proximité entre Kelsen et Wittgenstein, à peu près à la même époque, il y a trois stratégies qui se mettent en place, de la part des internationalistes, pour essayer de défendre le droit international face aux souverainetés. Il y a la stratégie qui continue à s’appuyer sur le concept de souveraineté, donc c’est Triepel, Anzilotti, qui inventent justement le dualisme, qui, en fait, est un outil de défense du droit international : pour aller un peu rapidement, tout en continuant à faire croire aux États qu’ils sont souverains, au fond, c’est s’appuyer sur le principe du consentement, sur la volonté pour sécuriser le droit international, pour renforcer le caractère obligatoire du droit international.
Les deux autres stratégies passent par la contestation radicale de la souveraineté, la destruction du concept de souveraineté, c’est d’une part celle de George Scelle, dans la continuité de Léon Duguit et de Durkheim – la sociologie durkheimienne. Et en deuxième lieu, celle de Kelsen, avec l’approche normativiste. Si on regarde les trois, il me semble que la troisième, celle de Kelsen, est peut-être celle qui a le plus de liens avec la remise en cause du mythe de l’intériorité, du solipsisme du sujet, de l’individu. Il y a un passage noir sur blanc chez Kelsen : la souveraineté, c’est le solipsisme, et c’est ce qu’il faut détruire. C’est effectivement cette manière qu’a l’État de définir le monde à travers mon ego et à partir de mon ego, notamment à travers le phénomène du monisme à primauté de droit étatique ; c’est exactement le solipsisme.
55Une dernière remarque : je me demande s’il ne faut pas aussi aller voir ce que Michel Troper appelait « le dernier Kelsen », celui de la théorie des normes, où Kelsen se penche beaucoup plus sur les effets de volonté, ou ce que l’acteur du droit veut mettre dans la norme à partir d’une texture ouverte de la norme – idée que reprendra Hart. C’est une thèse que Michel Troper a notamment développée avec l’idée de la théorie réaliste de l’interprétation : au fond, les énoncés juridiques sont essentiellement vides et ils sont remplis d’une signification par la volonté de l’interprète. Je me demande s’il n’y a pas aussi quelque chose à creuser à partir de là.
Isabelle Delpla : En lisant votre texte sur Kraus, vous parlez plusieurs fois d’un juriste donc je n’avais jamais entendu parler, je le reconnais, Heinrich Lammasch, qui était juriste pénaliste et internationaliste, et qui a été, si j’ai bien compris, un des derniers chanceliers d’Autriche-Hongrie.
Jacques Bouveresse : [Heinrich Lammasch et l’entre-deux-guerres] Le dernier. Il a été le dernier Premier Ministre nommé par l’Empereur Charles Ier si je me souviens bien, qui a été, pour sa part, le dernier Empereur de l’Autriche-Hongrie. C’était en 1918. Il a donc été pendant une brève période, effectivement, Ministerpresident de l’Autriche. Mais il a également, ce qui à certains égards est encore plus significatif, été un des négociateurs du traité de Saint Germain en Laye, qui a déterminé les conditions de la paix entre l’Autriche-Hongrie et les puissances de l’Entente. Et il a essayé courageusement d’obtenir une paix honorable pour son pays, mais il n’y est malheureusement pas parvenu.
Isabelle Delpla : Je ne le connais que par les citations que vous en donnez – mais il me semble qu’à la fois lui et Kraus se retrouvent dans une position de primauté du droit international ; mais, qui, dans les termes que vous avez exposés, est présenté comme un droit de l’humanité : la référence à l’humanité est constante, avec une invocation de l’humanité que les patries n’ont pas le droit de détruire – et une conscience assez aigue de la possibilité de la destruction de l’humanité par le nationalisme et les patries. La question s’adresse à la fois à Olivier et à vous : est-ce finalement un discours kantien classique ? Peut-on lui trouver une filiation wittgensteinienne, notamment dans les textes où Wittgenstein dit que si un lion parlait, on ne le comprendrait pas ? Donc le fait d’une 56humanité partagée qui est aussi celui de la compréhension d’un langage commun et de la capacité d’apprentissage du langage ?
Jacques Bouveresse : Oui, je pense que, chez Kraus, c’est tout à fait clair ; et chez lui la référence à Kant est explicite et appuyée. Un des poèmes qu’il a écrit pendant la guerre s’intitule justement « Zum ewigen Frieden » (Vers la paix perpétuelle). Et un point commun entre lui et Lammasch est qu’ils ont adopté l’un et l’autre, pendant les années de la guerre, des positions pacifistes et antimilitaristes. Kraus fait, de toute évidence, partie de ces esprits que Schmitt aurait qualifié de naïfs et de sentimentaux, qui pensent que l’on est un être humain avant d’avoir une patrie, et qu’il ne faut l’oublier à aucun moment. Kraus est allé jusqu’à dire qu’un intellectuel, qui, au moment où a éclaté la Première Guerre mondiale, n’a pas pris position contre sa patrie au nom de l’humanité, a commis une faute difficilement pardonnable. À ses yeux, le vrai patriote est quelqu’un qui aurait dû dire non à la guerre, et par conséquent non à son propre État qui la voulait. C’est ce qu’il a fait lui-même. Il y a chez lui cette idée d’une primauté, qui est affirmée explicitement, des droits de l’humanité par rapport aux exigences de la patrie et du droit international par rapport au droit étatique. À partir du moment où la patrie vous demande quelque chose qui contredit une certaine idée de l’humanité, il ne faut pas hésiter à se transformer en critique et même en adversaire de la patrie. Après la guerre, il y a eu un texte très long de Kraus publié dans la Fackel, qui s’intitule Nachruf – ce qui veut dire oraison funèbre, ou nécrologie –, dans lequel il fait le bilan des désastres qu’elle a causés. Il y dit notamment que ce qui est dramatique, c’est qu’on n’ait pas identifié dès le début les vrais ennemis. Les vrais ennemis (intérieurs), pour lui, c’était à peu près le contraire de ceux qui ont été désignés et stigmatisés comme tels : les défaitistes, les pacifistes, les communistes, les Juifs, etc. Du côté allemand, on s’est, comme vous le savez, efforcé de se convaincre que ce n’était pas l’armée, qui n’a jamais été réellement vaincue, qui avait perdu la guerre, mais essentiellement les gouvernements et les civils. Les gouvernements, cela voulait dire, en l’occurrence, le parti social-démocrate, à qui on a fait endosser la responsabilité de la défaite et du traité de paix humiliant et injuste qui en est résulté. Ceux qui ont été considérés comme les ennemis n’avaient donc pas grand-chose à voir avec les vrais responsables, qu’il s’agissait 57avant tout de disculper. Les vrais ennemis pour Kraus, c’étaient les pangermanistes, les bellicistes, les journalistes va-t-en guerre, etc.
Si Lammasch était, semble-t-il, un juriste très important, très réputé et très influent à l’époque dans le domaine du droit international, il avait aussi, en plus de cela, le mérite d’avoir contribué de façon essentielle à la réforme complète de la justice pénale en Autriche – qui, à la fin du xixe siècle, était dans état d’arriération déplorable. Kraus l’a soutenu résolument dans cette tâche difficile et importante ; et il a mené un bon nombre de batailles sur ce terrain-là. Il a d’ailleurs continué à s’intéresser de près à la question du droit pénal et de la justice pénale ; et il a notamment publié en 1904, dans la Fackel, un article très substantiel et assez technique, intitulé « Ethik und Strafgesetz » (Éthique et loi pénale). Une des choses qui le révoltaient particulièrement, à l’époque, était ce que l’on peut appeler les « procès de moralité », dans lesquels il estimait que les tribunaux ont une tendance désastreuse à remplacer la recherche de la justice par le souci de protéger une morale puritaine, hypocrite et désuète. Une chose qui mérite d’être remarquée est que Lammasch et Kraus étaient tous les deux des adversaires déterminés de la peine de mort. Kraus la condamnait dans son principe et l’a qualifiée de « meurtre légal ». Il va sans dire que, quand elle a été rétablie sous le régime de Dollfuss, cela lui a posé un vrai problème.
Pour en revenir à la question du droit international et des moyens dont il devrait être doté pour pouvoir s’appliquer effectivement, tous les deux pensaient que, après la guerre, on aurait dû pouvoir traduire devant un tribunal international non seulement un certain nombre de chefs politiques et militaires, comme il en a été effectivement question, mais également les journalistes et les responsables de journaux qui s’étaient livrés à une propagande intense en faveur de la guerre ! Cela concernait essentiellement Moriz Benedikt qui était le directeur de la Neue Freie Presse, le grand journal libéral, mais également un directeur de journal qui s’appelait Friedrich Funder et qui était, lui, le directeur de la Reichspost, un journal de droite catholique. Le bellicisme de ce genre de journal était peut-être un peu moins surprenant. Quand j’étais enfant, il y avait chez mes parents des piles d’un journal catholique illustré qui s’appelait « Le Pèlerin ». J’en ai gardé un souvenir impérissable, parce que c’était comme l’illustration de la déshumanisation systématique et répétée de l’ennemi : l’Allemand y était présenté à 58chaque fois comme une sorte de brute épaisse inculte et ridicule. C’était absolument sidérant.
Lammasch, je crois, est mort en 1920, un an après la conclusion du traité de Saint Germain. Il semble, d’après ce qu’a raconté sa fille, qu’il soit mort en grande partie du fait du résultat désastreux auquel avaient abouti les négociations, qui ne correspondait en rien à ce qu’il avait souhaité. Ce n’est évidemment pas du tout à une solution de ce genre qu’il avait pensé, bien qu’il ait accepté entièrement l’idée qu’il y avait une responsabilité bien réelle, et même très importante de l’Autriche dans le déclenchement de la Première Guerre mondiale, et que cela exigeait que l’Autriche soit sanctionnée en conséquence, mais, autant que possible, de façon équitable et mesurée. Pour ne rien dire du fait qu’il avait très bien compris que, avec ce qu’était devenu le problème des nationalités en Autriche, celle-ci ne pouvait absolument pas rester ce que qu’elle avait été – c’est-à-dire une espèce d’État plurinational ou supranational, dans lequel on aboutissait à une situation telle que, par exemple, au parlement, on utilisait une douzaine de langues différentes et on ne parvenait ni à se comprendre ni à se mettre d’accord sur quoi que ce soit, ce qui avait pour conséquence qu’il était régulièrement suspendu : il l’était d’ailleurs au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale ! Lammasch, donc, était persuadé qu’il fallait accepter des changements importants, mais pas au point de penser qu’il fallait se résigner aussi pour finir à voir l’Autriche transformée en un État dont on pouvait se demander sérieusement après la guerre, du côté autrichien en tout cas, si c’était encore réellement un État et si celui-ci était viable.
Si bien qu’on a vu un écrivain comme Musil publier en 1919 un article intitulé « Der Anschluß an Deutschland », dans lequel il plaidait pour le rattachement de l’Autriche à l’Allemagne. Kraus est un des rares autrichiens – avec Lammasch – à avoir été strictement et dès le début opposé à l’idée de l’Anschluß. Même le parti social-démocrate était en grande partie partisan du rattachement, en dépit du fait que cette possibilité avait été exclue par le traité de Saint-Germain. Aussi ne faut-il pas être surpris de voir que, après l’entrée des troupes allemandes et la prise du pouvoir par Hitler en Autriche, il y a eu un plébiscite dont le résultat a été une quasi-unanimité en faveur du rattachement.
Je n’ai pas besoin d’insister sur le fait que Lammasch et Kraus auraient certainement approuvé tous les deux dans son principe la création d’un 59tribunal comme celui qui a siégé à Nuremberg pour juger les criminels nazis, ce qui signifie que leur point de vue était évidemment à peu près diamétralement opposé à celui de Carl Schmitt. Mais ce qui est remarquable dans leur cas est qu’ils considéraient qu’une instance judiciaire de cette sorte aurait dû déjà siéger après la Première Guerre mondiale pour juger les responsables principaux de la catastrophe. On peut donc dire d’eux qu’ils étaient très en avance sur leur temps et que l’avenir leur a donné, au moins en partie, raison. (On ne peut malheureusement pas dire du présent que nous sommes en train de vivre qu’il le fait aussi.)
Sur Lammasch, je n’en sais malheureusement, je l’avoue, pas autant que je le souhaiterais. J’ai lu avant de venir un livre de lui qui s’intitule Das Völkerrecht nach dem Krieg, c’est-à-dire « Le Droit international après la guerre », qui a été écrit en 1916. C’est extrêmement intéressant, parce que, en plein milieu de la guerre, Lammasch s’est demandé, évidemment avec de bonnes raisons, s’il pourrait encore y avoir un droit international après la guerre. Et il a répondu : il faut absolument qu’il y en ait un. Il considère qu’il est absolument indispensable que non seulement le droit international continue à exister, mais qu’il soit renforcé le plus possible. Ce qui est intéressant, c’est qu’à un moment donné, il affirme – en prenant une certaine distance par rapport à Kant – que, pour cela il n’est pas nécessaire qu’il y ait une espèce d’État mondial, voire même pour commencer simplement une Europe unifiée. La création d’une sorte de super-État de type européen, dont certains envisagent la possibilité, ne lui semble pas indispensable. Il suffit, estime-t-il, que le droit international existant déjà soit appliqué correctement, et en particulier que soit observé strictement le principe pacta sunt servanda. Vous évoquez le fait qu’une nation puisse être obligée, éventuellement, de se soumettre à des obligations de droit international, sans avoir signé le traité correspondant – mais Dieu sait si l’inverse a été prêché : c’est-à-dire le droit pour un État de rester à chaque instant, en vertu de sa souveraineté, juge de l’opportunité ou de la non-opportunité pour lui d’appliquer un traité international qu’il a bel et bien signé. Il n’y a qu’à voir la façon dont se comporte maintenant Trump qui est capable quelques jours après avoir signé un traité à caractère international de dire : « Non finalement, je ne le respecterai pas, parce que l’intérêt de l’Amérique passe décidément avant tout le reste, y compris avant les engagements que le pays a pris envers le reste du monde ». Lammasch 60était, à l’inverse, extrêmement strict sur l’obligation que l’on a de respecter les engagements internationaux que l’on a pris. Et il était même, sur ce sujet, d’un optimisme que l’on peut trouver curieux. Il affirme, en effet, à un moment donné qu’il y a bel et bien eu un progrès, puisque les États supportent désormais beaucoup moins bien qu’auparavant leur mauvaise réputation et sont beaucoup plus enclins à respecter des obligations morales. Quand j’ai abordé cette question dans Les premiers Jours de l’inhumanité, je me suis dit que c’était une chose qu’il est vraiment difficile de croire en ce moment.
Puisque ce qui nous intéresse ici est principalement la question de la confrontation entre le point de vue de Carl Schmitt, d’un côté, et celui de Lammasch et Kraus, de l’autre, une dernière chose qu’il est important d’ajouter est que, quand Carl Schmitt est allé jusqu’à affirmer, en reprenant une formule de Proudhon, que « Qui dit humanité, veut tromper », dont la généralité extrême et abusive à réellement de quoi surprendre et scandaliser, il est pour le moins difficile qu’il n’ait pas pensé à Kraus. C’est d’autant plus probable et même quasiment sûr que l’on sait à présent de façon à peu près certaine que le véritable auteur de l’article qui a été consacré à Kraus dans le livre de Franz Blei, Das grosse Bestiarium der modernen Literatur (Le grand Bestiaire de la littérature moderne) (1922), et qui s’intitulait « Die Fackelkraus », était Carl Schmitt lui-même. La Fackelkraus y est décrite comme un animal parasitaire qui se nourrit essentiellement d’excréments. Kraus a répondu vertement à cette attaque, en considérant que l’article, qui n’était pas signé, était dû à Franz Blei. Mais elle n’a pas dû le surprendre particulièrement, car il avait déjà été auparavant accusé d’être une sorte de coprophage et de faire partie des gens qui apportent en fait eux-mêmes les ordures qu’ils se croient chargés de nettoyer.
Isabelle Delpla : Vous dites qu’ils étaient très naïfs, d’avoir voulu faire juger des journalistes par un tribunal international … Naïfs ou visionnaires, parce que c’est ce qui a été fait au Tribunal Pénal international pour le Rwanda où l’on a jugé des membres de la radio « mille collines ». Streicher a aussi été condamné à Nuremberg.
Jacques Bouveresse : Cela arrive assez rarement, et n’a pas été le cas après la Première Guerre mondiale ; et pourtant cela aurait été 61mérité. J’ai lu un bon nombre de choses parmi toutes celles que les journalistes ont été capables de publier avant, pendant et après la Première Guerre mondiale. Une des raisons pour lesquelles Kraus en voulait particulièrement à la presse, c’est le comportement qu’elle eut en l’occurrence. C’était pour lui une véritable infamie, qu’il n’a jamais acceptée, il en parle encore très tardivement. Il est mort en 1936 et il n’a donc pas connu le pire, mais il était convaincu que si, comme on pouvait le craindre, on s’acheminait vers une guerre mondiale encore plus grande, la presse se comporterait à nouveau à peu près de la même façon. Il trouvait que les journaux, à quelques exceptions près, comme l’Arbeiterzeitung, s’étaient comportés pendant les années de la Première Guerre mondiale d’une façon absolument indigne, et qui aurait justifié, effectivement, qu’ils aient à rendre des comptes et que des sanctions sévères leur soient appliquées. Il a donné en 1927 une conférence à la Sorbonne, sous le titre « L’oiseau qui souille son propre nid ». L’oiseau qui souille son propre nid, c’était lui, parce qu’il était évidemment considéré le plus souvent comme quelqu’un qui avait passé toutes les années de la guerre et de l’après-guerre à dénigrer sa propre patrie et à la combattre. Ce qui, dans le cas de la presse comme dans celui de la plupart des autres responsables de ce qui avait été à ses yeux une sorte d’assassinat de masse, aggravait encore, de façon insupportable, la faute, est la facilité avec laquelle ils étaient parvenus à échapper à toute espèce de remords et à oublier à peu près immédiatement ce qui venait de se passer. Dans la conférence dont je parle, il s’indigne en particulier du comportement d’un certain nombre d’écrivains et de journalistes qui ont été des va-t-en guerre déclarés et des jusqu’au-boutistes, et puis, immédiatement après, sont allés, sans la moindre gêne, chez l’ennemi d’hier, en France ou ailleurs, jouer les pacifistes.
Sur ce point, j’avoue que je comprends assez bien l’attitude que Kraus a eue à l’égard de la presse. Si j’avais vécu à l’époque de la Première Guerre mondiale, et que j’aie vu ce dont elle était capable à cette époque-là – elle l’est d’ailleurs probablement restée –, je ne suis pas sûr que je n’aurais pas réagi à peu près comme lui, aussi bien à l’heure du bilan que pendant les années de l’horreur. Le problème réside, comme il l’avait déjà constaté, dans le fait que la presse continue à associer strictement sa cause à celle de la démocratie, et à considérer toute attaque contre elle à peu près comme une attaque contre la démocratie elle-même. Je 62soutiens personnellement, et je l’ai même écrit, que la presse se rend coupable elle-même fréquemment d’atteintes à la démocratie. Elle n’est pas, loin de là, par essence vouée à la défense de la démocratie. C’est une erreur fâcheuse de croire cela. Mais c’est ce qu’elle-même semble croire de façon à peu près inébranlable.
[La presse et le pouvoir politique] Kraus s’est retrouvé confronté à un problème de collusion entre presse et pouvoir politique à propos d’un journaliste qui était d’origine hongroise et qui s’appelait Bekessy, qu’il a réussi à faire chasser de Vienne. Cela a été une de ses grandes victoires. Parce que Bekessy avait un journal qui s’appelait Die Stunde – « L’heure » – grâce auquel il pratiquait à peu près ouvertement le chantage et l’extorsion de fonds. Il trouvait tout à fait normal que les journaux se fassent payer pour publier et surtout pour ne pas publier. Le monde politique hésitait fortement à s’en prendre à lui, à cause des informations réelles ou supposées qu’il détenait sur certains de ses membres et des « révélations » qu’il pouvait les menacer de faire. Il avait même fini par s’attaquer à Friedrich Austerlitz, le rédacteur en chef de l’Arbeiterzeitung, qui était un des amis de Kraus, ce qui a particulièrement révolté celui-ci. Mais même le parti social-démocrate, qui aurait dû en l’occurrence réagir fermement, ne l’a pas vraiment fait. Or Kraus, à la suite d’une campagne qui a duré des années, au moins trois ou quatre, a réussi à le faire chasser de Vienne, en restant à peu près seul, dans le combat, sans être aidé réellement par le monde politique ni, cela va sans dire, par la presse. Il a réalisé, en l’occurrence, un véritable exploit. Edward Timms, le biographe de Kraus, compare cela à peu près à ce qui se passerait si un satiriste anglais réussissait à réduire au silence Rupert Murdoch et à le contraindre à émigrer. Il n’y a évidemment à peu près aucune chance pour que cela arrive. Mais la disproportion des forces et l’improbabilité de la victoire, dans la bataille que Kraus a déclenchée et finalement gagnée, n’étaient a priori pas nécessairement beaucoup moins élevées. Il faut dire que, dans cette bataille judiciaire, comme dans tous les procès dans lesquels il s’est trouvé impliqués et qu’il n’a que rarement perdus, il a été aidé par un avocat absolument remarquable et entièrement dévoué à sa cause, qui s’appelait Oskar Samek, et qui a également joué un rôle important dans le sauvetage et la préservation de ses papiers et de sa bibliothèque quand le pouvoir, en Autriche, est tombé entre les mains des nazis. Tout cela nous ramène un peu à la 63question du droit et à celle des moyens de droit dont, à partir d’un certain moment, il a fait usage sans hésiter et de façon assez systématique pour se faire rendre justice quand il estimait avoir des raisons sérieuses de l’exiger. Il a même, ce qui est assez remarquable, réussi, en 1927, à faire condamner le Völkischer Beobachter et son directeur, Adolf Hitler.
[Sur la nation et le patriotisme] Un point aussi sur la nation et le patriotisme. Ni Kraus ni Wittgenstein, bien entendu, ne sont contre l’idée de nation, considérée en tant que telle. Ils sont d’ailleurs patriotes l’un et l’autre. Wittgenstein s’est engagé comme volontaire au début de la Première Guerre mondiale. Dans la famille Wittgenstein, on était même, de façon générale, très patriote. Et on avait, en plus de cela, tendance à accorder une importance considérable – que personnellement j’ai un peu de mal à comprendre – au devoir militaire et à la chose militaire. Le frère Kurt, qui était aux États-Unis, est revenu pour faire la guerre en Autriche. Il s’est suicidé en 1918, si je me souviens bien, parce qu’il commandait un régiment de Hongrois qui ont fait défection. Le moins qu’on puisse dire est qu’en Autriche-Hongrie, les Hongrois ne faisaient pas preuve d’un enthousiasme loyaliste très développé à l’égard de la Double Monarchie. Le fait est, en tout cas, qu’à la fin de la guerre, les trois frères, Ludwig, Paul (qui pourtant avait déjà perdu un bras au début de la guerre) et Kurt, étaient engagés sur le front italien. Ils ont eu évidemment une attitude et un comportement assez différents de ceux de Kraus. Wittgenstein a tenu à faire preuve de solidarité envers son propre pays, alors qu’il ne croyait apparemment pas que l’Allemagne et l’Autriche pouvaient réellement gagner la guerre.
Je ne suis pas en train, naturellement, de dire que Kraus n’était pas capable, pour sa part, de faire preuve, le cas échéant, de patriotisme. Pendant la Première Guerre mondiale, il a dénoncé ce qu’il appelait le « mensonge patriotique ». Mais quand Hitler est arrivé au pouvoir, et même déjà quand il était simplement sur le point d’y arriver, il a considéré que c’était le moment de redevenir, en un certain sens, un Autrichien patriote. On avait seulement été patriote bien trop tôt et à un moment où il aurait certainement mieux valu ne pas l’être. Mais il y a eu aussi, une vingtaine d’années plus tard, un moment où il s’est avéré nécessaire de l’être à nouveau, parce qu’il fallait à tout prix éviter que l’Autriche, qui était devenue en quelque sorte le dernier refuge de la culture allemande, tombe entre les mains de Hitler. Pour cela, il 64fallait être prêt à se battre et à utiliser le seul moyen qu’il connaissait lui-même à savoir la force. Et comme Kraus était convaincu qu’en aucun cas les démocraties occidentales ne seraient capables d’opposer à Hitler une résistance digne de ce nom, il était plutôt enclin à croire qu’il aurait fallu probablement accepter d’aller jusqu’à une guerre préventive, à laquelle l’Autriche elle-même aurait pu participer, contre l’Allemagne. Je ne dis pas que c’est la position qu’il fallait adopter, on peut tout à fait considérer qu’il valait mieux compter malgré tout sur les démocraties, même si elles ont tardé de façon coupable à réagir avec la fermeté et l’efficacité nécessaires, plutôt que d’accepter comme il l’a fait le régime de Dollfuss. Par conséquent, il n’y a aucun doute sur le fait que Kraus était certainement tout à fait capable d’aimer, lui aussi, son pays ; mais il n’était tout simplement pas prêt à accepter de lui un certain nombre de choses, en particulier le déclenchement d’une guerre absurde et monstrueuse. Sur ce point, je vois mal, je l’avoue, comment on pourrait ne pas lui donner raison.
Quand on songe à ce qu’a été la guerre de 14, ce qu’on peut lire dans le livre publié récemment par quatre historiens autrichiens, qui s’intitule Habsburgs schmutziger Krieg – la Guerre sale des Habsburgs – constitue une véritable abomination. La façon dont les Autrichiens se sont conduits au début de la guerre, lors de l’invasion de la Serbie, est une véritable horreur, dont ils préfèrent évidemment, autant que possible, ne pas entendre parler ! Le nombre de civils qui ont été massacrés ou qui ont été internés sans aucune justification, soupçonnés sans aucune preuve de déloyauté ou de trahison caractérisée, victimes d’exécutions sommaires, etc. est tout bonnement effrayant. Le comportement des Allemands en Belgique, à l’égard de la population civile, n’a pas été plus acceptable : il y a eu 6.500 civils massacrés pendant la traversée de la Belgique – je dis la traversée, alors que c’était en réalité une violation cynique de la neutralité du pays – une chose qui a indigné particulièrement Kraus. J’ai relu par curiosité le texte de Bethmann-Hollweg, le chancelier allemand, dans lequel il justifie le fait d’avoir choisi de passer par la force à travers la Belgique et le Luxembourg. Les Allemands avaient, en effet, commencé par demander au gouvernement belge l’autorisation de faire passer leur armée à travers le pays pour pouvoir envahir la France, parce que c’était essentiel pour eux. Malheureusement – si l’on peut dire – les Belges ont refusé et ont choisi de combattre. Or, en application du plan Schlieffen, il 65fallait absolument, pour les Allemands, réussir à vaincre complètement la France le plus rapidement possible, avant que la Russie ait pu trouver le temps et les moyens nécessaires pour mobiliser intégralement ses forces.
L’argumentation de Bethmann-Hollweg est sidérante ! Il dit : « On va traverser la Belgique, même sans l’accord de celle-ci, on sait que c’est contraire au droit, mais on va le faire quand même, parce qu’il y a un intérêt supérieur qui est en cause, à savoir l’existence même de la nation allemande, qui est menacée simultanément sur deux fronts par un ennemi beaucoup plus puissant ». Il précise en même temps que, à la fin, quand elle aura remporté la victoire, l’Allemagne sera disposée à payer des réparations appropriées pour ce qu’elle a été obligée de faire. Des réparations ! Pour les destructions causées, peut-être, mais on ne va pas réparer les dégâts humains et ressusciter tous ceux – militaires et civils confondus –, qui ont été tués ! Kraus a trouvé un nom pour ce genre de démarche et de comportement. Il a appelé cela la mentalité de « l’innocence persécutrice », dont il dit qu’elle est devenue un mode de pensée qui est en train de se généraliser fâcheusement. C’est celui de l’attaquant, qui au moment même où il commet un acte d’agression caractérisé, soutient qu’il n’a jamais rien fait d’autre que de se défendre contre un ennemi ou une coalition d’ennemis beaucoup plus puissants que lui et prêts à utiliser sans scrupule, si on leur en donne la possibilité, des moyens encore bien plus destructeurs et inhumains que ceux de leur victime réelle ou potentielle. Il va sans dire que, pour ceux qui, du côté allemand, raisonnent de cette façon, si l’Allemagne s’est trouvée obligée de faire une guerre sur deux fronts, ce n’est pas parce qu’elle l’a voulu, mais parce qu’elle y a été forcée. Kraus constate à ce propos avec une certaine pertinence que la Première Guerre mondiale a été au fond une guerre sans agresseurs. Tous les pays belligérants ont été convaincus de ne faire en réalité rien d’autre que se défendre. Un poème que Kraus a écrit au cours de ces années-là s’intitule même « Allgemeine Verteidigungskrieg » (Guerre de défense universelle). Il n’est pas nécessaire de souligner que Hitler avait parfaitement compris la leçon et a utilisé le raisonnement de l’innocent persécuteur (et criminel) de façon systématique et avec une efficacité encore beaucoup plus grande. Un des avantages majeurs d’une guerre sans agresseurs est évidemment que c’est aussi une guerre sans coupables et c’est ce qu’a été, pour Kraus, d’une façon qu’il n’a jamais admise, la guerre de 1914-1918.
66Il y a eu, bien entendu, comme je l’ai dit, également des abominations du côté autrichien, et pas seulement du côté allemand. On attribuait généralement à cette époque-là – chez les Autrichiens en tout cas – à l’Autriche un visage plus souriant et plus rassurant que celui de l’Allemagne. L’Allemand passait volontiers pour une sorte de brute impitoyable et sanguinaire, tandis que les Autrichiens étaient supposés présenter une apparence plus humaine, plus détendue, plus conciliante et plus aimable. Mais que cela corresponde ou non à une certaine réalité, cela ne semble en tout cas pas, remarque Kraus, avoir fait beaucoup de différence pour ce qui concerne la façon de concevoir et de conduire la guerre. Dans les faits, la guerre du coté autrichien a été aussi impitoyable et le droit bafoué de façon peut-être encore plus inadmissible que du côté allemand. Il semble, en effet, qu’en Autriche, l’emprise des militaires sur le droit et la justice, et le processus de militarisation de ceux-ci qui s’en est suivi, aient pesé encore plus fortement et plus longtemps que dans la plupart des autres pays belligérants. Rien que pour l’Autriche, Kraus mentionne le chiffre effarant de 11.200 potences qui ont été dressées pour l’exécution de citoyens de la Double Monarchie qui avaient été condamnés à mort par les tribunaux militaires, et dont beaucoup étaient des habitants des régions frontalières de l’Empire, soupçonnés simplement de sympathies pro-serbes, pro-russes, pro-italiennes, etc., qui suffisaient déjà à faire d’eux des traitres potentiels et même probablement réels. C’est un sujet extraordinairement intéressant – ce qu’il est advenu du droit pendant les années de la Première Guerre mondiale, c’est-à-dire la façon dont les militaires ont réussi à faire prévaloir une conception du droit et de la justice qui était essentiellement la leur et qui a tendu à faire fonctionner les tribunaux, même une fois la paix revenue, nettement plus qu’il n’était nécessaire et légitime, sur le modèle des cours martiales Kraus n’a pas oublié non plus de protester contre la militarisation dangereuse de la police, qui s’est manifestée notamment, de façon tragique, dans la répression sanglante de la manifestation du 15 juin 1927, sous la responsabilité du Préfet de police Johann Schober, qui a été, en même temps que Bekessy, une des cibles privilégiées du satiriste, mais contre lequel il n’a malheureusement, cette fois-ci, rien pu faire.
On comprend, en outre, très bien que les gens comme Kraus en aient voulu tout particulièrement à tous ceux qui, après la Première Guerre mondiale, ont instauré ce qu’on peut appeler l’industrie de la 67commémoration, qui pour lui était en réalité une organisation de l’oubli. On a, en effet, systématiquement mythifié, idéalisé et sacralisé la guerre, essentiellement pour essayer de transformer ceux qui avaient été avant tout des victimes à qui il n’avait été laissé aucun choix en héros qui ont consenti volontairement au sacrifice. Je dis cela simplement pour essayer de faire comprendre un peu mieux la raison du ressentiment particulier qu’il éprouvait à l’égard des journalistes, qui ont joué un rôle beaucoup plus important qu’ils n’ont consenti à le reconnaitre après coup, surtout en Autriche. Kraus dit de celle-ci que la presse était au fond à peu près le seul pouvoir réel qui y existait, le seul qui gouvernait véritablement. Or il est normal et naturel d’imputer à ceux qui ont un pouvoir plus grand une responsabilité qui l’est également. Il dit même de la presse en général qu’elle sera le dernier pouvoir absolu. Ce n’est sans doute pas ce qui est arrivé. Mais la question de savoir s’il y a réellement, dans nos sociétés, un contrepouvoir suffisamment efficace à celui qu’elle détient n’en continue pas moins à se poser.
Benjamin Bourcier : [Pour finir], je vous propose une réflexion générale sur le mythe de l’intériorité politique en regard de votre travail sur Robert Musil. Il faut rappeler que vous avez participé en France à la découverte d’une tradition philosophique assez occultée, notamment par la place accordée à la tradition philosophique allemande, à savoir la tradition philosophique autrichienne. Dans cette tradition autrichienne, vous vous êtes intéressé aux écrits de Robert Musil à une époque où seul, avec Jean-Pierre Cometti et Kevin Mulligan, vous prêtiez attention à cette œuvre littéraire pourtant déjà traduite en français L’homme sans qualité. Aujourd’hui, il existe deux livres assez complets de vos travaux sur Musil (Robert Musil, L’homme probable, le hasard, la moyenne et l’escargot de l’histoire, éditions de l’Éclat, coll. Tiré à part, 1993) ; puis le second qui est un recueil d’articles que vous avez publiés dans des revues et qui ont été rassemblés (La voix de l’âme et les chemins de l’esprit, Seuil, Liber, qui est plus récent, celui-ci, de 2001). Avec ces textes, vous avez contribué à faire découvrir la philosophie de Musil, notamment par la nature des relations qu’il entretient avec la tradition philosophique, qui peut notamment nourrir tout à fait légitimement l’idée de cours ou de lecture, « Musil philosophe », de la même manière que peut être on peut avoir des cours sur « la philosophie de Pierre Bourdieu », par exemple.
68Musil a clairement écrit sur la morale mais aussi sur certaines questions qui relèvent de l’épistémologie, de la réflexion sur la culture, sur l’époque, etc. Or, comme tel, le politique semble ne pas être au cœur de sa pensée. Aussi, je voudrais tout d’abord revenir à nouveau sur un violon d’Ingres que vous avez défendu et avec constance, je dirais, c’est l’idée selon laquelle une des vertus peut être, une des tâches qu’il faut faire en philosophie politique et en philosophie tout court, consiste à se déprendre des pseudo-entités, à clarifier le langage et cela vaut aussi pour le langage politique et ce dans le but, peut-être, non seulement de mieux comprendre les problèmes politiques, mais aussi peut être de mieux comprendre aussi les erreurs, ou les tragédies politiques et phénomènes graves … Suivant cet angle-là, Musil peut être intéressant pour peut-être réfléchir sur ce mythe de l’intériorité politique, en tant qu’il développe la critique d’une certaine vision de la communauté politique fermée, visant sa glorification et ce qu’il incarne dans l’histoire de ce roman philosophique qu’est l’homme sans qualité, c’est l’Action parallèle. Chez Musil, on trouve du coup une certaine – et vous l’avez développé dans vos livres – problématisation du mythe de l’intériorité politique à partir d’une forme de critique du patriotisme nationaliste. Musil pourrait ainsi être convoqué dans ce chapitre du mythe de l’intériorité politique en tant qu’il s’agit de critiquer certaines fictions ou certains pseudo entités. C’est là ma question : Est-ce que vous pensez que Musil peut nous apprendre des choses justement, à ce niveau-là de la critique, et dans ce sens-là de mythe de l’intériorité politique qui est circonscrit ?
Jacques Bouveresse : Énormément. Un de mes sujets d’étonnement constant, c’est l’absence à peu près totale de Musil dans toute, je dirais, la culture française. La théorie et la critique littéraire se sont très peu intéressées à lui. Les philosophes, à quelques exceptions près, n’en parlent pour ainsi dire jamais. C’est, je l’avoue, une chose que je n’arrive toujours pas à comprendre. Comme il l’avait déjà compris lui-même, il appartient à la catégorie des auteurs qu’on respecte parce qu’à défaut de connaître réellement leur œuvre, on a une certaine idée de leur réputation, mais qu’on ne lit pas. Alors que s’il y a un auteur dont on pourrait faire un usage extrêmement intéressant et éclairant, c’est bien Musil. Je me souviens d’avoir dit une fois dans une conférence – je crois que c’était à Baltimore –, malheureusement devant un public qui comportait un 69certain nombre de derridiens et de heideggériens fervents, qu’on pouvait en apprendre considérablement plus, en lisant des auteurs comme Musil et Kraus qu’en lisant Heidegger, sur des phénomènes comme le nazisme et sur le monde moderne en général. C’est, bien entendu, une chose que je continue à penser encore aujourd’hui et même, d’une certaine façon, plus que jamais. Mais vous n’aurez sans doute pas de peine à imaginer ce que j’ai pu entendre quand je l’ai dite ! Il y a, encore maintenant, des heideggériens français qui soutiennent imperturbablement que seul Heidegger a été en mesure de comprendre réellement en profondeur et de nous faire comprendre ce qu’était le nazisme. Je trouve, pour ma part, que c’est surtout une chose qu’il a réussi à faire croire.
Mais il faut dire que j’ai passé énormément de temps à lire Musil, et le plus souvent, autant que possible, en allemand. Quand on le fait, il me semble qu’on trouve dans L’Homme sans qualités, par exemple, une mine de renseignements, y compris simplement historiques, extrêmement précieux, sur ce qu’étaient réellement la situation du monde intellectuel et la situation générale en Allemagne, en Autriche et dans le monde contemporain, et une profusion d’analyses qui sont d’une perspicacité étonnante et presque toujours d’une actualité remarquable. C’est un livre qui à chaque instant nous parle de nous et de ce qui est en train de nous arriver. C’est vrai notamment quand on aborde une question comme celle que vous évoquez, qui apparait d’ailleurs presque dès le début dans le roman, à propos d’une mésaventure qui est arrivée à Ulrich quand il était au lycée …
Benjamin Bourcier : Ulrich c’est le personnage principal du livre …
Jacques Bouveresse : C’est le héros. Il a eu la mauvaise idée de rédiger une dissertation dans laquelle il exposait un point de vue qui doit être devenu à un moment donné à peu près celui de Musil, bien qu’il ait été, pour sa part, éduqué dans une école militaire et ait accueilli dans un premier temps avec enthousiasme le déclenchement de la guerre en 1914. En gros, le petit Ulrich s’est permis de suggérer qu’au fond, personne ne devrait se sentir autorisé à éprouver plus de considération et d’admiration pour sa propre patrie que pour celles des autres et à juger la première supérieure aux secondes. Inutile de vous dire de quelle façon la dissertation en question a été reçue. Mais je pense que c’était la 70conviction profonde de Musil, qui était spontanément internationaliste. Il était persuadé notamment que la culture est par définition internationale. Quand elle devient nationale, c’est qu’elle décline.
Il peut être utile de signaler à ce propos que Musil a adhéré à peu près immédiatement au mouvement paneuropéen, qui avait été créé par le comte Coudenhove-Kalergi. Il pensait, après la fin de la Première Guerre mondiale, que le seul espoir de réussir à instaurer une paix, sinon perpétuelle, du moins durable, était la création d’une Europe digne de ce nom. Quand je vois ce qui est en train de nous arriver en ce moment, je ne peux pas m’empêcher de penser à ce qu’il dit à propos de la tendance désastreuse qu’a l’humanité à revenir toujours à des solutions anciennes pour résoudre des problèmes nouveaux, qui exigeraient justement des solutions également nouvelles. Au nombre de ces solutions qui n’en sont pas et qui sont comme des uniformes que l’on est toujours prêt, en cas de besoin, à ressortir du placard et à réutiliser avec le même insuccès, pour ne pas dire, le même résultat catastrophique, il mentionne ce qu’il appelle « les fétiches de l’époque » : la nation, la religion et la race. Je n’ai pas besoin d’en dire plus pour que vous compreniez où je veux en venir. Bref, je considère que Musil – pas seulement le Musil de L’Homme sans qualités, mais également celui des Essais et des Journaux – est un auteur qui est sous-utilisé de façon déplorable.
Isabelle Delpla,
Emmanuel Pasquier,
Olivier de Frouville,
Bruno Gnassounou
et Benjamin Bourcier
1 Jacques Bouveresse, « Philosophie du langage et de la connaissance », Leçon inaugurale au Collège de France, 6 Octobre 1995, accessible à https://books.openedition.org/cdf/660
2 Hans Kelsen, Théorie pure du droit (1re éd. 1934), trad. Charles Eisenmann, Paris, Éditions Bruylant/Librairie générale de Droit et de Jurisprudence, 1999.
3 Hans Kelsen, Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu Einer Reinen Rechtslehre, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1920, 1928, réimpr. Aalen, Scientia Verlag, 1960.
4 Hans Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État (1945), trad. Béatrice Laroche, Paris, Bruylant/LGDJ, 1997, p. 300.
5 « L’ordre juridique international est en effet, selon un qualificatif qu’on lui a autrefois occasionnellement appliqué, une civitas maxima ; il l’est dès aujourd’hui. », Hans Kelsen, Les rapports de système entre le droit interne et le droit international public, Recueil des Cours de l’Académie de Droit international de La Haye, 1926, tome 14, Paris, Librairie Hachette, 1927.
6 Emmanuel Pasquier, De Genève à Nuremberg. Carl Schmitt, Hans Kelsen et le droit international, Paris, Classiques Garnier, 2012.
7 Hans Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État, op. cit., p. 415.
8 Voir, par exemple, Hans Kelsen, Théorie générale du droit et de l’État, op. cit., p. 414.
9 Carl Schmitt, Le Nomos de la terre dans le droit des gens du Jus Publicum Europaeum (1950), trad. L. Deroche-Gurcel, Paris, Presses universitaires de France, 1992.