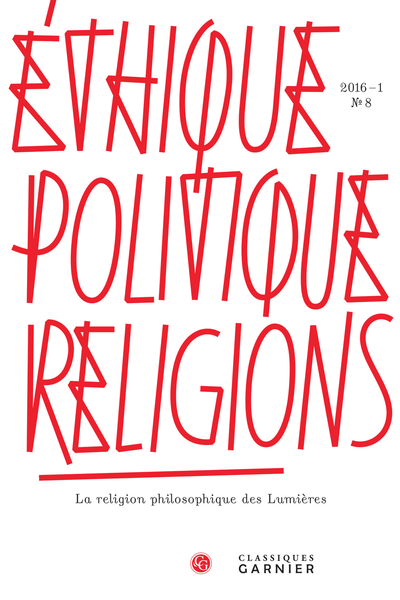
Recension
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Éthique, politique, religions
2016 – 1, n° 8. La religion philosophique des Lumières - Auteur : Drien (Pierre-Alain)
- Pages : 167 à 176
- Revue : Éthique, politique, religions
- Thème CLIL : 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN : 9782406063001
- ISBN : 978-2-406-06300-1
- ISSN : 2271-7234
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-406-06300-1.p.0167
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 13/09/2016
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Recension
Sylvie Courtine-Denamy, De la bonne société. L. Strauss, E. Voegelin, H. Arendt. Le retour du politique en philosophie, Éditions du Cerf, 2014.
Difficile de recenser cet ouvrage sans avoir une pensée émue pour Sylvie Courtine-Denamy décédée à la suite d’une longue maladie en octobre 2014. De la bonne société condense en partie les travaux et les interrogations qui ont guidés ses recherches tout au long de sa vie, tels que la pensée philosophique, le judaïsme, le politique, le féminisme ou encore la sécularisation. On peut également souligner sa contribution dans la réception en France du philosophe Eric Voegelin – encore peu connu dans l’hexagone – par la traduction en français de certains de ses ouvrages, la publication d’articles et sa participation active à la Voegelin Society.
Sylvie Courtine-Denamy confronte dans son dernier ouvrage trois auteurs – Leo Strauss (1899-1973), Eric Voegelin (1901-1985) et Hannah Arendt (1906-1975) – qui partagent de réels points communs, et, en premier lieu, celui d’être tous trois des German émigrés (autrichien dans le cas d’Eric Voegelin) qui ont effectué, en partie, leur carrière universitaire aux États-Unis pour fuir le totalitarisme1 et l’antisémitisme en Europe (Voegelin était un protestant luthérien, bien qu’il ait fui l’arrivée des nazis « comme s’il était juif », selon les mots de Reinhold Knoll). En outre, ils ont en commun de s’être attachés à comprendre la crise de leur temps – le phénomène totalitaire – et de la lier à une crise plus large, que l’on nomme « crise de la modernité », perçue différemment mais impliquant néanmoins une remise en cause de la modernité et de son rapport avec la tradition. Traiter de la crise fait en effet naître de profondes divergences entre ces auteurs. Si tous les trois s’accordent sur le fait que le totalitarisme n’est pas un accident de l’histoire, ni un retour en arrière ou à un âge sombre et barbare, un âge « moyenâgeux » (Strauss, Voegelin et Arendt s’attacheront par ailleurs dans leurs travaux à lutter contre les clichés modernes envers la pensée prémoderne), et que le processus de la modernité joue un
rôle essentiel dans la faillite politique du xxe siècle, ils ne s’accordent cependant pas sur l’identification de ce processus. Strauss et Voegelin mènent en effet une étude véritablement historique alors qu’Arendt, bien qu’elle loue la tradition, ne cesse d’insister sur la perte de celle-ci et le caractère résolument nouveau de la modernité, se rapprochant à ce titre davantage de Hans Blumenberg. On fait face ici à un problème plus sérieux qu’il ne pourrait paraître de prime abord. Sylvie Courtine étudie et relie ces trois auteurs car ils prônent un retour au politique par une préoccupation sur l’idée de bien contre la menace totalitaire et la furie de la technique. À ce titre, Strauss, Voegelin et Arendt ont été catalogués comme « conservateurs », bien qu’ils s’en défendaient tous les trois, et Sylvie Courtine consacre d’ailleurs quelques pages à démontrer l’absurdité d’une telle réduction. On ne peut néanmoins nier qu’ils ont, contre leur gré, contribué à fournir un appui intellectuel à la pensée conservatrice américaine. Si De la bonne société constituait un ouvrage sur le conservatisme, le trio Strauss-Voegelin-Arendt aurait été tout à fait pertinent, or ce n’est pas le cas. Le fil conducteur du livre est la bonne société, la question du bien, alors que, paradoxalement, l’Auteure ne traite de ce problème qu’en conclusion de l’ouvrage. Il faut en réalité comprendre que cette question est traitée de manière indirecte par nos trois philosophes quand ils s’attachent à saisir le mal de leur temps : la crise politique totalitaire. Strauss et Voegelin, pour comprendre l’abandon du bien, mènent une étude historique – ils peuvent d’ailleurs être classés parmi les historiens de la philosophie, voire historien des idées en ce qui concerne Voegelin en référence à son grand travail précédant Ordre et Histoire. L’ordre est le thème central de leur philosophie, et l’histoire n’est rien d’autre qu’une succession d’ordre et de désordre dans la sphère politique et sociale. Tous deux cherchent à saisir pourquoi la philosophie politique n’a pas su anticiper et affronter le totalitarisme (ou la tyrannie moderne) ; cela implique une remise en question de la tradition de la pensée politique occidentale. Arendt ne se pose pas le problème de la même façon. Selon elle, il ne faut pas remettre en question la tradition de la pensée politique : elle reconnaît néanmoins que la philosophie n’est pas entièrement étrangère à l’apparition du phénomène totalitaire, mais la question de l’ordre n’est pas aussi fondamentale que chez Strauss et Voegelin ; elle insiste davantage sur l’événement caractérisé par l’émergence d’une nouveauté. Le travail d’Arendt consiste donc en
la mise en lumière des éléments nouveaux contenus dans le totalitarisme qui ne laisse pas de place à une étude historique.
À cet égard, il est difficile de saisir le bien fondé d’une mise en relation de Arendt avec Strauss et Voegelin. Cependant, le mérite de l’ouvrage de Sylvie Courtine-Denamy est de proposer, via Arendt, un contre-pied aux thèses straussienne et voegelinienne. On pourrait, un peu trivialement, résumer cette opposition en qualifiant les positions apportées par Voegelin et Strauss de « religieuses » (quoique nettement moins chez Strauss que chez Voegelin), tandis qu’Arendt adopte une position clairement « areligieuse ». À ce titre, le débat épistolaire entre Arendt et Voegelin au sujet de l’origine religieuse (ou non) du phénomène totalitaire – que Sylvie Courtine traite dans la deuxième partie de son ouvrage – est particulièrement fécond. Ce point a par ailleurs toute son importance dans leur compréhension respective de la modernité et de la sécularisation.
La méthode utilisée par Sylvie Courtine-Denamy pour confronter les trois auteurs est elle aussi originale. Il ne s’agit ni d’une simple comparaison des théories de chaque auteur, ni d’un exposé successif de doctrines contradictoires, Sylvie part d’un problème, comme le judaïsme ou la modernité, et fait dialoguer les auteurs entre eux en se basant non seulement sur leurs écrits respectifs mais également sur leurs correspondances – quand elles existent (on regrette à ce titre qu’il n’y a jamais eu le moindre échange épistolaire entre Leo Strauss et Hannah Arendt) – et sur leurs autobiographies. Cela produit un corps riche en informations tant sur la pensée des auteurs que sur les anecdotes de leur propre vie, on peut relever par exemple l’épisode de l’exil des trois philosophes, en particulier le départ rocambolesque de Voegelin d’Autriche à l’arrivée de la Gestapo. On retrouve également des inédits, comme la traduction d’une lettre de Voegelin à Arendt du 8 avril 1951 ou encore une étude des Loose Notes on « The News Science of Politics » de Leo Strauss. De la bonne société constitue ainsi un ouvrage essentiel pour découvrir un peu plus que la pensée de Strauss, Voegelin et Arendt.
L’ouvrage de Sylvie Courtine se divise en trois parties : la première consiste en une revue des positions politique et religieuse de Strauss, Voegelin et Arendt ; la deuxième se focalise sur leur compréhension du totalitarisme via le nazisme et le bolchévisme ; enfin, la dernière se concentre en grande partie sur leur analyse de la modernité, et, de façon moindre, sur leur conception de la vie bonne.
La première partie, intitulée « Dans l’ombre de l’apocalypse », traite du judaïsme et du sionisme tels que perçus par Strauss, Voegelin et Arendt. Cette partie met à l’honneur Strauss et Arendt et leurs divergences quant au sionisme. Ils ont certes en commun de relier judaïsme et assimilation dans le monde occidental, c’est-à-dire de mettre en avant à la fois l’impossibilité de fuir ses origines juives et l’échec de l’assimilation des Juifs dans l’Europe chrétienne. Strauss et Arendt ont également en commun d’avoir un temps approuvé le sionisme avant de le rejeter avec force. C’est là que leurs avis divergent. Arendt décrit un sionisme laïque et politique, et, en faisant du problème juif un problème « purement politique », elle élargit ce dernier à l’humanité tout entière. Arendt regrette cependant la dérive nationaliste du mouvement sioniste et mesure les conséquences des affrontements avec les Palestiniens. Pour Strauss, le sionisme politique – limité à l’action politique – se heurte au sionisme culturel, c’est-à-dire à la révélation biblique. Cette vision nous confronte au problème central de la thèse straussienne : le conflit entre foi et raison. La probité intellectuelle nous contraint en effet à choisir entre la croyance et la raison. À ce titre, Strauss critique toutes les tentatives de « fusion » ou d’altérations, telles que celle de Rosenzweig, accusé de transformer le judaïsme en un système de philosophie. La question est de savoir si cette probité peut être effectivement respectée : quoi qu’il en soit, bien que Strauss ne soit pas contre l’instauration d’un État juif, le sionisme en tant que solution athée au problème juif ne satisfait pas l’auteur de Droit naturel et histoire.
Voegelin est plus en retrait dans cette partie, mais on peut noter la pertinence de ses travaux sur le racisme et l’antisémitisme dès les années 1930. On retient également son apport sur le judaïsme dans son premier tome d’Ordre et Histoire, Israël et la Révélation, où il caractérise la révélation mosaïque de « saut dans l’être », débouchant sur une meilleure compréhension de l’homme et de son existence ; un tel « saut » se retrouvera, avec une plus grande intensité, avec la philosophie grecque et la révélation chrétienne.
Dans cette première partie, Sylvie Courtine-Denamy a montré le caractère « dissident » au niveau politico-religieux de Strauss, Voegelin et Arendt vis-à-vis du contexte politique et social de leur époque. Dans la deuxième partie, « Saisir l’effroyable », l’auteure étudie les interprétations des trois philosophes face aux idéologies de leur temps : le
nazisme et le communisme. La particularité de Strauss est de ne parler ni d’antisémitisme, ni de racisme, ni même de totalitarisme ; il se focalise sur la tyrannie, qui est un fait politique et donc en aucun cas une nouveauté en soi. Il mène son attaque en soulignant la faiblesse de la société libérale caractérisée par le rejet nihiliste des valeurs, elles-mêmes considérées comme nihilistes. En ce sens, Strauss fait de la démocratie libérale, telle qu’il l’a connue dans les années 1920, la mère de la tyrannie contemporaine. Au contraire, Arendt distingue le totalitarisme de la tyrannie en remarquant l’absence de lois dans la tyrannie, alors qu’un régime totalitaire repose sur une loi : une loi de la nature dans le nazisme, une loi de l’histoire dans le bolchévisme. Cette loi est cependant définie par Arendt comme une loi de mouvement avec une fonction d’accélération. Totalitarisme et tyrannie visent l’incapacité d’action, les relations entre les hommes sont détruites. Plus que la tyrannie, la logique idéologique contenue dans le totalitarisme conduit à l’isolement, à l’abandon ; ainsi, en perdant sa caractéristique pluraliste, la politique est détruite. Arendt accuse une pratique de la pensée moderne qui confond les domaines de la pensée et de l’agir ; cela n’est pas sans rappeler ce que Leo Strauss dénonce dans Droit naturel et histoire : l’effondrement de la théorie dans la pratique. Voegelin, quant à lui, interprète le totalitarisme en terme de « gnosticisme » qu’il replace, plus précisément, dans le contexte de la décadence de la civilisation chrétienne, laquelle remonte aux mouvements sectaires du xiie siècle. Bien qu’Arendt qualifie l’effondrement de la société chrétienne de davantage qu’une « stupidité intellectuelle », elle considère cependant le contexte de cet effondrement trop vaste pour expliquer le phénomène totalitaire.
S’en suit une analyse comparée de Voegelin et Arendt sur les causes de l’antisémitisme et sur la judéité. Voegelin insiste sur les idées de corps et de peuple élu pour expliquer l’antisémitisme alors qu’Arendt souligne la dimension « internationale » du judaïsme. Dans les deux cas, l’antisémitisme se révèle être une réaction : réaction contre l’idée d’élection pour Voegelin, et réaction contre la dimension « internationale » du judaïsme pour Arendt. Cela serait à l’origine du fanatisme de la civilisation occidentale contre le judaïsme.
Strauss, Voegelin et Arendt évoquent ensuite l’utopie marxiste. Cette utopie est d’une certaine manière la fin de la modernité, c’est-à-dire le projet moderne poussé à son extrémité. Elle révèle alors son cosmopolitisme,
incarné dans l’exemple de l’État mondial, et sa volonté de redéfinir l’homme. Dans cette optique, Sylvie Courtine-Denamy expose la pensée de Strauss sur la « bonne tyrannie » qui met en évidence le rôle de la morale ; car si la démocratie libérale et le communisme visent une même fin – la société universelle prospère – elles divergent sur les moyens utilisés pour parvenir à cette fin. Cela pousse Strauss à parler de « tyrannie » ou de « despotisme oriental » au sujet du communisme. Pour Voegelin, l’utopie marxiste résulte de l’activisme gnostique dont le but est de couper la relation de l’homme à la transcendance ; pire, elle coupe l’homme de son lien à la ratio, le communisme se révèlant ainsi comme une non-philosophie. Enfin, Arendt soulève les contradictions à l’intérieur même de la théorie marxiste, l’homme y est compris comme un animal laborans dont le projet est de vivre dans une société où le travail est aboli, cette contradiction résulte de la confusion entre travail et action ; en outre, cette contradiction montre de surcroît que la projection du travail productif sur le politique détruit la pluralité nécessaire à la politique véritable, et, dans le pire des cas, déshumanise les hommes.
La troisième et dernière partie – « La modernité effrénée » – traite de l’interprétation faite par Strauss, Voegelin et Arendt de la « modernité ». Strauss fait de Machiavel et Hobbes les fondateurs de la modernité en ce qu’ils participent à vider la philosophie de son contenu « politique », c’est-à-dire à abandonner la question du bien et du juste, ou encore la question du régime politique le meilleur. Pour Leo Strauss, parler de modernité revient à parler de rupture, de scission avec la pensée prémoderne, c’est-à-dire la philosophie antique et médiévale. Au contraire, la pensée d’Eric Voegelin se situe sur un schéma continuiste et la modernité est caractérisée selon lui par son gnosticisme, plus précisément dans la dégradation de l’interprétation de l’eschaton chrétien, dont la période s’étend du haut Moyen-Âge à nos jours. Cette dégradation s’est intensifiée à la Renaissance et a atteint son point culminant dans le phénomène totalitaire. Hannah Arendt rejette à la fois la position de Strauss et celle de Voegelin. Selon elle, la modernité est habitée par un principe nouveau, et surtout par la conscience de cette nouveauté (conscience que reconnaissent également Strauss et Blumenberg). Cette conscience fut notamment présente chez Machiavel et Rousseau. Bien que l’analyse de ces deux philosophes politiques par Strauss, Voegelin et Arendt puisse diverger, ils mettent en avant le changement de la nature humaine,
par la redéfinition de la vertu, mais, plus généralement, par l’influence qu’opère le projet moderne sur la nature de l’homme : la maîtrise de la nature. À ce sujet, ils critiquent l’hégémonie de la science moderne sur les sciences humaines – en particulier sur la science politique –, l’aveuglement causé par le progrès technologique, la relativisation des valeurs et l’historicisme qui nuisent à la capacité de juger et éloignent l’homme de la ratio.
En conclusion, Sylvie Courtine-Denamy expose la pensée de chacun des trois auteurs sur la possibilité de faire revivre la « bonne société ». Il ne s’agit pas d’effectuer un « retour en arrière », mais plutôt de faire revivre l’idée de bien en retrouvant le chemin de la raison véritable tout en l’accommodant aux spécificités de l’âge de la technique et de la société libérale. Aucun des auteurs ne rejette la modernité, il est cependant nécessaire de l’aménager pour ne pas sombrer dans une modernité « effrénée ». Cela passe par une restauration de la vie de la raison, au sens de la ratio des classiques, en tant que pensée méditante à l’inverse de la pensée moderne « mécaniste » ou « activiste ». Il ne semble pas y avoir de solution à la crise politique que nous rencontrons si ce n’est la pensée méditante. Une telle pensée se retrouve néanmoins confrontée à au moins deux obstacles : premièrement, l’activité philosophique que loue Strauss, Voegelin et Arendt est le fruit d’une minorité (aristocratie) difficilement compatible avec l’égalité prônée par nos démocraties ; deuxièmement, elle impliquerait une transformation de la nature humaine, corrompue depuis la modernité par la volonté de puissance et le désir de certitude qui louent des solutions concrètes et une pensée « mathématique » plutôt que la méditation.
Le lecteur se retrouve donc coincé, tiraillé, entre les thèses séduisantes de Strauss, Voegelin et Arendt et le caractère insoluble du conflit entre foi et raison. Sylvie Courtine ne nous indique aucune porte de sortie, ni même une préférence entre ces trois philosophes, elle insiste sur les forces et les faiblesses des thèses de chaque auteur. Par delà, elle souligne volontiers le propre tiraillement qu’éprouvent ces philosophes, tel que Strauss face à l’impossibilité de penser un judaïsme séculier, ou encore Voegelin face à l’impasse qu’implique le tournant séculier de la philosophie moderne. Bien que tous les trois voient dans le common sense anglo-saxon une possibilité pour préserver l’ordre juste dans la crise moderne de l’ordre, aucun n’indique cette voie comme la solution
ultime. Pour Voegelin, le common sense est caractérisé par sa compacité noétique alors que nos sociétés requièrent une noesis différenciée pour se redresser. Chez Arendt, c’est la question du sens qui doit demeurer vivante, alors que Strauss, dans une posture moins religieuse que Voegelin, insiste sur la pensée méditante.
C’est donc la philosophie qui semble triompher dans De la bonne société, mais le choix de confronter Leo Strauss, Eric Voegelin et Hannah Arendt met aussi en avant l’élément religieux. Bien qu’Arendt ne croie pas en un retour au religieux, l’intérêt qu’y portent Strauss et Voegelin nous pousse à considérer, ou reconsidérer, le rapport du religieux au politique dans un monde menacé par tous les fondamentalismes.
Pierre-Alain Drien
Université Lyon III – IRPhiL
1 Terme lui-même ambigu puisque toujours rejeté par Leo Strauss lui préférant « tyrannie contemporaine ».