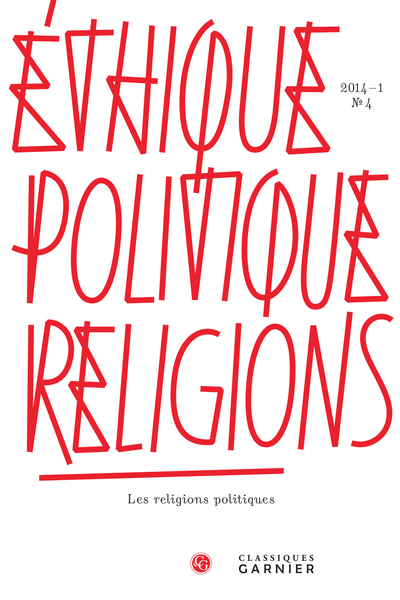
Religions politiques, religions séculières Le totalitarisme est-il un phénomène religieux ?
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Éthique, politique, religions
2014 – 1, n° 4. Les religions politiques - Auteur : Lara (Philippe de)
- Résumé : Les aspects religieux de l’idéologie nazie sont tout à la fois empiriquement évidents et déroutants sur le plan théorique. Quelles sont les alternatives significatives dans le cadre des interprétations religieuses du totalitarisme ? À quelles conditions les concepts de « religion séculière » ou de « sacralisation de la politique » peuvent-ils être utiles à la compréhension historique ? Tels sont les points explorés ici à travers les œuvres de Léon Poliakov, Emilio Gentile et Marcel Gauchet.
- Pages : 85 à 98
- Revue : Éthique, politique, religions
- Thème CLIL : 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN : 9782812429392
- ISBN : 978-2-8124-2939-2
- ISSN : 2271-7234
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-2939-2.p.0085
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 07/07/2014
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Religions politiques,
religions séculières
Le totalitarisme est-il un phénomène religieux ?
Les totalitarismes sont-ils des religions, des phénomènes religieux ? On sait qu’il s’agit d’une question embrouillée : les définitions varient en même temps des deux côtés de l’équation, plusieurs débats se mélangent, qui donnent souvent le sentiment vertigineux et frustrant qu’au moment de toucher du doigt un élément décisif pour la compréhension des totalitarismes, il ne reste plus entre nos mains que des querelles de mots sans substance, une poulie qui tourne à vide comme disait Wittgenstein – et il me semble que tel est le cas avec la discussion sur religion ou idéologie entre Arendt, Voegelin et Jules Monnerot, ou avec celle, plus récente, sur la transcendance ou l’immanence de l’idéologie nazie entre Ernst Nolte et George Mosse. Que nous apportent, que nous disent les différentes manières de penser les (putatives) religions politiques ou séculières ? Je voudrais dégager des distinctions qui font une différence, en les mesurant notamment au problème redoutable entre tous de la signification de l’antisémitisme absolu nazi. L’expression « antisémitisme absolu » vise à marquer la singularité radicale de l’antisémitisme éliminationniste nazi, tout en laissant ouverte la détermination de cette singularité.
Brièvement et formellement, on peut disposer les unes par rapport aux autres les interprétations religieuses du totalitarisme selon deux grands contrastes : 1 / sacralisation ou sécularisation, autrement dit point de vue de l’historiographie, ou point de vue de la philosophie de l’histoire ; 2 / religion ou sorcellerie (magie).
Une présentations exhaustive des théories des religions politiques/séculières dépasse le cadre de cette étude. On tirera grand profit du tableau dressé par Emilio Gentile dans son « Critical Survey » de 2005
des théories des religions politiques1 (néopaganisme, hérésie immanentiste, sacralisation). Je partirai d’un florilège tiré des discours de Hitler qui illustre le caractère à la fois irrécusable, massif, de la religiosité totalitaire, et son ambivalence foncière, n’imitant la religion que pour lui substituer le règne de l’idéologie. J’évoquerai ensuite les théories non religieuses du totalitarisme, avant d’examiner trois œuvres, celles de Léon Poliakov, d’Emilio Gentile, et de Marcel Gauchet, qu’on peut qualifier d’interprétations religieuses du totalitarisme mais suivant des concepts très différents de religion.
Hitler prédicateur et sauveur
Le style chrétien fréquemment emprunté par Hitler dans ses discours est troublant : en effet, il y superpose l’immanentisme radical (la volonté, le peuple-race en action) et la transcendance du Dieu-race (le nazisme est la religion d’« un Dieu indiscernable du destin et du sang », suivant une formule admirable de Rauschning) ; la mystique du sacrifice ; l’imitation de la religion chrétienne (mais pas de l’antijudaïsme chrétien !), érigeant le Führer en Sauveur et l’entreprise nazie en Rédemption, et, puisque rien ne ressemble plus à un torpilleur qu’un contre torpilleur, la dimension anti religieuse de ces mêmes discours, destinés en réalité à substituer la « croyance » nazie au christianisme2. Le discours nazi joue sur les connotations diverses de « croyant en Dieu », gottglaubig à l’époque : au sens des églises chrétiennes, du « christianisme allemand » (c’est-à-dire du protestantisme pro nazi), et du « Mouvement de la foi allemande », qui est la branche ouvertement antichrétienne de l’idéologie nazie. Pas de proclamation anti juive dans ces extraits mais la texture religieuse qui fournit son registre et son intensité à l’antisémitisme absolu (« en me débarrassant des Juifs, j’œuvre pour les fins du seigneur ») et à la guerre d’anéantissement à l’Est. Voici, avec de brefs commentaires :
Vous êtes en moi et je suis en vous […] Camarades ! Nous marchons vers des temps difficiles ! Notre vie tout entière ne sera rien d’autre qu’un combat ! Vous êtes nés de ce combat ! N’espérez pas la paix pour demain ou après-demain ! (discours à Kiel devant 45000 SA, 7 mai 1933.)
Le style christique habille la figure du « pouvoir peuple » (une expression de Marcel Gauchet), la fusion totale du chef et de la communauté au-delà de toute représentation.
Ce n’est pas un hasard si les religions sont plus stables que les États : elles enfoncent ordinairement leur racine plus profondément dans la terre […]. Je sais que nos intellectuels sont souvent possédés de l’orgueilleuse ambition de mesurer ce peuple d’après les critères de leur science et de leur prétendu entendement. Et cependant, il s’agit ici de choses que souvent l’entendement ne voit pas parce qu’il est incapable de les voir (10 mai 1933).
À rapprocher de la formule de Saint Paul : « Je détruirai la sagesse des sages et j’anéantirai l’intelligence des intelligents » (Corinthiens, I, 19). Hitler cherche une connivence avec l’anti-intellectualisme de l’Église antimoderne, mais aussi avec le mysticisme de l’émotion et du sacrifice.
Le ciel peut en être témoin : la faute de notre peuple est éteinte, le blasphème est expié, la honte écartée (2 septembre 1933).
Ma volonté est votre foi. Tel doit être votre credo ! Ma foi est, pour moi, tout comme pour vous, tout ce qui existe sur terre ! Cependant la chose la plus grande que Dieu m’ait donnée ici-bas, c’est mon peuple. C’est en lui que réside toute ma foi (1er mai 1935).
Ces formules marquent le retournement de la transcendance religieuse dans l’immanence. Le peuple, en devenir, est rapatriement dans l’ici-bas des fins ultimes mais aussi transfiguration du salut terrestre en salut tout court : éternité du peuple-race, hors de l’histoire et donc immortel. Voici trois exemples de religiosisation du discours nazi, suggérant l’identification de Hitler avec le Christ :
Le parti continuera à vivre même quand je ne serai plus là (16 septembre 1935).
Je ne me soumets pas à ce monde, car il ne peut me juger […]. Ce n’est qu’à toi que je me soumets, ô mon peuple allemand ! Juge-moi ! (Meeting électoral, Essen, 27 mars 1936).
Malheur à celui qui ne croit pas. Celui-là pèche contre le sens de la vie tout entière […] C’est le miracle de la foi qui a sauvé l’Allemagne (Congrès du parti, septembre 1936).
Les deux extraits suivants illustrent le glissement du terrain du pseudo-christianisme à celui de l’idéologie en action : ce sont deux formulations voisines de la transcendance de l’immanence de la race, mais la première a un accent plus chrétien, la seconde plus ouvertement totalitaire : la volonté de Dieu, c’est nous qui l’accomplissons par notre seule volonté.
Nous autres nationaux-socialistes, si l’on fait abstraction de notre Dieu dans le ciel, croyons d’abord à notre peuple allemand. Dans nos actes, nous obéissons à la volonté du Tout-Puissant […]. Si la Providence ne nous avait pas guidés, je n’aurais pas trouvé le bon chemin, si souvent difficile à distinguer […] Aussi sommes-nous croyants, nous nationaux-socialistes (Würzburg, 1937).
Ceux qui partagent la croyance en la race ont le devoir sacré, chacun dans la position où il est, de comprendre que la volonté de Dieu, on ne fait pas qu’en parler superficiellement et sans fin, mais qu’on la fait (date non déterminée).
Enfin dans ces extraits de discours électoraux en Autriche, au lendemain de l’Anschluss, la parodie de christianisme est ici évidemment opportuniste, s’adressant aux électeurs autrichiens mais, même comme propagande, encore faut-il qu’elle ait un minimum de sens, de crédibilité. Cette contre religion n’est pas charlatanesque : griserie, hauteur religieuse, langage évangélique, communiel, sacrificiel. On notera la sûreté avec laquelle Hitler parodie les Évangiles en prenant la place du Sauveur, mais ne cite pas l’antijudaïsme chrétien :
Dans les frères qui sont venus à son secours, ce peuple voit les hommes qui le sauvent d’un abîme de détresse.
Au commencement était le peuple, et ensuite seulement vint le Reich.
Puisse demain chaque Allemand reconnaître l’heure qui sonne, prendre conscience de lui-même et s’incliner en toute humilité devant la volonté du Tout-Puissant qui, en quelques semaines, a accompli pour nous des miracles.
Interprétations non religieuses
Rappeler les interprétations non religieuses des totalitarismes permet de préciser le périmètre des théories des religions politiques ou séculières : par « interprétation non religieuse » je vise les théories du nihilisme (Rauschning), de l’idéologie (Arendt3), de l’interprétation esthétique de Mosse qui insiste sur la mise en scène, la morphologie de la ferveur. Chez Mosse, la religion figure encore mais comme analogie plutôt que comme concept. On a enfin l’interprétation instrumentale ou, comme le dit Emilio Gentile, « charlatanesque », selon laquelle les nazis ne croyaient pas à leurs mythes, même quand ils leurs donnaient une allure religieuse (notamment pour séduire des auditoires chrétiens). Dans « l’organisation de l’enthousiasme », il faut comprendre ici que l’enthousiasme est entièrement fabriqué par le pouvoir. Du coup l’ambivalence géniale de cette formule d’Elie Halévy en 1936 est perdue. Raymond Aron était, il me semble, tenté par cette interprétation charlatanesque, mais il a été retenu de l’adopter par l’intensité mystique de l’adhésion totalitaire, dont il avait été le témoin direct, d’où son recours à une version sobre de la théorie de la sécularisation : « Je propose d’appeler religions séculières les doctrines qui prennent dans les âmes de nos contemporains la place de la foi évanouie et situent ici-bas […] le salut de l’humanité4. » Le mot clé est ici « âmes », au pluriel et non au singulier distributif, qui aurait pu suffire : c’est qu’il s’agit de chaque âme, une par une pour ainsi dire. Un tel mot situe la substitution sur le terrain de l’expérience personnelle, de sorte que ce n’est pas une thèse de philosophie de l’histoire sur la sécularisation, comme chez Voegelin, mais une description, tout au plus rattachable à une théorie à la Rudolf Otto de l’universalité d’un certain type d’expérience du Très haut (du numineux). Les religions séculières sont le substitut de la foi et de l’autorité dans un monde désenchanté et bureaucratique. Aron reprend le thème wébérien de la force du charisme face à la pesanteur du pouvoir anonyme. L’homme moderne, « prisonnier[s] d’un métier
monotone, perdu[s] dans la multitude des villes », trouve dans le Parti « une communauté spirituelle ». Comprises en ce sens, les religions séculières ne sont pas des religions.
Le sacré et le diable selon Poliakov
En revanche, Poliakov dans ses premiers travaux affirmait nettement le caractère religieux du nazisme. Dans les premières pages du Bréviaire de la haine (1951)5, il fait une distinction suggestive au sein des politiques antijuives des nazis entre les mesures « profanes », comme les exclusions professionnelles, les spoliations, l’intimidation et les brutalités, mises en œuvre dès 1933, et les « mesures sacrales » inaugurées par la loi du 15 septembre 1935 (la 1re des « lois de Nuremberg ») pour la protection du sang allemand et de l’honneur allemand, interdisant le mariage et les relations sexuelles entre Juifs et Aryens. C’est cette séparation sacrale qui rendit possible, selon Poliakov, le passage à l’extermination, que ne préparaient pas encore les persécutions profanes. Le sens théorique, sociologique de « sacré » dans ce contexte est confirmé par une citation de Durkheim, « l’influence dynamogénique qu’elle [la religion] exerce sur les consciences6 ». Le nazisme est une religion en vertu des traits suivants : (1) pouvoir supérieur de l’âme raciale, à la fois « immanente » et « supérieure » ; (2) soumission absolue au Führer qui est l’émanation et l’interprète du Volk, du Dieu-race ; (3) constitution du Volk (« en devenir », im Werden) en Église, (4) diabolisation des Juifs, « car pour cette religion, il fallait de toute nécessité un Diable » (p. 6). L’impureté du Juif est l’attestation, la concrétisation de la pureté de
la race. Suivant la définition durkheimienne, la religion se signale par l’union d’une communauté autour et par des valeurs ultimes, qui ne sont pas seulement des croyances au sens intellectuel du terme, mais une organisation sociale (une « Église ») et une source d’énergie morale (« dynamogénique »). Elle consiste dans la séparation des « choses sacrées ». Les lois de Nuremberg sont des lois sacrales en tant qu’elles séparent et protègent les choses sacrées. Avec elles, la persécution change de dimension, elle passe du registre ordinaire, « profane » de la discrimination (boycott des magasins, interdictions professionnelles, etc.) au registre de la séparation du pur et de l’impur, avec l’interdiction du mariage et des relations sexuelles entre Juifs et Aryens et les autres interdictions de contact qui vont se multiplier à partir de 1935. Elles instaurent une religion de la race. Poliakov cite Robert Kanters, impeccable et précoce durkheimien, qui écrivait dans un Essai sur l’avenir de la religion publié en 19457 : « la division du monde en sacré et profane est présente à chaque instant dans la mémoire d’un Allemand : il vit presque continuellement dans une atmosphère religieuse […] Ce trait [le tabou du contact avec les Juifs dans tous les domaines] marque d’une façon éclatante le contraste entre le monde de la tiédeur et une vie pénétrée par la foi ».
Mais il y a aussi dans le signalement de la religion nazie par Poliakov un élément qui ne cadre pas avec la théorie durkheimienne du sacré et qui prendra une importance croissante dans son œuvre ultérieure, la diabolisation. L’analyse de Poliakov va combiner, si je puis dire, haine sacrale et haine démonologique des Juifs, en donnant un poids relatif croissant à cette dernière au fil de son œuvre8. Le point clé est que la diabolisation de la « contre-race » juive n’est pas le corrélat de la sacralisation de la race mais un phénomène sui generis. Dans sa réflexion sur l’antisémitisme nazi, Poliakov arrivait au fond, en se gardant bien sûr de toute systématisation, à une sorte de synthèse entre deux conceptions : la thèse de la religion nazie, la sacralisation de l’antisémitisme étant une condition de l’extermination, et la thèse d’un phénomène tenant de la sorcellerie plutôt que de la religion, une régression pré-religieuse,
irrationnelle, relevant de la pensée magique du complot, de forces malfaisantes invisibles mais omniprésentes (ce qu’il appellera la causalité diabolique). Poliakov abandonne alors le vocabulaire de Durkheim et, avec sa sûreté coutumière, il s’appuie sur un durkheimien du deuxième cercle, Lévy-Bruhl, qui s’était justement éloigné de Durkheim avec sa théorie de la « mentalité mystique », caractérisée par l’imbrication du naturel et du surnaturel, du visible et de l’invisible, à l’opposé de la séparation sacré-profane caractéristique du fait religieux. En résumé, pour Poliakov en 1951, l’antisémitisme sacral (phobie de la souillure) commande l’antisémitisme démonologique (terreur du complot), les lois de Nuremberg commandent l’accréditation des Protocoles des Sages de Sion, alors que trente ans plus tard, Lévy-Bruhl l’emporte sur Durkheim, l’interprétation magico-mythique sur l’interprétation religieuse de l’antisémitisme absolu.
Le parcours de Poliakov est donc pour ainsi dire la récapitulation des alternatives fondamentales dans la compréhension des religions totalitaires.
Sacralisation et apocalypse
Emilio Gentile a sa place dans cette discussion, bien qu’il n’ait pas écrit directement sur le nazisme parce que son œuvre sur le fascisme et sur l’apocalypse de la modernité9 a une portée théorique générale. Même s’il emprunte à d’autres sources (notamment les vues anthropologiques de Croce sur le besoin de religion – « personne ne veut vivre malheureux ») Gentile m’apparaît pour le principal comme un durkheimien. Il est toutefois un durkheimien averti des simplifications et malentendus auxquels la théorie de la religion de Durkheim peut conduire : a – la tautologie fonctionnaliste (toute chose est ce à quoi elle sert, la cohésion sociale sert à entretenir la cohésion sociale), immortalisée par la chaussure de Hannah Arendt10 ; b – la version de Georges Bataille de la
théorie du sacré, défini comme « le mouvement communiel des sociétés », c’est-à-dire un sentiment flottant qui peut prendre toutes sortes de formes et investir toutes sortes d’objets. Cette théorie incontrôlable est au fond une variante du grand récit de la sécularisation, c’est-à-dire du sacré moderne comme transfert de sacralité consécutif au retrait du religieux. Le point de Durkheim est de prendre au sérieux le religieux aussi bien sous l’aspect de l’institution (de l’Église) que sous celui de l’expérience vécue, et non pas d’en faire une simple étiquette pour des choses aussi vagues que le « mouvement communiel » des sociétés cher à Bataille.
La méthode de Gentile est d’abord une réaction à la négation du phénomène des religions politiques, avant tout à sa réduction au charlatanisme. D’où son travail imposant au plan descriptif : le phénomène est irrécusable, ses manifestations impossibles à considérer sans y reconnaître un phénomène sui generis. Mais c’est aussi une réaction contre la philosophie de l’histoire explicite ou implicite dans les discours de la sécularisation, que ce soit sous sa forme chrétienne, sous la forme de la sociologie sommaire du transfert de sacralité, que professent Bataille et ses amis du Collège de sociologie, ou enfin sous la forme de la théorie de « l’immanentisme » (selon la définition du fascisme chez Nolte), toutes théories qui sont en fait des variantes du même récit de la sécularisation (des dommages collatéraux de la sécularisation). Et il aurait sans doute peu de sympathie pour la théorie de la « sortie de la religion » de Marcel Gauchet qui, tout en refusant le schème de la sécularisation, inscrit l’âge des totalitarismes dans une philosophie de l’histoire. La sacralisation de la politique est pour Gentile un phénomène sui generis (la théorie du transfert de sacralité n’explique rien), que l’historien doit s’attacher à décrire et à expliquer, mais dans des catégories anthropologiques, sociologiques et non théologiques, ce que font ultimement les philosophies de l’histoire. Sous l’apparence d’un concept éclectique (puisqu’il combine un certain fonctionnalisme avec une phénoménologie de l’expérience du sacré), la « sacralisation de la politique » selon Gentile fournit une théorie rigoureuse de la religiosité obligée des totalitarismes, elle-même un moment et une figure extrême du
phénomène plus large que Gentile appelle l’apocalypse de la modernité. C’est un fait historique, qu’il faut d’abord décrire avant d’en préempter l’explication. Parmi les différentes définitions de la sacralisation de la politique, on retiendra particulièrement celle-ci :
Un processus qui appartient à la société moderne, par lequel la dimension politique, après avoir acquis son autonomie par rapport aux religions traditionnelles et métaphysiques, acquiert un caractère religieux propre, devenant la source de nouveaux systèmes de croyances, de mythes et de rites, prenant ainsi les traits et les fonctions propre à la religion, de sorte qu’elle constitue une interprétation du sens et de la finalité de l’existence humaine11.
Emilio Gentile cultive les définitions longues, qui empêchent la théorisation historique de céder au démon de la philosophie de l’histoire, à savoir la téléologie, pour ne pas dire la théo-téléologie. La fécondité de cette méthode est immense, non seulement sur le plan positif, la description du réseau des faits et des chaînes causales, mais aussi en termes de clarification conceptuelle, et il faut s’attendre que l’enquête sur cette « apocalypse de la modernité », commencée avec le livre éponyme, sous titré « la grande guerre et l’homme nouveau » rapportera autant que celle sur la trajectoire fasciste.
Gentile a ainsi mis au jour le passage de la simple conscience historique à la conscience régénérative ou, plutôt, la dimension palingénésique endémique de la conscience historique des modernes. On peut styliser cette trajectoire ainsi : c’est un produit de l’universalité de la nation. L’universalisation des nationalismes est une tendance inhérente à l’idée même de nation, de sorte que le monde des nations n’est ni français, ni herderien, il est plutôt hobbesien : la nation n’est ni soluble dans l’universel abstrait, à la française, ni singularité paisible au milieu des autres nations comme chez Herder. Les nations sont égales certes, mais chacune aspire à être plus égale que les autres, à offrir la meilleure synthèse. De sorte qu’il y a une surenchère dans la conquête de la modernité. C’est pourquoi ce sont les nations les plus tardives à divers titres qui ont suivi un cours paroxystiques.
Si je puis dire, l’entreprise revient à donner un sens aux concepts de révélation, de régénération, d’eschatologie dans l’histoire de la modernité, sans endosser une théologie et une philosophie de l’histoire, ce qui n’est
pas facile (il ne suffit pas de faire une soustraction !). Elle a amplement prouvé son gain en intelligibilité. Mais le démon de la philosophie de l’histoire ne peut-il pas être bienfaisant à l’occasion ?
« On n’échappe pas à la philosophie de l’histoire »
Tout le travail de Marcel Gauchet repose sur l’idée qu’on n’échappe pas à la philosophie de l’histoire (titre d’un bel article publié en 199112). Cela en fait un historien déroutant pour les historiens. Mais historien tout de même en même temps que philosophe. Il est intéressant pour notre propos à deux titres : un concept original de religion séculière, une interprétation originale de l’antisémitisme absolu nazi. Voyons cela.
Marcel Gauchet opère avec un concept de religion séculière littéral (ni ersatz, ni formation charlatanesque), définie comme la « réinvention de la forme religieuse par des moyens séculiers », « contre religion religieuse ». « Le sens ultime des entreprises totalitaires réside dans le dessein de reconstituer les rouages de l’unité religieuse de l’intérieur et à partir de la modernité individualiste, égalitaire, représentative, futuriste13. » La figure inédite du leader totalitaire est un rouage clé de l’opération : il s’agit de « ressusciter à partir du plébiscite des masses la personnification du pouvoir qui tenait du mandat du ciel » (ibid.) : les ingrédients à première vue terrestres, parti unique, politique totale, Egocrate, impérialisation, contiennent une religiosité fondamentale latente. « Derrière cette image révolutionnaire de la pleine entrée en possession de soi, se dissimule l’insistance de la dépossession religieuse ». La transcendance religieuse est l’inconscient du triomphe de la volonté (de l’immanence). Rien à voir dans ce cas également avec le modèle à tout faire du transfert de sacralité. Gauchet reprend ou retrouve Gentile sur le rôle matriciel de la Grande guerre comme « expérience sacrificielle ».
« Je n’aurais jamais imaginé, écrit Robert Hertz en 1914, à quel point la guerre, même cette guerre moderne tout industrielle et savante,
est pleine de religion. » (cité par Gauchet p. 33) Expérience inédite en ce qu’elle est une « expérience mystique profane » (op. cit., p. 41), qui fait coïncider la souveraineté de l’individu et la contrainte absolue de l’appartenance, et fait du don anonyme de soi l’expression suprême de la possession de soi. Pour Gauchet, bien plus que la brutalisation des sociétés, c’est cette figure du sacrifice, d’une volonté individuelle qui s’abolit elle-même, qui engendre un type d’acteur historique inédit, auquel « l’âge totalitaire donnera un emploi » (p. 47). Nous ne sommes pas loin de la fabrique de l’homme nouveau telle que Gentile est en train d’en faire l’histoire. L’analyse montre que l’homme nouveau répond à une attente autant qu’à la volonté démesurée des mouvements totalitaires.
Le propre des religions séculières est de s’épuiser rapidement du fait de l’obligation de se réinventer sans cesse pour « fabriquer du sacré avec du profane », « susciter un climat mystique hors religion ». Le totalitarisme est contraint de « produire lui-même la surréalité qui le justifie » (p. 414) (« le fascisme vit d’exaltation, et l’exaltation, c’est moi ! », disait Mussolini, inventeur du culte de la personnalité). La surenchère n’est pas un trait circonstanciel mais de structure. Emilio Gentile l’a démontré dans le cas du fascisme, avec la marche sans répit du régime vers l’impérialisation et la guerre, qui le mènera à sa perte mais qui seule le maintenait debout.
L’antisémitisme est selon Gauchet « une religion séculière à lui tout seul » : ce n’est pas le racialisme, ni l’eugénisme, ni la philosophie de la lutte pour la vie qui font du nazisme une religion, c’est l’antisémitisme, un antisémitisme en rupture avec ses devanciers car il « travaille avec un matériau symbolique et selon une démarche mythique », c’est-à-dire au-delà de toute théorie biologique ou historique. Religion séculière car « l’antisémitisme (…) est inséparable du projet de reconstruire l’ancien monde de l’intérieur et sur la base du nouveau » (p. 224). Avant-garde de la modernité dissolvante (l’argent), mais au service du renforcement d’une identité et d’une communauté traditionnelle, le Juif est le « double maléfique » du patriote allemand, « l’image de la réussite dans une tâche où l’on craint soi-même d’échouer » (p. 224), La contre race (métissée, invisible, dissolvante) est en réalité la race par excellence : la race comme volonté de race. Ce schéma est très éclairant, mais il n’explique pas encore comment le double maléfique devient ennemi radical, à extirper.
Saul Friedlander a eu une intuition approchante avec le concept d’antisémitisme rédempteur, mais il s’agissait pour lui d’une des filiations de l’antisémitisme nazi, celle qui va de Wagner à Hitler via Chamberlain et, loin d’en faire un paradigme exclusif, il y voit une des composantes parmi d’autres de l’antisémitisme absolu des nazis. Gauchet va plus loin dans la compréhension du passage à l’acte, du discours éliminationiste à la pratique de l’extermination, mais moyennant une seconde étape de l’explication de la religion nazie qui me semble sortir des limites de la religion séculière pour rejoindre le modèle de la sorcellerie. La force mobilisatrice de l’antisémitisme n’est pas de l’ordre de la sacralisation (de la race) mais de la mythologie. La figure du Juif « résume en langage symbolique le flottement identitaire du pays entre deux logiques » (particularité et universalité), non pas toutefois sous la forme encore rationnelle du but sacré, comme dans le grand récit de l’histoire de l’ascension de la germanité chez Chamberlain, mais comme une immense angoisse, convertie en un discours de combat apocalyptique. On songe ici à l’analyse de la mentalité mystique chez Lévy-Bruhl, qui en soulignait la dimension « affective ». Il aimait à citer un shaman eskimo qui, interrogé sur les croyances de son groupe, déclarait : « Nous ne croyons pas, nous avons peur ».
Le tournant exterminateur coïncide avec la guerre à l’Est (c’est le noyau rationnel de l’historiographie fonctionnaliste14). La Shoah commence avec le Komissarbefehl et se déchaîne dès le début de l’opération Barbarossa (juin 1941) et s’amplifie avec la perspective de la défaite. Au plan du noyau mythique et symbolique, antisémitisme et impérialisation deviennent alors une seule et même chose, l’impérialisme répondant à la « menace suprême ».
La « projection dans le réel de l’antisémitisme mythique » (si on les tue tous, on va gagner), si elle est irréductible à un processus fonctionnel, n’est pas non plus à proprement parler intentionnelle. « Le mythe antisémite, qui permettait de se définir par la négative sur une autre scène moyennant l’élection d’un double maléfique, s’est transmué, sous la pression de cette lutte finale pour l’existence ou la disparition, en foi
délirante dans le pouvoir du meurtre réel. Il n’y a plus que la disparition du double qui puisse promettre sa propre survie. Le symbole s’est littéralisé. » (p. 508). Cette mythologisation de l’idéologie excède ce que la sacralisation implique encore de rationalité – par le lien rationnel entre les fins ultimes et l’action collective, et la structuration du monde en choses sacrées et choses profanes – pour tomber dans une sorte de pensée magique. Gauchet parle de « sorcellerie meurtrière ». Ce basculement ne peut être réduit à une réaction circonstancielle ou à un enchaînement (« radicalisation cumulative » chère à Hans Mommsen et à l’école fonctionnaliste), parce que cette dimension mythologique, quasi magique est présent dès le début dans le discours idéologique nazi.
La théorie de la sacralisation de la politique et celle de la théorie de la religion séculière comme anti-religion religieuse ont, avec leurs points de convergence nombreux et leur divergence enrichi la compréhension des totalitarismes. La philosophie de l’histoire apparaît comme un cadre encombrant mais dont il n’est pas évident de se passer complètement. Le nazisme impose une autre dimension enfin, celle du court-circuit entre le mythe et l’idéologie. Poliakov l’avait entrevu de façon intuitive, en s’abstenant de pousser la théorisation explicite trop loin. Gentile et Gauchet nous offrent deux promesses autrement charpentées de compréhension de la trajectoire moderne.
Philippe de Lara
Institut Michel Villey
(Université Panthéon-Assas)
1 E. Gentile, « Political Religions : A Concept and its Critics – A Critical Survey », Totalitarian Movements and Political Religions, vol. 6, no 1, June 2005.
2 Voir P. Thibaud, « Le contre catholicisme d’Adolf Hitler », dans Philippe de Lara (éd.), Naissances du totalitarisme, Paris, Cerf, 2011.
3 Elle feraillera avec Voegelin et avec Jules Monnerot contre leur thèse du caractère religieux de l’idéologie totalitaire.
4 R. Aron, L’Âge des empires et l’avenir de la France, 1940.
5 L. Poliakov, Le Bréviaire de la haine (1951), Bruxelles, Complexe, 1985.
6 Cette citation est très remarquable car elle est extraite non pas des Formes élémentaires de la vie religieuse (1912) mais d’une conférence de Durkheim en 1914 qu’on ne pouvait trouver à l’époque que dans un ouvrage collectif édité en 1919 par l’Union de Libres penseurs et de Libres croyants pour la Culture morale (il sera réédité par Jean-Claude Filloux en 1970). Cela prouve une grande familiarité de Poliakov avec l’école française de sociologie : un exemple typique de son style unique d’historien intuitif mais utilisateur discret et savant de ressources conceptuelles tirées de la philosophie et des sciences humaines.
7 R. Kanters (1910-1985) deviendra un critique littéraire influent.
8 L. Poliakov, La Causalité diabolique. Essai sur l’origine des persécutions (2 vol., 1980-1985), réédité en un volume avec une préface de Pierre-André Taguieff, Paris, Calmann-Lévy, 2006.
9 E. Gentile, L’apocalisse della modernita. La Grande guerra per l’uomo nuovo, Mondadori, 2008 / L’Apocalypse de la modernité, trad. S. Lanfranchi, Paris, Aubier, 2011.
10 « Et même si, dans certaines circonstances particulières, il devait arriver que deux choses singulières jouent le même “rôle fonctionnel”, je ne les tiendrais pas davantage pour identiques que je ne crois que le talon de ma chaussure est un marteau lorsque je l’utilise pour enfoncer un clou dans le mur. » (H. Arendt, « Lettre à l’éditeur de Confluence en réponse à Jules Monnerot » (1954), traduit par Jacques Dewitte, Revue du Mauss, no 22, 2003).
11 TMPR, op. cit., p. 29.
12 Repris dans M. Gauchet, La Condition politique, Paris, Gallimard, 2005.
13 M. Gauchet, À l’épreuve des totalitarismes, Paris, Gallimard, 2010 (vol. 3 de L’avènement de la démocratie), p. 545.
14 C’est l’un des mérites du grand livre de Timothy Snyder, Terres de sang (Gallimard, 2012) que d’avoir fait droit et aux circonstances locales et à l’intention idéologique dans le déclenchement de la Shoah. Voir sur ce livre Philippe de Lara, « Deux empires pour un massacre », Revue historique, no 667, septembre 2013.