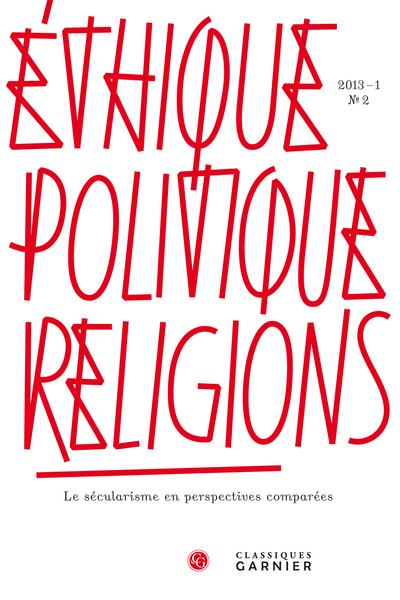
Recensions
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Éthique, politique, religions
2013 – 1, n° 2. Le sécularisme en perspectives comparées - Auteurs : Godefroy (Bruno), Desbiolles (Blondine)
- Pages : 185 à 198
- Revue : Éthique, politique, religions
- Thème CLIL : 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN : 9782812412004
- ISBN : 978-2-8124-1200-4
- ISSN : 2271-7234
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-1200-4.p.0185
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 03/07/2013
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Jacques Derrida, Séminaire « La peine de mort ». Volume I (1999-2000), Paris, éditions Galilée, 2012.
Ce volume intitulé Séminaire la peine de mort de Jacques Derrida est l’un des premiers publiés de la longue série d’ouvrages posthumes du philosophe dont la parution devrait s’étaler sur une quarantaine d’années, à savoir un ouvrage par an en moyenne. Cette entreprise éditoriale d’envergure permettra très certainement de donner une image encore plus précise de ce qu’aura été cette aventure intellectuelle appelée la déconstruction. Dans ce volume, le lecteur retrouve l’une des grandes interrogations de Derrida qui est celle de savoir ce qui fait le propre de l’homme par rapport à l’animal. La propriété humaine qui est ici déconstruite est la mort inscrite dans la question juridico-politique de la peine capitale. L’auteur met donc en œuvre une stratégie intellectuelle consistant à déconstruire la mort en en faisant une question inséparablement politique et éthique.
Apprendre à penser la mort en dehors de tout horizon est ce qui déstabilise le lecteur enfermé qu’il est dans un système de pensée qui fait de la mort l’horizon de tout horizon, plus encore, le calcul, à savoir l’attente qui oriente toute décision. La mort est le grand calcul de tout vivant et la déconstruction telle qu’elle est mise en œuvre dans ce volume est comme une invitation à refuser ce calcul lorsqu’il prend la forme extrême et exceptionnelle de la peine de mort en tant qu’économie fondatrice de toute vie. Derrida nous invite ici à déconstruire ce calcul, à l’obscurcir afin d’y introduire des contre-forces anéconomiques, lesquelles seraient à même de démonter la souveraineté de cette économie reposant sur la violence de la peine de mort. Autrement dit, c’est l’échafaudage sur lequel elle repose que l’auteur tente de déconstruire : « Par échafaudage, j’entends aussi bien la construction, l’architecture à déconstruire que la spéculation, le calcul, le marché, mais aussi l’idéalisme spéculatif qui en assure les étais […]. La déconstruction est peut-être toujours, ultimement, à travers la déconstruction du carno-phallogocentrisme, la déconstruction de cet échafaudage historique de la peine de mort » (p. 55). Le concept de carno-phallogocentrisme, dont la présence pourrait
étonner dans ce séminaire, fait signe vers l’idée d’un lien étroit entre peine de mort et sacrifice. Tuer l’autre, c’est vouloir le sacrifier. Mais le sacrifier à quoi et à qui ? Pour qui et pour quoi ?
Cette force pulsionnelle, qui nourrit en profondeur le carno-phallogocentrisme des institutions politiques, n’est pas une force comme les autres, elle excède toutes les autres, elle règne en souveraine au plus profond de notre inconscient politique et s’inscrit dans celui du pouvoir théologico-politique dont l’Etat souverain est la traduction ultime. Ce pouvoir souverain règne sur tous les vivants par la carnivoricité qui, pour Derrida, est sa raison d’être. Dit autrement, la peine de mort doit être comprise comme la conjonction de trois institutions politiques clés que sont la souveraineté théologico-politique, la carnivoricité et le sacrifice. La souveraineté s’avérant être la manifestation politique de ce pouvoir qui ne vit que de la carnivoricité sacrificielle et qui lui permet d’ingérer tant les vivants humains que non humains, tout en établissant cependant une distinction ontologique dont la limitrophie même est l’enjeu central de la peine de mort revisitée et déconstruite par Derrida. Ce qu’on pourrait appeler un cannibalisme symbolique au fondement de la souveraineté politique n’a, de plus, comme raison d’être que de se distinguer de l’animalité en tant que celle-ci est pensée comme étant toujours en dehors de la loi, hors la loi.
L’animalité étant pour le souverain ce qui ne peut se soumettre à aucune loi, la peine de mort instituée par ce dernier va se servir de cette croyance pour faire du condamné à mort le seul vivant capable de dignité et méritant par là même son inscription, par la mort, dans l’univers humain carno-logocentré. Ce sacrifice carno-phallogocentrique d’origine théologico-politique est l’opération par laquelle le condamné acquiert le statut d’être capable de s’élever au dessus de la vie, de toute vie animale : Il ya donc au fondement de la peine capitale « cette idée, nous dit Derrida, que la peine de mort est un signe de l’accès à la dignité de l’homme, un propre de l’homme qui doit savoir, dans son droit, s’élever au dessus de la vie (ce que ne sauraient faire les bêtes), cette idée de la peine de mort comme condition de la loi humaine et de la dignité humaine, on devrait presque dire de la noblesse de l’homme… » (p. 78). Cette thèse est partagée, est le propre, si l’on peut dire, de tous les défenseurs de la peine de mort, leur présupposé qui les conduit, en réalité, à l’idée que seul l’humain accède à la sphère de la moralité. Celle-ci n’existe donc
qu’en opposition avec celle de la supposée amoralité animale. Platon, Rousseau, Kant, Genet, Blanchot et bien d’autres dont les idées sont analysées en profondeur par Derrida dans l’ouvrage, partagent chacun à leur manière cette croyance morale.
C’est en ce sens que Derrida pense que la peine de mort est une invention humaniste au sens littéral du terme puisque là où il y a peine de mort, il y a volonté d’étendre la dignité humaine à tout homme, donc à l’humanité entière selon le paradoxe fondateur de tout humanisme digne de ce nom ! Mais inversement et symétriquement, là où il y a peine de mort, il y a aussi violation de cette même dignité sensée faire le propre de l’homme. La peine de mort ayant donc été aussi pensée comme la négation de cette propriété essentielle de l’humain consistant à s’extraire de l’animalité pour atteindre, car il s’agit toujours de configurer en permanence les limites de cette propriété, l’inviolabilité humaine, ce principe également humaniste par lequel l’humanité s’invente performativement son propre et à laquelle Hugo et Camus ont apporté leurs arguments abolitionnistes qui conduiront, par exemple, à son abolition en France en 1981.
Autrement dit, tous les humanismes, abolitionnistes ou pas, déconstruits ici par Derrida, reposent sur des conceptions philosophiques très proches marquées par la césure entre l’humain et le non humain : en effet, au premier est accordé le monde de la loi, du droit et de la morale, la peine de mort étant au fondement de l’entrée dans l’humanité et en humanité du vivant humain grâce au sacrifice qui fait loi et qui a donc force de loi ; au second est refusé son inclusion dans tout univers moral par le fait même d’exercer sur lui un tel pouvoir théologico-politique dans lequel et par lequel le sacrifice carnivore joue un rôle autre que celui qui régit ou gouverne l’univers humaniste de la loi. L’apport de Derrida est de montrer dans ce volume que ces deux formes de sacrifice sont en réalité les deux faces d’une même médaille en ce sens qu’elles contribuent inséparablement à l’invention de l’humain et du non humain et à la définition même de ce que l’Occident appelle le politique.
Déconstruction du paradoxe engagé par la peine de mort elle-même : son histoire est guidée par le désir permanent de s’humaniser dans et par la cruauté en se sens que toute humanisation de cette « machine » à produire de la mort vise à augmenter sa cruauté puisqu’il s’est toujours agi de rendre plus efficace le calcul de la mort programmée par
elle, donc soumise à un horizon d’attente où la souveraineté se mesure à son pouvoir de dire et de donner et le temps et la mort, à savoir le temps de la mort. Bien plutôt, nous avertit Derrida, d’enlever le temps, de « détemporaliser » l’existence du vivant à tuer. La souveraineté est donc le temps calculé dont la cruauté consiste à dénier la finitude du vivant au vivant lui-même. L’éthique derridienne passe donc ici par la déconstruction de toute souveraineté : « L’insulte, l’injure, l’injustice fondamentale faite à la vie en moi, au principe de vie en moi, ce n’est pas la mort même de ce point de vue, c’est plutôt l’interruption du principe d’indétermination, la fin imposée à l’ouverture de l’aléa incalculable qui fait qu’un vivant a rapport à ce qui vient, à l’à-venir et donc à de l’autre comme événement, comme hôte, comme arrivant. » (p. 120). La déconstruction se présente donc dans ce séminaire comme une philosophie reposant sur un carré chiasmatique puisque si politique et éthique sont inséparables pour juger la peine de mort, alors humanité et animalité ne peuvent être distingués pour comprendre la généalogie de la peine capitale déconstruite ici selon ces quatre points de vue au principe même de la philosophie dans son ensemble de Derrida comme philosophie du vivant soumis à la souveraineté zoopolitique dont les séminaires suivants en présenteront les principes de fonctionnement au-delà de cette peine de mort qui en est comme le symptôme tragique.
Patrick Llored
Université Lyon 3 – IRPhiL
Claus Heimes, Politik und Transzendenz. Ordnungsdenken bei Carl Schmitt und Eric Voegelin, Berlin, Duncker & Humblot, 2009.
L’ouvrage de Claus Heimes correspond à la publication d’une thèse acceptée au département de Sciences politiques de la Freie Universität de Berlin en 2007. Regroupant plusieurs travaux, l’auteur ne peut développer une structure argumentative véritablement linéaire, mais l’ensemble suit une perspective séduisante, la comparaison entre les œuvres de Carl Schmitt et Eric Voegelin en tant que conceptions de l’ordre politique ancrées dans un au-delà transcendant. Cependant, alors que l’auteur semble davantage familiarisé avec les concepts voegeliniens, son analyse comparative tend au cours du livre plus à reformuler ceux-ci sous une perspective fortement schmittéenne qu’à éclairer leur véritable sens.
Le premier chapitre de l’ouvrage, tenant lieu de préambule, est aussi celui qui touche au mieux le cœur de la problématique. Heimes rapproche les positions développées par Schmitt et par Voegelin dans ses écrits juridiques, c’est-à-dire avant 1938, sous l’angle de la critique du positivisme, principalement de la science pure du droit de Hans Kelsen. Schmitt comme Voegelin verraient la nécessité d’inclure dans la sphère juridique une sphère pré-positive, une sphère des « idées », plus particulièrement la question de l’existence de l’unité constitutive porteuse du droit, qu’il s’agisse de la « communauté » (Gemeinwesen) chez Schmitt ou de l’« unité de sens » (Sinneinheit) chez Voegelin (p. 24). À juste titre, Heimes souligne dans ce moment de la pensée de Voegelin un problème qui traverse son œuvre, contre l’idée d’une césure en 1936-1938 défendue par d’autres interprètes. L’« unité de sens » s’exprimant à travers des symboles de l’ordre, le droit se devrait d’inclure ces symboles dans sa sphère d’analyse, rejoignant ainsi la perspective développée dans les œuvres tardives. Cependant, la critique adressée à cette époque par Voegelin à Schmitt, pourtant sous-jacente dans leur correspondance que l’auteur n’évoque pas, n’est abordée que superficiellement, en renvoyant principalement à la compréhension différente que Voegelin et Schmitt auraient de leur rôle, l’un comme philosophe, l’autre comme juriste, et donc de leur action dans la sphère politique (voir aussi chap. 5). Voegelin réfute la trop forte dépendance des catégories utilisées par Schmitt, notamment « volonté », « unité », « puissance », vis-à-vis de son époque, son analyse ne pouvant de ce fait atteindre une vue plus large
et libérée de l’influence de son temps. Néanmoins, Heimes remarque à juste titre, mais brièvement, que le dernier ouvrage de Voegelin consacré au droit, L’État autoritaire, est précisément le plus schmittéen. Voegelin ne serait pas allé plus loin dans cette direction, se voyant confronté au même problème que celui qu’il diagnostiquait chez Schmitt, à savoir une liaison inévitable entre l’analyse théorique des idées et la situation politique concrète (p. 40) – une allusion au soutien apporté par Voegelin au régime autoritaire de Dollfuss.
Dans le deuxième moment de l’analyse, le chapitre consacré à la « sémantique de l’ordre » (Grammatik der Ordnung), Heimes repose la question du rapport entre Voegelin et Schmitt dans un cadre plus large, la question de la transcendance et de la révélation. Dans ce qui constitue le véritable cœur de l’ouvrage, Heimes propose tout d’abord une analyse de l’œuvre de Schmitt, s’appuyant principalement sur les travaux de Heinrich Meier – une perspective intéressante, mais qui n’est pas des plus critiques et mériterait une contrepartie. Dans le cadre de la problématique développée par Heimes, le fondement de l’ordre dans la transcendance, l’interprétation de l’œuvre schmittéenne comme « décisionnisme occasionaliste » proposée par Karl Löwith (Der okkasionelle Dezisionismus von C. Schmitt, 1935) représente le principal obstacle et occupe donc à juste titre une place centrale dans l’ouvrage. Löwith retourne l’analyse schmittéenne du romantisme comme dénué de tout attachement à une norme, son « occasionalisme », contre Schmitt lui-même, son « décisionnisme » étant tout autant dénué de point d’ancrage, si ce n’est l’adaptation à la « facticité » du moment. Pour Heimes, la critique de Löwith, fortement influencée par la vision du Schmitt collaborateur, se trompe premièrement de perspective (p. 52). En effet, pour Schmitt comme pour Voegelin, les « idées d’ordre » (Ordnungsideen) doivent justement être distinctes de tout contenu concret, puisqu’elles ne s’expriment pas directement dans la réalité politique. Deuxièmement, Löwith ne verrait pas la « stricte distinction » (p. 55) opérée par Schmitt entre la description, ce qui est, et l’affirmation, ce qui doit être (Sein / Sollen). Ainsi Schmitt, en tant que juriste, se concentrerait avant tout sur la description. En particulier, la distinction entre ami et ennemi, au cœur de la Notion du politique, serait avant tout empirique ; cette distinction existerait dans le monde et, sans elle, toute politique serait impossible. Ce faisant, Schmitt révèle le point d’ancrage de son analyse. En effet,
pour Heimes, l’« anthropologie politique » (p. 60) que sous-entend Schmitt est fortement marquée par le catholicisme, le péché originel et l’homme capable du Mal, un arrière-plan se reflétant dans la vision « apocalyptique » (p. 66) d’un monde sans politique et surtout dans le concept paulinien de « katechon », la force retenant la fin des temps à venir (2 Th 2.6).
Avec le « katechon », Heimes pense avoir trouvé le « point d’Archimède » de la pensée schmittéenne – « Schmitt croit au katechon » (p. 70) – et ce faisant la réponse ultime à la critique en termes de « décisionnisme occasionaliste » formulée par Löwith. Le « katechon » rend possible l’histoire même, comme eschatologie, s’étendant entre la création et la fin du monde, et donne au politique une dimension apocalyptique. Pour Schmitt, il importe donc de reconnaître entre les acteurs politiques en présence cette force du « katechon », assurant l’ordre face au danger permanent de la dissolution porté par les ennemis du « katechon ». Cette conception entrerait ainsi dans son combat contre le communisme, et c’est en effet certainement ainsi qu’il faut comprendre le « satanisme » de l’époque du socialisme athée évoqué dans le chap. iv de la Théologie politique. Heimes va plus loin, voyant parallèlement dans la collaboration avec le régime national-socialiste « le moment de la grande et fatale erreur de la compréhension schmittéenne de la politique, imprégnée du katechon » (p. 75), Schmitt s’étant trompé en reconnaissant en Hitler la puissance « katéchontique » du moment. Cette « erreur » révèle bien la difficulté de faire du « katechon » le « point d’Archimède » de la pensée de Schmitt. Comme le remarque Heimes, si « ce qu’est » le katechon est clair, « qui » il est ne l’est pas, et il devient au cours de la lecture manifeste que ce « point d’Archimède » découvert par Heimes ne permet en définitive pas de sortir de la critique de Löwith, analysée comme souvent de manière trop superficielle dans cet ouvrage. En effet, Löwith ne critique pas le détachement des « idées d’ordre » d’un contenu concret, mais situe clairement son analyse dans une perspective anthropologique, et attaque cet arrière-plan de l’analyse schmittienne pour son absence de référence à une norme quelconque, par exemple chrétienne. Cette critique publiée sous pseudonyme n’est pas aussi isolée que le pense Heimes. De son travail d’habilitation, L’homme comme semblable (Der Mensch als Mitmensch, 1935), à d’autres études consacrées à la notions d’humanité publiées dans les années 1930, Löwith cherche
à réhabiliter une conception de la « personne » inconciliable avec la perspective de Schmitt. On s’étonnera que le « point d’Archimède » découvert dans l’arrière-plan anthropologique « chrétien » de Schmitt ne mène pas une réflexion plus critique et aboutie quant à la véritable pertinence de cette association et à la vacuité de la notion de « katechon ». La tentative menée par Heimes dans son interprétation de Schmitt doit impérativement être relue parallèlement à la critique de Löwith, d’autant plus que cette interprétation constitue l’arrière-plan utilisé par l’auteur dans sa lecture de Voegelin.
La présentation de la pensée voegelinienne proposée dans un troisième temps par Heimes en reprend les moments essentiels et met principalement l’accent sur ses œuvres tardives, Ordre et Histoire et Anamnesis. Pour Heimes, la « sémantique de l’ordre » développée par Voegelin trouve son origine en Dieu, la philosophie de la conscience voegelinienne mettant l’accent sur le « metaxy », le lieu de l’expérience de la transcendance. L’histoire est à ce titre « le processus de différenciation dans la conscience, processus d’où découlent seulement dans un deuxième temps les ordres humains » (p. 96), la philosophie de la conscience se présentant ainsi comme l’articulation entre les premières réflexions juridiques de Voegelin et ses dernières œuvres plus théoriques. La « thérapie de l’ordre » (p. 101) proposée par Voegelin consiste donc à récupérer dans les symboles plus ou moins différenciés cette expérience de la transcendance, cette « tension » relativisant l’« égophanie » moderne, critiquée par Voegelin à la suite de George Santayana (Egotism in German Philosophy, 1915).
À la suite des présentations distinctes de Schmitt et de Voegelin, Heimes rassemblent les deux penseurs sous la notion de « théologie politique », c’est-à-dire non sous l’angle de la critique du positivisme juridique, mais, et cette étape se révèle beaucoup plus hasardeuse, en mettant en parallèle « katechon » et « metaxy ». Selon Heimes, les deux « notions d’ordre » (Ordnungsbegriffe) sont l’une comme l’autre une forme de l’« entre », renvoyant donc à la conception voegelinienne d’une « tension » fondamentale chez l’homme vers la transcendance. Néanmoins, Heimes calque une perpective schmittéenne sur son analyse de la pensée de Voegelin. S’il paraît vraisemblable, chez Schmitt, que la révélation par le Christ est « l’événement historique central » (p. 106), cela est beaucoup moins évident chez Voegelin. Sans aller jusqu’à parler de Jésus comme d’un « détail superflu » dans la pensée voegelinienne,
comme le fait Gerhart Niemeyer, il est difficile d’approuver Heimes dans son interprétation de Voegelin. En particulier, il donne à la complexe conception voegelinienne du temps comme « présence s’écoulant » (fließende Präsenz) la « même valeur que l’identification de Jésus comme le premier homme et la référence de Jésus au Saint Esprit, qui se manifeste à l’homme dans le temps » (p. 106), la notion de « transcendance » cédant progressivement le place à « Jésus ». Cette « présence » évoquée par Voegelin serait donc la présence du Christ, donnant ainsi à la notion de « metaxy » une valeur apocalyptique semblable au « katechon » schmittéen, sa négation revenant s’opposer à Dieu. Ainsi, pour Heimes, « au-delà d’une expérience de l’ordre orientée sur la révélation du Christ, il n’y a qu’anomie, tentation immanentiste, religion politique, révolte égophanique, hybris, Antechrist et déchéance de Dieu » (p. 106), la référence à la place relative du christianisme dans l’œuvre de Voegelin intervenant bien tard dans l’analyse. La reformulation de la pensée voegelinienne en catégories schmittéennes se poursuit avec l’interprétation de la résistance du philosophe face au désordre comme un « combat », l’« orientation vers l’ennemi » étant « nécessaire » chez les deux auteurs (p. 109).
En mélangeant ainsi les deux perspectives, Heimes reste aveugle à la différence fondamentale intervenant dans la place donnée au christianisme chez les deux auteurs, et plus largement au fondement de leur pensée. La conception schmittéenne du politique tout comme sa vision du christianisme sont effectivement essentiellement « polémiques » (p. 107), le « katechon », « point d’Archimède » de sa pensée selon Heimes, étant lui-même une notion polémique, c’est-à-dire imposant la distinction essentielle entre ami et ennemi, une opposition exacerbée par la dimension « apocalyptique » de ce conflit. Il s’agit certes là d’un moment fondamental pour l’unité du politique, qui se construit en partie par l’exclusion. Chez Voegelin au contraire, l’accent est mis sur la cohésion de cette unité, sur le moment de l’inclusion, d’où la place centrale du « corpus mysticum » paulinien dans son analyse. Le « metaxy » n’est pas une notion polémique impliquant une quelconque dimension apocalyptique, mais le noyau d’une anthropologie mettant en avant l’ouverture commune vers la transcendance, telle qu’on la trouve dans la conception bergsonienne de la « société ouverte ». Ce faisant, Voegelin et Schmitt ne s’opposent pas seulement quant à la compréhension de
leur rôle, en tant que philosophe ou juriste, détaché ou non de la réalité politique, comme le développe Heimes dans le dernier chapitre de son ouvrage (chap. 5), mais précisément sur le point mis en exergue par la critique de Löwith, celui de l’anthropologie philosophique. Alors que le rapport à la transcendance de Schmitt a pour principal résultat de charger l’histoire d’une dimension apocalyptique, par le biais du « katechon », sans pour autant garantir une conception positive de l’homme, principalement vu comme « dangereux » (p. 62), Voegelin recourt à cette tension vers la transcendance comme fondement d’une unité possible, comme point de référence éternel face à la contingence des événements historiques. Si l’ouvrage de Heimes offre donc une vue d’ensemble sur les interprétations allemandes tant de Schmitt que de Voegelin, il importe pour la réception de ce dernier d’aborder ce rapprochement avec grande précaution.
Bruno Godefroy
Université Lyon 3 – IRPhiL
Le Péché et la Foi. Écrits sur la religion de John Rawls, textes traduits par Marc Rüegger, introduits et commentés par Robert Adams, Joshua Cohen et Thomas Nagel, postface par Jürgen Habermas. Paris, éditions Hermann, collection « L’Avocat du Diable », 2010.
Après le décès en 2002 de John Rawls, dont la Théorie de la justice1 a marqué, dès sa publication en 1971, un formidable renouveau pour la philosophie politique contemporaine, ses proches et collègues firent deux découvertes étonnantes. Tout d’abord, on retrouva dans son ordinateur un court texte intitulé « Sur ma religion », dont nul n’avait eu vent jusque-là et qui ne semblait pas destiné à une quelconque publication. Rawls y décrit l’évolution de ses sentiments religieux, depuis la ferveur de ses deux dernières années de licence à Princeton jusqu’à ses considérations actuelles sur la religion, en passant par les événements et les réflexions qui l’ont conduit à abandonner son engagement chrétien au profit d’un théisme modéré. Suite à cette première découverte, on retrouva dans la bibliothèque de Princeton le mémoire que le jeune Rawls avait soumis en décembre 1942, et qui marquait l’achèvement précipité de sa licence avant son départ pour le front.
Ce mémoire, intitulé A Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith : An Interpretation Based on the Concept of Community, offre une vision tout à fait nouvelle et émouvante tant de l’homme qu’avait été John Rawls que des origines de sa pensée politique et morale. Dans ce travail de fin de cycle, Rawls thématise le péché et la foi comme, respectivement, l’anéantissement et le rejet de la communauté, et l’intégration parfaite de la personne au sein de la communauté. L’homme est en effet une personne, pas simplement un individu ; en tant que tel il est irremplaçable, unique, et responsable. Or pour Rawls cette personnalité ne peut se développer que sur le fond de la communauté. L’homme est essentiellement un être communautaire puisqu’il est une créature de Dieu, qui est donc rattachée à son créateur et aux autres êtres que celui-ci a voulus : Rawls pense la communauté sous un régime triadique, avec Dieu comme point de référence auquel chaque être est lié directement, ce réseau vertical se doublant ensuite des relations horizontales entre les hommes. Dans ce modèle les relations personnelles, qui incluent la
relation de Dieu et des hommes, constituent un réseau étroit au sein duquel toute incidence se répercute nécessairement à tous les autres niveaux. Le péché consiste donc moins à commettre de mauvaises actions sur le plan physique, où les relations dites naturelles de l’homme aux objets n’ont rien de condamnable, qu’à pervertir les relations personnelles constitutives de la communauté, car cela revient ultimement à rompre avec Dieu. Rawls distingue deux types de péché : l’égoïsme, qui est bon au niveau strictement naturel mais devient un péché en tant que modalité des relations personnelles, et l’égotisme. L’égotisme est le véritable péché, le plus démoniaque et la source de tous les autres : il est l’amour pervers de soi, l’orgueil, qui conduit à mépriser autrui et à le rabaisser au niveau de simple adorateur. En tant que tel, il est négation de la communauté, rupture, démesure. Ce raisonnement s’accompagne d’une réfutation des doctrines dites « naturalistes », qui justement rabattent l’ensemble des relations sur le plan purement naturel, et est complété ensuite par une analyse de l’isolement du pécheur, du salut, de la grâce, de la conversion et de l’amour chrétien.
Ces deux textes constituent en quelque sorte les pôles de la pensée religieuse de Rawls comme de son existence : une foi vive, engagée, exigeante dans ses jeunes années, soutenue par une pensée déjà rigoureuse quoique parfois un peu maladroite. À la fin de sa vie, un regard beaucoup plus austère et détaché porté sur le christianisme, et même une lassitude à l’égard des églises et de leurs combats politiques mais derrière laquelle pointe encore un grand intérêt pour les communautés de foi et le rôle qu’elles peuvent jouer dans le monde social. Pourtant cette polarité ne saurait être pensée en terme d’opposition, encore moins de contradiction : si la ferveur du jeune Rawls n’a pas résisté à l’épreuve de la guerre, les concepts qu’il commence à élaborer dans son mémoire de licence forment une esquisse des principes de philosophie politique et morale sur lesquels il bâtira toute sa pensée à venir. Le remarquable appareil critique qui encadre, en trois volets, ces deux textes posthumes offre au lecteur tous les outils nécessaires pour retrouver sous la plume de Rawls les linéaments des concepts et des principes qui, dès la publication de sa Théorie de la justice, resteront des exigences fondamentales de sa philosophie.
1. L’introduction, rédigée par Joshua Cohen et Thomas Nagel, constitue une présentation synoptique des deux textes qui dégage les
principaux points de contact entre le mémoire de 1942 et les œuvres suivantes, sur le plan politique. Celui-ci est certes absent du mémoire, mais les notions que Rawls forge alors préfigurent les concepts proprement politiques qui articuleront sa Théorie de la justice. Ainsi la priorité du juste sur le bien, le caractère séparé des personnes, le rejet de la conception contractualiste de la société, la condamnation de l’inégalité et le rejet de l’idée de mérite sont autant de thèses qui sont en 1942 avancées dans un cadre religieux, mais qui seront reconstruites sous un angle strictement politique et moral dès 1971.
2. Le commentaire de Robert Merryhew Adams porte sur la dimension théologique du mémoire : il réinscrit la pensée du jeune Rawls dans le réseau des œuvres et des auteurs qu’il lisait et qui l’inspiraient, tout en menant une analyse approfondie de sa critique du « naturalisme » et de la reconstruction qu’il propose des notions de fin, de communauté, de péché, de conversion et de révélation. Cette analyse a le souci constant de rattacher la démarche de Rawls aux principes de l’épiscopalisme orthodoxe, qui définissaient son engagement religieux d’alors, et plus encore aux travaux d’éthique religieuse d’auteurs tels qu’Emil Brunner, Philip Leon, Reinhold Niebuhr ou Anders Nygren, envers qui le jeune Rawls reconnaît une grande dette quoiqu’il n’hésite pas à s’en démarquer avec plus ou moins de bonheur.
3. La postface de Jürgen Habermas met en lumière les structures éthiques et communicationnelles mises en place par Rawls dans son travail de mémoire, puis suggérées dans « Sur ma religion ». En montrant comment les notions de « personne » et de « société » constituent, dès 1942, les pôles fixes entre lesquels Rawls élabore un réseau normatif complexe, et en dégageant les racines religieuses de sa morale déontologique, Habermas explique la transformation ultérieure de son éthique religieuse en une éthique égalitaire et universaliste du devoir, fondée non plus sur Dieu mais sur la raison. Habermas souligne néanmoins l’ambiguïté du statut de la religion dans l’œuvre de Rawls, à laquelle une place importante est rendue dans ses derniers travaux. Cette ambiguïté est d’ailleurs marquée dans le texte « Sur ma religion », rappelant que Rawls, quoique ayant perdu la foi et se montrant sévère quant au christianisme, a toujours manifesté un profond « tempérament religieux2 ».
Le Péché et le Foi. Écrits sur la religion représente ainsi une lecture précieuse pour la compréhension de Rawls. Si certains passages sont parfois déroutants pour le lecteur non averti, le souci des commentateurs de dégager de manière claire et approfondie les concepts en germe dans le texte de 1942, ainsi que leurs reconstructions et transformations ultérieures, offre une vision synoptique et une analyse puissante d’une dimension jusque-là assez méconnue de la vie et de la pensée de Rawls.
Blondine Desbiolles
Université Lyon 3 – IRPhiL