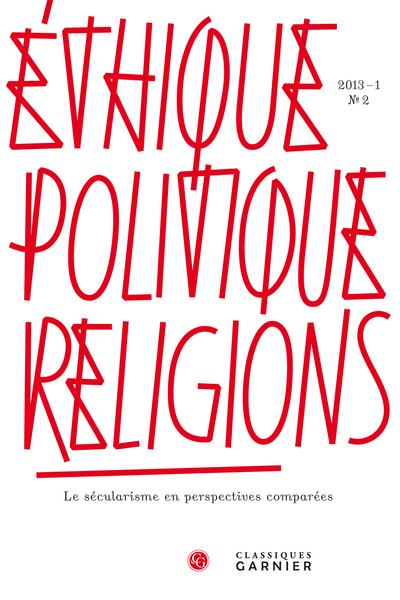
Le sécularisme comme objet anthropologique ?
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Éthique, politique, religions
2013 – 1, n° 2. Le sécularisme en perspectives comparées - Auteur : Obadia (Lionel)
- Résumé : Forgées à partir du vocabulaire confessionnel, de la pensée sociale et des vicissitudes historiques du christianisme, les notions de sécularisme et de sécularisation ont très rapidement été généralisées à la situation de « la » religion dans le « monde moderne ». À l’épreuve de la réalité historique, ce modèle signale bien ses soubassements monothéistes et ethnocentrés. Alors que l’anthropologie s’intéresse toujours plus à un domaine du séculier longtemps abandonné à d’autres disciplines, elle doit pour opérer une conversion de regard sur ses objets tout en conservant ses méthodes : l’ethnographie et le comparatisme. À quoi pourrait ressembler une anthropologie du sécularisme, donc ? À la suite des réflexions de Talal Asad (2003) et d’autres anthropologues, cet article tente de poser quelques bases à un champ émergent qui implique de désoccidentaliser l’approche du sécularisme.
- Pages : 119 à 141
- Revue : Éthique, politique, religions
- Thème CLIL : 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN : 9782812412004
- ISBN : 978-2-8124-1200-4
- ISSN : 2271-7234
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-1200-4.p.0119
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 03/07/2013
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : anthropologie, sécularisme, théocentrisme, méthode et perspective
Le sécularisme comme objet anthropologique ?
Les comportements, représentations, attitudes mentales et organisations sociales relevant du « séculier » sont-ils de nature à intéresser l’anthropologie ? La question, apparemment naïve, ne l’est que faussement : car à travers elle ce sont des préférences et habitudes disciplinaires, circonscrivant des champs de connaissance, qui se dévoilent. Encore faut-il que l’on s’entende sur ce que l’on appelle ici « anthropologie » et que soit dégagée clairement sa contribution, puisqu’il en est nécessairement une, qu’elle soit cruciale ou secondaire, à la compréhension du sécularisme. L’idée qui sera défendue dans les pages qui suivent, c’est que le projet d’une anthropologie du sécularisme est intellectuellement possible et nécessaire, et qu’il peut s’inscrire dans la continuité de plusieurs programmes de l’anthropologie : les études de diffusion ou la déconstruction postcoloniale. De la même manière qu’une sociologie de l’irréligion et une histoire l’athéisme tardent à s’installer, malgré la postérité des travaux sur la sécularisation dans l’ensemble des sciences humaines et sociales1, une anthropologie du sécularisme (qui ne se confond pas avec les premières), déjà suggérée, mais encore peu développée doit préalablement être mise à l’épreuve de sa consistance et de sa pertinence : le sécularisme est-il ainsi un objet légitime de l’anthropologie, et si c’est le cas, comment l’étudier ?
L’anthropologie et le sécularisme
Lorsqu’on considère rétrospectivement la tradition intellectuelle de l’anthropologie, cette science comparative des cultures et sociétés, l’évidence s’impose qu’elle s’est longtemps et abondamment penchée sur les comportements sociaux, dans leurs variantes culturelles et cultuelles, notamment, sur la base d’un postulat simple : les sociétés « modernes » et occidentales sont sécularisées, les sociétés « traditionnelles » et extra-occidentales demeurent religieuses. Elle ne pouvait donc faire place à ce qui apparaît en première instance comme un produit du monde occidental, celui dont sont issus l’anthropologie (en tant que mode de connaissance) et l’anthropologue (en tant que sujet de cette connaissance), qui ne pouvait être le monde « autre », du point de vue d’une primitivité, c’est-à-dire, d’une altérité à la fois conçue comme temporelle et géographique pour celui qui l’observe. Cette conception, prédominante depuis la fin du xixe siècle, n’a été mise en critique et relativisée que tardivement, lors de la décolonisation des territoires explorés par les ethnologues, et, partant, la décolonisation de leur propre regard et savoir sur les autres cultures.
L’anthropologie a ainsi logiquement érigé la religion au rang de premier objet d’étude légitime – premier dans le double sens « historique » (car l’étude des religions fut à la naissance de l’anthropologie au xixe siècle) – et à propos de la nature épistémique des objets de cette anthropologie naissante (car il n’y à l’époque de légitime en anthropologie que ce qui relève du « primitif »). Selon une ligne de séparation géographique et disciplinaire que Jack Goody avait décrite comme un « Grand partage » entre les sociétés et les savoirs sur les sociétés, la sociologie et les sciences des sociétés proches et « moderne », d’un côté, l’anthropologie et les sciences des sociétés lointaines dans le temps et dans l’espace, de l’autre, il y avait peu de chance que l’anthropologie rencontre l’incroyance dans la pensée, l’irréligion dans les actes et des mécanismes séculiers dans les systèmes sociaux et politiques de régions prétendument entièrement assujetties au symbolique et à la cosmologie. En réalité, et toujours plus nombreux sont les auteurs à s’accorder sur ce point, les idées et attitudes relatives au séculier sont antérieures au
sécularisme, qui n’a été formulé qu’en tant qu’idéologie politique au xixe siècle, et il se trouve quantité de sociétés « traditionnelles » où elles se retrouvent également, mais dans en ordre dispersé, ce qui limitait les chances de les saisir. La certitude avec laquelle les anthropologues, depuis La Civilisation primitive d’Edward Tylor (1876-1878) jusqu’au récent ouvrage Au fondement des sociétés humaines de Maurice Godelier (2007), en passant par le Manuel d’ethnographie de Marcel Mauss (1947), ont perpétué cette image de sociétés non-occidentales toutes entières baignées de religion – et donc exemptes de sécularité.
Depuis quatre décennies, maintenant, l’anthropologie a toutefois commencé à délaisser ses terrains exotiques et son attachement à des catégories de pensée évolutionnistes pour se rapatrier sur les sociétés occidentales et explorer les mondes modernes – ceux-là même qui présentent la figure inverse des terrains traditionnellement « religieux » de l’anthropologie. Et quand bien même elle serait demeurée attachée aux terres d’exploration lointaines, les processus de modernisation et surtout de mondialisation traversent désormais de part en part les sociétés ethnologisées qu’il est devenu impossible de ne pas trouver des expressions séculières (si jamais ces sociétés en étaient initialement dépourvues) – de la même manière que les sociétés occidentales modernes sont traversées de mouvements de résurgence religieuse, d’installation de nouvelles traditions ou d’exportation de mouvances spirituelles qui en font moins des déserts que des haut lieux de la religion. La représentation idéale d’isolats socio-culturels traditionnels, non altérés par influences occidentales et séculières, baignant dans leur cosmologie et leur ritualité, contrastant avec le monde « moderne », a fait long feu. Cette cartographie englobante, aux effets de stéréotypisation, trace néanmoins une frontière entre Eux et Nous, entre l’Occident et le reste du monde, entre la tradition et la modernité, entre le religieux et le séculier, qui a longtemps représenté le socle confortable sur lequel des théories générales de la modernisation et, partant, de la sécularisation, pouvaient être élaborées comme participant d’un rayonnement des lumières rationalistes de l’Occident sur le reste d’un monde obscurci par la foi. Mais à s’y pencher de plus près, si, effectivement, avant que se mettent en place les processus de sécularisation hors du monde occidental, en vertu de l’immense projet colonial qui a amené à une expansion mondiale des modèles de l’Occident moderne, tout porte à croire qu’il a existé un peu partout dans le monde
et dans l’histoire des formes germinales de sécularisme, dont la forme et le contenu, ainsi que la destinée historique, les éloignent de ce modèle de référence qu’est le sécularisme occidental moderne2.
Contestations : origine, nature
et extension du sécularisme
Car il ne faut pas s’y tromper : le sécularisme, en tant qu’idéologie politique, formulée explicitement en vue d’une intention de dissoudre les fondements religieux de l’ordre politique et social des nations modernes, est une création tardive (xixe siècle) et européenne. Pour autant, l’idée d’un monde qui ne serait pas entièrement contrôlé par le divin ou le surnaturel (et donc gouvernable sans référence religieuse), ou que certains secteurs de ce monde peuvent aisément être soustraits à leur influence est repérable dans certaines pensées et chez certains penseurs de l’antiquité (occidentale ou pas) et au fil même de siècles que l’on a pensé « foncièrement religieux », comme le Moyen Âge. Le sécularisme, comme projet politique et social, donc, fondé explicitement sur une relégation (plutôt qu’une éviction) du religieux de la sphère des affaires publiques (en particulier sociales et politiques) se pose néanmoins comme résolument moderne. Pour autant, et contrairement à ce qu’une lecture simplifiée de l’histoire tend à le montrer, si le sécularisme est advenu tardivement en tant que catégorie sémantique dans le temps historique, les idées séculières lui sont largement antérieures3. Mais l’élévation de ces idées au rang de pensée politique, et surtout leur triomphe sur des idées religieuses préalablement dominantes en matière de légitimation de gouvernement est définitivement localisée au cœur historique (d’abord) du xixe siècle, et dans le contexte d’une Europe traversée par les idées positivistes et rationalistes, les mouvements anticléricaux, la sécularisation des systèmes éducatifs, qui
vont saper les fondements idéologiques et sociologiques des Églises chrétiennes – et donc, à l’époque, de « la religion » en général. C’est à partir de cette convergence de mouvements idéologiques, associées à des forces plus matérielles (la révolution industrielle est ses effets : urbanisation, exode rural et déracinement du nouveau prolétariat, etc.), que les xviiie et xixe siècles sont considérés comme les siècles du prélude pour certains, d’essor pour d’autres, de ce processus historique qu’est la sécularisation. Paradoxalement, le siècle du Progrès et du positivisme aura aussi été celui qui a vu s’épanouir ou fleurir de nombreux mouvements ésotériques, occultistes et néo-magiques au cœur géographique (cette fois) de la modernité (Europe et Amérique du Nord), qui font du xixe le siècle et du positivisme, et du spiritualisme… Le sécularisme y est affirmé avec force (toujours en Europe et en Amérique du Nord) mais la sécularisation, déjà, a les formes et les effets d’une « déchristianisation4 » mais pas nécessairement ceux d’une « déreligionisation » de l’ensemble des sociétés modernes – ou alors à penser que la « révolution spirituelle » dont des sociologues comme Paul Heelas annoncent l’arrivée imminente5, ne signifie la résurgence d’un sacré « modernisé » qui s’adapte aux prérequis idéologiques et sociaux de la sécularisation (individualisme, rationalisme, etc.) – le sentiment religieux sans les contraintes des institutions religieuses, en somme.
Quelle que soit la forme culturelle ou nationale qu’il revêt, pour que le sécularisme fasse l’objet d’une étude anthropologique il faudrait sans doute que l’anthropologie se soit enfin débarrassée de ses présupposés primitivistes, de ceux à partir desquels les sociétés « traditionnelles » étant religieuses par essence, elles ne pouvaient qu’être par nature des terreaux peu fertiles pour voir naître des idéologies séculières. L’essor et le développement d’un sécularisme conquérant au point de se confronter frontalement aux institutions religieuses, de leur contester leur pouvoir politique, idéologique et leurs vertus éducatives apparaît alors comme l’expression d’une sorte de « génie » occidental, qui, depuis les travaux de Max Weber jusqu’à ceux d’Ernst Gellner, était seul à même de donner naissance à des pensées et des sociétés entièrement séculières – ou du
moins dans lesquelles le séculier (non-religieux) n’avait pas de statut minoritaire, face à une religion dominante6.
En fait, c’est dans le cadre d’une histoire globale des idées, valeurs, et institutions séculières (i.e. « dans-le-monde », « non-religieuses » ou « indifférentes à la religion ») qu’est pensée l’émergence du sécularisme. Par sécularisme on n’entend pas ici un simple substitut de l’athéisme (au plan des idées), de l’agnosticisme ou de l’irréligion (au plan des affiliations spirituelles et/ou appartenances confessionnelles), mais la doctrine qui contient un projet politique de société excluant toute intervention de la religion dans les affaires de l’État. C’est dans ce sens, qui forme généralement son cadre de définition dans le monde anglo-saxon, que le sécularisme se distingue de l’athéisme, de l’incroyance, de l’irréligion et autres… En tant qu’idéologie, voire « vision du monde7 », le sécularisme ne se confond pas non plus avec la sécularité qui figure une configuration particulière d’idées (en général, des versions de l’athéisme) et d’institutions (systèmes politique, éducatif, de santé…) séculières, pas plus qu’il ne se confond avec la sécularisation qui représente le processus historique effectif de dislocation ou de distanciation du religieux et du politique (donc l’autonomisation de celui-ci).
À la manière d’une histoire culturelle de la modernité, avec laquelle elle se confond souvent, l’histoire du sécularisme admet des profondeurs et des généalogies diverses. Certains lui attribuent une histoire longue, remontant à Anaxagore le ionien (500 av. J.C.)8, d’autres une généalogie moyenne, au Moyen Âge et à Joachim de Flore (1130-1202), ou la Renaissance et à la réforme protestante9, d’autres, enfin, une histoire courte, qui remonte aux temps modernes, en particulier au xixe siècle à l’industrialisation et à l’émergence d’un rationalisme antireligieux. Si la sécularisation figure ainsi un processus de séparation entre la société et la religion, elle aura été énoncée à plusieurs reprises, à travers des voix et selon des arguments différents. Mais la version classique de la théorie de la sécularisation a installé, et pour longtemps, dans les sciences
sociales et religieuses, un modèle de philosophie de l’histoire qui se fonde sur l’idée d’une apparition tardive et par défaut du sécularisme. « À l’origine », telle que le veut la formule consacrée, les institutions sociales, représentations du monde, valeurs culturelles étaient religieuses. Et c’est avec le temps et l’avènement de forces sociologiques (dans la perspective durkheimienne) ou idéologiques (dans la perspective wéberienne) que s’est opérée cette rupture entre le religieux et le séculier. La théorie de la sécularisation suggère une succession de « phases » voire de visions du monde ou de « paradigmes » (pour paraphraser le théologien allemand Hans Küng) advenant dans l’histoire dans un mouvement irréversible. Mais non seulement les rythmes de cette un peu trop belle modélisation de la sécularisation sont ondulatoires, Jean Baubérot évoque à ce titre des « seuils de sécularisation » qui s’installent au fil du temps10, alors que Émile Poulat évoque pour sa part des « étapes de laïcité11 » mais Peter Berger a récemment montré que les processus (donc les séquences) de sécularisation étaient réversibles12, et il existe des formats particuliers de sécularisation (patterns) et enfin les variations du sécularisme se lisent en outre de la manière la plus explicite dans les lignes politiques que les États-Nations ont adopté à l’endroit des religions : la mosaïque des formes et des effets du sécularisme s’étend dans un continuum qui va des régimes de stricte séparation (France) jusqu’au système de l’« accommodement raisonnable » (au Canada).
Ambivalences du sécularisme :
monothéocentrisme historique et crypto-religiosité
La sécularisation qui est associée, comme projet et comme mouvement sociopolitique, à la modernité, se confond souvent avec elle. C’est ainsi que pour Jonathan Friedmann le projet de la modernité contient nécessairement un volet de « sécularisation ». Les sociétés qui par
extension, le sécularisme est logiquement un modernisme. Le modèle du philosophe français Marcel Gauchet, empruntant au sociologue allemand Max Weber l’idée d’un « désenchantement du monde », établit à partir d’elle un modèle de processus de relégation sociopolitique du sacré qu’il qualifie de « sortie de la religion13 ». Le sécularisme serait donc le rejeton naturel de la sécularisation, un descendant logiquement issu d’une relation généalogique s’imposant par l’évidence plus que par la démonstration.
Défini a minima comme un projet politique et social d’exclusion du religieux des affaires publiques, et a maxima comme une séparation consommée entre le politique et le religieux, le sécularisme avance un peu partout mais sous des formes différentes, eu égard aux contextes dans lesquels il s’installe et s’impose partiellement ou totalement. Ainsi, de la même manière que la sécularisation est un processus protéiforme, éminemment diversifié dans ses causes et dans ses effets14, le sécularisme admet des variations locales qui sont le fruit d’histoires culturelles, religieuses et politiques locales : la terminologie vernaculaire signale d’ailleurs bien que « sécularisme » relève plutôt d’un anglicisme emprunté à la Grande-Bretagne, qui s’est popularisé aux États-Unis sur la base d’une tradition de « free thought » (libre pensée) alors qu’en France prédomine le principe de laïcité15. Si, dans ces différents contextes, le « séculier » (quels que soient les autres substantifs potentiellement utilisés) oscille entre athéisme (paisible ou actif) et agnosticisme, la question d’une éventuelle nature religieuse du sécularisme s’est posée avec d’autant plus d’acuité que, depuis Émile Durkheim, en sociologie, mais également en philosophie politique, s’est ouvert le débat à propos de la substitution de la religion par des institutions séculières, qui reconduiraient, peu ou prou, explicitement ou pas, des aspects morphologiques ou symboliques de la religion. C’est ce qui amène, en 1944, Raymond Aron a forger le concept oxymore de « religions
séculières » à propos de certains systèmes politiques, un terme qui connaît encore une certaine postérité16.
On voit bien ici tout l’intérêt qu’il y a pour l’anthropologie à s’inviter dans les questionnements ouverts par la philosophie, la sociologie et l’histoire à propos des rapports entre religion et politique, entre religion et religion par analogie, etc. Et à rejoindre aussi ces disciplines dans un même questionnement général sur le devenir des religions dans la modernité – et des modèles de modernisation généralement contestés par l’anthropologie. Car implicitement ou pas, la théorie de la sécularisation est une théorie de la modernisation et logiquement, le sécularisme (comme discours sur le politique en tant qu’il est autonome du religieux) est un modernisme (une narration générale de l’histoire qui installe la modernité au rang de séquence ou temps particulier de l’histoire). Il existe alors d’indiscutables transformations idéologiques (l’émergence d’un rationalisme dont le scientisme est une variante) sociologiques (la laïcisation de l’éducation)… et parmi d’autres retournements historiques – évoqués dans l’introduction de ce numéro spécial – celui qui a amené les athées à créer le terme de « sécularistes » puis de « sécularisme » pour s’auto-conférer une identité sociale et une consistance culturelle. Le modèle français de la laïcité, fondé sur la loi de 1905 de séparation de l’Église et de l’État, incarne par excellence cette identité acquise à l’achèvement de nombreuses luttes idéologiques.
Une « anthropologie » du sécularisme ?
Pour autant, les contours, le projet, et même la méthode d’une anthropologie du sécularisme restent des plus flous. L’anthropologie se heurte en effet à l’image même qu’elle s’est donnée des sociétés qu’elle a étudié : sociétés religieuses par définition, parce que « primitives » d’abord ou « traditionnelles » ensuite, pour finir par n’être que « non-occidentales » mais dans tous les cas, au départ affectées de manière oblique, puis par la suite plus massivement, par les idées et institutions séculières.
Le péril, pour l’anthropologie, consisterait à se voir enfermée dans cette tendance, qu’on lui attribue volontiers par méconnaissance de ses régimes épistémologiques et de sa méthode17, à universaliser des expressions historiques ou ethnographiques de la religion enregistrés localement et d’entériner par extension l’idée que l’Homme serait « religieux par essence » et athée par accident. L’anthropologue américain Talal Asad, qui a réservé une partie de ses travaux à déconstruire et à révéler les soubassements idéologiques des catégories de l’anthropologie des religions (de type geertzien, c’est-à-dire, culturaliste), a ouvert (officiellement) le champ aux États-Unis en s’interrogeant notamment sur ce « à quoi pourrait ressembler une anthropologie du sécularisme18 », refusant d’en constituer une narration au raz de la factualité événementielle, mais préférant une saisir la double fabrique du séculier et du religieux dans l’histoire, comme formes discursives et forces idéologiques et sociales, qui ont établi les bases d’une puissante mythologie sur laquelle les États modernes se sont fondés : des valeurs (le Progrès, le développement, etc.) en rupture avec celles de la religion.
On pourra saluer chez Asad le caractère pionnier d’une approche véritablement anthropologique du sécularisme. On pourrait néanmoins s’interroger sur ce qui pousse Asad à maintenir l’analyse dans le cadre d’une anthropologie des religions – à la recherche de ce relève de ressemblances ou des correspondances de nature analogique, comme si le séculier ne pouvait encore et toujours être compris qu’en creux du religieux, ou, du moins, avec les outils intellectuels des sciences religieuses – en premier lieu, le concept de « mythe19 ». Le choix d’Asad peut néanmoins se justifier au regard des sources religieuses, actuellement âprement discutées, du sécularisme moderne. Les racines du sécularisme sont ainsi attribuées au protestantisme20 ou au catholicisme21. De même le degré de proximité ou
de résistance aux formes sociales, aux valeurs culturelles et aux idéaux politiques de la modernité séculière varient d’un contexte à l’autre : ces variations de sens, forme et fonction, interrogent ainsi la nature même de la modernité et de son pendant séculariste. Le sécularisme ne serait-il, finalement, qu’une religion qui s’ignore ou qui est, en tant que telle, dissimulée parce qu’officiellement disjointe d’elle – ce qui n’interdit pas d’en repérer des morphologies ou des contenus similaires ? Mais la similarité fait-elle l’identité ? Si Graeme Smith rappelle (sans prendre de risque intellectuel excessif) que le sécularisme est « l’ultime expression [historique] du christianisme [occidental]22 » Michel Onfray regrette, avec nettement plus d’éloquence (mais non sans quelques raccourcis quant au rôle exact de la religion dans l’histoire), que la laïcité demeure encore ontologiquement religieuse et enjoint ses lecteurs à le suivre dans le projet d’une « laïcité post-chrétienne », qui achèverait la déchristianisation de la pensée et de la société23. Mais les sociétés entières peuvent-elles si facilement rompre avec leur héritage culturel pour s’affirmer « modernes » et donc développer une conscience historique niant l’historicité de leurs idées24 ? Et jusqu’à quel point et sous quelles conditions exactes, autres que l’identification de symptômes psychiques (culpabilité, soumission à des instances transcendantes…) peut-on clairement statuer d’une pérennité de la « pensée judéo-chrétienne » (et des entraves qu’elle imposerait à la vie psychique et sociale) ? Quelle place doit encore jouer la religion, dans les sociétés de la modernité, sachant qu’elles peuvent alternativement se constituer dans un rejet assimilationniste et radical de la religion, s’inscrire dans une « transcendance laïque » pour paraphraser Henri Peña-Ruiz25, ou s’établir sur le mode du pluralisme confessionnel et du multiculturalisme ? Aucune de ces options, il faut le rappeler, n’aura incarné un système idéal qui aura résolu le problème des tensions entre forces idéologiques et politiques de la religion (dominante ou minoritaire) et du sécularisme. Il reste encore bien des chantiers à ouvrir pour élaborer une anthropologie du sécularisme, via par exemple, une ethnographie de la signification culturelle et subjective du « séculier » : les catégories sémantiques d’« athée » ou de « secularist » apparaissent
comme des labels identificatoires (et plus seulement des taxinomies ou typologies pour études statistiques) que les acteurs sociaux font désormais valoir stratégiquement. Et ce sont ces usages sociaux du référent séculier qui font évidemment écho aux multiples revendications ethniques et religieuses et renouvellent sans aucun doute le champ des politiques de l’identité (où le séculier a longtemps demeuré un référent neutre et strictement analytique).
Comparatisme et traduction transculturels :
une perspective anthropologique
Ce qui est sûr, néanmoins, c’est qu’avant de prétendre à dresser une histoire globale du sécularisme, une première prudence méthodologique s’impose : celle qui consiste à respecter le rapport localisé dans le temps de l’histoire et la géographie des cultures, des sociétés aux idées séculières. La trajectoire du sécularisme peut relever, comme c’est le cas en Turquie, de l’adoption mutatis mutandis du modèle français de la laïcité, avec emprunt de la racine lexicale mais pas du système in toto26, ou s’aligner, comme c’est le cas en Inde, sur une sorte d’athéisme d’État qui laisse néanmoins à la religion le champ libre hors de l’espace politique.
Dans tous les cas, c’est dans la configuration historique locale de forces séculières et religieuses en présence, que se façonnent les représentations collectives du sécularisme et les politiques visant à sa mise en œuvre. Ainsi, si les idées (de désacralisation de l’ontologie et de l’histoire) et les modalités institutionnelles (sous la forme d’organes sociaux laïcisés) du sécularisme ont des racines singulières et localisées (géographiquement, culturellement), il fallait opérer un détour par la comparaison des situations et des significations locales, des enjeux nationaux entourant les régimes politiques et systèmes sociaux séculiers. De ce point de vue, la
sociologie de Baubérot a déjà œuvré dans le sens d’une comparaison, en particulier à l’échelle de l’Europe, des différents régimes sociopolitiques27. L’histoire s’est aussi penchée sur des comparaisons entre deux contextes nationaux, comme la France (référence de la laïcité) et l’Italie, avec deux modèles d’État et arrière-plans culturels et religieux différents28.
La conception « américaine » (en fait, chrétienne et de droite) du sécularisme n’établit pas ce dernier dans un rapport d’équivalence avec une conception « française » (ici considérée comme globale, par-delà ses variantes) : la dernière est fondée sur une neutralité de jure et un ajustement de facto des religions dans un espace public pluriel, la première serait au contraire tout sauf neutre, et étant résolument inégalitaire car inscrite dans un rapport de force que les instances d’une laïcité de combat chercheraient à renverser à leur avantage29. Zuckerman n’est néanmoins pas le seul à développer ce nouveau champ dans le monde anglo-saxon. Barry Kosmin, s’est illustré aux États-Unis par la fondation d’un Institut Universitaire spécialisé dans l’étude du sécularisme, à partir duquel ont été entrepris de mêmes travaux comparatifs30. Là où Zuckerman présente des situations « à plat » de leur singularité empirique (malgré la richesse de chaque cas étudié et son potentiel de questionnement), Kosmin a quant à lui engagé un programme d’étude du sécularisme dans une « perspective internationale » qui interroge à la fois l’extension des catégories d’analyse au-delà de leur contexte de formulation initiale (laïcité hors France ? sécularisme hors États-Unis ?), mais aussi les enjeux scientifiques (et pas seulement les formes) entourant l’étude du sécularisme dans chaque nation31.
Dans le cadre de ces programmes comparatifs, les situations respectives des États-Unis et de l’Europe figurent à première vue des pôles opposés et des représentations archétypales des rapports des sociétés aux idées et aux modes d’organisation sociopolitique séculiers qu’elles ont plus ou moins officiellement adopté. La dichotomie conceptuelle forgée par Ahmet T. Kuru, distinguant deux régimes sociopolitiques, l’assertive
secularism et le passive secularism, s’avère un outil comparatif qui permet d’englober, tout en la dépassant, la singularité des contextes de la France, des États-Unis et de la Turquie. Si, dans le contexte européen, c’est un sécularisme d’État, qui entend contrôler les manifestations (c’est donc un assertive secularism), dans le contexte étasunien, l’État est quant à lui peu regardant à propos de l’inscription du religieux dans l’espace public (ce qui relève alors d’un passive secularism)32. Mais dès lors que l’analyse convoque d’autres catégories d’analyse, le curseur régional et la classification se trouve bouleversée. Barry Kosmin fait ainsi reposer son comparatisme sur l’opposition de politiques publiques en un hard secularism (un athéisme d’État contrôlant les religions et qui peut se montrer répressif, comme en Chine ou, autrefois, en URSS) et un soft secularism (une accommodation de l’État séculier avec des Églises dominantes, comme en Grande-Bretagne ou en Israël)33. Dans cette typologie, les États-Unis, la France et la Turquie apparaissent comme des formes intermédiaires, et non pas des formes polarisées aux extrêmes. Ces nations ne représentent donc des types-idéaux que dans le cadre d’une certaine théorisation, mais en aucun cas des modèles universalisables en vertu de la saillance de la forme particulière du sécularisme qu’elles ont adopté.
Désoccidentaliser les modèles du sécularisme
Le modèle français, celui de la laïcité, sert ainsi généralement de référence aux sciences des religions, comme étalon pour en mesurer les vairations, mais il n’offre finalement à la réflexion et à l’observation qu’une variante de la catégorie plus large de « sécularisme ». Ce modèle, s’il sert par ailleurs des fins comparatives, est aussi un associé à la marche de la modernité et à son extension à l’échelle mondiale. Adopter un modèle sociopolitique de type séculier, ou, au contraire, y résister, reflète les attitudes des sociétés non-occidentales face à l’extension des modèles de la modernité occidentale. Pourtant, les essais (précités) de modélisation
d’un sécularisme global dont les formes locales seraient des variations signalent bien que si une certaine historicisation du sécularisme place celui-ci au cœur de la trajectoire de la modernité occidentale, ses développements géographiques (sa « mondialisation ») interdisent désormais de l’instituer en tant que « méridien de Greenwich », pourrait-on dire des variantes du sécularisme ou des sécularismes.
Le centre de gravité empirique et surtout théorique franco-français de la laïcité s’est donc déjà largement décalé vers des formes particulières, fruits d’acculturations locales d’un modèle en expansion : la laïcité à l’allemande, à l’italienne, à la belge, pour demeurer dans l’espace européen, mais aussi et surtout dans des régions de culture et de religion fort différentes, comme la Turquie ou l’Inde, obligent à repenser l’extension du comparatisme hors de l’espace européen. Là, en dépit des variations observées entre le nord protestant et le sud catholique / orthodoxe dans les processus de sécularisation et impacts des idées séculières, de mêmes tendances au recul des grandes confessions (sur le plan de la sociologie des acteurs, comme de celle des institutions) et à la pluralisation des paysages religieux, via des phénomènes de migration (pour l’islam, l’hindouisme, le sikhisme, les religions traditionnelles chinoises, certaines écoles du bouddhisme) ou des processus de diffusion voire d’évangélisation (pour les « nouveaux » cultes).
Dans ce sens, l’ouvrage Secularism, religion and Multicultural Citizenship dirigé par Levey et Modood est un bon exemple de cet équilibre actuel des travaux sur le sécularisme entre les études historiennes à l’échelle d’une seule nation, un comparatisme intra-continental à propos d’une religion (l’islam) en Europe et un comparatisme intercontinental, installant d’autres grandes nations séculières, mais séculières autrement, au rang des objets légitimes. Évidemment, le sécularisme – et la laïcité – n’est ici qu’une manière détournée d’explorer les arrangements possibles entre religion et État, dans le contexte d’un multiculturalisme s’imposant un peu partout en Europe, plus qu’une véritable théorie des mutations du religieux, dans son rapport à un profane désormais érigé au rang d’idéologie et de modèle culturel dominant – donc converti en sécularisme. Ainsi, si l’athéisme réfère à des attitudes de croyance, l’irréligion à des appartenances confessionnelles, le sécularisme convoque quant à lui des ressorts idéologiques avant que de désigner des dispositifs institutionnels de gestion sociale des croyances et de la diversité culturelle.
Habituellement étudié pour la variété de ses formes religieuses, l’Inde apparaît, à l’initiative de l’approche politiste de Christophe Jaffrelot, comme l’un des sites du sécularisme dans le sous-continent indien, confronté aux vagues de nationalisme portées par les religions locales l’islam (au Pakistan), l’hindouisme (en Inde) et, dans une certaine mesure, par le bouddhisme (à Sri Lanka), s’avère un monde protéiforme, inscrit de manière diverse dans les constitutions nationales de la région, mais qui, toutes, se sont positionnées par rapport à un modèle occidental du sécularisme (d’importation, donc) qu’elles ont digéré et façonné à leur sauce – celle d’un presque continent qui, engagé dans la décolonisation34. Il ressort de ce détour par les sociétés extra-européennes l’émergence de modèles alternatifs, constitués dans une tension entre le politique et le religieux, mais sur la base d’autres systèmes religieux que le christianisme, et donc logiquement, d’autres arrangements. Si l’Inde apparaît comme un référent important, le sécularisme turc, une réinterprétation kémaliste du modèle de la laïcité, s’impose comme une référence majeure en matière de comparatisme. Mais si la Turquie et l’Inde font ainsi figure de référence à partir desquels se mesurent des écarts au régime français de laïcité, mais il ne faudrait pas que, pour autant, ces cas particuliers (ou érigés comme tels par les recherches contemporaines sur le sécularisme) soient installés au rang de modèles – au sens épistémologique du terme : comme représentation abstraite de la réalité à vocation heuristique – sans que préalablement ce qui « fait modèle » soit questionné. Ces trois pays, qui demeurent des références-étalon sur le plan historico-sociologique, ne doivent en effet pas saturer à eux seuls l’horizon des régions géographiques et des territoires de la réflexion où le sécularisme peut être mis à l’épreuve des faits.
Mais déjà, d’autres affinements théoriques émergent à partir de la confrontation du sécularisme avec d’autres régions et religions. Le second volume de Atheism and Secularity de Phil Zuckerman, sous-titré Global Perspectives offre un certain nombre d’études de cas dont la diversité justifie pleinement de consacrer au sécularisme un véritable programme comparatif. Les États-Unis (Bob Altemeyer) offrent ainsi à l’observation – et à la théorie – une multitude d’attitudes à l’endroit de la religion,
ce qui a pour conséquence une aussi vaste amplitude des catégories à l’usage dans les sciences religieuses à propos des dissidences face à la religion : entre les active atheists, les ordinary agnostic, unchurched, passive theists, unbelievers, … le choix des labels est très étendu. Au Japon, en revanche (Michael Roemer), être « non-religieux » (shu kyo wa nai) ne signifie pas être « athée », et devant les écarts existant entre une religiosité bigarrée, composée de croyances populaires, et d’affiliations officielles à des traditions existantes, mais aussi de revendications à l’athéisme ou à l’agnosticisme. Dans ce sens, si le Japon est une société séculière sur le plan politique, elle n’est pas en revanche sécularisée sur celui de la culture. Dans les pays d’ex-Union soviétique (Leontina Hormel), l’athéisme d’État de l’URSS aura profondément marqué les mentalités (des générations qui l’ont connu) mais l’effondrement de ce qui fut un « bloc » géopolitique majeur aura entraîné chez les nouvelles générations un regain de religiosité (qui s’est traduit par une démultiplication des offres en matière spirituelle) loin du modèle séculier intériorisé par leurs parents. Si l’Afrique, ici à travers l’exemple du Ghana (Kwasi Yirenki et Baffour Takyi), reste un continent largement dominé par l’influence des religions locales et d’importation (et des luttes qui les opposent), les voix du sécularisme commencent à s’y exprimer, non pas seulement sur le plan de modèles de gouvernance politique qui ne sont sécularisés qu’en apparence, mais sous la forme de groupements auto-labellisés « séculiers » de plus en plus visibles sur les scènes sociales et politiques. L’observation d’autres contextes nationaux, au Niger, par exemple, révèlent le caractère « ambigu » d’un sécularisme établi politiquement, mais contesté par des instances religieuses promptes à faire valoir, dans le cas de l’islam, la consubstantialité de l’ethnique et du religieux35. Alors que la Grande-Bretagne se caractérise par des Églises socialement visibles et culturelles acceptées, le taux d’indifférence religieuse est en hausse (Samuel Bagg et David Voas). Le même volume questionne la particularité du rapport entre l’islam et le sécularisme, des idées séculières souvent considérées comme antinomiques parce qu’imposées par l’Occident mais elles peuvent avoir aussi des racines indigènes anciennes (Jack Eller). L’Inde, en revanche (Innaiah Narisetti), depuis Nehru, a
éprouvé moins de difficultés à digérer les idées séculières d’Occident, empruntées à l’ancien colonisateur, et qui ont infusé dans le système politique de la plus grande démocratie du monde, sous la forme de modes de modalités de gouvernance mais aussi d’organisations de la société civile qui se revendiquent de cet athéisme culturel. Dans un tout autre registre, les pays scandinaves révèleraient un étonnant paradoxe (Peter Lüchau) : si les Églises occupent une place centrale dans la vie sociale et politique, les scandinaves sont, pour leur part faiblement religieux… tout en se revendiquant faiblement d’un athéisme. Une sécularisation sans sécularisme, donc. La Chine, enfin (Liang Tong) ferme cette collection d’études de cas avec une analyse dans la profondeur historique du sécularisme en Chine, qui doit autant à ses très anciennes racines confucéennes qu’à ses plus récentes idéologies politiques (maoïsme).
La Chine s’avère ainsi un territoire fécond pour l’analyse : le sécularisme d’État, initialement ouvertement hostile à la religion (zongjiao) et plus encore aux croyances populaires qualifiées de « superstitions » (mixin), a fini par reconnaître cinq religions « officielles », tout en leur réservant, ainsi qu’aux nouveaux cultes de type sectaire (xinxing zongjiao et xiejiao, comme le mouvement Falungong, persécuté localement) un contrôle d’État. Le sécularisme chinois, plus radical que la laïcité française ou turque, se présente pourtant de la même manière le cadre politico-légal d’une idéologie athéiste. Des travaux comme ceux de Michael Szonyi, Vincent Goossaert, Yang Mayfair Mei-hui ou enfin Benoît Vermander engagent sérieusement une réflexion sur la manière dont la sécularisation et le sécularisme peuvent être pensés à partir du terrain chinois. Si Szonyi examine les possibilités et l’intérêt de transposer à l’histoire et à la sociologie de la Chine une théorie forgée dans le creuset de l’histoire monothéiste occidentale36, Vincent Goossaert a déjà ouvert la voie en montrant le rôle inattendu de revitalisation de la religion qu’a joué non seulement le sécularisme des administrations d’État et des institutions intellectuelles, mais également l’invention de la catégorie de « religion » (zongjiao)37. Yang Mayfair Mei-Hui a récemment réuni une collection d’essais examinant la variété des effets des processus de modernisation
et de sécularisation sur les différentes (grandes ou petites) traditions religieuses chinoises38 alors que Benoît Vermander montre, de manière convaincante, que, si l’Occident a tendance à ériger le christianisme au rang de religion de référence en matière de généalogie de la sécularisation (ou « religion de la sortie de religion » comme le stipule Marcel Gauchet), le confucianisme, dans son contexte, celui d’une Chine engagée dans une modernisation empruntant partiellement seulement à l’Occident, s’est aussi avéré une religion « mondaine » qui s’est autonomisée par rapport à une sphère politique qui s’est sécularisée au fil des siècles39, et a érigé un sécularisme dur (antireligieux) au rang d’idéologie d’État.
Ce ne sont là que quelques exemples, extraits d’un contexte religieux, culturel et politique très particulier, celui de la Chine. Mais d’emblée, on saisit bien là que des causes différentes (d’émergence du sécularisme : politiques et à partir de matrices culturelles différentes) peuvent avoir des effets similaires (contrôle d’État mais regain social) de même que des causes similaires (établissement d’un programme politique sans référence religieuse) peut donner lieu à des effets différents (l’officialisation des cultes « autorisés »). Et que dans tous les cas, l’histoire du sécularisme chinois admet à la fois des similitudes formelles et des écarts significatifs avec d’autres formes du sécularisme, en particulier la laïcité française. Enfin, pour conclure ce bref panorama des possibles en matière de comparaison, il serait aventureux d’ignorer les nombreuses régions plus localisées où le sécularisme œuvre partiellement et lui confère une bien moindre visibilité.
Après que les religions aient bénéficié de ce traitement, c’est désormais la comparaison entre les sécularismes dans les contextes occidentaux et extrême-orientaux qui ouvre ainsi un domaine prometteur et fertile, de nature à réinterroger les catégories conceptuelles des sciences humaines et sociales de la religion, à l’aune de la délocalisation du terrain, et, partant, du décentrement du regard anthropologique, qui affranchit l’analyse des présupposés occidentalo et monothéocentrés des théories classiques ou récentes de la sécularisation. Pour peu, évidemment, que le programme soit mené en parallèle d’une réflexion critique sur les
représentations des sociétés en question, tant elles sont, en particulier pour les sociétés asiatiques – Inde et Chine – construites dans et par l’imaginaire anthropologique comme des « nations spirituelles » (comme l’a montré Stephan Feuchtwang40) où le séculier ne peut surgir historiquement et s’imposer culturellement que de manière contingente et sous la pression de forces exogènes (coloniales).
Conclusion
Le champ d’une anthropologie du sécularisme est donc ouvert, et, loin d’être entièrement circonscris, peut à l’évidence s’ouvrir sur plusieurs chantiers simultanément. Nul n’est besoin de contrarier des questionnements énoncés de fraiche date, ou récemment apparus en anthropologie sociale et culturelle, et dont le caractère heuristique demande à être éprouvé empiriquement et conceptuellement. Car l’anthropologie ne compte pas le sécularisme (ni le reste de son réseau sémantique) parmi les concepts clefs de ses théories41 et s’est toujours montrée circonspecte face aux modèles associant le déclin des religions à la modernité42.
Considérant que de nombreux questionnements dont se saisit actuellement l’anthropologie sur ce thème ont déjà été abordés dans des champs disciplinaires connexes, cette anthropologie a le choix de dépasser – ou non – ses cadres disciplinaires. Plus spécialisées, la sociologie et la philosophie (des sociétés occidentales) ont déjà installé des traditions intellectuelles, autour d’une réflexion sur les conditions d’émergence et les impacts sociaux de la laïcité (dans la perspective du prolifique Jean Baubérot, par exemple) ou d’un questionnement sur les théologies politiques, telles que développées dans la tradition allemande de philosophie.
Faut-il alors que l’anthropologie se rallie à d’autres programmes tracés par dans d’autres creusets disciplinaires ? ou dispose-t-elle déjà de ses propres outils et pistes de recherche ? Le programme asadien présente l’avantage de maintenir l’approche du sécularisme dans le cadre d’une anthropologie politique et critique, c’est-à-dire, d’une anthropologie bien installée dans ses traditions intellectuelles. Mais d’autres programmes peuvent également être mobilisés, et finalement, plusieurs grandes pistes s’offrent à l’analyse anthropologique, à l’image, d’ailleurs, de l’étude transculturelle de la modernité, à laquelle l’anthropologie du sécularisme s’apparente43 : soit faire l’étude du sécularisme comme « invention indépendante » et donc traiter sa généalogie propre dans son contexte d’émergence et de développement, et, partant des « emprunts » dont il a pu faire l’objet (pour reprendre deux concepts clefs de l’anthropologie du début du xxe siècle de Franz Boas, fondateur de l’École Nord-Américaine « culture et personnalité »), soit examiner les racines et développements non-occidentaux du sécularisme, en restituant la part historique, certes, importante, des influences occidentales, mais sans réfuter a priori l’existence de sécularités ou de formes séculières extra-européennes et prémodernes.
En clair, l’identité du sécularisme oscille ainsi entre monogenèse et diffusion, ou phylogenèse (ce qui n’exclue pas la diffusion) : soit il est né de l’Occident chrétien et s’est répandu sur la surface de la planète par imitation ou imposition (ce que semblent quand même confirmer la majorité des travaux historiques), soit il est né ailleurs mais a été fécondé par le modèle occidental du sécularisme, qui, en s’imposant localement, a littéralement « écrasé » les formes séculières antérieures en les délayant dans des représentations de sociétés non-occidentales, religieuses par excès. L’anthropologie, dans ces conditions, peut conserver un domaine de compétences privilégié que lui confèrent ses objets (les cultures et sociétés vivantes) et sa méthodologie (empirique et comparative) mais maintenir le propos dans le registre d’une stricte orthodoxie disciplinaire n’est sans doute pas le plus intéressant à ce propos : sans les données qualitatives et la perspective de l’histoire, les réflexions et les cadres logiques de la philosophie, les données quantitatives et analyses de la
sociologie, sa contribution se limiterait à une ethnographie comparée des comportements et agencements séculiers, alors qu’elle peut porter l’analyse sur le plan plus large de l’ontologie même du sécularisme.
Talal Asad avait donc sans doute raison d’affirmer, il y a déjà presque une décennie que l’anthropologie du sécularisme n’existait pas en tant que telle mais qu’elle restait à fonder. Rien n’a vraiment changé dans ce sens et si l’anthropologie se saisit du sécularisme, c’est encore comme un objet bien plus légitime en sociologie ou en histoire, qui s’est invité, bien malgré les ethnographes, sur leurs terrains de prédilection, après que les religions « tribales », « ethniques » ou « primitives » se soient vues elles aussi affectées par les idéologies et institutions séculières, après le choc des monothéismes expansionnistes. Cette fondation doit néanmoins, idéalement, s’affronter à plusieurs épineux problèmes. En premier lieu, celui de la nécessaire dislocation épistémologique de la figuration relationnelle et projective des sociétés traditionnelles, comme reflet inverse des sociétés modernes, et, partant, d’un principe de symétrie qui dépasse l’opposition « Eux » (les non-Occidentaux, traditionnels, croyants) et « Nous » (les Occidentaux, modernes, non-croyants). En second lieu, celui d’une réévaluation de la place du religieux dans les sociétés « sécularisées » (avec la sociologie des « réveils » ou des « retours » du spirituel) qui n’a curieusement pas encore été accompagnée d’une remise à plat complète de l’asymétrie du regard sur l’Autre, en reconnaissant le séculier ailleurs et d’ailleurs, sauf à pointer du doigt les difficultés rencontrées par un improbable « modèle occidental » du sécularisme à s’imposer sur le plan politique, culturel et idéologique (en tant qu’archétype, respectivement, de la démocratie, de l’humanisme et de l’athéisme). Sur cette base, le vieux modèle diffusionniste, pourtant déjà ancien voire disqualifié en anthropologie, s’avère un outil précieux pour mettre en lumière les sécularismes imposés, d’emprunt ou adoptés par mimétisme, pour affiner les modèles réductionnistes de l’histoire (du religieux au séculier, à travers la modernisation), et pour injecter un semblant de relativisme dans une rédaction ethnocentrée de l’histoire du sécularisme qui fait violence aux dynamiques des sociétés non-occidentales. Enfin, il reste sans aucun doute à l’anthropologie encore un effort à faire pour dépasser l’habitude prise au fil des décennies à inscrire mécaniquement les sociétés « autres » dans la catégorie des sociétés « religieuses », voire à saisir des phénomènes profanes – comme le football, la politique, les festivités
musicales modernes, etc. – avec une grille d’analyse d’anthropologie religieuse. Toute heuristique qu’elle soit, cette démarche ne laisse pas encore la possibilité d’une analyse séculière du sécularisme en anthropologie. Il reste donc à œuvrer dans le sens d’une « déreligionisation » de l’anthropologie dès lors que ses objets ne sont plus ontologiquement ou projectivement religieux …
Lionel Obadia
CREA (EA 3081)
et LARHRA (UMR 5190)
1 Phil Zuckerman, « The Social Scientific Study of Atheism and Secularity », in : Phil Zuckerman (ed.), Atheism and Secularity. Vol. 1 : Issues, Concepts and Definitions, Santa-Barbara, Denver, Oxford : Praeger/ABC-Clio, 2010.
2 Un débat critique que j’ai entamé dans l’article : « Anthropologie, religion et modernité. Quelques réflexions sur le modernisme et le primitivisme des sciences de l’Homme », Parcours anthropologiques, 2004 (4), p. 11-21.
3 Graeme Smith, A Short History of Secularism, Londres, I. B. Taurus, 2008.
4 Voir à ce sujet Henri Desroche, Sociologies religieuses, Paris, PUF, « Le sociologue », 1968.
5 Paul Heelas, et Linda Woodhead, The Spiritual Revolution : Why Religion is giving Way to Spirituality, Oxford, Blackwell, 2004.
6 Cf. Alan Mac Farlane « Ernest Gellner and the Escape to Modernity », in J. A. Hall et I. C. Jarvie (éd.), Power, Wealth and Belief : Essays in Honour of Ernest Gellner, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, p. 121-136.
7 Hunter Baker, The End of Secularism, Weathon (Illinois), Crossway, 2009.
8 Graeme Smith, op. cit.
9 Chez Troelstch, et Weber. Cf. Jean-Pierre Sironneau, Sécularisation et religions politiques, Paris-New York, Mouton, 1982.
10 Jean Baubérot, Laïcité 1905-2005. Entre passion et raison, Paris, le Seuil, coll. « La couleur des idées », 2004.
11 Émile Poulat « Les quatre étapes de la laïcité », in (collectif) Nouveaux enjeux de la laïcité, Paris, Le Centurion, 1990, p. 31-42.
12 Peter L. Berger (éd.), Le Réenchantement du monde, Paris, Bayard, 2001.
13 Marcel Gauchet, Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Paris, Gallimard, 1985.
14 Voir, de ce point de vue, la synthèse éclairante qu’en fait Steve Bruce dans le chapitre « Secularization » dans Bryan S. Turner (Ed.) The New Blackwell Companion to the Sociology of Religion, Chichester (GB), Wiley-Blackwell, 2010, p. 125-140.
15 Comme l’a rappelé entre autres, Barry A. Kosmin, « Contemporary Secularity and Secularism » in B. A. Kosmin, A. Keysar (Eds), Secularism & Secularity. Contemporary International Perspectives, Hartford (CT), ISSSC, 2007.
16 Cf. par exemple, Albert Piette, Les Religiosités séculières, Paris, PUF, 1993.
17 Cf. Lionel Obadia, Anthropologie des religions, 2e édition, Paris, La Découverte, 2012.
18 Cf. le chapitre « What might and Anthropology of Secularism Look Like ? » dans son ouvrage Formations of the Secular. Christianity, islam and Modernity, Stanford, Stanford University Press, 2003, p. 21-66.
19 James K. A. Smith, « Secularity, Religion, and the Politics of Ambiguity », Journal for Cultural and Religious Theory, 6 (3), 2005, p. 116-121.
20 Patrick Cabanel, Le Dieu de la République. Aux sources protestantes de la laïcité (1860-1900), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. « Carnot », 2003.
21 Comme l’a fait Louis Dumont, Essais sur l’individualisme. Une perspective anthropologique sur l’idéologie moderne, Paris, Le Seuil, 1983.
22 Graeme Smith, op. cit., p. 2
23 Michel Onfray, Traité d’athéologie, Paris, Grasset, 2005, p. 279-281.
24 Danilo Martucelli, Sociologies de la modernité, Paris, Gallimard, 1999.
25 La Laïcité pour l’égalité, p. 28
26 En Turc « laiklik » est un dérivé du terme français « laïcité », mais dans le système turc, les laïcs sont « anti-religieux » et le régime de laiklik est un régime de contrôle direct de la religion par l’État, et non pas un régime de séparation comme en France. Informations tirées de l’intervention de Chérif Ferjani lors de la journée d’études « autour du sécularisme » (Lyon 3, IRPhiL, 7 février 2010)
27 Les Laïcités dans le monde, Paris, PUF, 2010.
28 Jean-Dominique Durand (dir.), « Quelle laïcité en Europe ? », Chrétiens et sociétés, Documents et Mémoires no 2, Lyon, Institut d’Histoire du Christianisme/LARHRA, 2003.
29 Hunter Baker, op. cit., p. 21.
30 http://www.trincoll.edu/Academics/centers/isssc/Pages/default.aspx
31 Barry A. Kosmin, Ariela Keysar, Secularism & Secularity. op. cit.
32 Ahmet T. Kuru, Secularism and State Policies toward Religion. The United States, France, and Turkey, Cambridge, Cambridge University Press, 2009.
33 Barry A. Kosmin, « Contemporary Secularity and Secularism », op. cit., p. 3.
34 Christophe Jaffrelot, Aminah Mohammad-Arif (dir.), Politique et religions en Asie du Sud. Le sécularisme dans tous ses états ?, Paris, EHESS, coll. « Purusartha », 2012.
35 Abdoulaye Sounaye « Ambiguous Secularism. islam, Laïcité and the State in Niger », Civilisations, vol. LVIII, 2, décembre 2009, p. 41-57.
36 Michael Szonyi, « Secularization theories and the Study of Chinese Religions », Social Compass 56 (3), 2009, p. 312-327.
37 Vincent Goossaert, « The Concept of Religion in China and the West », Diogenes, 2005, 52, p. 13-20.
38 Yang Mayfair Mei-Hui (ed.), Chinese Religiosities : Afflictions of Modernity and State Formation, Londres, Berlekey, Los Angeles, University of California Press, 2008.
39 Benoît Vermander, « Réveil religieux et sortie de la religion en Chine Contemporaine », Perspectives chinoises, 2009 (4), p. 4-17.
40 Stephan Feuchtwang, « India and China as spiritual nations : a comparative anthropology of histories », Social anthropology, 17 (1), p. 100-108.
41 George Shulman, « Redemption, Secularization, and Politics », in D. Scott, C. Hirschkind (eds), Powers of the Secular Modern : Talal Asad and his Interlocutors, Stanford, Stanford University Press, 2006, p. 154.
42 Robert W. Hefner, « Multiple modernities : Christianity, islam and Hinduism in a Globalizing Age », Annual Review of Anthropology, 1998, 27, p. 83-104.
43 Lionel Obadia « Religions et modernités : anciens débats, enjeux présents, nouvelles perspectives », Socio-anthropologie, « Religions et modernités », no 17-18 (double), 1er sem. 2006, p. 9-42.