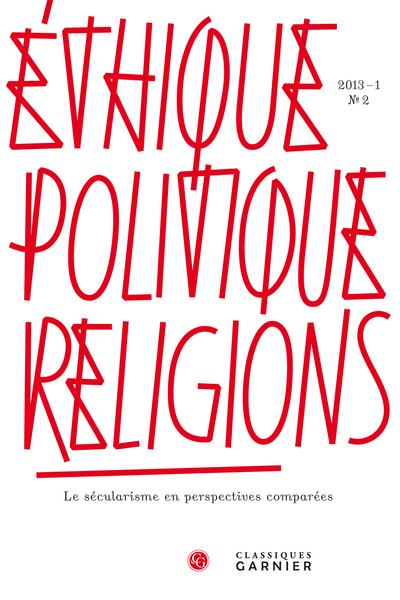
La pensée post-métaphysique face au « défaitisme de la raison » Une discussion de Entre naturalisme et religion, de Habermas
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Éthique, politique, religions
2013 – 1, n° 2. Le sécularisme en perspectives comparées - Auteur : Monod (Jean-Claude)
- Résumé : La série d’essais récents que Habermas a consacrés à la place de la religion dans les démocraties contemporaines suggère celles-ci devraient inciter les citoyens « séculiers » ou athées à s’ouvrir davantage aux ressources éthiques et symboliques des grandes religions monothéistes, pour faire face à deux périls : la perte de solidarité qui accompagne l’essor du capitalisme néolibéral, et les perspectives de manipulation indéfinie du vivant par les biotechnologies. Cet article discute la pertinence des arguments de Habermas et s’interroge sur l’évolution qu’a suivie l’auteur de la Théorie de l’agir communicationnel, qui semble aujourd’hui gagné par ce qu’il déplorait jadis comme un « défaitisme de la raison » : la rationalité séculière ne peut-elle fournir elle-même des normes éthiques et politiques susceptibles de répondre aux dangers évoqués ?
- Pages : 87 à 98
- Revue : Éthique, politique, religions
- Thème CLIL : 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN : 9782812412004
- ISBN : 978-2-8124-1200-4
- ISSN : 2271-7234
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-1200-4.p.0087
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 03/07/2013
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : sécularisation, rationalité, démocratie, Habermas, solidarité
La pensée post-métaphysique
face au « défaitisme de la raison »
Une discussion de Entre naturalisme et religion,
de Habermas
« Qui veut éviter une guerre des cultures doit se remettre en mémoire la dialectique inachevée du propre processus de sécularisation de l’Occident1 », notait Jürgen Habermas dans un récent discours sur les rapports entre foi et savoir. L’idée d’une dialectique de sécularisation visait à mettre en lumière un processus biface : l’instance politique-étatique et les instances religieuses-ecclésiales se sont transformées les unes et les autres à l’épreuve du pluralisme, de la tolérance et de la sécularisation, dont les effets se sont exercés à la fois sur les formes de vie religieuses (qui ont gagné la sphère privée et « sociale » et abandonné leur position hégémonique-coercitive appuyée par l’État) et sur les formes de vie politiques (qui ont dû renoncer au monopole de la religion et/ou de l’interprétation du « sens » dernier de l’existence collective). Elle invitait à concevoir les intégrismes et les « retours du religieux » comme des réactions au processus de sécularisation, qui sont aussi « modernes » dans leurs moyens et leurs formes d’action et leur inscription dans l’économie capitaliste qu’elles sont « anti-modernes » dans leurs valeurs et leur opposition radicale à la sécularisation « occidentale ». Le thème d’une dialectique de sécularisation constituait aux yeux de Habermas une voie pour favoriser les conditions d’un pluralisme réel, c’est-à-dire un pluralisme moderne qui ne cherche pas à éradiquer les visions discordantes, mais qui permette aux courants anti-sécularistes de s’exprimer pacifiquement sans mettre en péril la structure des sociétés sécularisées.
Le propos d’un certain nombre des essais rassemblés dans le recueil Entre naturalisme et religion reprend, approfondit et déplace quelque
peu cette perspective. Ce volume est composé un peu de bric et de broc : on n’a pas affaire ici à un ouvrage fortement charpenté, mais à un ensemble d’articles sur des sujets variés, de la vieille querelle de la liberté et du déterminisme ranimée par le réductionnisme neurologique jusqu’à l’idée d’une constitution politique mondiale en passant par un hommage à Adorno, le fil rouge est assez ténu. Nous privilégierons ce qui concerne cette thématique des rapports entre philosophie et religion, que Habermas creuse depuis plusieurs années.
« Une conscience de ce qui manque »
Habermas inscrit son entreprise sous le patronage de la philosophie kantienne de la religion. Il ne s’agit pas de reprendre le contenu déterminé de cette philosophie : il s’agit plutôt de reprendre et d’actualiser le geste essentiel, soit la délimitation des exigences réciproques adressées par Kant en direction d’une raison consciente de ses limites et d’une foi « dans les limites de la simple raison ». Habermas plaide à son tour pour un dialogue critique et autocritique entre la philosophie et ce qu’il nomme tantôt « la religion », tantôt « l’héritage religieux », tantôt les « traditions religieuses », tantôt les ressources normatives des religions – on constate un certain flou, à cet égard. Mais l’accent se porte d’avantage aujourd’hui, dans le propos de Habermas, sur cette part d’autocritique attendue de la rationalité philosophique – et c’est sur ce point que ce livre peut faire débat. L’un des principaux défis contemporains de la démocratie semble être en effet, pour Habermas, d’éveiller chez ses citoyens « laïcs » ou « séculiers », à l’égard des traditions religieuses, une « disposition à apprendre2 ». Habermas marque ainsi clairement l’infléchissement qui sépare, à ses yeux, l’ancienne tâche philosophique de Religionskritik, nécessaire en son temps (disons : du xviie siècle au xixe siècle, ou à la première moitié du xxe siècle), et la tâche actuelle : « dans l’Occident européen, le temps des oppositions entre des compréhensions anthropocentrique et théocentrique est révolu. Nous avons plus intérêt désormais
à tenter de récupérer les contenus bibliques dans une foi de raison qu’à combattre la soutane et l’obscurantisme3 ». Le diagnostic ne doit-il pas nous surprendre, même s’il a été amorcé par Habermas depuis plusieurs années ? Le penseur de la raison communicationnelle ne croit-il plus dans les seules ressources de la rationalité pratique et communicationnelle pour fournir une base motivationnelle suffisante face à des périls caractérisés de diverses façons : « une modernité qui tend à sortir de ses rails » (p. 14), « une conscience normative qui s’étiole de tous côtés » (p. 14), « la progression du naturalisme et de sa foi aveugle dans la science » (p. 150), etc. Habermas récuse certes tout recours « antimoderne » à une tradition biblique ou à une théologie politique reconstruite, tel qu’on le verrait pratiqué par Leo Strauss ou Carl Schmitt (p. 55 et p. 162), et plus encore ce qu’il considère comme les errements d’une « philosophie religieuse » qui mêle à une « spéculation néopaïenne » un « vocabulaire eschatologique » dont elle efface les traces – visant ici Heidegger (p. 60). Mais il estime que la rationalité gagnerait à prendre « conscience de ce qui manque » – selon le titre d’un chapitre suggestif, qui s’ouvre sur l’évocation de l’enterrement sans prêtre ni bénédiction, mais dans une église, de l’agnostique Max Frisch –, et c’est clairement ici dans le domaine pratique-éthique que Habermas situe essentiellement ce « manque » – dans le sillage de l’attente kantienne d’un soutien des représentations religieuses aux obligations pratiques, aux devoirs éthiques envers autrui, aux « idéaux porteurs d’une obligation collective » (p. 146). « La raison pratique, – estime Habermas qui commente Kant –, manque à sa destination si elle n’a plus la force de faire prendre conscience aux cœurs profanes de ce que la solidarité est partout dans le monde offensée, si elle n’a plus la force d’éveiller et d’entretenir une conscience de ce qui manque, de ce qui scandalise » (p. 146). Si Habermas se reconnaît dans ce souci kantien, il se demande comment faire jouer cette intuition, cette préoccupation, dans le cadre d’une pensée « post-métaphysique ».
Une nouvelle évaluation des ressources religieuses
pour la philosophie
Le souci de préserver des schèmes éthiques fondamentaux historiquement liés, en Occident, au judéo-christianisme – intégrité et unité de la personne, égalité essentielle des êtres humains, solidarité avec les humiliés et les offensés – n’est pas nouveau chez Habermas. Mais une certaine évolution ou inflexion semble avoir marqué sa relation aux ressources qu’il mobilise à cette fin. Pourquoi Habermas, pour le dire dans les termes de Max Weber qu’il n’a cessé de reprendre et de retravailler, ne fait-il plus confiance à l’énergie de la Wertrationalität, de la « rationalité en fonction de valeurs », nourrie et instruite au plan politique par l’instance dialogique de la « raison communicationnelle », pour contrer les effets réifiants et aliénants de l’expansion de la Zweckrationalität, de la « rationalité instrumentale » qui, laissée à elle-même, finit dans le pur déploiement d’une exploitation sans frein des (significativement nommées) « ressources humaines » et constitue toutes choses en « moyens » ? Dans Théorie de l’agir communicationnel comme encore dans Le Discours philosophique de la modernité, le principal héritier (avec Axel Honneth) de l’école de Francfort se démarquait de ses maîtres Adorno et Horkheimer, mais aussi de Walter Benjamin, pour leur tableau apocalyptique commun de la rationalisation moderne, en faisant valoir l’existence d’un « contenu normatif de la modernité », irréductible à la seule montée en puissance de la rationalité instrumentale, et « concrétisé » dans des instances de protection et de solidarité institutionnalisées (État de droit, État-Providence, etc.) ou non (mouvements sociaux et politiques de solidarité avec les démunis, les exploités, les minorités, etc.). S’il thématisait bien (mais c’est là un topos de la philosophie allemande, depuis Hegel au moins4) ce « contenu normatif de la modernité » comme une forme de sécularisation des représentations judéo-chrétiennes de l’égalité et de l’intégrité de la personne à travers leur « réalisation » juridique et politique dans l’État de droit moderne, il ne jugeait pas alors nécessaire une réactivation de cette « source » religieuse : le résultat sécularisé valait pour lui-même, et Habermas marquait plutôt
sa distance à l’égard des accents « religieux » de ceux des représentants de l’école de Francfort qui maintenaient l’horizon d’une rédemption ou d’un messianisme (au parfum éventuellement révolutionnaire), comme Benjamin. De même, il reprochait explicitement à Max Weber de ne pas avoir pris en considération la possibilité et l’effectivité d’une « éthique communicationnelle détachée du fondement d’une religion de la rédemption » (Théorie de l’agir communicationnel, trad. fr., t. 1, p. 253).
Un revirement mystérieux
Que s’est-il passé pour qu’un revirement se soit produit chez Habermas sur ce point ? La chose reste, à vrai dire, mystérieuse. Habermas semble avoir fait sienne l’idée selon laquelle la rationalité serait incapable de fournir par elle-même un « concept de la vie bonne » (p. 164) – une idée qu’il trouvait exprimée chez Max Weber et taxait alors, encore assez récemment, de « positivisme », ou qu’il tenait pour procédant d’une vision restrictive de la rationalité. Selon l’auteur de la Théorie de l’agir communicationnel, abandonner les « points de vue éthiques » ultimes à la décision, donc à l’irrationnel, était le signe, chez Max Weber, d’un défaitisme de la raison partagé, aux yeux de Habermas, par les auteurs de la Dialektik der Aufklärung. On peut évoquer ainsi un texte typique du pessimisme de Horkheimer, « Raison et conservation de soi », que citait Habermas dans la Théorie de l’agir communicationnel :
Que chez le bourgeois la raison ait toujours déjà été définie par rapport à la conservation de soi, va visiblement à l’encontre de la définition exemplaire de Locke, suivant laquelle la raison se caractérise par le fait qu’elle dirige l’activité intellectuelle, sans tenir compte des fins que cette dernière peut toujours servir. Mais la raison est bien loin de se séparer de cette fin déterminée en sortant de la fascination de l’auto-intérêt de la monade : elle n’élabore au contraire que des procédures pour servir plus complaisamment encore n’importe quelle fin chérie par la monade. L’accroissement de l’universalité formelle de la raison bourgeoise ne signifie pas que s’accroisse la conscience de la solidarité universelle5.
Face à cette rationalité monadique et dissociée d’une morale de la solidarité, Adorno et Horkheimer ne présenteraient, selon Habermas, qu’une « opposition abstraite » - c’est la « bouteille à la mer » d’Adorno, la recherche d’une esthétique pointant les failles, l’irréconciliation et un horizon non-dialectique de plénitude possible, mais dont l’accès paraît quasi mystique. Ce défaitisme de la raison serait le résultat, comme chez Weber, d’un concept restreint de la raison : Habermas voyait dans cette vision d’une raison indifférente aux fins, amputée de sa portée pratique, le corrélat d’un concept positiviste de science, celui que construit Weber en plaçant hors de son champ tout le domaine du « devoir être ».
Or d’un côté, Habermas maintient aujourd’hui la référence à une raison communicationnelle et d’un contenu normatif de la rationalité, mais d’un autre côté, il semble avoir opéré une radicalisation de l’idée libérale selon laquelle une société tolérante mais aussi une philosophie tolérante et post-métaphysique doit s’en tenir à une « réserve » fondamentale sur les fins que s’assignent les individus, en fonction de leurs croyances respectives. « Si une pensée postmétaphysique est astreinte à la retenue éthique, note-t-il, puisque tout concept de vie bonne et exemplaire lui échappe avec ce qu’il suppose en général d’obligations, à l’inverse, les Ecritures saintes et les traditions religieuses expriment des intuitions, évoquant la faute, la rédemption, l’issue salvatrice d’une vie vécue dans l’irrémédiable, qui, au fil des siècles, ont été méticuleusement égrenées et herméneutiquement entretenues » (p. 164). La philosophie post-métaphysique se voit donc astreinte à une retenue éthique, mais elle garde un rôle d’éclaircissement et de traduction. « La philosophie […] ne peut, dans son rôle de traductrice, que favoriser la concorde morale, juridique et politique, en apportant ses lumières dans la multiplicité légitime des projets de vie substantiels développés par les croyants, de quelque confession qu’ils soient, ou par les non-croyants, mais sans intervenir comme un concurrent “mieux-sachant” » (p. 50).
Cette position en retrait procède aussi, semble-t-il, d’une perception très inquiète des effets du « naturalisme » et du scientisme sur la perception de soi des individus des sociétés occidentales : la montée en puissance du naturalisme saperait ainsi les représentations éthiques fondamentales de la « personne irremplaçable » (p. 133), de l’individu
libre (contre tout déterminisme neurologique strict), et ruinerait peu à peu les bases motivationnelles de l’altruisme et de la solidarité. Le précédent des redoutables conséquences éthico-politiques du « darwinisme social » pourrait être ici évoqué, mais Habermas a également pointé, dans un ouvrage récent (L’Avenir de la nature humaine), les dangers d’un certain « eugénisme libéral » qui se fait jour. La perspective de voir les individus classés, voire « autorisés » à accéder à l’existence en fonction de leur patrimoine génétique, n’est pas de l’ordre de la science-fiction, et l’on accordera volontiers à Habermas qu’une certaine volonté de « liquider » radicalement tout « héritage judéo-chrétien » peut finir par détruire certaines barrières éthiques précieuses, notamment le sentiment d’une égale dignité de tout être humain. Habermas est cependant conscient des risques inverses, ceux qui, au nom d’une dignité inconditionnée de la « vie », reviennent à dénier aux femmes le droit d’avorter, et il n’apporte pas vraiment de réponse théorique nouvelle à l’interrogation sur le moment où l’opposition aux biotechnologies devient une fermeture irrationnelle à certains progrès possibles.
Sécularisation et solidarité :
insuffisances de la raison pratique ?
Le plaidoyer en direction d’une ouverture de la rationalité démocratique aux sensibilités religieuses se place aussi sur le terrain pratique des solidarités face à l’extension indéfinie d’une logique marchande. Il y a peut-être là, à l’arrière-plan, une expérience sociale et politique familière : quiconque a participé à des mouvements de solidarité avec des populations socialement exposées a dû constater qu’une part non négligeable des « troupes » des mouvements d’aide aux démunis, des associations de solidarité, qui vont du secteur caritatif au soutien aux sans-papiers, aux demandeurs d’asile, etc., est bien constituée par des individus issus de mouvances confessionnelles, en particulier, sous nos latitudes, chrétiennes. Or, écrit Habermas, « la division du travail entre les mécanismes d’intégration du marché, de la bureaucratie et de la solidarité économique s’est déséquilibrée, et tend à laisser la place à des
impératifs économiques qui désormais prévalent sur les rapports favorables à l’épanouissement individuel entre des sujets agissant de conserve » (p. 48). Or face à ce processus, « les sensibilités sont de moins en moins réceptives aux pathologies sociales, et à la vie gâchée en général » (Ibid.). C’est ce déficit de sensibilité à la vie diminuée que les traditions éthiques religieuses pourrait contribuer, selon Habermas, à corriger, en réveillant peut-être le sentiment de la « solidarité des ébranlés » dont parlait Patocka. Car ces traditions seraient porteuses de « quelque chose d’intact, qui ne se retrouve nulle part ailleurs […] – je veux parler de sensibilités et de possibilités d’expression suffisamment différenciées pour pouvoir évoquer la vie faillie, les pathologies sociales, les échecs des projets individuels de vie ou la dégradation des conditions de vie » (p. 164-165).
Il est difficile de prendre position sur ce « nulle part ailleurs », qui relève d’une profession de foi. Il ne s’agit certes pas de répéter la « critique de la religion » à la façon du scientisme triomphant du xixe siècle qui est parfois allé jusqu’à appeler à la destruction active des Églises et à l’extirpation de tout contenu éthique judéo-chrétien (y compris l’idée d’égalité), et on accordera volontiers à Habermas qu’une disposition « ouverte » à l’égard des éthiques religieuses peut contrecarrer utilement une forme purement fonctionnaliste de rationalité, conçue comme la maximisation de l’efficacité. De même, l’idée de dignité humaine a bien un certain halo religieux qu’on ne se hâtera pas de détruire sous ce prétexte, comme cela a été régulièrement fait dans la construction de programmes eugénistes au xxe siècle. De même, enfin, l’idée ou la tâche d’une traduction de schèmes religieux dans la langue non-confessionnelle et non-communautaire de la philosophie est assurément intéressante, dans la filiation de la vision hégélienne d’une philosophie de la religion qui sache transformer les représentations en concepts, mais sans la prétention hégélienne à effectuer ainsi la « réalisation » dans le savoir d’une pensée d’abord « seulement » symbolique. On entend encore ici la forte formule lancée par Habermas dans Glauben und Wissen : « une sécularisation qui ne détruit pas s’accomplit sur le mode de la traduction ».
Qu’il s’agisse de la réflexion sur les éventuels « fondements prépolitiques de l’État de droit démocratique », selon la formule de Böckenförde longuement discutée par Habermas, ou de la thématique benjaminienne d’une solidarité remémorante, engageant la responsabilité vis-à-vis de ce qui n’a pas été fait, la mémoire des torts et des vaincus de l’Histoire, en
une traduction du thème biblique, messianique, d’un passé qui appelle sa rédemption, les voies indiquées par Habermas au titre d’une telle tâche de traduction sont fécondes, à titre d’enrichissement de la pensée séculière. Mais cela me semble beaucoup moins convaincant lorsque Habermas suggère que seules des ressources religieuses peuvent apporter des forces motivantes à une rationalité désespérée d’elle-même.
Autant il me paraît indéniable que quelque chose de la valorisation chrétienne d’« une humanité à l’image de Dieu [a été] transposée dans l’égale dignité et le respect inconditionnel dû à tous les hommes » (p. 165), autant il me paraît contestable d’affirmer que les plus fortes (voire les seules ?) réserves normatives dont nous disposions face à l’érosion des solidarités résident dans les « Ecritures saintes et les traditions religieuses », avec leur trésor d’« intuitions » (p. 164). Ce que Habermas a si souvent déploré comme un « défaitisme de la raison » ne l’a-t-il pas gagné à son tour ? Ne peut-on dire qu’une pensée séculière de la dignité et de l’égalité s’est constituée depuis longtemps, sans doute partiellement sous l’effet d’une sécularisation des contenus chrétiens, mais aussi en lutte contre les limites d’une conception « seulement » métaphysique et religieuse de l’égalité ? Habermas ne le nierait pas, mais il semble convaincu que cette éthique séculière est aujourd’hui insuffisante ou épuisée. On n’est nullement obligé de le suivre dans cette voie.
Quelles ressources pour une pensée
post-métaphysique ?
Ce qui motive mon intérêt pour la question de la foi et du savoir, écrit Habermas, c’est le désir de mobiliser la raison moderne contre le défaitisme qu’elle couve en son sein. La pensée post-métaphysique peut tout à fait surmonter seule ce défaitisme lorsqu’il se manifeste dans les accents postmodernes mis sur la « dialectique de la raison », ou dans la foi servile en la science dont fait preuve le naturalisme. Il en va autrement d’une raison pratique qui ne peut plus compter sur la caution d’une philosophie de l’histoire et s’est mise à désespérer de la force motivante de ses raisons, tant il est vrai que les tendances au déraillement de la modernité viennent moins conforter les commandements de sa morale de justice qu’elles ne les contrecarrent (p. 145).
Habermas distingue donc différentes répliques face à ce danger qui prend lui-même différentes formes. Il rappelle ici la réplique qui a été la sienne au défaitisme de la raison dans sa version post-métaphysique, qu’il n’a cessé de combattre dans sa variante française (Foucault et Derrida) ou américaine (Rorty) : ici, les ressources internes de la philosophie post-métaphysique seraient suffisantes pour traquer les contradictions et les faiblesses des positions adverses. De même, face au scientisme, la pensée post-métaphysique peut faire valoir différents arguments contre le déterminisme rigide, elle peut notamment pointer la confusion entre liens nomologiques (liens causaux dans un enchaînement entre faits) et liens sémantiques (entre des énoncés ou des raisons). En revanche, la pensée post-métaphysique ne suffirait plus à mobiliser la raison pratique une fois perdu le soutien ou la caution d’une philosophie de l’Histoire. Pourquoi ? Parce qu’ici, ce n’est plus affaire d’intelligence mais de décision (décision d’agir de façon solidaire) et d’exhortation (d’auto-exhortation). Il y a peut-être ici un aspect autobiographique dans la réflexion de Habermas, qui renvoie à son propre détachement progressif vis-à-vis du marxisme, auquel il est fait allusion lorsqu’il évoque « une raison pratique qui ne peut plus compter sur la caution d’une philosophie de l’histoire et s’est mise à désespérer de la force motivante de ses raisons ». Dans le Discours philosophique de la modernité, encore, Habermas traitait Foucault un peu comme un renégat de la gauche et du marxisme, en citant des lignes très ironiques de Foucault à propos du « mythe de la Révolution » et de la philosophie de l’histoire dialectique6. Or Habermas s’est lui-même éloigné de cet horizon. Dans Droit et morale, par exemple, il déclarait : « dès lors que la confiance historico-philosophique dans la dialectique de la raison et de la révolution, dont le scénario avait été envisagé par Hegel et par Marx, est historiquement usée, la voie réformiste des essais et des erreurs est désormais la seule moralement défendable7 ». Une décennie plus tard, la voie réformiste reste ouverte pour Habermas, mais elle semble manquer de carburant civique. L’expérience d’un certain triomphe des politiques « anti »-solidaires, si l’on peut dire (le néolibéralisme, le tout
marché, le développement exponentiel de l’économie spéculative, de la spéculation outrancière et de ses effets sociaux dévastateurs, avant même la crise financière internationale…), les « réformes » dirigées plutôt vers le démantèlement des structures de solidarité… tout cela a changé les perceptions politiques de la « modernisation ». On le comprend bien. Mais est-ce vraiment du seul côté de la « traduction » des schèmes religieux que l’on peut et doit chercher une réponse à cet affaiblissement (éthique) et à ce revirement des politiques réformistes ? On peut être sceptique sur ce point.
Dans le passage cité plus haut, ce qui me semble problématique, c’est l’asymétrie posée a priori entre, d’un côté, la pensée philosophique post-métaphysique, à qui est imposée une retenue éthique, et, de l’autre, les Ecritures saintes et les traditions religieuses qui sont investies de conceptions et d’intuitions donnant contenu à la vie bonne. Pourquoi la pensée post-métaphysique serait-elle vouée à une telle retenue éthique ?
Que les religions puissent fournir des schèmes, des exhortations, des motivations morales en vue d’un engagement pour la justice ou la solidarité, je ne le nierai nullement. Que la philosophie cherche à traduire certaines de ces représentations ou exhortations dans un langage séculier et délié de toute obligation rituelle, délié aussi de toute appartenance communautaire, cela paraît hautement légitime, et on peut dire en effet que de Kant à Levinas, elle n’a cessé de le faire. Mais dans son souci d’ouvrir les citoyens « séculiers », agnostiques, etc., à l’écoute des ressources religieuses, il me semble que Habermas en vient à minorer les ressources éthiques propres aux idéaux et aux logiques politiques qui se sont construites à partir de normes de justice qu’on peut concevoir sans référence à une souche religieuse. Une vision articulée, conforme à la complexité historique et généalogique, ne doit assurément pas renvoyer la religion à une fonction uniformément « obscurantiste », au règne de l’hétéronomie et du préjugé, selon une version manichéenne d’un certain progressisme. Mais elle ne devrait pas non plus verser dans le conte de fées crypto-apologétique, selon lequel l’autonomie, la liberté de conscience, etc., auraient été le simple produit historique du christianisme en son auto-déploiement. Comme si l’histoire moderne n’avait pas été traversée de combats, de conflits pour assurer l’autonomisation du champ scientifique, par exemple, pour une plus grande liberté individuelle, ou dans le domaine des mœurs, en particulier sexuelles, etc. On constate
aujourd’hui cette tendance à remplacer ou à renverser le grand récit de l’émancipation par un grand récit de la modernité comme produit du déploiement « nécessaire » d’une « logique » chrétienne. Ce nouveau grand récit inversé a des effets de distorsion au plan historiographique, et il n’est pas sûr qu’il ait des effets particulièrement libéraux au plan politique – notamment en raison de la contrepartie négative de cette histoire apologétique : d’autres sphères culturelles et religieuses seraient, elles, intrinsèquement et « théologiquement » étrangères à cet horizon de l’autonomie, de la sécularisation et de la démocratie. L’islam, ici, est le repoussoir essentialisé du grand récit de la « sécularisation par le christianisme ».
Jean-Claude Monod
CNRS – Archives Husserl
1 Jürgen Habermas, Glauben und Wissen, Francfort/Main, Suhrkamp, 2001, p. 11.
2 Jürgen Habermas, Entre naturalisme et religion. Les défis de la démocratie, traduit de l’allemand par Christian Bouchindhomme et Alexandre Dupeyrix, Paris, Gallimard, 2008, p. 165-166.
3 Ibid., p. 13-14.
4 Je me permets de renvoyer sur ce point à mon ouvrage La Querelle de la sécularisation, de Hegel à Blumenberg, Paris, Vrin, 2002.
5 Horkheimer, « Raison et conservation de soi », in Horkheimer, Éclipse de la raison, trad. fr., Paris, Payot, 1974, p. 207, cité par Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, t. 1, trad. fr. J.-M. Ferry, Paris, Fayard, 1987 (éd. allemande : 1981), p. 392.
6 Voir à ce propos notre article sur Habermas et Foucault dans Yves Cusset & Stéphane Haber (éd.), Habermas et Foucault. Parcours croisés, confrontations critiques, Paris, CNRS éditions, 2006, p. 85-95.
7 Jürgen Habermas, Droit et morale, trad. fr. de Ch. Bouchindhomme et R. Rochlitz, Paris, Seuil, 1997, p. 71.