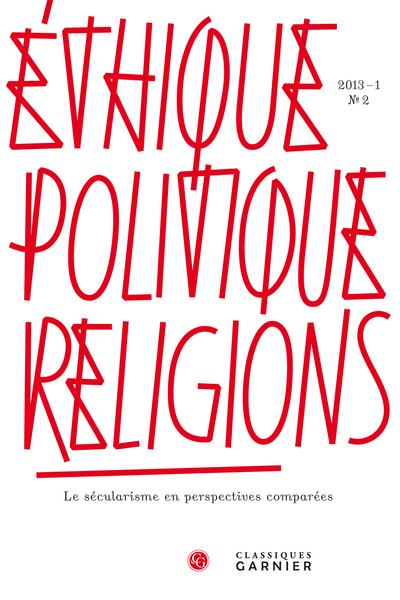
Entre revendication de sécularisme et « théorème de sécularisation » Le statut de la modernité philosophique
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Éthique, politique, religions
2013 – 1, n° 2. Le sécularisme en perspectives comparées - Auteur : Gontier (Thierry)
- Résumé : Si le terme de sécularisme est souvent employé pour signifier quelque chose comme une « sortie de la religion », celui de sécularisation est plus ambigu, signifiant (en son sens moderne) à la fois le passage du religieux au séculier et la permanence refoulée du religieux dans ce même séculier. Le « théorème » de sécularisation, ainsi que la formule de Hans Blumenberg, prend ici son sens polémique, désignant une forme de mystification de la modernité prétendue laïque. Nous voulons ici retracer quelques grandes étapes de la « querelle » (Jean-Claude Monod) de la sécularisation depuis Carl Schmitt jusqu’à Hans Blumenberg et au-delà, en passant notamment par Erik Peterson et Karl Löwith. La question posée, à travers ce parcours historique, est celle d’une permanence assumée (qui ne soit donc pas de l’ordre de l’automystification) du religieux dans nos sociétés contemporaines laïques.
- Pages : 65 à 86
- Revue : Éthique, politique, religions
- Thème CLIL : 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN : 9782812412004
- ISBN : 978-2-8124-1200-4
- ISSN : 2271-7234
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-1200-4.p.0065
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 03/07/2013
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : sécularisme, sécularisation, religieux (permanence du), Blumenberg (Hans), Schmitt (Carl), Peterson (Erik), Löwith (Karl).
Entre revendication de sécularisme
et « théorème de sécularisation »
Le statut de la modernité philosophique
Dans l’usage courant, nous entendons par « sécularisme » le mouvement historique – ou la situation qui a découlé de ce mouvement – de constitution d’un espace, intellectuel comme institutionnel, séculier autonome, libéré de la tutelle du religieux. En un sens, le sécularisme désigne une revendication attachée à l’acte même de philosopher depuis ses origines. Ainsi, les physiciens ioniens ont les premiers donné une interprétation « séculière » des origines du cosmos, en faisant référence non à des divinités, mais à des éléments matériels (l’eau, le feu, etc.). Platon a donné à cette revendication une orientation politique : la cité platonicienne est dégagée de la théologie traditionnelle, qui fait les dieux immoraux et flatte les tendances individualistes contraires à l’esprit civique1. Il est vrai que Socrate, accusé de ne pas vénérer les dieux de la cité, se défend de l’accusation d’athéisme, mais il ne se disculpe pas de ne pas croire aux dieux de la cité (ce qui était le chef d’accusation) : le divin prend chez lui non la forme que lui donne la théologie « civile » (terme plus tardif, dont la première occurrence connue se trouve chez Varron, pour décrire précisément ces théologies qui sont comme des créations spontanées de la cité), mais une forme purement rationnelle, celle du Bien, ou du cosmos qui en est l’image sensible.
Mais cette revendication de « sécularité » est avant tout caractéristique de la modernité, où elle se trouve associée à une critique, souvent radicale, de la religion. Les théoriciens du droit naturel revendiquent une politique débarrassée de toute fondation surnaturelle, et fondée sur la raison seule, exprimée dans des lois universelles et connues
publiquement. Pour Spinoza, si le gouvernement humain doit imiter le gouvernement divin, c’est par sa fondation sur des lois rationnelles2. Et l’on a souvent remarqué que dans le frontispice du Léviathan de Hobbes, la représentation du souverain, qui tient dans sa main droite le glaive et dans main gauche la crosse de l’évêque, symboles respectifs du pouvoir temporel et spirituel (le théologique étant ainsi doublement soumis au politique : parce que c’est le souverain qui tient la crosse, et parce qu’il la tient de sa main gauche), est comme une inversion symétrique de celle, commune au moyen âge, du Christ3. Cette revendication de sécularité est toujours d’actualité au niveau politique. Chez John Rawls, par exemple, l’artifice du voile d’ignorance a pour première fin d’opérer une distinction entre la justice politique et les doctrines métaphysiques ou « comprehensive » du bien : par ce terme, Rawls entend les conceptions de la nature du souverain bien, conceptions qui ressortissent en particulier des engagements religieux personnels, et doivent donc être mis à l’écart de la détermination d’une justice socio-politique purement séculière4.
À l’encontre de cette prétention, une question s’élève de façon récurrente depuis les années 1920 et l’ouvrage emblématique de Carl Schmitt Théologie politique (1922)5 : cette mise à l’écart du théologique n’est-elle pas un leurre ? C’est dans ce cadre que s’est développée ce que Jean-Claude Monod a nommé la « querelle de la sécularisation6 ». Car le terme de « sécularisation », en son sens actuel, possède une nuance connotative que n’a pas le terme de « sécularisme », à savoir l’idée d’une forme de permanence du théologique dans le processus de laïcisation de la modernité – et donc, précisément, d’une négation de ses prétentions au « sécularisme ». Cette tension entre deux termes
en apparence proches porte en elle l’une des questions récurrentes de la pensée dite « postmoderne », à savoir celle de la « légitimité » de la modernité (pour reprendre l’expression de Blumenberg7) et des valeurs dont elle se réclame : la laïcité, le rationalisme, le progrès, l’autonomie, etc. De ces questions dépend celle de la relève de la modernité à partir de la ressaisie critique de ses propres fondements : s’agit-il de renouer avec le lien perdu à un théologique prémoderne, ou d’assumer, voire d’accomplir, le projet d’autonomie initié par cette modernité ? C’est dans ce cadre problématique que je me propose d’examiner ici l’un des usages principaux de ces notions dans la philosophie contemporaine.
La modernité comme prisme du sécularisme
et/ou de la sécularisation
Les termes de « séculier » et de « sécularisation » ont paradoxalement une origine religieuse : un moine régulier est sécularisé lorsqu’il devient un prêtre séculier ; une communauté monastique se sécularise en devenant un simple chapitre ; une abbaye est sécularisée en perdant son bénéfice régulier pour devenir une église. En ce sens, « séculier » ne s’oppose pas à « spirituel » ou à « religieux », mais plutôt à « régulier », et désigne un certain mode de présence du religieux au monde (l’Église dans sa vocation terrestre), par opposition à un autre mode de vie religieuse (disons « hors du monde »). En ce sens, on pourrait parler, ainsi que le fait Blumenberg dans un contexte un peu différent8, de l’usage moderne du terme de « sécularisation » comme résultant lui-même d’une sécularisation de la notion même de sécularisation.
C’est bien en ce second sens que l’on parle de la « sécularisation » des biens du clergé, en faisant référence à la confiscation des biens religieux lors des diverses révolutions nationales. Ce second sens est élargi lorsqu’on parle de façon métaphorique de « sécularisme » ou de
« sécularisation » pour désigner un certain nombre de phénomènes caractéristiques de ce que Marcel Gauchet nomme (en évitant le terme, pour lui connoté, de « sécularisation9 »), la « sortie de la religion » : indifférence progressive face à la religion, baisse du nombre des fidèles et plus encore des vocations cléricales, etc. Ces notions conservent encore de leur usage premier leur caractère premièrement descriptif. En ce sens, elles relèvent premièrement de la compétence de l’historien, de l’anthropologue ou du sociologue. Il appartient ainsi à l’historien d’étudier la lente sortie de la société médiévale des cadres imposés par la religion et le dégagement progressif d’un champ séculier. Le philosophe (ou l’historien de la philosophie) est sans doute lui aussi intéressé aux tensions théoriques qui gouvernent ce passage : par exemple, l’homme ne possède-t-il qu’une fin ultime à laquelle s’ordonnent toutes les autres (Thomas d’Aquin, Gilles de Rome), ou possède-t-il une fin terrestre autonome qu’il peut pleinement réaliser dans un cadre séculier, et en particulier dans une société « laïque », gouvernée par un « souverain » non soumis à l’autorité de l’Église (Dante, Guillaume d’Ockham, Marsile de Padoue, etc.)10 ?
Ces termes acquièrent encore un degré de généralité supplémentaire lorsqu’on parle de « sécularisme » ou de « sécularisation » non pour simplement décrire un certain groupe de phénomènes à l’intérieur d’une évolution historique, mais pour expliquer cette évolution historique dans son ensemble. Ces notions servent ici de schèmes d’interprétation de la modernité en général : elles ne désignent plus certains phénomènes liés à la modernité historique, mais caractérisent l’essence de cette modernité. Le modèle d’une telle interprétation se trouve chez Max Weber11. On pourrait aussi bien trouver ce type d’herméneutique chez Hegel, Karl Löwith ou Carl Schmitt (sur lesquels je reviendrai un peu plus loin). Si je prends comme exemple Weber, c’est parce que chez lui, cette herméneutique de l’histoire se fait, ou prétend se faire, avec la « neutralité » du savant – même si, à titre personnel, Weber n’assiste
pas en spectateur insensible à cette marche de l’histoire, mais montre face à elle un mélange complexe d’enthousiasme et de nostalgie.
La notion de sécularisation acquiert de plus un sens transitif qu’elle n’avait pas avant, et que Blumenberg a formulé sous la forme « B est la sécularisation de A12 ». Si on élargit la formule, on arrive à ce que Blumenberg nomme, du fait de son caractère systématique, le « théorème de sécularisation », selon lequel tout B peut être compris comme la sécularisation d’un A : B désigne ici tel ou tel phénomène caractéristique de la modernité et A sa racine théologique médiévale. Ainsi, poursuit-t-il, « l’éthique moderne du travail est la sécularisation de l’ascèse monacale, la révolution mondiale est la sécularisation de l’attente eschatologique, le président de la République est la sécularisation du monarque13 ». Il poursuit plus loin, non sans ironie, sa liste des analogies fallacieuses14 : le travailleur ou l’entrepreneur comme saint sécularisé ; la psychanalyse comme confession sécularisée ; l’idée démocratique moderne de l’égalité des citoyens devant la loi comme égalité des hommes devant Dieu sécularisée ; le manifeste communiste comme messianisme juif sécularisé ; le progrès comme Providence sécularisée ; la science comme théologie sécularisée ; la puissance du souverain de l’État moderne comme toute-puissance divine sécularisée, etc. Blumenberg dénonce ici le caractère a priori et systématique de cette catégorie herméneutique, qui peut s’appliquer arbitrairement à peu près à tout et n’importe quoi : si par exemple le travailleur dévoué à sa tâche est un saint sécularisé, son strict inverse, le dandy inactif, qui entretient un rapport distancié avec le monde, peut lui aussi être compris comme une sécularisation du saint. Si cette catégorie a pour fonction d’expliquer la modernité, elle manque assurément son objet, de par son incapacité à déterminer précisément les modalités de son fonctionnement et les limites de son applicabilité.
C’est à cet endroit que s’ouvre la « querelle » de la sécularisation dans son champ philosophique. Comprenons-en bien les enjeux. Il ne s’agit pas seulement de rigueur scientifique : aussitôt que s’est transformé le sens même du « séculier » (non plus le siècle ordonné au spirituel, mais le siècle dans sa réalité autonome), les notions de « sécularisation » ou de « sécularisme » ont commencé à prendre leur valeur polémique. On est en général
pour ou contre l’« expropriation politique des biens du clergé », comme la nomme Blumenberg15. Pour, si l’on pense alors que cette confiscation est une restitution, contre, si l’on pense qu’il s’agit là d’une spoliation16. Plus encore, on est pour ou contre le processus de laïcisation engagé par la modernité (souvent, d’ailleurs, on est à la fois « pour et contre »), et, bien entendu, pour ou contre la modernité elle-même, entendue, pour reprendre la définition que Kant donne des Lumières17, comme la « sortie de l’être humain de l’état de minorité dont il est lui-même responsable » : pour, si l’on se réclame de l’héritage des Lumières, et que l’on pense comme Kant la sortie du religieux comme la libération d’une tutelle illégitime, contre si l’on pense que cette revendication de « libération » n’est en réalité qu’une supercherie, destinée à couvrir des actes moins avouables.
C’est donc là le premier usage polémique des notions de « sécularisme » et de « sécularisation ». Mais la question acquiert un intérêt supplémentaire lorsque ces mêmes termes se trouvent paradoxalement retournés contre cette même modernité. C’est à cet endroit que cette question prend sa véritable amplitude problématique, lorsqu’elle participe d’une attitude de soupçon à l’égard des fondements de la modernité rationaliste et libérale. La question fondamentale devient alors : la modernité est-elle vraiment ce qu’elle prétend être, à savoir une « sortie » du religieux ? Cette revendication de laïcité et de fondation des institutions humaines (politique, mais aussi morale, scientifique, etc.) sur la seule raison n’est-elle pas au fond une tromperie ? Le « sécularisme » n’est-il pas en réalité imprégné de religieux ? C’est ici que le terme ambigu de « sécularisation » révèle ses potentialités polémiques. Car, par ce terme, nous entendons en effet quelque chose de plus qu’un simple passage d’un état à un autre. Nous entendons plutôt un changement qui possède le double caractère 1/ d’un transfert : il n’y a de changement que sur le fond d’une continuité. Si « B est la sécularisation de A », alors B n’est
pas entièrement nouveau par rapport à A : la sécularisation ne fait donc pas vraiment sortir du religieux, elle ne fait que recycler un matériau religieux dans un autre contexte (séculier). 2/ d’une perte : si « B est la sécularisation de A », alors B est A moins quelque chose, à savoir la dimension de transcendance. Ainsi, par exemple, le culte moderne de l’État ou du progrès peuvent-ils être compris comme de nouvelles formes de religions privées de transcendance. À travers cette double opération de captation (la modernité comme héritage) et de dépréciation (la modernité comme indigne de cet héritage), la notion de sécularisation devient, pour reprendre encore une expression de Blumenberg, une « catégorie de l’injustice historique », au service d’un discours antimoderne.
Sécularisation et antimodernisme
On peut dire que ce type de discours s’est développé à deux grands moments au xxe siècle. Le premier se situe après la Première Guerre, dans les années 1920, au moment de la remise en cause des schémas « optimistes » de type hégélien d’une réalisation, à travers l’histoire, du divin dans le monde – il se poursuit dans les années 1930, avec la montée des totalitarismes, compris comme des religions séculières (le personnalisme chrétien en France, Eric Voegelin, Raymond Aron, etc.)18. Le second moment est caractéristique de la période qui suit la Seconde Guerre, soit des années 1950-1970 – et n’est pas un hasard si l’épicentre de ce débat a longtemps été l’Allemagne : on peut dire que les discussions amorcées alors se prolongent, voire connaissent un regain d’intérêt, aujourd’hui dans la réflexion que la modernité libérale produit sur ses propres fondements.
L’un des textes les plus emblématiques de ce débat (je ne dis pas nécessairement le plus caractéristique, car d’autres affichent de façon plus visible leur antimodernisme) est possiblement l’incipit du troisième chapitre de la Théologie politique de Carl Schmitt. L’histoire de la réception de cet ouvrage mérite qu’on s’y arrête un instant. Publié en 1922, il est
rédigé par un penseur qui se réclame à l’époque de la pensée antilibérale conservatrice et catholique. Ce n’est cependant que dans les années 1930, dans un contexte marqué par la menace totalitaire (c’est bien la seconde édition, de 1934, qui donne à l’ouvrage une large audience) et les tentatives d’emprises du politique sur le religieux, qu’il fera l’objet d’un débat sur les relations entre théologie et politique. Mais, par un curieux anachronisme, c’est surtout depuis les années 1950 qu’il se trouve au centre des réflexions sur la modernité et le libéralisme (Carl Schmitt a accompagné lui-même cette évolution en publiant en 1969 un second ouvrage, lui aussi titré Théologie politique). Citons in extenso ce texte de 1922, dont on ne retient trop souvent que le début :
Tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l’État sont des concepts théologiques sécularisés. Et c’est vrai non seulement de leur développement historique, parce qu’ils ont été transférés de la théologie à la théorie de l’État – du fait, par exemple, que le Dieu tout-puissant est devenu le législateur omnipotent –, mais aussi de leur structure systématique, dont la connaissance est nécessaire pour une analyse sociologique de ces concepts. La situation exceptionnelle a pour la jurisprudence la même signification que le miracle pour la théologie. C’est seulement en prenant conscience de cette position analogue qu’on peut percevoir l’évolution qu’ont connues les idées concernant la philosophie de l’État au cours des derniers siècles. Car l’idée de l’État de droit moderne s’impose avec le déisme, avec une théologie et une métaphysique qui rejettent le miracle hors du monde et récusent la rupture des lois de la nature, rupture contenue dans la notion de miracle et impliquant une exception due à l’intervention directe, exactement comme elles récusent l’intervention directe du souverain dans l’ordre juridique existant. Le rationalisme de l’Aufklärung condamna l’exception sous toutes ses formes. La conviction théiste des auteurs conservateurs de la contre-révolution put dès lors tenter d’appuyer idéologiquement la souveraineté personnelle du monarque avec des analogies tirées d’une théologie théiste19.
Sous sa neutralité scientifique apparente, ce texte porte en lui un fort potentiel polémique, que je voudrais faire ressortir en proposant quatre niveaux de lecture :
1/ Il y a tout d’abord l’affirmation d’un transfert historique. C’est là l’aspect qui retient souvent le plus l’attention du lecteur contemporain, du fait de l’évolution du débat dans les années 1950 et de sa focalisation
sur le sens de l’histoire. Hans Blumenberg n’a-t-il pas dit qu’il s’agissait de la « forme la plus forte du théorème de la sécularisation », en précisant cependant « non seulement en raison de l’affirmation des faits qu’elle contient mais aussi des conséquences qu’elle inaugure20 ». Car la lecture de Blumenberg ne s’arrête pas au texte de 1922 : elle tient rétroactivement compte des évolutions postérieures du débat. Si, en effet, on se limite à une lecture stricte du texte, Carl Schmitt n’insiste pas vraiment sur cet aspect de transfert. Il s’agit là pour lui de la sécularisation en son sens le plus « superficiel » (« cela est vrai non seulement… »). Carl Schmitt répète à plusieurs endroits de sa Théologie politique que l’analogie entre la souveraineté moderne et la toute-puissance divine (opérée au xvie siècle par les partisans d’une politique laïque contre les prétentions ultramontaines) est une sorte de formule usée. Il parle au premier chapitre de « l’expression indéfiniment répétée et complètement vide de “puissance suprême”21 », et il cite encore au chapitre suivant la « vieille définition », inlassablement reprise, pour laquelle la souveraineté est la « puissance suprême, juridiquement indépendante, déduite de rien22 ». Dans La Notion de politique de 1927, il écrira encore que « les formules évoquant la toute-puissance de l’État ne sont souvent que des sécularisations superficielles de formules théologiques sur l’omnipotence de Dieu23 ». Bref, si Schmitt a une certaine affection pour les premières théories modernes de l’État – en particulier celle de Bodin –, c’est pour d’autres raisons que cette définition creuse de la souveraineté : c’est précisément parce que, à côté d’elles (ou en marge d’elles), les premiers penseurs modernes du droit savaient encore – contrairement aux théories postérieures de l’État de droit – poser la question de la souveraineté dans son effectivité concrète, donc parce qu’ils se situaient encore dans une sorte de modernité de compromis, capable de reconnaître les limites de la rationalité et la nécessité de l’autorité.
2/ Aussi superficielles soient-elles, ces généalogies renvoient à la parenté plus profonde, qui est de l’ordre de l’analogie de structure. Comme l’avait vu Leibniz (cité par Schmitt24), le droit et la théologie ont en commun
d’avoir affaire à un mixte de rationalité et d’autorité25. Avant lui, Bacon disait déjà qu’en théologie comme en droit, on ne raisonne qu’à partir de « placita », c’est-à-dire de principes posés arbitrairement (ad placitum) et non établis par la raison26, les règles d’un jeu, qui servent de base à la réflexion, sans être elles-mêmes questionnées. Dans la réinterprétation de Schmitt, on peut dire que dans les deux cas (le droit et la théologie – notons que le parallèle ne fonctionnerait pas pour d’autres sciences, les mathématiques par exemple, et que le modèle pris en ce sens n’est nullement universalisable à l’ensemble des champs épistémiques dans leur évolution moderne), la rationalité se trouve confrontée à ses limites concrètes. C’est bien là le thème récurrent du Schmitt de la fin des années 1910 et du début des années 1920 : la confrontation « ratée » du droit contemporain, enfermé dans son idéal creux de pure rationalité normative, à la question de l’effectivité politique concrète, en comparaison de la confrontation « réussie » de l’Église catholique à la question de sa « visibilité » dans l’espace social.
Dans ce troisième chapitre de la Théologie politique de 1922, cette « théologie politique » se donne comme un simple concept opératoire pour une « analyse sociologique des concepts juridiques », dont la fonction est de « découvrir la structure ultime, radicalement systématique, et de comparer cette structure conceptuelle avec l’élaboration conceptuelle de la structure sociale à une époque donnée27 » – entendons d’éclairer les institutions juridico-sociales en faisant appel aux représentations les plus générales (métaphysiques, théologiques) qui gouvernent une société donnée à telle ou telle période de son histoire : par exemple une théologie théiste (un Dieu gouvernant personnellement au-dessus des lois générales) préside à l’idée décisionniste du droit à la Renaissance et l’Âge Classique, alors qu’une théologie déiste (un Dieu soumis aux lois) gouverne celle de l’État de droit postérieure aux Lumières. Carl Schmitt affirme la neutralité scientifique de son concept de sécularisation : le chapitre 4 de cette même Théologie politique fait, il est vrai,
usage de ces concepts en un sens ouvertement polémique, mais Carl Schmitt se garde bien d’y parler en son nom : il se couvre, pour ainsi dire, en faisant un portrait provocateur de Donoso Cortès (auquel, bien entendu, il s’identifie implicitement), conservant ainsi l’ambigüité entre un concept scientifique et une notion polémique – une ambigüité qui sera en partie levée dans les textes ultérieurs.
3/ Même à ce niveau cependant, et sans prendre en ligne de compte le chapitre 4, la notion recèle un sens polémique sous-jacent. L’idée selon laquelle les concepts politiques modernes sont des sécularisations de concepts théologiques a une portée critique ad hominem dès lors que la politique moderne prétend s’être « libérée » de la théologie. Assimiler, comme le fait le juriste libéral Hans Kelsen28, la loi à un « Deus sive natura » tout en prétendant ne pas faire de théologie politique est soutenir une position contradictoire. Car une théologie déiste reste une théologie : simplement, elle est confuse (un dieu qui règne tout en étant soumis aux lois) et inassumée. Elle se développe de façon insidieuse, et pour ainsi dire « sauvage ». Si elle est cohérente avec elle-même, la modernité libérale tend vers l’athéisme – les libéraux ne sont pour Schmitt rien d’autre que des bakouniniens ou des léninistes mous et peureux (et Schmitt ne cache pas en retour sa fascination envers les vrais radicaux nihilistes). Mais – et c’est là le nœud de l’affaire – l’athéisme lui-même n’est pas une libération de la théologie : se révolter contre Dieu n’est pas sortir de la religion. Carl Schmitt ne se privera jamais de montrer que ses adversaires soi-disant laïcs sont en réalité plus théologiens que lui, que leur soi-disant pacifisme inaugure en réalité de nouvelles guerres de religions, etc. Le concept de « sécularisation » devient dès lors une arme de combat redoutable contre le rationaliste libéral.
4/ Cette critique ad hominem porte enfin en elle une prise de position. Contre cette théologie diffuse, Carl Schmitt propose en effet, indirectement dans son chapitre 4 une théologie claire (donc théiste), capable
d’assumer sa propre position et la position politique qui en découle. Par derrière la défense apparente d’une théologie catholique officielle, encore présente chez les premiers jurisconsultes (qui représentent à ce titre la moins mauvaise modernité), c’est la théologie radicale de la contre révolution catholique, dont le penseur le plus extrême est Donoso Cortès, que Carl Schmitt défend contre la théologie contradictoire et inassumée du libéralisme moderne. L’autoritarisme politique (i.e. la dictature) représente donc une sécularisation assumée et réussie, parce qu’elle sécularise les « bons » théologoumènes : le péché originel, la foi inconditionnée, etc. – les bonnes vertus politiques, c’est-à-dire les vertus du conservatisme, sont les mêmes que les vertus du catholique, à savoir la patience, l’obéissance et l’humilité.
Dès les années 1920 donc, le « théorème » de sécularisation sert d’arme contre la revendication moderne, rationaliste et libérale, de sécularisme. Cette dimension polémique apparaît encore mieux dans l’un des textes les plus caractéristiques de ce que j’ai nommé la « seconde vague » de la critique du sécularisme et de la sécularisation, l’ouvrage de Karl Löwith, Histoire et salut, dont la première édition, anglaise, date de 1949. Le plan du livre est en lui-même révélateur : il s’agit chercher le « sens caché » d’un concept fondateur de la modernité, celui de « progrès », dans une origine historique plus lointaine. Ce qui fait que l’ouvrage suit un ordre historique régressif, en remontant de Marx et Hegel à la philosophie des Lumières, puis à la gnose de Joachim de Flore, puis enfin aux pensées authentiquement « fondatrices », ou plus précisément au lieu authentiquement fondateur de la pensée moderne qu’est la confrontation du naturalisme antique et de la théologie chrétienne du salut. Une telle démarche oriente par avance les résultats de la recherche, comme le montre l’introduction :
L’exposé historique qui va suivre de notre conception de l’histoire voudrait montrer que la philosophie moderne de l’histoire prend ses racines dans la croyance biblique en la rédemption et qu’elle prend fin avec la sécularisation de son modèle eschatologique29.
La pensée moderne de l’histoire est inférieure à ses deux modèles. La pensée antique résolvait le problème du mal par sa conception cyclique
du cosmos (tout mal est compensé par un bien, toute mort par une vie, etc.) ; la pensée chrétienne a quant à elle posé un problème neuf, celui du salut, mais elle n’a jamais prétendu le résoudre dans ce monde : en posant cette question du salut au niveau de l’histoire, la modernité apparaît comme un produit bâtard.
Löwith déploie contre la modernité toutes les ressources polémiques du « théorème » de sécularisation. Il emprunte ainsi les deux grands axes que j’ai défini :
1/ en faisant apparaître comme « emprunté » ce que la modernité revendique comme original :
La non-religion du progrès demeure […] une sorte de religion, dérivée de la croyance chrétienne en un but à venir, même si elle pose à la place d’un eschaton déterminé et supra-mondain un eschaton indéterminé et intra-mondain30.
2/ en dévalorisant ce qui est vraiment original, pour le faire apparaître comme inauthentique :
La philosophie des Lumières n’a nullement étendu et enrichi [enlarged] le schéma théologique d’explication de l’histoire, elle l’a au contraire rétréci et rabougri [has narrowed it down] en ravalant la Providence divine au rang de la prévision humaine du progrès, et en la laïcisant ainsi31.
En résumé, comme on le dit quelquefois d’une thèse que l’on veut discréditer, ce qui est bon n’est pas neuf, et ce qui est neuf n’est pas bon. À ces deux niveaux, il faut en ajouter un troisième : la modernité n’est pas ce qu’elle prétend être, à savoir le fruit d’un acte intellectuel nouveau, rationaliste et séculier – elle est une forme d’imposture.
La défense du sécularisme
Ces critiques du (prétendu) sécularisme moderne fixent les repères du débat actuel. Je voudrais examiner rapidement, et sans prétendre être exhaustif, deux types de réponses qui ont pu leur être apportées.
La première peut paradoxalement être faite au nom de la théologie elle-même, qui, afin de sauver la transcendance du spirituel, refuse de voir dans le monde séculier actuel quelque forme d’image ou de copie d’un modèle théologique. On trouverait des exemples de ce purisme chez Karl Barth du côté protestant, ou chez Erik Peterson du côté catholique (ou, dans un registre un peu différent, Franz Rosenzweig du côté juif). Dans la seconde édition de son Commentaire à l’Épitre aux Romains, paru en 1921, Barth souligne, contre le christianisme « social » de son époque, la stricte séparation entre les exigences de la foi et les exigences mondaines (morales, politiques), entre la justice divine et la justice humaine : en voulant réaliser le Règne de Dieu, la société en construction ne s’identifie qu’à la Tour de Babel32. Bien entendu, il ne s’agit que d’une demi attaque, car elle ne touche que les versions « optimistes », de type hégélien, de la sécularisation : mais nous avons vu que chez Carl Schmitt lui-même existait un modèle de sécularisation « réussie », à savoir l’autoritarisme politique, équivalent juridico-social de l’autoritarisme scripturaire et dogmatique. C’est d’ailleurs contre Carl Schmitt qu’Erik Peterson écrit, en 1935, son ouvrage Le Monothéisme : un problème politique33. En 1935, nous sommes, comme il a déjà été dit, dans un tout autre contexte qu’en 1922. Carl Schmitt, autrefois défenseur d’une conception catholique de la modernité, et, dans le domaine politique, d’une forme de dictature présidentielle capable de tenir à l’écart du jeu politique les partis radicaux, s’est, en 1934, rallié au nazisme. Le syntagme même de « théologie politique » prend dans ce contexte un sens nouveau, désignant la mainmise de l’institution politique sur les institutions ecclésiales. Celle-ci se traduit
concrètement par le serment de fidélité que prêtres et pasteurs doivent prêter au Führer. Malgré son catholicisme, Carl Schmitt accompagne cette évolution sur le plan intellectuel, en déclarant, dans la préface de la réédition de sa Notion de politique de 1934, que le politique est « le total » : en 1938, il critiquera Hobbes pour ne pas avoir réussi à faire du pouvoir politique un pouvoir religieux à même de s’imposer à l’intérieur des consciences des sujets34. Certains protestants, conduits par Karl Barth, réagiront à cette politisation du religieux en rédigeant la déclaration de Barmen. Malgré les différences qui opposent les deux théologiens, la position d’Eric Peterson peut être comprise comme un analogue de cette position du côté catholique, au sens où, pour l’une comme pour l’autre, la théologie ne saurait sans perdre sa signification se constituer en instrument politique.
On peut résumer ainsi la position de Peterson : la théologie chrétienne est en son fond « insécularisable ». Ou, pour dire les choses autrement, les catégories fondamentales de la théologie chrétienne ne peuvent faire l’objet d’un transfert dans des réalités « séculières » et notamment dans des structures étatiques. Pour le montrer, Peterson emprunte le détour d’une histoire savante de la relation entre la théologie chrétienne et la politique impériale dans les premiers siècles de l’ère chrétienne. Il montre que l’idée de « théologie politique », développée d’Aristote à Philon d’Alexandrie et à Eusèbe de Césarée (théologien chrétien au service de l’Empereur Constantin), a été réfutée comme contradictoire en ses termes par Augustin. Ce dernier s’est opposé au christianisme « politique » de deux façons : 1/ en soulignant le caractère incommensurable de la justice divine par rapport à la justice sociale. Augustin a ainsi raillé Cicéron, qui croyait que le règne de la justice adviendrait avec Auguste : il a pu mettre lui-même sa prédiction à l’épreuve, puisque le premier acte d’Auguste arrivé au pouvoir a été d’offrir sa tête et ses mains à Antoine35. 2/ En montrant que le schéma trinitaire chrétien n’est pas transférable dans des schèmes de souveraineté étatique ; le schéma arien du Fils créature du Père pouvait encore s’adapter à la propagande impériale : « un Dieu dans l’Univers pour un roi sur la Terre ». Il n’en
va pas de même de la Trinité telle qu’elle est définie par les Conciles de Nicée et de Constantinople, et élaborée du point de vue théorique par Augustin. Celle-ci ne peut traduire au niveau théologique aucune forme de pouvoir de ce monde. D’où la conclusion de l’ouvrage :
Ainsi se trouve non seulement réglée la question théologique du monothéisme comme problème politique, et la foi chrétienne libérée de son lien avec l’Empire romain, mais aussi, fondamentalement accomplie la rupture avec cette « théologie politique » qui abusait du message chrétien pour légitimer une situation politique. Une « théologie politique » ne saurait plus croître que sur le terrain du judaïsme ou du paganisme. Mais le message chrétien du Dieu trinitaire se tient par-delà judaïsme et paganisme, puisque le mystère de la Trinité n’existe qu’en Dieu lui-même, et non dans la créature. De même, nul empereur ne saurait garantir cette paix que recherche le Christ : elle est le don de celui qui est « plus haut que toute raison36 ».
Et une courte note rattache cette querelle à la position de Carl Schmitt :
Le concept de « théologie politique » a été introduit dans la littérature par les travaux de Carl Schmitt, Théologie politique, Munich, 1922. Ses considérations, à l’époque, n’ont pas été exposées de façon systématique. Nous avons tenté ici de démontrer à partir d’un exemple concret l’impossibilité d’une telle « théologie politique37 ».
La théologie politique est « impossible » parce qu’elle revient à poser une forme de proportionalité entre le séculier et le religieux, et à méconnaître ainsi l’absolue transcendance de Dieu. Ce n’est certes pas ce que voulait faire Carl Schmitt en 1922 (« ses considérations, à l’époque, n’ont pas été exposées de façon systématique »), mais c’est ce à quoi a abouti logiquement sa pensée en 1934.
L’autre critique vient du défenseur laïc des acquis de la modernité – et certains (dont Schmitt lui-même) n’ont pas manqué de dénoncer l’alliance « objective » entre le théologien puriste et le rationaliste libéral. Dans la première partie de son ouvrage de 1969 sur La Légitimité des temps modernes, Hans Blumenberg s’attaque au « théorème » de sécularisation qui revient à dire que « les Temps modernes sont la continuation du christianisme par d’autres moyens38 ». À l’inverse, pour Blumenberg,
la modernité part d’un acte intellectuel nouveau, qui consiste dans l’auto-affirmation de la raison humaine dans son pouvoir authentiquement créateur et transformateur. La défense de modernité passe par une critique de l’herméneutique « substantialiste » de l’histoire, fondée sur l’idée (aristotélicienne) d’une substance restant identique à elle-même, tout en revêtant des accidents divers dans divers contextes. Si Blumenberg entend légitimer la modernité, ce n’est pas en tant qu’héritage d’un noble passé (Schmitt lui en fera reproche : pour lui, on ne peut parler de légitimité qu’en se référant à une continuité historique). Il faut ainsi passer de la catégorie substantialiste d’Umsetzung (de « déplacement » d’une même substance dans un autre lieu, qui n’est plus son lieu originaire) à celui d’Umbesetzung (celui de « réinvestissement » d’une place laissée vide). Citons Blumenberg :
Ce qui, dans le processus interprété comme sécularisation, s’est passé le plus souvent, du moins à de très rares exceptions près reconnaissables et spécifiques, ne peut pas être décrit comme mutation (Umseztung) de contenus authentiquement théologiques qui en s’aliénant d’eux-mêmes seraient devenus séculiers, mais comme « réinvestissement » (Umbesetzung) de positions de réponses devenues vacantes dont les questions correspondantes ne pouvaient être éliminées […]. Des contenus tout à fait hétérogènes peuvent assumer des fonctions identiques à certains endroits du système de l’interprétation du monde et de celle de l’homme par lui-même39.
La modernité est « légitime » non parce qu’elle se réfère à un héritage théologique, mais parce qu’elle apporte la réponse à une question à laquelle le Moyen Âge n’avait pas su répondre. Et puisque répondre à une question, c’est le plus souvent aussi en changer la formulation, on peut dire que la modernité est aussi et avant tout un requestionnement, une reformulation en de nouveaux termes des questions posées à l’âge théologique. La question n’est plus en effet celle de la réalisation d’une fin ultime de l’homme, mais, plus modestement, de l’amélioration possible de sa condition dans histoire. De ce point de vue, la modernité constitue bien une sortie du théologique, et non une transformation de ce théologique en une forme de théologie mondaine. Ce terme de « sortie du théologique » doit être pris en un sens plus général, comme libération vis-à-vis de toute menace que la transcendance peut faire
peser sur l’activité rationnelle de l’homme (nous ne disons pas libération de toute relation vis-à-vis de la transcendance, ce qui serait tout à fait autre chose). La modernité n’a pas forgé de nouveaux dieux – elle tend à se libérer de l’emprise de toute hétéronomie (et en particulier de celle de l’absolutisme politique – Blumenberg est fondamentalement un libéral), quelle que soit sa forme. Des analyses que Blumenberg fait des pensées de Bruno, de Descartes, de Hobbes, de Leibniz, de Hegel même, montrent dès la Renaissance la mise à distance par la modernité de toute valeur absolue, qu’elle soit transcendante ou immanente. On peut dire que Blumenberg interprète la modernité à travers un prisme qui est celui de la postmodernité, comme si elle était une pré-postmodernité40.
Sécularisme et permanence du religieux
Faut-il considérer cette question de la sécularisation comme définitivement réglée au profit d’une affirmation de l’autonomie du séculier et de la mise à l’écart de la transcendance ? Je voudrais en conclusion présenter quelques schémas de « permanence » du théologique dans nos sociétés sécularisées qui prennent pleinement en compte les critiques faites par le théologien et par le libéral.
Que vaut tout d’abord le « purisme » théologique ? Toute religion (chrétienne compris) ne possède-t-elle pas une surface mondaine, politique et sociale – le christianisme ne faisant pas ici exception ? C’est là un des arguments de Schmitt dans sa « réponse » à Peterson. Cette réponse date non de 1934, mais de bien plus tard, en 1969 – soit près de 10 ans après la mort de Peterson. Le contexte est encore bien différent – celui de la théologie de Vatican II, et plus précisément de la constitution Gaudium et spes. Si Schmitt n’est en rien un sympathisant de Vatican II, ce n’est cependant pas parce que Vatican II représente pour lui une forme de déchéance mondaine du christianisme. C’est plutôt parce que la théologie que le christianisme social ouvre au monde est une mauvaise théologie (libérale, démocratique, rationaliste, antidogmatique, etc.). C’est là ce
qui oppose Schmitt à Hans Barion, par ailleurs ami de Schmitt (comme l’étaient, avant 1934, Schmitt et Peterson), à qui s’adresse le Théologie politique de 1969 : l’un et l’autre sont des représentants d’un courant que l’on nommerait aujourd’hui « intégriste », opposés à la transformation du christianisme en un Évangile social, mais ils le sont pour des raisons différentes : Hans Barion s’appuie sur l’idée développée par Peterson en 1934 du caractère incommensurable du Royaume par rapport à tout idéal terrestre, alors que Schmitt reconnaît au moins à Vatican II d’avoir envisagé avec sérieux le fait que le christianisme possède une existence mondaine et sociale – « séculière » au premier sens que nous avons donné à ce terme41.
L’argumentation complexe de Carl Schmitt42 trouve son apogée avec la réhabilitation d’Eusèbe de Césarée43. L’argument le plus fort est celui-ci : si Eusèbe a mis la théologie chrétienne au service de la politique impériale, cela ne signifie pas que l’imperium romanum était pour lui une réalisation terrestre du Royaume de Dieu (comme prétend l’être la société libérale) ; cela signifie plutôt qu’il représentait de son point de vue la bonne structure politique dans et pour l’attente du Royaume de Dieu, à même de faire obstacle au chaos politique, dont la forme extrême consiste précisément en la confusion du politique et de l’eschatologique, et de pendre ainsi au sérieux la condition pécheresse de l’homme et la transcendance de la justice divine. La « bonne » théologie politique est celle qui veille à l’aménagement de ce temps de l’attente, sans prétendre substituer l’ordre social au Royaume.
L’idée que Schmitt met ici en place de « katékhon44 » (celui qui retarde l’avènement du chaos) sert un propos essentiellement antimoderne et conservateur. Il convient néanmoins d’en retenir la définition d’un sécularisme qui reconnaît au séculier une forme d’indépendance, sans voir pour autant en lui une « sortie » de la religion. Cette notion peut être réemployée dans de nouveaux contextes, qui ne sont pas nécessairement conservateurs. Il en va jusqu’à un certain point ainsi avec la théologie
dite « de la libération » d’un Jean-Baptiste Metz (qu’il nomme lui-même une « nouvelle théologie politique45 »). La « théologie du monde » n’est pas une théologie mondaine ou mondanisée. Metz a retenu les leçons de Barth et de Peterson : il ne s’agit aucunement pour lui de confondre la justice terrestre et la Royaume : entre la praxis humaine et le Royaume s’interpose ce que Metz nomme la « réserve eschatologique ». Le monde de l’attente n’est pas pour autant privé d’une dynamique théologique – après tout, le temps de l’attente est aussi celui qui suit la première venue du Christ (ce dont Schmitt serait sans doute bien incapable de rendre compte) : « le croyant n’agit donc pas seulement “dans” le monde : il le modifie, le transforme dans l’horizon de [la] promesse [eschatologique, d’un monde futur] divine46 ». La théologie a ainsi principalement un rôle critique à l’égard de la société présente : « Toute théorie eschatologique doit donc devenir théologie politique, en tant que théologie critique (de la société)47 ». L’eschatologie revêt ainsi une fonction « critico-créatrice », pour entrer en discussion « avec les grandes utopies politiques, sociales, techniques, avec les promesses, qui mûrissent dans la société moderne d’une humanisation universelle du monde48 ». Dans une telle perspective, le temps de l’attente n’est pas simplement un temps de la conservation, et les idéaux démocratique et libéraux de paix et de justice universelle ne sont pas incompatibles avec la foi dans une autre justice et une autre paix à venir.
Cette idée d’une permanence du théologique en tant qu’instance critique du politique peut être reprise à un autre niveau par le philosophe libéral et laïc. D’ailleurs, lorsque nous parlons de laïcité, à quel modèle nous référons-nous ? Au modèle antireligieux des Lumières françaises ? Au modèle anglo-saxon de la tolérance mutuelle de toutes religions sur la base d’un minimum consensuel commun ? Je relèverai ici deux modèles porteurs de projets spéculatifs plus ambitieux. Tout d’abord le modèle bergsonien, repris par Voegelin49, de la société ouverte – entendons ici ouverte non à la praxis humaine (selon le sens
que donnera Popper à cette notion de société « ouverte »), mais à un horizon de transcendance, dont les diverses religions ne sont que des expressions partielles et imparfaites. La théologie mystique devient ici (dans un projet radicalement opposé à celui de Schmitt) une instance critique contre la tendance du corps social au repli identitaire50. Le second modèle, qui prolonge d’une certaine façon le premier, est celui d’une restauration du théologique ou du mythique comme instance critique générale et sceptique du politique. Comme l’avait déjà vu Tocqueville, décrivant le théologico-politique américain, plus que tout autre régime, la démocratie a besoin cette instance critique pour se conserver comme telle tout en protégeant les libertés contre la « tyrannie de la majorité » : « En même temps que la loi permet au peuple américain de tout faire, la religion l’empêche de tout concevoir et lui défend de tout oser51 » (ce qui ne veut bien entendu pas dire que la religion fait en quelque façon commandement de ne rien concevoir ou oser).
On pourra citer bien des projets contemporains, conservateurs ou progressistes, voire révolutionnaires, qui vont en ce sens, de Voegelin à Taubes, Castoriadis, Lefort, Badiou ou Habermas, pour n’en citer quelques-uns. La vraie opposition ne se situe pas en réalité entre conservateurs et progressistes : elle se situe plutôt entre ceux qui, à travers une nouvelle théologie politique, tendent à revêtir le politique d’une dimension de sacralité que la religion a en quelque façon perdu et ceux qui voient dans le théologique une force de destitution, ou en tout cas de secondarisation, du pouvoir politique. On se souviendra ici de l’avertissement de Thomas Steams Eliot en 1939 : « Si vous ne voulez pas de Dieu (et il est un Dieu jaloux), il vous faudra faire votre révérence à Hitler ou Staline52 ». Aussi faut-il distinguer une critique du politique qui reste encore à l’intérieur du politique et une critique (en son fond sceptique,
et par là fondamentalement libérale) du politique qui se situe hors du champ politique. C’est peut-être en ce sens que le théologique – par-delà toute tendance au dogmatisme – peut aujourd’hui préserver nos sociétés sécularisées de la menace qui les guette toujours de se constituer en nouveaux pôles de sacralité.
Thierry Gontier
Université Lyon 3 – IRPhiL
Insitut universitaire de France
1 Voir, entre autres, les ouvrages classiques de Victor Goldschmidt, Platonisme et pensée contemporaine, Paris, Vrin, 1990, rééd. 2000 et de Henri Joly, Le Renversement platonicien. logos, épistémè, polis, Paris, Vrin, 1974, rééd. 1995.
2 Traité théologico-politique, ch. vi, texte établi par F. Akkerman, trad. et notes J. Lagrée et P.-F. Moreau, Paris, PUF, 1999, rééd. 2005, p. 181.
3 Cf. sur ce point l’ouvrage classique de Horst Bredekamp, Stratégies visuelles de Thomas Hobbes. Le Léviathan, archétype de l’état moderne, introduction de. O. Christin, trad. D. Mogliani, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 2003.
4 Voir par exemple Libéralisme politique, chapitre V (« la priorité du juste et les idées du bien »), 1993, trad. C. Audard, Paris, PUF, 1995, rééd. 2006, p. 216-218.
5 Carl Schmitt, Théologie politique, trad. J.-L. Schlegel, Paris, Gallimard, 1988. Cette édition comprend les deux ouvrages homonymes de Schmitt, le premier ayant été publié en 1922, le second en 1969.
6 Jean-Claude Monod, La Querelle de la sécularisation de Hegel à Blumenberg, Paris, Vrin, 2002.
7 Hans Blumenberg, Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt am main suhrkamp 1966-1976 (3 volumes), rééd. (revue et augmentée) 1983-1985 ; trad. fr., La Légitimité des temps modernes, trad. M. Sagnol, J.-L. Schlegel et D. Trierweiler, Paris, Gallimard, 1999.
8 La Légitimité des temps modernes, p. 19.
9 Cf. p. ex. La Religion dans la démocratie. Parcours de la laïcité, Paris, Gallimard, 1998, p. 7.
10 Voir en particulier les travaux de Ruedi Imbach, par exemple dans Dante. la philosophie des laïcs, Paris, Fribourg, Éditions du Cerf, Éditions Universitaires de Fribourg, 1996, ou dans Thomas d’Aquin, Boèce de Dacie, Sur le bonheur, textes introduits, traduits et annotés par R. Imbach et I. Fouche, Paris, Vrin 2005.
11 Voir en particulier L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme…, trad. I. Kalinowski, Paris, Flammarion, coll. « Champs classiques », 2000, rééd. 2002.
12 La Légitimité des temps modernes, p. 12.
13 Ibid.
14 Ibid., p. 21-22
15 Ibid. p. 27
16 Ainsi, Rémi Brague voit, après Edmund Burke, dans cette opération de sécularisation un « scandale », un « vol pur et simple » de propriétaires légitimes et « spoliés sans indemnité », le « déni de justice » étant accompli avec un « machiavélisme parfait » (« La sécularisation est-elle moderne ? », dans M. Fœssel, J.-F. Kervégan et M. Revault d’Allonnes (dir.), Modernité et sécularisation, Paris, CNRS éditions, 2007, p. 23-24.
17 Réponse à la question : qu’est-ce que les lumières ?, trad. H. Wismann (un peu modifiée), dans Emmanuel Kant, Œuvres philosophiques, dir. F. Alquié, Paris, Gallimard, coll. « La Pléiade », t. II, p. 209.
18 Voir ici le recueil de textes réunis dans Le Totalitarisme. Le xxe siècle en débat, textes choisis et présentés par E. Traverso, Paris, Éditions du Seuil, 2001.
19 Théologie politique (1922), p. 46.
20 La Légitimité des temps modernes, p. 101.
21 Théologie politique (1922), p. 18.
22 Ibid., p. 28.
23 La Notion de politique (1ère éd. 1927, 2e éd. 1928, 3e éd. 1932), trad. fr. Marie-Louise Steinhauser, Paris, Calmann-Lévy, 1972, et Paris, Flammarion, 1992, p. 81. Je souligne.
24 Théologie politique (1922), p. 47.
25 « Il y a entre théologie et jurisprudence une merveilleuse similitude, l’une et l’autre ayant pour origine : 1/ la raison d’où dérivent la théologie naturelle et le droit naturel, 2/ l’écriture […]. la théologie est une espèce de jurisprudence prise d’une manière universelle » (Leibniz, Nouvelle méthode pour apprendre et enseigner la jurisprudence, 1667).
26 Francis Bacon, Du progrès et de la promotion des savoirs, éd. M. Le Dœuff, Paris, Gallimard, 1991, p. 279.
27 Théologie politique (1922), p. 54.
28 « Il a coûté une peine infinie, jusqu’à ce que l’homme ait compris que dieu n’était que la personnification de la nature devant être conçue comme un système de lois. ce problème du rapport de dieu et du monde ressemble en tous les points essentiels au problème du rapport de l’état et du droit » (Hans Kelsen, « L’essence de l’État », 1926, trad. P.H. Tavoillot, dans La Pensée politique de Hans Kelsen, Cahiers de philosophie politique et juridique, Université de Caen, 1990, p. 33-34).
29 Karl Löwith, Histoire et salut. Les présupposés théologiques de la philosophie de l’histoire, trad. M.-Ch. Challiol-Gillet, S. Hurstel et J.F. Kervégan, Paris, Gallimard, 2002, p. 22.
30 Ibid., p. 147-148.
31 Ibid., p. 135.
32 Voir Karl Barth, L’Épître aux Romains, trad. P. Jundt, Genève, éd. Labor et Fides,1967, p. 436-463.
33 Erik Peterson, Le monothéisme : un problème politique, trad. A.-S. Astrup avec la collaboration de G. Dorival, préface de B. Bourdin, Paris, Bayard, 2007.
34 Voir Jean-Paul Larthomas, « Contre le nihilisme hitlérien : la déclaration de Barmen (1934) », dans J.-F. Mattéi, Nietzsche et le temps des nihilismes, Paris, PUF, 2005, p. 171-187.
35 La Cité de dieu, III, 30, trad. G. Combès, intro et notes G. Bardy, dans Œuvres de Saint Augustin, Paris, Desclée de Brouwer, tome 33, 1959, p. 517-519.
36 Le Monothéisme : un problème politique, p. 123-125.
37 Ibid., p. 124, note 170.
38 La Légitimité des temps modernes, p. 17.
39 Ibid., p. 75
40 Voir mon article, Th. Gontier, « Blumenberg et l’origine des temps modernes : présentation », dans Revue de métaphysique et de morale, 2012, no 1, p. 3-13.
41 Ce contexte est bien expliqué dans la préface de Jean-Louis Schlegel à la Théologie politique, p. ii-iv.
42 Cette argumentation est clairement résumée l’ouvrage de Jan-Werner Muller, Carl Schmitt. Un esprit dangereux, trad. S. Taussig, Paris, Armand Colin, 2007, p. 220-224.
43 Théologie politique (1969), p. 142-145.
44 Seconde épître aux Thessaloniciens, 2, 1-12, trad. TOB.
45 Johannes Baptist Metz, Pour une théologie du monde, trad. H. Savon, Paris, Le Cerf, 1970, p. 110.
46 Ibid., p. 66
47 Ibid., p. 134.
48 Ibid., p. 110.
49 Voir mon ouvrage, Th. Gontier, Eric Voegelin. Symboles du politique, Paris, Michalon, coll. « Le Bien Commun », 2008, p. 71-82 et p. 107-119.
50 Voir mon article, Th. Gontier, « De la théologie politique à la religion politique : Eric Voegelin et Carl Schmitt », Th. Gontier et D. Weber (dir.), Eric Voegelin. Politique, religion et histoire, Paris, Le Cerf, 2011, p. 45-66, ou la version (plus complète) anglaise, « From “Political Theology” to “Political Religion” : Voegelin and Carl Schmitt », The Review of Politics, vol. 75, 2013-1, p. 25-43.
51 La Démocratie en Amérique, I, II, 9, dans Œuvres, sous la dir. d’A. Jardin, Paris, Gallimard, coll. « La Pléiade », t. II, 1992, p. 338 ; voir aussi sur ce point l’étude classique et claire de Pierre Manent, Tocqueville et la nature de la démocratie, Paris, Gallimard, 2006 (1re éd. 1982), p. 117-149.
52 The Idea of a Christian Society, Londres, Faber & Faber, 1939.