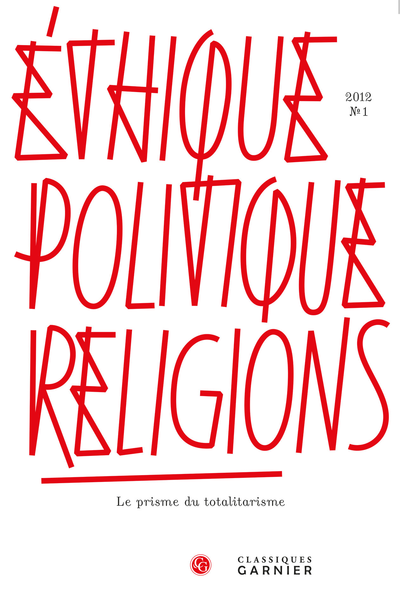
Le langage du totalitarisme Victor Klemperer et George Orwell
- Publication type: Journal article
- Journal: Éthique, politique, religions
2012, n° 1. Le prisme du totalitarisme - Author: Tirloni (Valentina)
- Abstract: Totalitarian power is mostly apparent in the use of language. By studying these two texts (the Orwellian novel 1984 and Lingua Tertii Imperii by Klemperer) we are able to reconstruct the underlying rhetorical techniques and their philosophical foundation. Supported by a well-organized system of rites and ceremonies, totalitarian language succeeds not only in creating an outwardly respectable reality, but in dehumanizing its subjects and in entirely extinguishing every freedom.
- Pages: 115 to 132
- Journal: Ethics, Politics, Religions
- CLIL theme: 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN: 9782812408823
- ISBN: 978-2-8124-0882-3
- ISSN: 2271-7234
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-0882-3.p.0115
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 02-21-2013
- Periodicity: Biannual
- Language: French
- Keyword: totalitarianism, political rite, nominalism, empiricism, Orwell, Klemperer
Le langage du totalitarisme
Victor Klemperer et George Orwell
Langage et politique partagent un étrange destin : celui de mettre en forme une réalité dans le double but de la faire partager avec les associés d’une communauté et de la forger selon des fins politiques propres à une idéologie. Certes, le rapport du langage politique au politique n’est pas la simple mise en forme des projets du politique. Il semblerait en effet que le premier puisse constituer le second, l’informer, le structurer, mais aussi lui fournir les conditions de son existence. Si le langage politique n’est pas seulement une rhétorique du politique, le politique lui-même peut trouver son fondement en lui. Qu’arrive-t-il alors si le discours politique ou institutionnel se fonde sur un langage, écrit ou improvisé, pour véhiculer une idéologie, pour forcer la réalité ou pour amadouer les participants d’un groupe social et les priver de la libre et véritable participation politique ? Tel est bien le cas dans les exemples ici rassemblés, qui nous offrent l’occasion d’analyser1 un langage politique assez inquiétant si on le rapporte à la relation que nous entretenons habituellement à la vérité : les exemples tirés des systèmes totalitaires illustrent quelques aspects dignes de réflexion pour mieux comprendre la structure du discours et celle du consentement sur lesquels ces mêmes pouvoirs totalitaires ont bâti leur réussite et leur durée. Quels sont donc les caractères communs des langages politiques totalitaires qui sont capables de convaincre et de susciter l’adhésion, même quand les faits décrits par le langage ne coïncident manifestement pas avec les traits de la réalité la plus évidente ? Sur quoi s’appuie le langage politique pour
pervertir les phénomènes mêmes ? Et pourquoi son action se révèle-t-elle si efficace ?
Pour cette étude nous avons choisi le roman2 1984 d’Orwell et le carnet philologique LTI. Lingua Tertii Reich de Klemperer. L’analyse comparée semble d’autant plus troublante si l’on pense que ces deux auteurs ont été dans l’impossibilité de pouvoir communiquer librement et de se confronter autour d’un thème qui les rapproche autant. L’un, anglais et politiquement engagé, n’épargnera pas ses critiques aux systèmes totalitaires de gauche ; l’autre, allemand et libéral, confiera à son carnet ses analyses du langage qui l’avait privé de la liberté politique et sociale. De plus, les deux publieront des considérations similaires à peu près à la même période : 19843 est achevé en 1948 et publié l’année suivante ; LTI est composé entre 1945 et 1947, pour voir le jour à Berlin-Est en 1947.
Pourquoi s’agit-il d’une question philosophique ?
Le questionnement sur les traits fondamentaux du langage totalitaire est tout d’abord un questionnement philosophique4, dans la mesure où il relève du rapport entre la réalité et le langage qui la représente. Autrement dit, le rapport5 entre la pensée qui met sous la forme de la parole un monde extérieur et ce monde qui se donne à la parole n’est
pas un rapport univoque et universel, qui se trouve au cœur de toute réflexion philosophique sur le rapport entre un sujet et un objet. Dans ce cadre, le problème du rapport entre pensée et monde extérieur, ou vice versa, a donné naissance à des analyses sur la communication politique6 qui ont bien dégagé les techniques rhétoriques exploitées pour convaincre et obtenir une prise de position politique, s’exprimant par exemple par un vote au moment des élections. Elles ont bien mis au jour les effets politiques immédiats et actuels comme la spectacularisation du politique, la leaderisation (ou leadership personnalisé) et la personnalisation de l’autorité politique, ainsi que sur le plan strictement linguistique, le recours à des procédés bien spécifiques, l’utilisation de l’euphémisme, des superlatifs, les changements de signifié de mots d’usage courant, etc.
Si tous ces aspects sont repérables dans nos sociétés contemporaines et démocratiques, qu’est-ce qui nous permettrait de distinguer le langage totalitaire du langage politique soi-disant démocratique, mais qui recourt cependant à une technique rhétorique déterminée en vue de ses fins ? Communément, il est admis d’abord que le parti totalitaire distord le langage en connaissance de cause, et qu’il poursuit sa fin avec une détermination inouïe par rapport aux systèmes où la liberté des médias est telle que l’opposition conserve toujours, quoique plus ou moins, la possibilité de contradiction. Citons ici Michel Foucault : « Je suppose que dans toute société la production du discours est à la fois contrôlée, sélectionnée, organisée et redistribuée par un certain nombre de procédures qui ont pour rôle d’en conjurer les pouvoirs et les dangers, d’en maîtriser l’événement aléatoire, d’en esquiver la lourde, la redoutable matérialité […]. Le discours n’est pas simplement ce qui traduit les luttes ou les systèmes de domination, mais ce pour quoi, ce par quoi on lutte, le pouvoir dont on cherche à s’emparer7 ».
En ce sens, le langage nommé novlangue8 (en anglais newspeak) par Orwell peut être considéré comme le degré zéro de tout langage totali
taire, le point de raffinement absolu du langage totalitaire, heureusement non réalisé à ce jour. Ces mêmes caractères se retrouvent aussi dans le langage du national-socialisme tel que le présente le texte du philologue allemand Victor Klemperer, qui en a étudié l’application à un langage totalitaire historiquement déterminé, même si les caractères qu’il a mis au jour ont pu faire l’objet de comparaisons avec le langage d’autres systèmes totalitaires, et en particulier du communisme marxiste-léniniste9.
La visée totalitaire porte en effet non seulement sur le contrôle des actions individuelles et sur la maîtrise de la réalité, mais aussi sur la maîtrise et le pouvoir d’une description unique du monde, qui n’a d’autre fin que de légitimer et confirmer le pouvoir constitué. Si nombre de critiques ont discuté le fait qu’Orwell puisse être considéré comme un philosophe politique, il reste indiscutable que ses romans ont beaucoup apporté à l’étude de la théorie politique, comme l’attestent les nombreuses références philosophiques implicites dégagées par J. Wesley Joung10. Selon ses analyses, on retrouvera bien chez Orwell l’empirisme et le nominalisme, voire l’instrumentalisme linguistique. Les premières références philosophiques sont faites au Léviathan de Thomas Hobbes (partie finale du livre) et aux Essais sur l’entendement humain de John Locke, selon lesquels le langage n’est que l’instrument de la pensée au sens où la pensée préside à la formation des mots, et que le langage ne fait que fournir une expression à des idées déjà formées. La fonction du langage est de permettre la connaissance du monde mais, étant donné que cette connaissance est empirique et qu’elle vient de l’expérience sensorielle, on ne peut interpréter le monde en passant par le langage : en revanche on peut connaître le monde à travers la perception empirique guidée par l’intellect, et qui peut s’exprimer sous la forme de mots qui restent, de toutes façons, conventionnels. Le langage a ainsi une fonction mimétique, puisqu’il copie la réalité. La pensée est indépendante du langage et les idées sont indépendantes des mots. C’est dans le contexte d’un profond hiatus entre pensée et réalité qu’on peut lire la citation
suivante : « Ainsi le mot libre existait encore en novlangue, mais ne pouvait être employé que dans des phrases comme “le chemin est libre”. Il ne pouvait être employé dans le sens ancien de “liberté politique” ou de “liberté intellectuelle”. Les libertés politique et intellectuelle n’existaient en effet plus, même sous forme de concept. Elles n’avaient donc nécessairement pas de nom11 ».
Outre l’empirisme et le nominalisme, on retrouve le déterminisme linguistique, pour lequel le langage n’est qu’un instrument de l’intellect : le langage permet d’articuler une pensée ; en ce sens, les mots sont prédéterminés, ils précèdent la pensée et même la compréhension de la réalité. À travers les noms, on attribue un signifié à chaque réalité, tout en sachant qu’il y a toujours, dans la relation cognitive, une forme de barrière entre le sujet et l’objet. Mais dans le domaine du politique, parsemé de symboles et de discours séduisants et rhétoriques, le langage et la mise en forme de la vérité à partir du monde extérieur constituent le lieu privilégié pour l’exercice de l’abus de pouvoir. Le risque d’une distorsion de la réalité est très élevé, dès lors que les références aux objets sont de plus en plus instables, tant parce que l’on parle d’un programme politique qui n’a pas encore vu le jour que parce que le domaine du politique est connoté par une série de notions qui se référent à un système axiologique, c’est-à-dire à une variété de valeurs sociales et éthiques qui nous imposent une réflexion philosophique sur l’éthique du politique, l’idée du bien, ou, pour parler un langage plus contemporain, la garantie de droits.
Le risque de distorsion de la réalité est encore plus important quand on a à faire au passé, dont la mémoire est conservée dans les livres ou les journaux. Ici, le langage n’est pas une copie de la réalité : il interprète et crée cette réalité. Edward Sapir a bien souligné comment, s’il est vrai qu’on a besoin du langage pour penser et comprendre le monde, le langage a lui-même des limites sur le plan tant du vocabulaire que de la syntaxe et de la grammaire. Il est clair que la structure grammaticale et le vocabulaire de langues différentes peuvent ouvrir différentes perspectives d’un même monde. Les limites personnelles concernant le langage et l’expérience culturelle d’un individu peuvent, elles aussi, restreindre la compréhension de la réalité. Autrement dit, le découpage
de la réalité ou du passé peut être un instrument pour interpréter les faits : dans 1984, la manipulation du passé12 est manifeste, comme en témoigne l’exemple de la réduction de la ration de chocolat, qui est présentée comme une augmentation.
L’instrumentalisme linguistique et le déterminisme linguistique trouvent place dans la vision dualiste de la réalité, décrite en « 1984 » et incarnée par les deux personnages principaux et antagonistes : en effet le personnage principal, Winston Smith, incarne une vision du monde empiriste selon laquelle les mots doivent refléter la réalité objective comme un miroir ; l’inquisiteur du Parti, O’Brien, est pour sa part porteur d’un déterminisme selon lequel la réalité n’existe que dans la conscience des individus. Pour ce dernier, le syllogisme est simple : si le langage contrôle la conscience et le Parti contrôle le langage, alors celui-ci pourra contrôler les consciences et peut façonner le monde selon les besoins de la propagande du pouvoir. Dans le roman, la vision du monde d’O’Brien semble prendre l’avantage sur celle de Winston : mais le but d’Orwell est de montrer jusqu’où le langage peut s’emparer des hommes et des femmes pour leur faire nier la réalité objective qu’il saisissent par leur expérience.
Le langage politique totalitaire :
la réalité du national-socialisme
Venons-en à l’analyse du langage du Troisième Reich telle qu’elle a été développée par Victor Klemperer13 dans son journal. Cette référence historique nous achemine vers la compréhension des aspects fondamentaux de tout langage totalitaire. En effet, l’auteur, témoin de la montée du nazisme, s’accroche à ses carnets pour résister à la montée d’une langue qui rend les interlocuteurs à ce point prisonniers de l’idéologie que les
opposants eux-mêmes finissent par la parler et l’assimiler. Klemperer recourt à l’image du balancier : le carnet lui fournit un point d’ancrage dans une réalité dont l’horreur échappe à toute compréhension possible. C’est, effectivement, à travers cet exercice philologique qu’il observe de quelle façon les mentalités s’imprègnent de l’hystérie d’une langue. Il s’agit d’un témoignage direct de l’expérience du totalitarisme nazi par un juif qui se considérait comme totalement allemand. S’il n’y a aucune tentative de théorisation de la langue du totalitarisme, il s’agit néanmoins d’une série de notes – plus précisément un carnet – sur les expressions linguistiques de l’expansion du pouvoir de l’Allemagne nazie et, à travers différentes anecdotes, sur la réception de sa langue. Dans LTI, Victor Klemperer montre qu’il est possible de décrypter la structure d’une langue visant à vicier et pervertir la réalité.
Quels sont les caractères propres à la langue du national-socialisme ? Pour reprendre une expression forgée par Jean-Pierre Faye14, et développée par Alice Krieg-Planque15, la langue du Troisième Reich est une langue « totale », qui se construit à partir de « formules » qui visent à se diffuser non seulement dans la sphère publique mais aussi dans la sphère privée, au point qu’il n’est plus possible de distinguer la limite entre individu et collectivité d’appartenance. John Wesley Young16 a dégagé quelques uns des éléments structuraux sur lesquels la LTI se fonde pour atteindre ses fins.
Le premier de ces éléments est le recours massif à l’émotion (emotionalism17), afin que le discours hitlérien puisse s’ancrer au plus profond de l’esprit allemand et obtenir une fidélité inconditionnée. Dans les discours publics, à la radio ou lors des manifestations, le langage a la valeur d’une puissance magique capable d’exciter l’enthousiasme et les passions du peuple. Les effets émotionnels comptent beaucoup plus que les signifiés des mots employés, aussi importants soient-ils. Ainsi, « peuple (Volk) » ou « sang » introduisent une dimension de fraternité. De même, le mot « Volksgemeischaft » et ses dérivés, qui renforcent l’idée
de la communauté, de peuple, permettent de faire surgir des émotions perdues dans un nouveau sub-langage émotionnel et irrationnel. Le langage du sang, de la Heimat, compose avec l’image d’un lien racial mystique unifiant tous les Allemands au long de l’histoire dans une grande communauté historique, dont le passé teutonique est ressuscité afin de faire appel au patriotisme national.
Un deuxième élément, assez proche du premier, concerne l’amour pour les mots d’origine étrangère (xenologophilia). En effet, dans la rhétorique politique des discours publics, l’émission à très fort volume de sons incompréhensibles contribue à confondre les esprits et à les plonger dans un univers magique et initiatique : quelques mots ont une valeur positive, tels Dynamik, Instinkt, Idee, Garant, Agitation, Paladin, heroisch, total et fanatisch ; d’autres sont chargés d’un sens péjoratif, tels Invasor, Aggressor, System, Plutokratie, diffamieren, diskriminieren. Certains de ces termes contribuent aussi à engager la société dans une dynamique déterminée, en la confirmant dans l’idée d’une destinée que l’histoire lui a conférée et qu’elle doit accepter : les exemples les plus célèbres sont Sturm, Blitz, Blitzkrieg, Bewegung.
Un troisième élément est formé par les acronymes, les mots abrégés et les superlatifs utilisés pour magnifier le monumentalisme de la langue du Troisième Reich. Ainsi les appellations des Gestapo, SS, sur lesquelles Orwell calquera les termes inventés dans sa novlangue de ComInter ou Minipax et Miniver pour désigner respectivement les ministères de la guerre et de la propagande (nommé ministère de la vérité). Ces mots monumentaux servent à souligner l’efficacité et la grandeur de l’appareil bureaucratique18 dont l’Allemagne s’est dotée pour gérer et réglementer toutes les phases de la vie humaine, en exerçant sa forme spécifique de biopouvoir. Cet éloge latent de la bureaucratie, souvent associé à une métaphore organiciste, est en fait visé par une mécanisation19 délibérée de la langue qui, à travers des métaphores techniques, tend à une systématique déshumanisation20 de la personne, réduite au rang de maillon d’une chaîne dessinée par l’histoire du peuple germanique. L’emploi
récurrent des superlatifs et des adjectifs comme kolossal ou total vise à conditionner des esprits à croire à l’invincibilité du mouvement politique du national-socialisme : c’est le cas pour les expressions de guerre super-totale, de guerre la plus totale ou la plus radicale.
La brutalité de la langue – qui constitue le quatrième élément – reflète l’absence de toute forme de libéralisme qui pourrait introduire une diversité ou une « altérité » de pensée. Ce caractère s’accompagne d’une constante militarisation de la langue : tout devient ainsi lutte, Kampf, Krieg et marche vers une destination future qui n’est pas encore acquise.
Un cinquième élément est constitué par l’euphémisme, qui par ailleurs sert à camoufler les échecs les plus manifestes de la politique national-socialiste : le besoin de masquer la vérité avec des « formules » comme « solution finale », « contribution volontaire », « traitement spécial », ainsi que le tristement célèbre « Arbeit macht frei », sont là pour témoigner de la perversité d’une langue qui masque la vérité en la forgeant selon son propre bon vouloir idéologique. Cette réalité se caractérise par un manichéisme manifeste : il n’y a qu’une opposition entre blanc et noir, entre bien et mal, sans zones d’ombre faites de gris et d’incertitude. Le langage totalitaire est bipolaire car, en empêchant de se former une opinion autonome, il contribue à la distinction tranchée, pragmatique et performative des entités du monde. Le langage bipolaire dénote implicitement de quel côté sont placés les individus qui ont raison et possèdent par conséquent le pouvoir. Ce bipolarisme distingue la LTI de la novlangue imaginée par Orwell, car l’écrivain anglais envisage le cas limite d’une langue qui élimine toute altérité possible. La vision monolithique de 1984 sera effectivement possible quand la novlangue sera parvenue à sa version définitive, qui ne permettra plus de retraduire une pensée dans l’ancienne langue naturelle.
Le langage politique totalitaire :
la fiction d’Orwell
Le roman 1984 raconte la vie de Winston, employé au Ministère de la Vérité, où il est censé changer le passé contenu dans les archives pour les faire correspondre aux idées et versions officielles du Parti. Le monde
est divisé en trois grandes superpuissances à régime totalitaire qui sont en guerre perpétuelle entre elles et qui changent assez fréquemment leurs alliances. Winston représente ainsi le raccord entre l’ancien monde – caractérisé par le langage naturel – et la nouvelle vision du monde incarnée par l’angsoc (le socialisme anglais). Face à la brutalité de cette novlange qui réduit de plus en plus toute réflexion autonome et spontanée, Winston prend conscience du danger auquel il s’exposerait si la Police de la Pensée le traquait. La structure triadique de la société décrite n’est que l’unité de base qui, comme dans une fractale, se reproduit de façon identique dans le langage, dans les principes politiques de l’idéologie dominante et dans les couches sociales. Les continents en guerre sont au nombre de trois car la triade a un puissant effet catalyseur et organisateur. Comme l’a montré Th. Caplow21, elle est à l’origine de tout système social, organisé autour de relations stables et facilement prévisibles. Les slogans de l’angsoc sont eux aussi au nombre de trois : « la guerre, c’est la paix » ; « la liberté, c’est l’esclavage » ; « l’ignorance, c’est la force ». Il en va de même pour les vocabulaires qui constituent la novlangue, ou les principes de l’angsoc : la double-pensée (doublethink) consiste à croire à une chose et en même temps à son contraire, sans passer par la résolution synthétique opérée par la dialectique ; la mutabilité du passé qui entraîne la ré-écriture de l’histoire ; le refus de la réalité objective, qui permet d’opposer un présent figé dans le respect des décisions prises par la hiérarchie à un passé en perpétuelle évolution.
1984 est ainsi tout d’abord une dystopie, c’est-à-dire un récit de fiction où, dans une société imaginaire, le monde est représenté dans ses conséquences négatives extrêmes, contrairement à l’utopie, où prévaut une dimension irénique. Si Orwell a affirmé que ce qu’il avait le plus désiré dans sa vie, c’était d’écrire sur la politique par la voie de l’art22, son dernier roman lui permet de montrer l’isomorphisme entre l’ordre existentiel et l’ordre politique, fondus dans l’esthétique23 de la fiction
littéraire. En effet, en combinant sur un mode esthétique fiction littéraire et genre utopique, Orwell peut projeter dans un futur possible ce qui commence à poindre dans le monde contemporain. Le carnet de Klemperer donne ici raison à cette fiction littéraire, en montrant que les caractères totalitaires mis en évidence par Orwell n’ont pas été si loin du réel. François Brune met en relief, à juste titre, le pouvoir métonymique24 de l’écriture orwellienne là où chaque élément renvoie à une totalité globale signifiante et où les aspects d’ordre existentiel entrent en résonance avec l’ordre politique. Cet effet de métonymie est exemplaire de la visée totalitaire, qui tend à faire coïncider ces deux ordres afin de pouvoir mieux les maîtriser.
Selon Orwell, d’après ses essais et ses romans où l’on retrouve son engagement politique, tout système totalitaire vise à abolir la pensée indépendante et, de manière plus générale, toute forme de pensée ou raisonnement. Il est donc nécessaire de créer une langue qui puisse empêcher toute forme hérétique de pensée. Ainsi, en contrôlant la langue, le pouvoir politique contrôle en même temps les sujets. En ce sens la newspeak créée par Orwell n’est que l’imitation satirique et parodique d’une tendance25 du monde contemporain et de la naissance des systèmes totalitaires. À la base de sa réflexion, on retrouve ses constats sur la détérioration de la littérature et de la politique : c’est pour cela qu’il modèle la nouvelle langue d’Océanie en empruntant les traits de décadence de sa propre époque, tant sur le plan politique que sur le plan littéraire.
Les caractères structuraux de la newspeak sont présentés dans l’annexe du livre, juste après le mot « fin » du roman. Cette annexe fait-elle partie du roman, ou le fait qu’Orwell ait ressenti le besoin de l’analyser en détail reflète-t-il l’espoir que celle-ci ne soit pas encore opérationnelle ? Il est impossible, en effet, d’identifier l’auteur de cette annexe consacrée aux principes de la nouvelle langue, qui doit être définitivement réalisée dans quelques décennies et qui ne permettra plus de traduire l’ancienne langue dans la nouvelle. S’agit-il de Winston, le personnage principal du roman, ou d’un autre interchangeable fonctionnaire du parti, ou
encore d’O’Brien ? Face aux éditeurs américains qui voulaient couper cette annexe de la publication du roman, Orwell se défend en répondant qu’elle fait partie intégrante du roman et remarque que si le lecteur ne saisit pas son signifié, il ne saura pas saisir non plus le signifié de tout le roman26.
Quoi qu’il en soit, cette langue a comme but spécifique « non seulement de fournir un mode d’expression aux idées générales et aux habitudes mentales des dévots de l’angsoc, mais de rendre impossible tout autre mode de pensée27 ». Et encore : « le novlangue était destiné, non à étendre, mais à diminuer le domaine de la pensée, et la réduction au minimum du choix des mots aidait indirectement à atteindre ce but28 ». Dans la conception du totalitarisme que l’on retrouve chez Orwell, il y a l’idée et le projet de créer une langue qui réalise la parfaite coïncidence entre réel et langage, permettant d’affirmer qu’il existe un et un seul monde, et qu’il n’y a pas d’autres mondes possibles. La visée totalitaire du langage implique donc de nier toute autre construction possible du réel et de réduire les conditions de verbalisation d’autres réalités et d’autres mondes. Ce qui ne peut être exprimé par la nouvelle langue ne peut être ni conçu ni imaginé ni dit, et encore moins exister : l’hérésie est tout ce qui introduit des mondes « impossibles ». Car il s’agit d’éliminer la possibilité d’imaginer d’autres mondes utopiques, différents de la représentation officielle. Pour nommer un autre vision du monde et une autre pensée, Orwell préfère le mot d’hérésie, comme pour souligner le caractère sacré que la vision du monde officielle possède vis-à-vis d’autres possibilités.
La novlangue est l’application technique du doublethink et du principe dualiste du noir-blanc. Elle fonctionne et produit ses effets, comme le Gestell décrit par Martin Heidegger lorsqu’il s’interroge sur l’essence de la technique. La nouvelle langue, en effet, devrait être telle qu’elle empêche toute autre réflexion ou pensée, en produisant comme effet principal, effet voulu et réalisé par la plupart des systèmes totalitaires, la déshumanisation. Le langage devient, en somme, l’outil à disposition du pouvoir pour forcer les masses et pour empêcher toute réflexion autonome et spontanée. De plus, quand le langage totalitaire s’impose
sous les formes analogues à celles du Gestell, il va de soi que toute autre possibilité de penser, de dire ou d’imaginer le monde est interdite29. La novlangue se fonde sur deux opérations : l’une grammaticale et l’autre lexicale. Dans la première sont reconduits deux principes généraux : d’une part l’interchangeabilité des unités linguistiques d’une phrase, c’est-à-dire la perte de distinction des fonctions propres aux noms, verbes, adjectifs, adverbes et la possibilité d’utiliser l’un à la place de l’autre ; d’autre part la régularité absolue de toute forme linguistique, sans exception. Le but est donc d’uniformiser la langue et par conséquent la pensée, qui est ainsi normalisée et standardisée. Chaque mot peut donc être utilisé indifféremment en tant que verbe, adjectif ou nom. Quelques règles ont été formulées pour garantir la formation des adjectifs en -able ; des adverbes en -ment ; des pluriels en –s ; des superlatifs avec plus- ou doubleplus- et de la forme négative en rajoutant in-. Du point de vue sémantique, il n’y a pas de place pour des synonymes ou contraires, car la langue totalitaire n’admet pas autre chose que la réalité qu’elle peut représenter.
Au niveau du vocabulaire, la nouvelle langue prévoie trois sections sémantiques bien distinctes, sans connexion entre elles. Le lexique A contient les rares mots simples, d’utilisation courante et quotidienne, dont le signifié a été préalablement établi de façon claire, afin d’éviter toute ambiguïté ou nuance dangereuses. Le lexique B a été créé pour les mots « formés pour des fins politiques, c’est-à-dire des mots qui, non seulement, dans tous les cas, avaient une signification politique, mais étaient destinés à imposer l’attitude mentale voulue à la personne qui les employait30 ». On y retrouve des mots composés d’autres mots ou de parties fusionnées selon un critère euphonétique. Il n’y a pas de mots politiquement neutres, car ces mots sont le reflet de l’idéologie dominante. Là, l’ambiguïté est présente et recherchée, mais ciblée sur des contextes d’utilisation qui en assurent cependant le bon usage politique et idéologique. Il s’agit donc d’une sorte de sténographie verbale31 qui condense en peu de syllabes une série importante d’idées. La prononciation de ces mots composés était assez simple et harmonieuse ; chaque
mot pouvait être formé par n’importe quels éléments du langage. Avec ce lexique qui remplace l’intelligence par le réflexe conditionné induit par les mots B, il est possible seulement de faire des choix entre des oppositions binaires32. Les mots B, en outre, sont en général des abréviations, ou des mots constitués par très peu de syllabes, car, pour être efficace, la prononciation d’un mot doit être de courte durée afin d’éviter soigneusement les associations d’idées et pensées, lesquelles pourraient avoir l’effet néfaste d’évoquer des souvenirs, des images du passé ou des signifiés non orthodoxes. En effet, l’exemple proposé de façon ironique par Orwell est celui du mot « Internationale Communiste », qui, réduit à « Komintern33 » n’aurait pas permis de rappeler à la conscience les drapeaux rouges, la solidarité et la fraternité de Karl Marx ou de la Commune de Paris. Ces opérations sur le langage permettent ainsi de rendre le discours – surtout celui à contenu idéologique – le plus indépendant possible de l’auto-conscience34.
Le lexique C est formé par les mots techniques et scientifiques, mais sans substitution possible, comme s’ils étaient enfermés entre des cloisons étanches. On remarque l’absence de la catégorie abstraite de science, laquelle est, en revanche, comprise dans la catégorie plus compréhensive et totalisante de l’« Angsoc ». Toute idée ou produit d’une créativité quelconque est ainsi émanation de la même discipline totalisante.
Rituels politiques
Un dernier point mérite d’être évoqué. Orwell permet aussi de comprendre le lien entre langage et rituel, comme lieu privilégié de formation du consensus et de conservation du pouvoir : car il n’y a pas de politique sans rituels, sans qu’on puisse pour autant réduire la politique à ses rites. Les fêtes nationales ou les cérémonies d’intronisation de nouveaux pouvoirs en sont un exemple toujours actuel et valable,
car les rites sont en effet de puissants instruments d’intégration sociale, dont le dispositif se déploie sur quatre dimensions au moins, et dont le totalitarisme va illustrer l’usage, le passage à la limite ou l’abus. La première dimension est celle qui permet de recueillir un consensus, en réfléchissant les structures culturelles d’une société, c’est-à-dire en reproduisant de façon autoréférentielle son propre système de formules et règles. La deuxième concerne l’utilisation des rituels en vue de l’exhibition du pouvoir, afin de rendre évidente la force du pouvoir lui-même, ainsi que sa légitimité. La troisième dimension des rituels politiques consiste dans le fait de conférer un sens partagé aux évènements de la vie sociale, en justifiant les actions entreprises par les gouvernants. Enfin, le rituel poursuit le but spécifique de détruire l’image publique de l’adversaire, ou de lui attribuer la responsabilité des insuccès de la société. Néanmoins la fonction la plus évidente du rituel politique est, comme l’a montré Baczko35, celle de socialiser les individus dans un corps politique collectif.
Pour obtenir une adhésion pleine à son idéologie, un régime totalitaire accorde donc une place conséquente aux rituels politiques et à la création d’événements partagés36. Outre le but de renforcer la participation du peuple, ces rituels ont pour fin de renforcer l’intime conviction de la légitimité du régime. Si les exemples historiques comprennent les nombreuses parades militaires, les marches de « libération », les discours publics d’un balcon ou les rituels des communiqués de presse (par exemple ceux de l’Instituto Luce italien), dans 1984, Orwell fait surtout référence au rituel quotidien des deux minutes de haine, pendant lesquelles chaque matin à onze heures les assujettis peuvent se déchaîner et donner libre cours à leurs pulsions. Ce rituel légitime la violence et l’encourage, tout en la maintenant sous le contrôle du pouvoir établi. C’est une façon de canaliser les passions humaines, en les commandant à distance et en les dirigeant sur une cible connue et reconnue par le pouvoir. Le rituel, dont le programme peut changer, commence toujours par l’image d’Emmanuel Goldstein, ennemi du Peuple, qui agit comme le réflexe conditionné de Pavlov : les individus présents dans la salle peuvent alors se laisser aller aux pires manifestations de colère et de haine. Ce sont bien l’ennemi et sa présentation qui renforcent
le rituel, car, au lieu d’être un exclu de la vie politique, Goldstein est tout à fait intégré au Parti, lequel peut tirer profit de la démonisation de l’adversaire. Cette pratique, qui n’est pas si loin de pratiques réelles dans la réalité contemporaine, se fonde sur l’idée que l’ennemi confère au spectacle politique le pouvoir d’éveiller les passions, les craintes et les espoirs exploités par le pouvoir dominant, et surtout que ce dernier peut réaffirmer, aux yeux du public, son engagement et son rôle légitime face à un ennemi menaçant37. Mais c’est pendant la seconde minute que le climax des pulsions et des sentiments négatifs – sciemment orchestré par le Parti – touche à son apogée : c’est à ce moment que les pulsions peuvent prendre corps physiquement, et animer les personnes présentes qui, « même contre (leur) volonté38 », commencent à s’agiter dans toutes les directions. La haine apparaît ainsi comme « une émotion abstraite, indirecte, que l’on pouvait tourner d’un objet vers un autre39 ». Le rituel se termine avec la projection de l’image du sauveur, le Big Brother, qui estompe l’explosion émotionnelle et l’apaise en lui donnant une mystérieuse sérénité. Alors se produisent la dissolution de l’image et l’apparition des trois slogans du Parti. Actes de prière et d’extase accompagnent un chant psalmodié lent et rythmé, d’une lourdeur solennelle et grave : un hymne à la sagesse et à la majesté, composé de deux mots seulement « Big Brother ». Quant aux slogans manifestement paradoxaux sur angsoc, Simone Veil remarque leur caractère particulier, car il n’y a pas de paradoxes dans le monde totalitaire puisque la mise en forme de la vérité et de la réalité dépend intégralement de ceux qui, en détenant le pouvoir, détiennent aussi la langue. Le pouvoir totalitaire définit et redéfinit la langue de leur pouvoir40.
La « semaine de la haine » est l’autre grand rituel politique auquel s’adonne la population, sous la direction du Parti : elle consiste en une série de cortèges, conférences, réunions, parades, programmes télévisés – où les écrans diffusent la chanson de la haine, caractérisée par un rythme obsessionnel et sauvage qui a pour but d’hypnotiser les
masses41. Comme dans une véritable société du spectacle42, la semaine se déroule sans que l’objet et le contenu des manifestations soient connus ou précisés, montrant comment le rituel atteint ses objectifs grâce aux pratiques répétées sans conscience et de façon mécanique.
Conclusions
Tout discours politique est censé se présenter comme la bonne représentation de la réalité, la seule possible et véritable. Dans le débat politique et social démocratique, ce discours oriente les choix des individus dans leur préférence politique. S’il ne peut pas être neutre, il se montre au moins par le langage comme digne de foi et partageable par ceux qui en ont été convaincus. Dans les systèmes totalitaires, au contraire, ces choix se montrent beaucoup plus difficiles à effectuer, car le discours politique est fondé sur un langage politique dont la visée est de détruire toute confrontation politique ou ontologique avec l’autre. Le langage totalitaire essaie – en paraissant réussir – de faire coïncider l’ordre du discours et l’ordre du monde, en réduisant les écarts qui, dans tout système démocratique, constituent la richesse du débat politique lui-même. Les deux exemples ici présentés – littéraire ou historique – mettent en lumière les dangers attachés à tout langage politique, bureaucratique ou administratif, si les dérives ne sont pas dénoncées à temps. Si les systèmes politiques totalitaires ont sans doute rencontré des résistances, il se peut néanmoins que certains aspects du totalitarisme se retrouvent sous une forme aujourd’hui atténuée ou subliminale, comme par exemple dans les procédures bureaucratiques de certaines démarches administratives. Est-on à l’abri d’un langage administratif qui fait massivement recours au mot « dispositif » ? Quelle liberté possède-t-on face à la variété et à l’utilisation massive de dispositifs ? Combien de fois recourt-on à la formule « mettre en place le dispositif de … » que l’on entend de plus en plus dans le langage courant ? Sur quelles bases pourrait-on en légitimer ces usages ? Autrement dit, qui
se masque derrière cette mise en place des dispositifs ? Ne serait-elle pas une façon pour négliger ou décliner toute responsabilité personnelle face à l’action ? « Qui custodiet custodes ? ».
Valentina Tirloni
Université Lyon 3 – IRPhiL
1 Marianne Franchéo (dir.), Langage et pouvoir en interaction. Étude de quelques exemples, préface Pierre Achard, Feuillets de l’ENS de Fontenay-St Cloud, 1995 ; Roger Fowler, Bob Hodge, Gunther Kress, Tony Trew, Language And Control, Routledge et Kegan Paul, Londres, 1979.
2 Il ne sera pas inutile de rappeler les autres exemples littéraires sur les systèmes totalitaires, en se référant aux textes d’Adolf Huxley (Le Meilleur des Mondes, paru en 1931), de Ray Bradbury (Fahrenhait 451, en 1951) et d’Ievgueni Zamiatine (Nous Autres, en 1920). Autre référence cinématographique est le beau film The Truman Show, de Peter Weir (Paramount Pictures, 1998), qui a obtenu en France plus d’un million d’entrées et aux Etats Unis a eu plus de 125 millions de dollars de recettes, montre l’intérêt porté au cauchemar du Big Brother. Toute émission télévisée de reality show repose sur la prise directe et en huis clos de la vie des participants : la vidéosurveillance est choisie afin de se montrer et par là atteindre la célébrité, tandis que dans le système totalitaire, elle est un instrument de contrôle dont on ne veut que se cacher.
3 George Orwell, 1984, trad. fr. Amélie Audiberti, Folio Gallimard, Paris, 1972, éd. 2001.
4 Sur cette dimension philosophique de l’ouvrage, cf. Jean-Daniel Jurgensen, Orwell ou la route de 1984, Robert Laffont, Paris, 1983, p. 25.
5 Cf. Murray Edelman, Pièces et règles du jeu politique, trad. fr. Christian Cler, Éditions du Seuil, Paris, 1991, en particulier p. 32.
6 Gianpietro Mazzoleni, La Comunicazione politica, Il Mulino, Bologne, 2004 ; Lorella Cedroni, Tommaso Dell’Era, Il Linguaggio politico, Carocci, Rome, 2002 ; Sara Bentivegna, Comunicare in politica, Carocci, Rome, 2001 ; Dominique Wolton, Penser la communication, Flammarion, Paris, 1997, en particulier p. 175-195 ; Dan Nimmo, Sanders, Keith (dir.) Handbook of political communication, Sage Publications, Paris, 1981, en particulier p. 195-267.
7 Michel Foucault, L’Ordre du discours, Gallimard, Paris, 1971, p. 10-12.
8 Quoi qu’il puisse paraître étrange, le mot « novlangue » est masculin dans la traduction française du roman 1984. Nous préférons néanmoins décliner novlangue au genre féminin le long de cet article.
9 Pour l’analyse de la langue de bois et du langage administratif du régime communiste soviétique, nous renvoyons au texte de Françoise Thom, La Langue de bois, Julliard, Paris, 1987.
10 John Wesley Young, Totalitarian Language : Orwell’s Newspeak and its Nazi and Communist antecedents, The University Press of Virginia, Charlottesville-Londres, 1991.
11 Orwell, 1984, op. cit., p. 422.
12 Sur le rapport entre passé et garantie des droits dans un état de droit, cf. Guy Haarscher, Philosophie des droits de l’homme, Éd. de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 4e édition, 1993.
13 Victor Klemperer, LTI, la langue du IIIe Reich : carnets d’un philologue, Albin Michel, Paris, 1996.
14 Jean-Pierre Faye, Théorie du récit. Introduction aux langages totalitaires, Hermann, Paris, 1972 et aussi Langages totalitaires, Hermann, Paris, 1972.
15 Alice Krieg-Planque, La Notion de « formule » en analyse du discours. Cadre théorique et méthodologique, Presses universitaires de Franche-Comté, Besançon, 2009.
16 John Wesley Young, Totalitarian Language. op. cit., p. 76-103.
17 Ibid., p. 77.
18 Robert Hariman, Le Pouvoir est une question de style. Rhétoriques du politique, trad. fr. Laurent Bury, Klincksieck, Paris, 2009, p. 199-235.
19 Jacques Dewitte, Le Pouvoir de la langue et la liberté de l’esprit. Essai sur la résistance au langage totalitaire, Michalon, Paris, 2007, p. 169 sq.
20 Victor Klemperer, LTI. op. cit., p. 204.
21 Theodore Caplow, Deux contre un, trad. fr. P. Cep, Armand Colin, Paris, 1971. Voir aussi Annie Vérut, « 1984 : de Dieu à Big Brother » in Revue Les Années Trente. Special Orwell 1984, Université de Nantes, no 1, novembre 1983, p. 109-129.
22 « What I have most wanted to do throughout the past ten years is to make political writing into an art », in Sonia Orwell et Ian Angus, Collected Essays, Journalism and Letters, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 1968, vol. I, p. 6.
23 Frédéric Regard, 1984 de George Orwell, Gallimard, Paris, 1994, p. 16-21. Pour un avis contraire, voir Simon Leys, Orwell ou l’horreur de la politique, Hermann, Paris, 1984, p. 56.
24 François Brune, Sous le soleil de Big Brother. Précis sur « 1984 » à l’usage des années 2000. Une relecture d’Orwell, L’Harmattan, Paris, 2000, p. 141-146.
25 Jeffrey Meyers, A Reader’s Guide to George Orwell, Thames and Hudson, Londres, 1978, p. 144-146.
26 Bernard Crick, George Orwell. A life, Secker & Warburg, Londres, 1981, p. 386.
27 G. Orwell, 1984. op. cit., p. 422.
28 Ibid., p. 423.
29 Valentina Tirloni (dir.), Du Gestell au dispositif. Comment la technicisation encadre notre existence, EME, Bruxelles-Fernelmont, 2010.
30 G. Orwell, 1984. op. cit., p. 426-427.
31 Ibid.
32 François Brune, 1984 ou le règne de l’ambivalence. Une relecture d’Orwell, Editions Lettres Modernes, Paris, 1983, p. 63.
33 G. Orwell, 1984. op. cit., p. 432.
34 Ibid., p. 432-434.
35 Bronislaw Baczko, Les Imaginaires sociaux, Payot, Paris, 1984, p. 32.
36 Bernard Lamizet, Sémiotique de l’événement, Lavoisier, Paris, 2006.
37 Murray Edelman, op. cit., p. 129.
38 George Orwell, 1984. op. cit., p. 28.
39 Ibid.
40 Simone Veil, « 1984 : A European Perspective », in Shlomo Giora Shoham et Francisis Rosenstiel, And He Loved Big Brother. Man, State and Society in Question, The MacMillan Press, Conseil d’Europe, Londres, 1985, p. 46.
41 Ibid., p. 211 et sq.
42 Voir le texte classique de Guy Debord, La Société du spectacle, Gallimard, Paris, 1992.