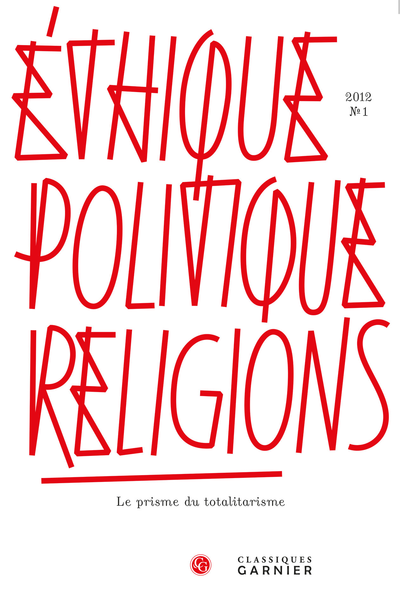
Le dieu mortel et ses fidèles sujets Hobbes, Schmitt et les antinomies de la laïcité
- Publication type: Journal article
- Journal: Éthique, politique, religions
2012, n° 1. Le prisme du totalitarisme - Author: Balibar (Etienne)
- Abstract: Returning to the discussion concerning the relationship between Hobbes and Schmitt, while simultaneously relating it to contemporary debates over the “visibility” of Islam in the French public sphere, we examine three points in succession : How do we reconcile Hobbes’s doctrine of the artificial personality of the State with his militant anticlericalism ? Does the interpretation offered by Schmitt improve our understanding of the difficulty inherent in subjecting citizens to the authority of the law, which leads to the sacralizing of the latter ? How do we evaluate the tendency inherent in political sovereignty to attribute a theological function to the internal enemy of the state ?
- Pages: 27 to 39
- Journal: Ethics, Politics, Religions
- CLIL theme: 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN: 9782812408823
- ISBN: 978-2-8124-0882-3
- ISSN: 2271-7234
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-8124-0882-3.p.0027
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 02-21-2013
- Periodicity: Biannual
- Language: French
- Keyword: secularism, body politic, pluralism, public enemy, potestas indirecta
Le dieu mortel et ses fidèles sujets
Hobbes, Schmitt et les antinomies de la laïcité
La préface que j’avais rédigée en 2002 pour la traduction française du livre de Schmitt Le Léviathan dans la doctrine de l’État de Thomas Hobbes aux Éditions du Seuil1 avait déjà atteint des dimensions excessives avant que j’aie réussi à y insérer un développement auquel je pensais dès le début, et que je souhaitais intituler « L’impuissance de Dieu », relatif à la doctrine du Katékhon2. J’ai donc du y renoncer alors. Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est ici donnée pour y revenir. La conjoncture n’est plus tout à fait la même. Elle est surdéterminée, en particulier, par la relance des débats sur la signification et les modalités d’application de la « laïcité » à la française. Les projets de loi en cours relatifs à l’interdiction du port de la burqa ou du niqab dans ce qu’on appelle « l’espace public » et qui semble devoir inclure tout lieu qui n’est pas soustrait aux regards de tiers, montrent assez à quelles extrémités cette notion peut conduire lorsqu’elle est considérée, non seulement comme un élément constitutif de la souveraineté de l’État, mais comme la source de légitimité principale de sa forme républicaine. Or c’est toujours dans l’urgence d’une conjoncture que nous identifions la pointe des questions qu’il faut poser aux textes classiques pour déterminer ce qui, aujourd’hui encore, fait la vitalité de leurs énoncés théoriques. Inversement, il fait peu de doute à mes yeux, d’une part, que la conception hobbesienne de la séparation de l’Église et de l’État, avec les fluctuations que peut comporter sa réalisation institutionnelle mais aussi l’intransigeance de la position de principe qu’elle
incarne, constitue au sein de la doctrine classique du ius circa sacra, autrement développée par Locke ou par Spinoza, la « source » typique de la doctrine française d’une laïcité d’État, ou si l’on préfère d’une laïcité comme attribut de la puissance publique3. D’autre part, c’est sur ce point plus encore que sur d’autres que la double emprise de la pensée de Hobbes sur le concept schmittien du politique et de celui-ci sur l’interprétation des tensions qui travaillent la pensée de Hobbes s’avère éclairante, voire incontournable : elle permet d’examiner en son centre même, c’est-à-dire le rapport entre l’absolu de la souveraineté politique et la constitution du sujet de l’État, le double mouvement de dé-théologisation et de re-théologisation (probablement sans fin) qui caractérise le Léviathan hobbesien, mais aussi à un degré ou un autre ses applications pratiques dans l’histoire européenne moderne. Dans ce qui va suivre, et qui n’est bien entendu qu’un programme, je vais donc esquisser trois points : Premièrement, comment faut-il rapporter à sa doctrine de la personnalité artificielle de l’État l’anticléricalisme de Hobbes, tel qu’il s’exprime en particulier dans les parties III et IV du Léviathan ? Deuxièmement, en quoi la lecture de Schmitt, et le « forçage » qu’elle comporte (dont j’avais fait l’axe de mon commentaire de 2002) nous permet-elle d’identifier une difficulté névralgique au cœur de la conception hobbesienne de l’assujettissement des citoyens et des associations qu’ils forment à l’autorité de la loi, qui conduit à la sacralisation de celle-ci ? Troisièmement, enfin, comment évaluer au plus juste la tendance de la souveraineté à théologiser la fonction de l’ennemi intérieur de l’État, et la façon dont elle évolue entre le prototype hobbesien et la reprise schmittienne, dont certaines transformations actuelles des fonctions politiques de la « laïcité » montrent l’actualité ?
Hobbes : nécessité d’un anticléricalisme d’État
L’anticléricalisme de Hobbes, dont la cible explicite est l’Église catholique, mais qui est susceptible de s’étendre à d’autres organisations formelles ou informelles (ou, comme il dit, au chapitre 22 du Léviathan, « systèmes ») réunissant au sein de la société civile des croyants ou des fidèles ayant en commun la poursuite d’un même objectif de salut et la reconnaissance d’une même autorité spirituelle, est exposé avec force dans les IIIe et IVe parties de l’ouvrage, trop souvent laissées de côté dans les explications modernes, alors qu’elles en fournissent la clé des intentions. On voit qu’il recouvre un ensemble très complexe d’opérations critiques, herméneutiques et juridiques, allant de l’analyse du fondement anthropologique des croyances religieuses (qui réside dans une faculté métaphorique propre au langage humain, qui le détourne en permanence de sa fonction cognitive naturelle) à la dénonciation de l’usage fait par l’Église, en tant que hiérarchie de pouvoir séparé, et par ses ministres, des superstitions et du besoin d’obéissance des individus pour les assujettir à un pouvoir concurrent de l’État qui leur promet un salut au-delà de ce monde. Cet anticléricalisme forme évidemment la contrepartie – annonciatrice d’un certain courant des Lumières et, plus tard, du positivisme – d’une conception de l’éducation rationnelle et de l’essence pragmatique de l’obéissance à la loi, qui sont essentielles à la notion hobbesienne de la politique en tant que construction purement humaine. Il coexiste cependant de façon surprenante, embarrassante pour les interprètes qui ont tendance à la minimiser ou, au contraire, à en faire la vérité cachée de la doctrine, avec une mise en valeur des dimensions mythiques, sinon mystiques, de l’État de droit (ou de l’État comme « machine » juridico-politique), que résume l’expression de « Dieu mortel » dont Hobbes se sert pour caractériser l’excès de pouvoir résidant dans l’attribution à l’État seul du droit de punir les criminels, ou les simples délinquants, quand il introduit la métaphore biblique du « Léviathan » empruntée au Livre de Job. Y aurait-il donc une « bonne » et une « mauvaise » pratique de la métaphore, dépendant des fins politiques auxquelles elle sert ? Je pense qu’on peut traiter la question selon deux points de vue inverses l’un de l’autre.
On peut la traiter à partir de la positivité essentielle de la personne artificielle de l’État – qui est la positivité de sa fonction protectrice de la vie et des propriétés de ses sujets, et la positivité du système juridique constitué de lois qui ne peuvent requérir l’obéissance et entraîner la sanction en cas de manquement que si elles ont été préalablement publiées dans les formes – et comme une contrepartie de cette positivité. En effet, cette positivité veut dire que l’État, combinant la fonction législative avec les prérogatives de gouvernement, mais essentiellement organisé comme un pouvoir judiciaire de régler les conflits entre les citoyens en dernière instance et d’imposer l’ordre légal, a le monopole de l’autorité. En face de lui, les autres sources d’autorité sont comme nulles, sinon la sienne ne serait pas souveraine. On sait que ceci est obtenu, idéalement, par le mécanisme de la représentation, qui fait que les sujets eux-mêmes abandonnent leur autorité pour la reconnaître, après-coup, dans la personne essentiellement fictive qu’ils ont investie du pouvoir de les représenter tous en même temps. Aliénation totale, dira Rousseau. Cette aliénation n’implique aucunement que les sujets (ou citoyens) ne forment entre eux aucune association particulière, et n’aient aucune liberté d’initiative. Nous ne sommes pas dans un totalitarisme. Mais elle signifie qu’il ne peut exister en face de l’État aucune organisation dont le pouvoir soit concurrent du sien lorsqu’il s’agit de requérir l’obéissance, et singulièrement de faire en sorte que les individus admettent l’autorité d’un jugement qui porte sur leur propre vie. Or tel serait – tel est – précisément le cas de toute Église (et plus généralement de tout « pouvoir spirituel ») qui promet le salut à ses fidèles, et pour cette raison les délie, même partiellement ou « sur un autre plan », de leur relation exclusive à la loi. Le matérialisme de Hobbes, ici absolument rigoureux, pose qu’une telle association (commençant dès l’acceptation en commun d’un enseignement), n’est rien d‘autre qu’un corps composé, artificiel comme celui de l’État et en face de lui, dont l’existence même détruit son pouvoir (car il n’y a pas de pouvoir absolu ou souverain là où il n’y a pas monopole, mais partage, division des compétences et négociation permanente). Un tel corps doit donc, ou bien être assujetti, c’est-à-dire dissous en tant que corps séparé, ou bien éliminé.
Mais on peut aussi traiter la question en sens inverse, à partir de la négativité qui court, comme un fil rouge, depuis la description des bases anthropologiques de l’État dans la « guerre de chacun contre
chacun » jusqu’à celle des causes de sa dissolution décrites en termes de pathologie sociale, selon une vieille tradition organiciste, en particulier au chapitre 29 du Léviathan. Leur caractéristique commune est de diviser l’âme du corps politique au moyen de « doctrines séditieuses » qui le précipitent dans une guerre contre lui-même, ce que trente ans plus tard le Béhémoth appliquera à l’histoire de la guerre civile anglaise causée par les dissensions religieuses4. On peut dire alors que ce qui caractérise essentiellement la construction du Léviathan, en tant qu’elle comporte non seulement une statique mais une dynamique, voire une économique des passions, et qu’elle se déploie non seulement dans le champ d’une théorie politique mais aussi, pour reprendre le terme de Roberto Esposito, dans celui d’une impolitique, c’est qu’elle doit être conçue pour résister à sa propre dissolution à laquelle l’entraînent des forces de mort qui finiront, inévitablement, par l’emporter. C’est bien l’idée de retardement que retrouvera Schmitt avec la notion du katékhon, mais c’est aussi, plus précisément, celle d’une fonction immunitaire qui protège le « corps » politique contre les germes de mort qu’il contient. Son instrument essentiel, on le sait, est la capacité de l’État d’inspirer la terreur à ses sujets (on dira même : d’inspirer à ses sujets la terreur qu’ils lui demandent pour se protéger de leur propre violence), selon les deux registres de la crainte religieuse, révérencielle, et de la crainte physique (awe and terror). On va voir que cette doctrine de l’État (et de la loi qui est son instrument essentiel) en tant que fonction d’immunité se traduit pratiquement en repérage d’ennemis publics, soit situés d’abord à l’extérieur du territoire de l’État, soit situés à l’intérieur, et qu’il convient d’éliminer ou de neutraliser. La grande question que pose la construction politique du Léviathan, considéré dans sa totalité, et que viendra sans aucun doute clarifier l’argumentation historique de son « double » longtemps retardé, le Béhémoth, c’est le rapport entre la désignation de l’ennemi principal, le Kingdom of Darkness du pouvoir ecclésiastique, et la multiplicité des identités sous lesquelles est susceptible de se cacher le pouvoir de subversion ou de résistance individuelle et collective à la loi. Mais de toute façon on voit que c’est de ce côté qu’il faut chercher la justification la plus profonde de la représentation de la machine étatique
comme une création monstrueuse de l’homme, qu’exprime le recours au mythe biblique du Léviathan, sur lequel se concentre Schmitt, et mieux encore peut-être la puissance métaphorique du frontispice de l’ouvrage, dont Horst Bredekamp a fourni un commentaire inégalé dans son livre sur les « stratégies visuelles de Hobbes5 ». L’immunité et le monstre ont en commun l’excès d’une fonction monopolistique. Et celle-ci, on le voit, ne concerne pas seulement, comme dira plus tard Weber, la violence légitime, mais aussi la « puissance métaphorique », mythologique et mythopoïétique qui est au cœur du langage théologique. Hobbes ne retire toute légitimité à la métaphore telle que l’emploie le pouvoir spirituel de l’Église que pour permettre à l’État de se l’approprier et de la concentrer en un seul point d’origine qui est aussi, au sens strict, un point de fiction. De ce fait même il croit pouvoir affirmer qu’elle cessera de proliférer à travers la société, mais au contraire – comme la violence – s’en retirera et y fera place aux opérations rationnelles de la science, de la pédagogie ou de la rhétorique, et du droit, qui sont les « civil sciences » par excellence, pour parler comme Quentin Skinner6. On aboutit ainsi à la figure profondément paradoxale, que j’oserai dire beaucoup plus « française » qu’anglaise, d’une laïcité qui a pour condition de possibilité et pour destination son propre redoublement théologique, concurrent des religions historiques.
Pluralisme et individualisme
De là nous pouvons passer au second point annoncé. Il me faut ici être bref, bien qu’on arrive au cœur de la construction institutionnelle de la souveraineté et de ses effets de subjectivation, au sens étymologique de construction de la figure du « sujet » (subjectus, subditus) qui reconnaît une certaine autorité ou forme le corrélat de l’obligation politique,
d’autant plus incontestée qu’elle émane, en fait, de lui-même. Je risque de simplifier outrageusement, mais je peux isoler certains thèmes car j’ai déjà esquissé une argumentation sur ce point dans ma préface au livre de Schmitt. Ce qui me paraît le plus important pour notre question, une fois reconnue comme il se doit l’appartenance, ou plutôt la contribution de Hobbes à la construction des bases du « libéralisme » moderne7, c’est de chercher à situer la position de Hobbes entre deux modalités bien différentes suivant lesquelles on peut faire émerger l’individu comme sujet dans la philosophie politique. On peut en effet considérer que l’individualité du sujet, qui fonde son autonomie, est une donnée naturelle (ou un fait de « droit naturel ») que présuppose la constitution même des sociétés civiles, et qui confère sa force contraignante à l’obligation – ce que figure justement l’allégorie du « pacte » ou du contrat originaire. Ou bien on peut considérer que l’isolement de l’individu (au moins « en droit », et en tant que sujet de droit disposant d’une volonté qui n’appartient qu’à lui) n’est jamais originaire, mais résulte de la dissolution plus ou moins complète, plus ou moins violente, de collectifs ou de liens d’appartenance préexistants (quelles que soient les modalités de cette dissolution : effet du commerce, de l’éducation, de l’action de l’État, d’une religion « individualiste », etc.). La conception commune – et on ne peut évidemment la renverser purement et simplement – c’est que Hobbes se situe du côté de la première position, et que même il en a fourni l’exposition la plus radicale, le prototype. Les choses sont pourtant plus compliquées si l’on accepte de considérer que le problème de Hobbes ne relève pas seulement de la statique, ou de la métaphysique, mais de la dynamique et de la science politique. On retrouve alors sous un autre angle le problème précédemment posé : celui d’une conservation ou d’une immunité du corps politique à l’encontre des germes de dissolution ou de mort qu’il contient, cette
fois dans la forme de ce que Hobbes appelle les « systèmes » constitués par association d’une pluralité de citoyens (chapitre 22 : Of Systemes Subject, Politicall and Private). Le but de l’association civile n’est certes pas d’empêcher les citoyens de formes des corporations ou des systèmes, qu’il s’agisse de compagnies commerciales ou de confréries charitables ou d’associations cultuelles, et même de familles. Mais l’association civile ne se perpétue que si ces systèmes demeurent « subjects », assujettis, c’et-à-dire fondamentalement s’ils renoncent à toute prétention de juger leurs propres membres, de se faire justice à eux-mêmes, en circuit fermé, reconnaissant au contraire à l’État et à ses organes judiciaires un droit permanent d’intervention en leur propre sein – quis judicabit ? C’est le grand critère énoncé par Hobbes, auquel Schmitt mais aussi le positivisme juridique de type kelsénien accordent une fonction décisive dans la constitution de la souveraineté ou de la norme juridique unitaire en tant qu’elle coïncide avec une norme étatique8. On peut alors concevoir que, à la limite, tendanciellement et aussi politiquement, c’est une seule et même tâche qui sous-tend la production des conditions de possibilité de la subjectivité individualisée, susceptible d’autoriser le souverain et ainsi de fonder l’État, en dissolvant au moins virtuellement, sur le plan du droit, les communautés préexistantes, et qui anime en permanence la politique destinée à prévenir l’autonomisation, non des individus, mais des collectifs, la transformation des appartenances en prétentions de se faire rendre compte avant de rendre compte à l’État, bref ce qu’on appellerait aujourd’hui l’apparition de « communautarismes ». Et l’on voit qu’il faut acquérir une conception plus complexe de l’individualisme hobbesien, dans laquelle l’histoire de l’État explique rétroactivement, en quelque sorte, les conditions de sa constitution.
Schmitt nous y aide, bien que sous une forme paradoxale, en décrétant que ce procès dialectique est le lieu de « l’échec de Hobbes » – échec « grandiose » il est vrai – à se libérer complètement des influences du mécanisme pour adopter une conception organiciste de l’État, et du lien qui – pour parler comme Rousseau, cette fois – « fait qu’un peuple est un peuple » au sein de l’État et ne reste pas une « multitude » atomisée. En faisant de la peur radicale de la mort dont l’autre homme est le porteur
potentiel le ressort ultime de la constitution de l’État, Hobbes identifie le ressort le plus puissant de cette unité organique, mais en maintenant un pluralisme essentiel des associations, bien que sous la juridiction du souverain, il « manque » la conclusion logique de son anthropologie pessimiste. Les paradoxes construits par Schmitt sur ce point (non sans une sorte de permanente altercation intime avec Hobbes) ont cependant un immense intérêt pour comprendre que la théorie hobbesienne, surtout dans le Léviathan, est habitée par une tension qui ne peut être ni résolue ni même stabilisée, mais seulement « forcée » ou tranchée par la « force » de la souveraineté et de son aura théologique. Le « pluralisme » hobbesien est si bien une réalité qu’on a pu de façon convaincante (David Runciman) y voir l’origine d’une lignée de philosophie politique et de sociologie du droit qui ne conduit pas aux théories de la souveraineté nationale mais aux « corporatismes » et aux « solidarismes » du xixe et du xxe siècle, en particulier dans la tradition socialiste libérale9. Cela permet d’éviter toute contamination de l’idée d’égalité, ou même d’égale liberté dont Hobbes est l’un des exposants classiques, avec l’idée d’une homogénéité ou d’une identité commune des citoyens, qui triomphe au contraire chez Schmitt, y compris par des références à Rousseau, au bénéfice de la signification plus large du terme Gleichheit et de son voisinage avec une Gleichartigkeit dans les textes de la période nazie. Mais cela suppose d’interpréter la souveraineté hobbesienne et l’assujettissement qu’elle entraîne comme une « pure » autorité de la loi, universelle et sans partage, doublée de contrainte étatique à l’exécution. Est-ce bien le cas ? On peut en douter, si on examine la façon dont fonctionne chez lui la distinction du public et du privé, qui fonde précisément l’universalité de la loi, et qui recoupe largement celle des « systèmes » corporatifs et de la société civile elle-même (c’est-à-dire de l’État). Ce fonctionnement est complètement dissymétrique : il ne s’agit pas d’une démarcation ou d’une limitation réciproque, entre des entités de même nature, mais d’un côté on a une limitation, ou une autolimitation (les associations privées doivent toujours reconnaître le droit du souverain d’intervenir en leur sein comme juge ou arbitre), et de l’autre on a une illimitation (l’État doit « totalement » pénétrer les systèmes, non pour les détruire,
mais pour les décomposer et les recomposer virtuellement et en faire des organes subordonnés de la société civile). Il y a bien une « dernière instance », et donc il faut qu’il y ait un excès de pouvoir de l’État sur les collectifs, sans quoi il n’y aurait pas d’individualisation absolue des sujets. Ou pire, il y aurait un simulacre subversif d’individualisation, dans lequel des individus résistent à la loi (donc à l’État) au nom des collectifs dont ils font partie, et des intérêts matériels ou spirituels qu’ils incarnent. On retrouve, par ce biais, la thèse du « Dieu mortel », analogue politique d’une souveraineté toute-puissante, ou plutôt on découvre le paradoxe que recouvre cette expression : celui d’un absolu qui serait pourtant historique, politiquement construit et reconstruit (donc, le cas échéant, détruit), et qui repose sur la dénégation de ses propres limites dans la forme d’un mythe d’origine10.
Sécularisation, laïcité, hostilité
Revenons alors, pour conclure, ou plutôt pour ouvrir la discussion, à la question dont nous étions partis : celle du modèle de « laïcité » de l’État et de la politique hérité de Hobbes. Modèle nécessairement très paradoxal, puisqu’il conjoint l’anticléricalisme le plus virulent avec une appropriation des attributs de la puissance divine – même transposés dans un registre juridique – au profit de la souveraineté politique, elle-même préparée au niveau anthropologique par une théorie des fictions et du renversement de la fonction métaphorique. Ne sommes-nous pas là exactement dans le cas de figure défini et généralisé, voire absolutisé par Schmitt et transformé en principe d’une philosophie de l’histoire de la modernité, dès son célèbre livre de 1922 sur la Théologie politique ? On s’expliquerait alors sans difficulté la fascination de Schmitt pour Hobbes, son altercation infinie avec ses énoncés. « Tous les concepts politiques [donc aussi les concepts juridiques, en tant qu’ils sont éminemment
politiques] sont des concepts théologiques sécularisés », Hobbes en est la preuve par excellence. Oui et non, en tout cas ici aussi il faut faire place, me semble-t-il, à la complexité d’un double mouvement : ce qui caractérise le problème posé en permanence par la lecture de Hobbes, c’est la difficulté de l’invoquer de façon univoque, soit à l’appui de la thèse « schmittienne » (c’est pourquoi sans doute Hobbes « résiste » à Schmitt, comme je l’ai suggéré en 2002), soit à l’appui de la thèse inverse, celle de Spinoza dans le Traité théologico-politique et dans l’Ethique, telle que l’a réactivée de nos jours un théoricien comme Jan Assmann pour « retourner » le sens de l’argumentation schmittienne en en reconnaissant la pertinence, à partir de l’idée que les modèles de « décision » et de « toute-puissance divine » (égyptiens, hébraïques) étaient toujours eux-mêmes déjà des théologisations de formes politiques monarchiques et impériales préexistantes11. Pourquoi cette discussion nous importe-t-elle ? Pas seulement parce que nous nous intéressons, spéculativement, voire esthétiquement, à l’interprétation de Hobbes et de Schmitt, mais parce que la question revient, de façon urgente, de savoir si ce sont les communautés religieuses qui, au sein de l’État moderne « laïque », constituent un cas particulier, même très important, du problème général du « communautarisme » auquel se heurte une conception unitaire de l’appartenance nationale et de la citoyenneté, oscillant sans cesse entre universalisme et organicisme ; ou bien si ce sont, en tant que telles, les appartenances religieuses et, conjoncturellement, certaines d’entre elles (le catholicisme dans l’Angleterre du xviie siècle, l’Islam dans la France, voire l’Europe du xxie siècle) qui sont projetées sur toutes les différences culturelles, sociologiques, historiques, et représentent aux yeux d’un discours de la souveraineté l’obstacle par excellence qu’il doit réduire – parce qu’elles ne se laissent pas « dissoudre » par des moyens purement juridiques en individualités assujetties à la loi, ou ce qui revient au même, parce que leur caractère « public », voire « politique », ne disparaît pas spontanément au bénéfice d’une « privatisation » radicalement dissymétrique ?
Je ne prétends pas résoudre ce dilemme, mais je veux le rapporter à une question qui taraude la lecture de Hobbes, et que j’avais
mentionnée plus haut : celle du rapport implicite, dans la construction du Léviathan, entre la désignation des ennemis publics, ou des forces « systémiques » de résistance à l’ordre juridique, et la constitution du pouvoir ecclésiastique en force spirituelle antagonique de la souveraineté politique. Il suffirait, je pense, d’un peu de temps, pour montrer l’affinité de cette question avec celle de l’état d’exception, qui a été privilégiée par Agamben dans sa tentative pour appliquer certaines leçons de Schmitt à l’interprétation des formes extrêmes de la violence politique dans les sociétés contemporaines, et par conséquent incorporer sur ce point la référence à Hobbes à la discussion. On doit ici se souvenir que la critique de la machine ecclésiastique développée par Hobbes ne se fonde pas sur une invention arbitraire de sa part, mais (cf. le chapitre 42 du Léviathan) sur le retournement de la doctrine de la potestas indirecta du pape à l’égard des souverains temporels développée par le Cardinal Bellarmin (et qui sera aussi un siècle et demi plus tard la source de la théorisation du « pouvoir spirituel » par Auguste Comte). La classification des « systèmes sujets » par Hobbes, répartis en organisations régulières et organisations irrégulières, et au sein de chaque catégorie en licites et illicites, dégage une liste de « résidus », ou d’associations incontrôlables, qui doivent donc être combattues par l’État en tant qu’ennemis au moins potentiels de l’ordre juridique, et qui semble à première vue dépourvue de toute unité12. Ce qui est frappant, néanmoins, c’est qu’à chaque fois on retrouve une conjonction de deux pôles, dont il n’est pas exagéré de dire que, pris ensemble, ils forment l’obsession « subversive » dont la politique hobbesienne est hantée, car elle dessine par avance la dissolution du corps politique, le retour à l’état de guerre à travers la « sédition » : ce sont d’un côté les groupements de sous-prolétaires ou les rassemblements populaires « de taille inhabituelle », de l’autre les sectes religieuses, et par excellence ce « parti de l’étranger » dans le champ des croyances que représente l’Église catholique. On peut donc suggérer que l’argumentation hobbesienne dessine en creux une formation de l’ennemi public, dont la figure idéale (c’est-à-dire diabolique) serait constituée par la capacité d’une secte religieuse, et par-dessus tout d’une Église centralisée, transnationale, comme l’est l’Église catholique « universelle », à organiser ou inspirer les mouvements populaires, et notamment ceux qui
sont virtuellement présents dans les masses paupérisées … On aurait là la figure, par anticipation, d’un parti révolutionnaire qui serait à la fois un parti de classe et un mouvement obscurantiste, c’est-à-dire fondé sur la superstition et la croyance. Ceci est en creux chez Hobbes, c’est-à-dire que c’est une hypothèse en quelque sorte retenue par Hobbes, de la même façon qu’elle devient chez Schmitt l’objet même d’une « politique » qui, pour se donner la tâche fondamentale de retenir la catastrophe révolutionnaire, et donc de construire la souveraineté en « contre-révolution préventive permanente », doit commencer par susciter son adversaire, en tant qu’ennemi intérieur. Il n’y a que sous la forme théologique que la « distinction ami-ennemi », fondatrice de la politique selon Schmitt, mais aussi organisatrice de la différence entre l’intérieur et l’extérieur de l’État, puisse venir se réinscrire à l’intérieur, et y susciter la figure catastrophique d’un corps étranger dont la présence même, ou les agissements, sont mortels pour la communauté politique. Ce que je veux suggérer, en somme, c’est que la théologisation de l’ennemi de l’ordre politique établi coïncide avec le passage d’une menace virtuelle à une menace réelle, ou plutôt projetée dans le réel pour en tirer des effets de souveraineté. Ce moment théologique du passage de l’État de droit à l’État de défense sociale et idéologique est l’enjeu de la continuité et de la discontinuité entre Hobbes et Schmitt. Il est aussi, à l’évidence, l’une des significations qu’il faut associer aux politiques théologiques de la laïcité ou de la laïcisation dans la conjoncture actuelle, d’autant plus virulentes que la souveraineté dont elles se réclament est, en pratique, plus incertaine.
Étienne Balibar
Université de Paris X – Nanterre
1 Carl Schmitt, Le Léviathan dans la doctrine de l’état de Thomas Hobbes : Sens et échec d’un symbole politique (1938), trad. D. Trierweiler, préface E. Balibar, postface W. Palaver, Paris, Éditions du Seuil, 2002.
2 « Le Hobbes de Schmitt, le Schmitt de Hobbes », préface à Carl Schmitt, Le Léviathan dans la doctrine de l’État de Hobbes, Editions du Seuil, Paris, 2002.
3 Il faut bien entendu préciser : dans l’une de ses interprétations, à laquelle s’oppose une conception qu’on peut dire « libérale », dans laquelle la laïcité n’est pas l’attribut de la puissance publique (faisant d’elle, comme chez Hobbes, un substitut de l’Église dans la fonction d’enseignement et de légitimation de l’autorité), mais la règle de droit permettant la liberté des cultes et la compatibilité des croyances dans la société. Cf. mon essai « Laïcité et universalité : le paradoxe libéral », Hommes et libertés. Revue de la ligue des droits de l’homme, no 143, 2008 (rééd. in La proposition de l’égaliberté, PUF, 2010).
4 Sur le Béhémoth, sa place dans la pensée de Hobbes et son rapport au Léviathan, cf. désormais Hobbes’s Béhémoth. Religion and Democracy, edited by Tomaz Mastnak, Imprint Academic, Exeter 2009.
5 Horst Bredekamp, Thomas Hobbes : Visuelle Strategien. Der Leviathan : Urbild des modernen Staates. Werkillustrationen und Portraits, Akademie Verlag, Berlin 1999 (trad. Fr. Editions de la Maison des Sciences de l’Homme)
6 Q. Skinner : Visions of Politics : Volume III, Hobbes and Civil Science, Cambridge University Press, 2002.
7 Non pas, cependant, ou pas essentiellement, au sens de l’individualisme possessif de Macpherson, moins encore au sens d’un libéralisme de l’autonomie de la société civile par rapport à l’État, mais au sens d’un libéralisme organique, ou institutionnel, dans lequel l’État, par l’intermédiaire de la loi, de la réglementation publique des droits individuels, assure et reproduit en permanence les conditions de l’autonomie de l’individu. Voir en particulier les livres de Lucien Jaume : Hobbes et L’État représentatif moderne, PUF, 1986 ; La liberté et la loi. Les origines philosophiques du libéralisme, Paris, Fayard, 2000. Sur Macpherson et les prolongements de sa thèse, cf. mon essai « Le renversement de l’individualisme possessif », in La Proposition de l’égaliberté, cit., p. 91-126.
8 Pour une discussion des points de convergence et de divergence entre Hobbes et Kelsen sur les rapports entre droit et État, cf. Franck Lessay, Souveraineté et légitimité chez Hobbes, PUF 1988, p. 178 sq.
9 David Runciman, Pluralism and the Personality of the State, Cambridge University Press, 1997.
10 Sur l’articulation des conceptions de la « toute-puissance de Dieu » et de la « puissance absolue du souverain » chez Hobbes (en particulier pour ce qui concerne la dissymétrie des obligations), voir le livre de Luc Foisneau, Hobbes et la toute-puissance de Dieu, PUF 2000.
11 Jan Assmann, Herrschaft und Heil. Politische Theologie in Altägypten, Israel und Europa, Carl Hanser Verlag, 2000.
12 Cf. mon tableau, p. 63 de l’édition de Schmitt, Le Léviathan …, Le Seuil 2002.