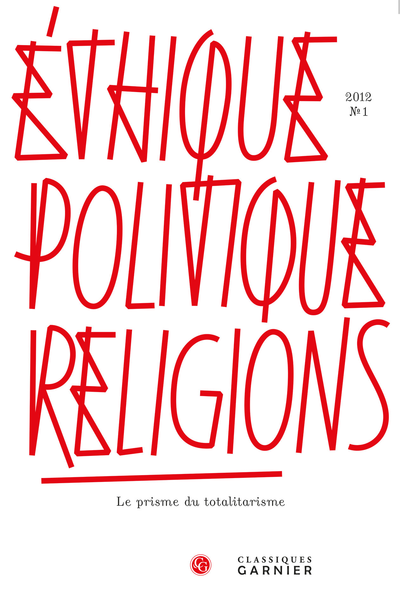
Introduction
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Éthique, politique, religions
2012, n° 1. Le prisme du totalitarisme - Auteur : Gontier (Thierry)
- Pages : 9 à 12
- Revue : Éthique, politique, religions
- Thème CLIL : 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN : 9782812408823
- ISBN : 978-2-8124-0882-3
- ISSN : 2271-7234
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-0882-3.p.0009
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 21/02/2013
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
Introduction
La catégorie de « totalitarisme » est sans doute d’un emploi problématique. Elle a longtemps été surdéterminée par des questions de conflit idéologiques, étant accusée de servir à un amalgame de régimes politiques différents, voire antagonistes. De fait, on aurait bien du mal à faire coïncider ce qui est de l’ordre du concept et ce qui est de l’ordre de la réalité historique. Si on prend comme caractère propre du totalitarisme la disparition de la société civile et son absorption par l’État, on montrera sans difficulté, par exemple, que l’Allemagne nazie n’a pas à proprement parler voulu faire disparaître l’économie capitaliste. Si on opte pour une définition plus « anthropologique », en prenant comme caractère spécifique du totalitarisme la destruction (ou tout du moins la volonté de destruction) de la personne humaine, comprise dans son orientation vers des fins qui se situent au-delà de la sphère du politique, nous rencontrerons le problème de l’Italie fasciste : si c’est dans l’Italie des années 1920 qu’a été théoriquement développé le concept de stato totalitario et qu’a été proclamé son statut d’objet nouveau de religion, il en va différemment en pratique, et le Concordat de 1929 reconnaît l’autorité spirituelle de l’Église catholique1. De même que le dirigisme économique n’est pas le totalitarisme économique2, l’État confessionnel n’est pas l’État totalitaire. La terreur, la violence planifiée, les meurtres de masses, sont à juste titre considérés comme des conséquences inévitables des régimes totalitaires, et de son projet dément de réaliser effectivement dans l’histoire une transformation de l’homme et de la société3 : mais on ne saurait affirmer que ces effets soient exclusifs aux
formes totalitaires de gouvernement. Il en va de même pour la forme de régime autoritariste, le dirigisme étatique, ou encore la formation de discours de propagande, y compris ceux sur le caractère organique de l’État, sa valeur éthique et la prééminence de la totalité sur l’individu : à supposer qu’il existe une spécificité des régimes totalitaires, celle-ci ne saurait être définie qu’avec des outils plus fins et plus précis.
Il n’est donc pas question de faire dire à ce concept de « totalitarisme » plus que ce que ceux qui l’ont inventé dans les années 1920-1930 ont visé à travers lui : il ne s’agissait pas pour eux de réduire des réalités historico-politiques complexes et diverses à des schémas réducteurs, mais de définir le caractère inédit de certains phénomènes caractéristiques liés à l’apparition de régimes politiques, quelles que soient par ailleurs leurs différences, afin de les comprendre à l’intérieur d’une perspective généalogique. Prise en ce sens, la notion de « totalitarisme » est plus qu’une catégorie d’appréhension de trois situations politiques historiquement déterminées (l’Union soviétique communiste, l’Italie fasciste, l’Allemagne nazie – pour ne pas parler des très nombreux régimes d’après-guerre qui se sont inspirés d’eux) : elle vise à rendre manifeste l’émergence d’une situation nouvelle présente, de façon plus ou moins manifeste, dans tous les régimes politiques modernes. En ce sens, l’apparition dans les années 1920-1930 de régimes autoritaires d’un type bien différent des régimes autoritaires monarchistes ou dictatoriaux classiques ne fait que manifester un certain nombre de structures latentes, potentiellement totalitaires, présentes dans l’ensemble de nos sociétés modernes. Les formes violentes des autoritarismes contemporains, ne sont dans ce contexte qu’un effet extrême de ces facteurs (modernity without restraint, écrivait Eric Voegelin), qui leur confère rétroactivement une visibilité particulière, de sorte qu’il existe dans nos régimes libéraux et démocratiques modernes, sinon un totalitarisme au sens plein du terme, tout du moins une tendance totalitaire qui n’emprunte pas nécessairement les formes de l’autoritarisme. La vraie portée polémique de cette notion de totalitarisme tient moins à l’amalgame qu’elle fait des régimes dictatoriaux de « droite » et de « gauche », qu’à la généalogie de la modernité qu’elle met en œuvre.
C’est bien à ce titre de « prisme » de la modernité que le totalitarisme reste encore aujourd’hui un concept heuristique, et le regain d’intérêt pour les analyses de cette notion ne peut être dissocié des discours que la
modernité produit aujourd’hui sur ses origines et ses finalités. Si Martin Heidegger a été l’un des premiers, après Nietzsche, à avoir produit une réflexion philosophique sur le caractère totalisant de la rationalité techniciste moderne, c’est sans doute Carl Schmitt qui a posé dans les termes les plus clairs ce qui constitue le défi intellectuel du totalitarisme – aussi le regain d’intérêt pour la question du totalitarisme va-t-il de pair avec le regain d’intérêt porté à Carl Schmitt, nonobstant ses engagements ignominieux dans la situation historico-politique de son temps. Carl Schmitt n’a certes pas inventé la notion de « totalitarisme » : celle-ci était déjà employée en un sens négatif par les penseurs personnalistes des années 1920-1930. En son sens positif (en vigueur avant la guerre), elle avait fait l’objet d’une élaboration théorique par Giovanni Gentile par exemple, pour qui le stato totalitario fasciste était défini comme la condition transcendantale de toute vie politique et comme une réalité éthique, inscrite, tel le Dieu d’Augustin, « in interiore homine ». Ce que Schmitt a mis en relief, c’est l’application de la notion non seulement à des régimes autoritaires historiquement déterminés (ici, le communisme soviétique), mais à certaines structures fondamentales des démocraties libérales modernes. Le totalitarisme (ou l’État total) n’implique donc pas nécessairement la violence manifeste, le règne de l’arbitraire ou la disparition de l’État de droit. Il est au contraire sous jacent aux visées de rationalisation juridique et de pacification politique caractéristiques de la pensée libérale. Si le totalitarisme implique la fusion entre la société civile et l’État, c’est moins en faisant disparaître la société civile qu’en faisant disparaître l’État, dans sa dimension proprement hétéronomique, pour ne laisser subsister comme unique réalité « politique » (ou pseudo-politique) que la société civile : le totalitarisme part ainsi non d’un surcroît de politisation, mais de la dépolitisation de la société et de la vie humaine ; et si tout, dans le totalitarisme, devient politique, c’est parce qu’a été perdue la spécificité du politique, de sorte que, dans la société libérale, tout devient politique parce que plus rien ne l’est au sens propre. De même, si, dans le totalitarisme, il n’y a plus de droit, ce n’est là que le résultat du mouvement moderne de rationalisation de la politique visant précisément à éliminer tout arbitraire, qui a abouti à ce que l’exception, au lieu de se situer en marge du droit et de le définir pour ainsi dire de l’extérieur et à partir de ses limites, se trouve intégrée à lui et placé en son cœur.
Nous n’allons pas faire ici la liste des paradoxes du totalitarisme, dont Schmitt a tenté de montrer qu’il se situait au fond de ce qui se revendique comme le plus éloigné (l’état démocratique moderne, les idéaux de pacification universelle, etc.)4. Mais nous voulons souligner qu’il s’agit là d’un défi intellectuel majeur : tout discours contemporain sur le totalitarisme, voire plus généralement sur la modernité, a dû, d’une façon ou d’une autre, se confronter à lui. Il s’agit dans ce recueil, à travers ces études, qui prennent souvent la forme d’études historiques précises, monographiques ou comparatistes, de repenser le projet de la modernité au-delà du prisme totalitaire et, pour ce faire, de repenser la généalogie intellectuelle de cette modernité et les conditions de sa relève actuelle, dans la ressaisie de ses fondements5.
Ce recueil est en partie le fruit de deux journées d’études lyonnaises : la première, consacrée aux rapports entre autoritarisme et totalitarisme, organisée le 11 avril 2008 par Thierry Gontier dans le cadre de l’IRPhiL (Institut de recherches philosophiques de Lyon) ; la seconde, sur Leo Strauss et Carl Schmitt, organisée le 27 avril 2010 par Lucien Oulahbib dans le cadre de l’École doctorale de philosophie de la région Rhône-Alpes.
Thierry Gontier
Université Lyon 3 – IRPhiL
Institut universitaire de France
1 Sur ce point, voir notre étude « Laïcité positive et polygonie du vrai. La religion de Giovanni Gentile et sa lecture de la philosophie renaissante », Archives de philosophie du droit, 2004, p. 61-76.
2 Ce point avait été souligné par David Cumin dans son exposé à la journée sur Leo Strauss et Carl Schmitt de 2010 (voir infra).
3 Voir notre étude « Totalitarisme, religions politiques et modernité chez Eric Voegelin », Ph. de Lara (dir.), Naissances du totalitarisme, Paris, Le Cerf, 2011, p. 157-181.
4 Ce qui ne veut pas dire que la pensée de Schmitt elle-même ne tend pas à une certaine forme de totalitarisme : celui-ci est moins à chercher dans sa doctrine de l’État fort (État autoritaire et dirigiste, mais pas nécessairement totalitaire) que dans les fondements anthropologiques de sa pensée juridico-politique. Voir sur ce point notre étude « De la théologie politique à la religion politique : Eric Voegelin et Carl Schmitt », Th. Gontier et D. Weber (dir.), Eric Voegelin. Politique, religion et histoire, Paris, Le Cerf, 2011, p. 45-66 – une version un peu plus complète de cette étude, traduite en anglais, étant à paraître début 2013 dans la Review of Politics.
5 Voir par exemple sur ce point notre introduction au cahier Hans Blumenberg : Les origines de la modernité, dans la Revue de métaphysique et de morale, 2012-1, p. 3-13.