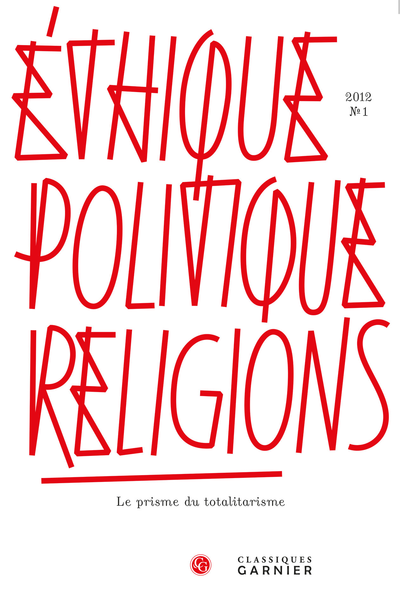
Figures de l’absolutisme et reconfiguration sociologique du totalitarisme
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Éthique, politique, religions
2012, n° 1. Le prisme du totalitarisme - Auteur : Wunenburger (Jean-Jacques)
- Résumé : La catégorie du totalitarisme ne devrait pas être confondue avec les formes de tyrannie. Ne serait-ce pas l’État démocratique moderne qui a permis, en se libérant du théologico-politique ancien, de faire émerger l’État totalitaire, dans ses paradoxes internes même ? Préfiguré déjà dans l’écriture des utopies, celui-ci ci ne semble pourtant pas avoir réussi à s’installer réellement dans l’histoire. Mais ne serait-il pas, de nos jours, en train de se métamorphoser sous des formes post-étatiques en se capillarisant dans la collectivité sociale elle-même ?
- Pages : 13 à 25
- Revue : Éthique, politique, religions
- Thème CLIL : 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN : 9782812408823
- ISBN : 978-2-8124-0882-3
- ISSN : 2271-7234
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-0882-3.p.0013
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 21/02/2013
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : absolutisme, theologico-politique, utopie, démocratie, servitude volontaire
Figures de l’absolutisme
et reconfiguration sociologique
du totalitarisme
Le phénomène politique du totalitarisme est tenu pour caractéristique de l’évolution des temps modernes. Décelé ou inscrit comme possible dès l’apparition du contrat social hobbesien, puis dès l’ère des révolutions du xviiie siècle, attribué à la rationalité rousseauiste, puis accompagnant l’avènement du communisme léniniste puis du nazisme, avant de triompher en Asie, pays réputés être les dépositaires d’un despotisme oriental, le totalitarisme devient, généralement, une forme à part entière de l’évolution de l’État au xxe siècle1. Il appartient à la typologie des régimes de la science politique contemporaine, mais n’en soulève pas moins des questions préliminaires majeures, largement débattues ces dernières décennies. Existe-t-il une essence propre du totalitarisme, en tant que forme de pouvoir non démocratique ? Celle-ci peut-elle absorber, englober toutes les formes plurielles empiriquement ainsi qualifiées ? L’unité nominale résiste-t-elle donc à la diversité factuelle, en Occident, en Orient ? Le totalitarisme est-il en rapport de continuité ou de discontinuité par rapport aux pouvoirs politiques illimités, arbitraires, oppressifs antérieurs ? N’est-il qu’une forme encore plus extrême de pouvoir despotique ? Ou bien, l’oppression post-démocratique en Occident ou en Orient doit-elle donner lieu à une phénoménologie et une logique propres ?
Sans prétendre aborder toutes ces questions, on tentera au moins de resituer le totalitarisme comparativement aux diverses formes d’absolutisation du pouvoir politique, de souligner les caractères en fait contradictoires ou paradoxaux de son régime, qui peut contraster
avec les traits identitaires des divers autoritarismes classiques, et enfin de comprendre si certaines formes sociales totalitaires, dissimulées, erratiques, capillaires ne sont pas encore plus significatives de sa nature profonde que ses formes affichées, spectaculaires, reconnaissables, qui ont dominé les Etats du xxe siècle. Mais dans ce cas le totalitarisme reste-t-il bien une pure catégorie du politique ? Sous quelles formes – inattendues – risque-t-on de le débusquer aujourd’hui ? Que nous révèle-t-il sur l’évolution de nos sociétés contemporaines en général ?
L’absolutisation symbolique de l’autorité
Dès le milieu du xxe siècle, des analystes, souvent précurseurs, ont tenu à souligner le caractère inédit des phénomènes politiques nés avec la révolution bolchevique en Union soviétique et avec le régime nazi en Allemagne, les fascismes italiens ou espagnols restant à bien des égards moins clairement en rupture avec les formes autocratiques antérieures. Un des premiers en France, Jules Monnerot (1949), a vu dans le communisme, à la fois l’achèvement des tyrannies anciennes et l’avènement d’une nouvelle religion politique, née de la laïcisation du sacré à l’ère des organisations industrielles : « Le totalitarisme est original par rapport à la tyrannie en ce qu’il est sacralisation du politique ; il se présente comme religion séculière et conquérante, de type “islamique” : indistinction du politique, du religieux et de l’économique, pouvoir concentré, et d’abord informe : mais d‘autre part, le totalitarisme n’est que la tyrannie idéalisée2 ». De telles interprétations, qui ont été souvent reprises sans référence à son auteur, présupposent la nature théologico-politique des pouvoirs étatiques du passé mais aussi l’existence d’une pluralité d’organisations politiques, différentes par rapport à leurs relations au pouvoir religieux. En ce sens le totalitarisme
serait une dérivation de l’absolutisation du pouvoir traditionnel, qui a connu des expressions et évolutions diverses, mais qui doivent être distinguées de la tyrannie. Le pouvoir politique est, en Occident au moins, considéré traditionnellement comme « absolu » et il n’a connu de limitation et de contrôle démocratiques que récemment, et encore plus formellement que réellement, et peut-être pour un laps de temps fort cours à l’échelle historique. Mais l’absolutisme de la souveraineté, en régime théologico-politique, n’est pas encore, et de loin pas, ni une tyrannie ni un totalitarisme au sens moderne3.
En se limitant à l’aire occidentale, marquée par les héritages de l’histoire gréco-romaine et sa christianisation depuis l’empereur Constantin, il apparaît que le pouvoir – roi ou empereur –, est avant tout gardien d’un ordre social par l’exercice d’une autorité, légitimée par le bien des assujettis, membres d’une communauté, qui demandent au prince de les protéger, et fondée par la volonté de Dieu, seule source symbolique de puissance, dont le Prince imite l’action de maintien de l’ordre sur terre. Comme l’attestent les études historiques, le « basileus » n’exerce pas une autorité de son propre chef, puisqu’il est censé être l’incarnation sur terre, dans le temps, pour un peuple, de la toute-puissance de Dieu, dont il est le « lieutenant » afin de faire régner la paix parmi les hommes. Telle est la justification du pouvoir politique dans les différents codes, théodosien (ive siècle) puis justinien, qui vont inspirer les discours politiques pendant des siècles dans l’empire d’orient et dans l’empire d’occident. Le roi-empereur est l’incarnation de la volonté et de la loi divines, principes de toutes choses, il partage avec le pontife-patriarche, la fonction de souveraineté, et de ce fait ce pouvoir politique est absolu. Dans l’empire byzantin, le chef politique est toujours reconnu comme la loi vivante (nomos empsychos, lex animata), en intermédiaire de la volonté divine. Par là, la volonté du « basileus » peut s’exercer sur la vie et la mort de ses sujets ; il s’en suit qu’elle n’est pas conditionnée par les autres volontés humaines en dehors de la tutelle divine, même si, de ce fait, elle ne peut être illimitée, puisqu’elle n’a pas son principe de souveraineté en elle. Si le pouvoir politique exerce bien une volonté toute puissante sur ses
sujets, ses décisions ne pouvant être transgressées4, il n’est pas source de l’autorité puisque toute « auctoritas » vient, selon l’adage paulinien, d’une transcendance à laquelle le pouvoir est soumis lui-même et dont il n’est qu’une imitation ici et maintenant5.
L’avènement du despotisme éclairé
Cette conception théologico-politique du pouvoir politique dans le grand Occident s’est sans doute plus largement maintenue en Europe orientale, jusqu’aux xviie et xviiie siècles, où l’alliance avec le christianisme d’orient, c’est-à-dire l’orthodoxie, a moins désacralisé le politique qu’en Occident ; la modernité s’est précisément constituée en Occident sur fond d’une dé-théologisation du politique, à travers la rationalisation, dès la fin du Moyen Âge, d’une souveraineté humaine autonome, comme toute-puissance d’un seul, qui agit pour le bien de son peuple6. Le Prince moderne, qui s’est délié de son pouvoir spirituel sur l’Église7, n’étend plus sa volonté que sur le plan temporel, dans les marges d’un contrat moral avec le peuple qui reconnaît son autorité tutélaire. Il voit ainsi l’étendue de son pouvoir limitée mais son action libérée de toute tutelle transcendante. Cette construction moderne qui prépare à l’avènement du régime démocratique, comme contrat entre un peuple libre et des gouvernants à qui il délègue sa volonté, a d’abord libéré la place pour une volonté politique pure, apte à vouloir réaliser les fins d’un peuple, la paix et l‘ordre,
par des moyens humains seulement, qui ne doivent plus imiter ceux de Dieu. Mais par là, la modernité séculière a fait apparaître une autre forme d’absolutisation de la volonté politique humaine dotée par soi-même de la toute puissance souveraine. Comme le souligne Jean Bodin en 1576, la souveraineté est une puissance absolue et perpétuelle et celui qui l’exerce doit commander sans obéir à quiconque : « Il faut que ceux-là qui sont souverains, ne soient aucunement sujets aux commandements d’autrui et qu’ils puissent donner loi aux sujets et casser ou anéantir les lois inutiles, pour en faire d’autres ; ce que ne peut faire celui qui est sujet aux lois ou à ceux qui ont commandement sur lui. C’est pourquoi la loi dit que le Prince est absous de la puissance des lois8 ». Sous cette forme le Prince a la liberté d’imposer et de décider sans avoir besoin de se soumettre à des lois ni à un accord ou un assentiment préalable du peuple, puisqu’il n’a de compte à rendre à personne d’autre qu’à lui-même, étant premier ou seul à avoir la puissance de commander. L’autocratie se développe donc sur les ruines du théologico-politique, exposée à une ligne de fracture parfois difficile à identifier entre autocratie et tyrannie.
Machiavel est le premier à chercher ce point de rupture entre bon et mauvais Prince. Le Prince machiavélien, autocrate par la raison d’État9, est bien distingué du tyran qui abuse du pouvoir sans souci du bien. Même si son action n’est pas tenue d’être morale, affirmant ainsi l’autonomie d’un vouloir politique, l’action du Prince n’est pas moins marquée par une « virtu », une puissance désireuse d’être respectée du peuple, qui jouit grâce au Prince avisé d’une paix en une république ou une monarchie prospère et ordonnée. Car Machiavel prend bien soin de différencier le despotisme éclairé, fût-il fourbe, répondant aux aspirations de son peuple, du despotisme sanguinaire, bref de la tyrannie d’un seul, cherchant à satisfaire ses seules passions égoïstes, funestes pour le sort de son peuple10. Ainsi donc laïcisée, marquée par la séparation du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel, le pouvoir politique moderne est bien encore absolu, autocrate, ce que n’ont pas manqué, plus ou moins, de copier bien des monarchies catholiques et des princes républicains pendant l’âge moderne.
De la liberté au totalitarisme :
l’autoritarisme charismatique
Même libéré de l’absolutisme religieux, le politique reste un art de gouverner les peuples maintenus à l’état de sujets. Il faut encore déconstruire le principe de souveraineté, et au lieu de le confier aux Princes, de l’attacher au sujet individuel, seule source, seul dépositaire, seule puissance, capable de le manifester11. En lieu et place du Dieu transcendant le pouvoir politique dépend à présent du citoyen, seul à même, dans sa souveraineté immanente et autonome originaire, de veiller à l’affirmation de soi, d’exercer sa puissance pour persévérer dans son être, voire pour en étendre la puissance. Le pouvoir, émancipé de l’instance divine, est à présent engendré et contrôlé par un seul contrat social, selon lequel le peuple délègue sa propre puissance à un gouvernement, pour obtenir en échange la sécurité et la justice12. Tout pouvoir ne peut donc être que délégué, sous certaines conditions, dans certaines limites, que définira le contrat politique moderne, base des gouvernements agissant par « représentation ».
Mais comment passer de la démocratie formelle, où le peuple détient la souveraineté, à la démocratie réelle où il l’exerce ? Comment empêcher à nouveau un individu charismatique, ou un groupe dominant (un parti), d’obtenir le suffrage d’une majorité de citoyens souverains, puis de les persuader que leur liberté, toujours menacée par d’autres volontés, gagnerait à leur transférer leurs volontés, afin que de cette volonté plébiscitée puisse naître la société démocratique, effective, future ?
Ainsi la démocratie post-révolutionnaire (fin du xviiie siècle et xixe siècle), en croyant avoir mis fin au despotisme, même éclairé, a rendu possible l’avènement d’une nouvelle forme d’absolutisation, d’une confiscation du pouvoir populaire, sous le prétexte de sa précarité
présumée et de son inachèvement. Différents gouvernements autoritaires, voire plébiscitaires, ont ainsi pu émerger depuis « démocratiquement ». Depuis le bonapartisme, l’autoritarisme (sous des formes combinées de restriction du pouvoir législatif ou de pleins pouvoirs donnés à l’exécutif) peut naître du fonctionnement légal de la démocratie, en s’autorisant l’usage exceptionnel d’une raison d’État en vue de sauver ou de réaliser la « vraie » démocratie. Comme le souligne Jacques Maritain : « Dans les temps modernes la notion despotique ou absolutiste de l’État a été largement acceptée par les théoriciens de la démocratie, et malencontreusement incorporée à la doctrine démocratique, en attendant l’apparition de Hegel, prophète et théologien de l’État totalitaire et divinisé. En Angleterre, les théories de John Austin ne tendaient qu’à apprivoiser et civiliser tant bien que mal le vieux Léviathan de Hobbes13 ». Il existe donc bien un despotisme du parti unique, du gouvernement de salut public, du chef charismatique, post-démocratique, dont la nouveauté vient de ce qu’ils prétendent servir la fin démocratique, finalité jadis irreprésentable et anachronique pour tous les despotes pré-modernes. La démocratie a ainsi fait apparaître par des « coups d’État », plus ou moins constitutionnellement légaux, des formes de gouvernement autoritaires puis de pouvoirs autocratiques, voire de tyrannies (particulièrement dans le prolongement des indépendances post-coloniales au xxe siècle, en dehors de l’Europe), qui se justifient généralement par la promesse de rendre possible un « retour à la démocratie ».
Le totalitarisme post-démocratique
Aucune de ces figures ne peut pourtant, en tant que telle, être confondue encore avec un régime politique totalitaire tel qu’il apparaît au xxe siècle. Que suppose donc cette dernière figure de spécifique ? Au vu de certaines analyses, ne conviendrait-il pas de penser une évolution intrinsèque du pouvoir qui, pour la première fois, ne se confond plus avec les indices de l‘autoritarisme, du despotisme, de la tyrannie, dont
il fait même disparaître les signes au moment où il renforce l’efficience de son contrôle ? Le totalitarisme moderne, post-démocratique (nazisme hitlérien, communisme stalinien, communisme maoïste, etc.) ne fait-il pas naître une autre logique, qui n’est plus celle d’une volonté hégémonique opprimant la volonté générale du peuple, mais d’un système paradoxal, contradictoire même, qui produit à la fois l’oppression et la liberté, incarne à la fois la volonté des gouvernants et la volonté des gouvernés réunis, confondus même, en une seule forme organique, etc. ? La littérature des témoins et victimes d’abord, les théories des politologues ensuite, n’ont pas manqué de cerner le caractère inédit des régimes totalitaires dans la coexistence de modes d’exercice du pouvoir contradictoires : simultanéité de la constitutionnalité et de la terreur, du gouvernement populaire et du culte de la personnalité, du mouvement et de l’immobilisme, de l’égalitarisme et de la Nomenklatura, du nationalisme et de l’internationalisme14, etc.
Mais en exprimant ainsi une logique post-politique de la puissance, qui met fin à la dualité entre peuple et État, le totalitarisme n’abandonne-t-il pas la seule forme d’exercice d’une volonté absolue – à travers le chef charismatique – en cherchant à la doubler par une administration de la société, bureaucratique, inquisitoriale, collectiviste, qui finit par dispenser de l’exercice de la puissance d’en haut pour contraindre chacun à s’auto-asservir par lui-même, au moins par peur ou par indifférence ? Toutes les expériences totalitaires contemporaines ont conduit, en effet, à forger la fiction que le pouvoir exprimait la seule volonté du peuple, qui s’exercerait par le truchement d’un appareil, le parti unique, qui constitue l’incarnation de la volonté générale. L’acteur principal n’est donc plus l’État, ni son chef, mais le peuple lui-même servi par ses fonctionnaires et membres du parti qui, au quotidien, se veulent le porte-parole de la liberté éclairée de chacun, afin de faire triompher dans le futur la cause juste.
Le propre de la logique du régime totalitaire est peut-être alors de ne plus concentrer l’autoritarisme et la violence dans l’État ni même à son sommet (comme dans les tyrannies), mais de la démultiplier dans
la totalité du corps social pour parvenir à discipliner la société entière au point de n’avoir presque plus besoin d’une hégémonie despotique, retrouvant dès lors la logique d’une servitude volontaire15. Au contraire, le recours ultime à une politique despotique sous un régime totalitaire (comme l’illustrent les cultes de la personnalité et les délires tyranniques de Staline, Mao Tsé Tung, Pol Pot, par exemples) témoignerait de la rémanence d’un ordre ancien, de la résistance de la société au totalitarisme (d’où une nouvelle révolution après la révolution, comme celle des garde-rouges sous Mao), et de la nécessité pratique que la dictature finisse par exterminer les mauvais sujets jusqu’à son propre auto-effondrement.
De fait, les totalitarismes du siècle précédent n’ont connu que quelques tentatives de mise en œuvre, catastrophiques ; les échecs successifs du pouvoir à produire une société totalitaire ont généralement entraîné la lente décomposition de l’appareil politique jusqu’à l’interruption de l’expérience, soudaine (Allemagne, Cambodge) ou lente (Union soviétique, Chine), sur fond d’un désastre humain, social, politique voire culturel vertigineux. Si aucun pouvoir totalitaire n’a donc, jusqu’à présent, réussi à se pérenniser, faute d’obtenir ce fonctionnement automatique d’une société quasi utopique, le modèle totalitaire n’en reste pas moins parfaitement connu par sa préfiguration mentale que l’on trouve déjà dans les maquettes des utopies, qui se sont développées, par l’écriture au moins, depuis le début de la modernité. L’utopie serait, en ce sens, le véritable laboratoire du totalitarisme, que les expériences politiques ont approché mais sans jamais encore parvenir à les réaliser complètement16. Et avec l’utopie, on parvient peut-être plus aisément à comprendre l’écart qui sépare l’autoritarisme politique historique, fondé sur la dualité de volontés, et le totalitarisme qui exige une dépolitisation de l’État comme sphère de domination, au profit d’une auto-contrainte généralisée et intégrale de la société, qui devrait uniformiser toutes les volontés sans recours à une volonté hégémonique.
De l’utopie au totalitarisme
En effet, les maquettes littéraires des utopies ne livrent-elles pas, depuis plusieurs siècles, l’image froide, esthétisée, littérarisée, de cet idéal totalitaire, toujours raté dans sa mise en œuvre ? Les utopies ne montrent-elles pas que le totalitarisme se socialise sur fond d’un État doux, bienveillant plus que violent, à l’opposé donc des tyrannies ? Deux séries de traits nous semblent être significatifs. En effet, le pouvoir politique en utopie, d’une part, ne s’exerce plus comme une volonté externe, dominante, tutélaire, qui cherche à créer un monde de volontés majoritairement inclinées vers l’intérêt général, préservant une liberté privée, qui peut exercer ses choix et ses droits sur une large portion de son existence individuelle et même sociale (liberté d’entreprendre, de commercer, etc.), comme dans les sociétés libérales, anti-utopiques, nées au xviie siècle, soucieuses d’exalter la puissance de l’individu et de limiter la sphère de l’État. Un pouvoir utopien devient alors totalitaire lorsqu’il cherche à prendre en charge la totalité des sphères d’existence de ses membres et, par l’administration, à contrôler intégralement la vie de chacun. Dans les maquettes des utopistes, l’idéal imaginé comprend toujours une gestion sans faille d’une « harmonie », d’un ordre sans conflit, née de la régulation des vies privées et publiques par la collectivité17. Bien des régimes totalitaires effectifs au xxe siècle ont d’ailleurs tenté de collectiviser à leur tour les existences et de programmer la vie des individus, jusqu’à la reproduction, au nom de l’eugénisme et du respect de la pureté ethnique18. D’autre part, au moment où il devient panoptique, le pouvoir politique en utopie n’accroît pas, en mesure, sa puissance mais au contraire se dissimule, se capillarise, se multiplie en autant de volontés de contrôle et d’assujettissement qu’il y a d’individus. En utopie totalitaire, chacun intériorise de fait les lois (réduites en nombre limité, aisées à remémorer), les règles, les obligations et rites et s’auto-assujettit en conformité avec ce que veut un État qui est partout et nulle part. Loin d’atteindre une forme de violence paroxystique sur
le modèle despotique, le pouvoir totalitaire en utopie devient doux, par les moyens d’une éducation totale et d’une surveillance tellement rapprochée qu’elle est en fin de compte internalisée. Ainsi chacun devient au pire, le tyran et le bourreau de soi-même.
Si tel est l’idéal-type utopien du totalitarisme, on peut se demander, paradoxalement, si les formes historiques réputées telles ont bien été les plus fidèles réalisations. Dans cette histoire post-démocratique, il ressort que ces régimes, tout en étant parvenus par l’éducation et la police, à éradiquer, de force, les manifestations des libertés individuelles, accusées de corrompre la volonté générale, sont restés des régimes politiques hybrides. D’abord en continuant à cultiver largement des formes autoritaires et charismatiques (via une culture du chef, du héros révolutionnaire, du sauveur, du guide, etc.), d’autant plus qu’ils étaient menacés de l’intérieur ou de l’extérieur ; ensuite, en utilisant la terreur plus que l’autodiscipline, même maintenue par une administration pléthorique censée encadrer la vie quotidienne uniformisée. Ce recours au fascisme et à la violence, loin d’illustrer le totalitarisme, en seraient plutôt les signes de son échec annoncé. Les scénarisations de violence croissante, de mobilisations inattendues de fractions du peuple contre d’autres, de changements d’appareil politique et administratifs par des purges violentes, témoigneraient plutôt de la panique du régime, devenu répressif, et de la résistance imprévue du peuple. Le totalitarisme accouche donc de tyrans démultipliés par une hiérarchie de tyranneaux, à toutes les échelles de l’administration sociale, lorsque précisément il commence à échouer.
Vers la société totalitaire consentie ?
Pourtant le totalitarisme, comme forme sociale préfigurée par les utopies, ne s’avancerait-il pas dans l’histoire contemporaine sous d’autres formes ? Ne sommes-nous pas, dans nos sociétés démocratiques en crise, en train de verser dans des sociétés totalitaires alors même que les gouvernements se maintiendraient dans l’ordre démocratique formel ancien ? Le totalitarisme ne serait-il pas devenu une forme honteuse de l’État
technico-scientifique et communicationnel mondialisé qui se targue de rendre compatibles marché généralisé et institutions démocratiques ? N’aurait-il pas choisi alors de rentrer par la petite porte de l‘ordre social cybernétisé, sécurisé et internetisé ? N’est-ce pas ce que redoutait de manière prémonitoire A de Tocqueville, dès 1840, lorsqu’il anticipait la montée en puissance d’un État-providence, qui pourvoirait de manière maternelle aux désirs d’une société avide de paix, de sécurité et de bonheur19 ? N’est-ce pas ce que permettent et induisent aujourd’hui les nouvelles technologies de la communication et du contrôle social ? Ne sommes-nous pas de plus en plus placés sous surveillance, insérés dans une société de traçage et de normalisation généralisés de nos sphères existentielles privées, pour devenir des échantillons de populations standardisées et instrumentalisées dans leurs désirs de consommation, de loisirs, dans leurs opinions et valeurs20 ? Ainsi le totalitarisme deviendrait la marque même, non d’une forme ultime d’autocratisme politique, mais de sa lente métamorphose en société policée dépolitisée, déshistoricisée, le politique devenant un appareil de pouvoir de moins en moins efficient d’action sur les volontés, ou de médiation des volontés, mais plutôt une sorte de prothèse de l’administration des choses en régime d’automatisme généralisé.
Dans ce contexte inédit, le totalitarisme devrait donc en fait disparaître des catégories du politique dont elle marque l’achèvement et devenir la caractéristique d’une forme nouvelle de vie de masses, soumises au marché mondial et à la société normalisée sans violence. Les totalitarismes célèbres et inouïs du xxe siècle, loin de risquer de réapparaître en tant que tels, loin de raviver les souvenirs tragiques d’une tentative de réalisation d’une utopie occidentale, qui a tourné court mais à quel prix, ne resteraient ainsi dans l’histoire que des monstres froids caricatures d’eux-mêmes. Finalement le totalitarisme doux et bienveillant a pris la place du totalitarisme violent, fausse image récurrente de l’autoritarisme politique. Mais n’est-ce pas lui qui finalement fait retour déjà, là où la
société totalitaire n’est pas encore parvenue à ses fins, dans tous les pays en voie de développement, par exemple, qui demeurent encore soumis aux aléas des tyrans, dont l’archaïque volonté de puissance s’engouffre dans les failles d’une société pré-totalitaire ?
Reste à savoir si ultimement le retour du religieux en certaines contrées de la planète ne va pas réitérer des aventures totalitaires comme celles qui ont incité J. Monnerot à rapprocher l’URSS d’un Islam, soupçonnant les étranges affinités entre le projet totalitaire politique commençant (milieu du xxe siècle) et certaines visées de collectivisation d’une société par un appareil religieux ? Si l’Islam, comme religion théocratique, baigne dans une source spirituelle supra-politique, les politiques islamistes qui en sont issues ne donnent-elles pas l’exemple d’une fascination pour le modèle de sociétés totalitaires, que les voies politiques nées dans la civilisation chrétienne ne sont pas, heureusement, parvenu à réaliser ? Nous sommes donc peut être à la veille d’un temps où à côté de quelques insularités démocratiques, se généraliseront des sociétés totalitaires, les unes mues par la frénésie technologique et consumériste, subsistant à l’ombre d’un bonheur asservi, les autres mues par un retour au religieux théocratique et panoptique, à moins qu’une société future ne télescope les deux traits, ce qui constituerait la victoire finale d’un ordre théologico-politique, parvenu à sa forme paroxystique, c’est-à-dire absolument totalitaire. Cela constituerait le point d’achèvement d’une histoire tourmentée qui n’était pourtant jamais parvenue à renoncer complètement à la liberté. Mais lorsqu’on renonce à la liberté pour les fins absolues, aussi bien temporelles que spirituelles, – et le risque est peut-être plus grand que jamais – il ne reste plus nulle part en l’homme d’étincelle de liberté capable de résister. Ce serait la forme de déshumanisation la plus redoutable. Pourtant la sphère du politique, première sphère de menace sur les libertés, en est peut-être aussi l’ultime rempart si l’on veut éviter de se laisser asservir par les idoles de la société (du bonheur) ou de la religion (du salut).
Jean-Jacques Wunenburger
Université Lyon 3 – IRPhiL
1 Sur les ancêtres du totalitarisme, J. L. Talmon, Les Origines de la démocratie totalitaire, Paris, 1966
2 J. Monnerot, Sociologie du communisme, Gallimard, 1949, p. 380. Le communisme est ainsi décrit en 1949 : « L’empire russe d’aujourd’hui est à la fois une tyrannie (un système intérieur imposé par une minorité à une majorité et tendant à maintenir et accroître par la coercition une réussite issue de circonstances favorables), un despotisme (seigneurial et terrien) et un “Islam” (conjonction conquérante d’un peuple et d’un groupe de peuples d’une part, et d’autre part d’une religion séculière missionnaire) » (p. 336).
3 Si Monnerot identifie un totalitarisme islamique, d’autres en parlent à propos de l’Égypte pharaonique, des Incas et Aztèques etc., signe qu’il ne s’agit peut-être pas d’une forme politique seulement, ni d’une forme récente, mais d’une forme d’organisation politico-sociale générique. Voir J. J. Walter, Les Machines totalitaires, Denoël, 1982.
4 Dans le droit justinien l’empereur est source absolue de loi : « Les disputes concernant les décisions de l’empereur sont interdites. L’expression du doute concernant les décisions de l’empereur est un sacrilège » (Milton A. Anastos, Aspects of the Mind in Byzantium. Political Theory, Theology and Ecclesistical Relations with the See of Rome, Burlington, 2001. Cité par M. Pop « Aspects de l’imaginaire politique médiéval dans la littérature roumaine du xvie et du xviiie siècles », Thèse, Université Jean Moulin Lyon3, 2008, p. 165).
5 Voir nos analyses « Le fondement traditionnel de la souveraineté », Une utopie de la raison, essai sur la politique moderne, La Table Ronde, 2002, p. 94 sq.
6 Voir la thèse de M. Gauchet, Le Désenchantement du monde, une histoire politique de la religion, Paris, Gallimard, 1985
7 Ce qui n’alimenta pas moins la question de la préséance des deux pouvoirs, question insatiablement réitérée pendant des siècles, avec le conflit entre Empereur-roi et papauté en Occident, qui en un sens empêche chacun d’eux de parvenir à une hégémonie absolue.
8 J. Bodin, Les Six Livres de la république, livre I, chap. viii, « De la souveraineté », Paris, Livre de poche, 1993, p. 120.
9 Sur cette formation de la raison d’État voir M. Senellart, Les Arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Paris, Le Seuil, 1995
10 Machiavel, Le Prince, chap. viii : « De ceux qui par scélératesse sont parvenus à principauté ».
11 Telle sera la formulation qui traverse Le Contrat social de Rousseau. Pour certains, la souveraineté absolue de Dieu n’a été que transférée au peuple, dont la figure nouvelle du citoyen-souverain hérite de tous les traits de la toute-puissance divine. Voir par exemple A. Camus, L’Homme révolté : ce qui signifierait que même la démocratie n’a pas encore rompu avec les catégories théologico-politiques. Il y aurait donc aussi un absolutisme du peuple dans la démocratie, au sens propre, populaire.
12 Voir Y. Ch. Zarka, Philosophie et politique à l’âge classique, PUF, 1998
13 J. Maritain, L’Homme et l’État, Paris, PUF, 1953, p. 17.
14 Voir entre autres : H. Arendt, Le Système totalitaire, Paris, Le Seuil, 1972 ; K. Papaioannou, L’Idéologie froide, Paris, Pauvert, 1967 ; J. J. Walter, op. cit. ; ainsi que l’œuvre de A. Zinoviev, dont Le Communisme comme réalité, Paris-Lausanne, Julliard-l’Age d’homme, 1981. Cette logique favorise l’usage du double langage.
15 La Boétie, Discours de la servitude volontaire, GF Flammarion, 1983.
16 Voir notre ouvrage, L’Utopie ou la crise de l’imaginaire, ed. J. P. Delarge, 1979, où se trouve développée l’hypothèse d’une préfiguration du totalitarisme.
17 Une des meilleures synthèses : J. Servier, Histoire de l’utopie, Paris, Gallimard, 1967
18 Pour la planification en régime communiste, voir L. Boia, La Mythologie scientifique du communisme, Caen, Paradigme, 1993.
19 A. de Tocqueville décrit ainsi au dessus des hommes semblables et égaux « un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux », De la démocratie en Amérique, Gallimard, 1961, tome II, p. 324 sq.
20 Voir p. ex. Aujourd’hui le nanomonde. Nanotechnologies, un projet de société totalitaire, Montreuil, L’Échappée, 2008.