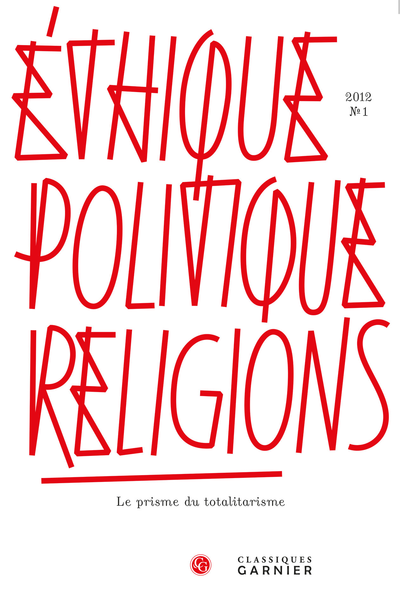
Droit naturel et État mondial Réflexions sur les dialogues entre Leo Strauss, Kojève et Schmitt
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Éthique, politique, religions
2012, n° 1. Le prisme du totalitarisme - Auteur : Jouin (Céline)
- Résumé : Cet article vise à éclairer le double dialogue qui eut lieu entre Leo Strauss et Alexandre Kojève, entre Kojève et Carl Schmitt à propos de l’État mondial. Il montre que le refus commun d’un État mondial, de la part de Leo Strauss et de Carl Schmitt, cache une incompatibilité profonde des « théories de la vérité » de ces deux auteurs, alors que le désaccord de Kojève et de Schmitt sur l’État mondial a pour arrière-plan de nombreuses affinités philosophiques « fondamentales ». Le droit naturel, le rapport à Hegel, la théologie politique et son rapport à la sociologie sont les questions qui servent à révéler la théorie de la vérité de ces auteurs.
- Pages : 57 à 73
- Revue : Éthique, politique, religions
- Thème CLIL : 3133 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie -- Philosophie contemporaine
- EAN : 9782812408823
- ISBN : 978-2-8124-0882-3
- ISSN : 2271-7234
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-0882-3.p.0057
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 21/02/2013
- Périodicité : Semestrielle
- Langue : Français
- Mots-clés : état mondial, droit naturel, théologie politique, hégélianisme, sociologisme
Droit naturel et État mondial
Réflexions sur les dialogues
entre Leo Strauss, Kojève et Schmitt
La critique schmittienne du droit naturel offre un bon point de départ pour éclairer les discussions entre Leo Strauss et Alexandre Kojève, entre Kojève et Carl Schmitt à propos de l’État mondial1. Heinrich Meier a reconstitué le dialogue mené à distance entre Carl Schmitt et Leo Strauss dans deux livres importants2. Sa thèse consiste à dire que Schmitt et Strauss sont séparés par le fossé même qui sépare la théologie politique de la philosophie politique, et partant, que la théologie politique est le « centre » de la pensée de Schmitt, « la caractérisation juste, la seule qui soit adéquate, de la théorie schmittienne3 ».
Il semble bien, en effet, que lorsque Schmitt et Strauss sont d’accord sur des points d’exégèse de la pensée de Hobbes ou quand ils condamnent ensemble l’idéal de l’État mondial, leurs conclusions s’accordent mais rarement leurs prémisses. Les deux auteurs semblent se parler de part et d’autre d’une frontière d’autant plus infranchissable que ce sont deux « théories de la vérité » qui sont en jeu. Néanmoins, il n’est pas sûr que le lieu d’où parle Schmitt soit aussi unitaire que Heinrich Meier le dit. À l’inverse, les conclusions politiques de Kojève et de Schmitt s’opposent souvent, notamment sur la question de l’État mondial, mais ces deux
auteurs n’en donnent pas moins l’impression de parcourir côte à côte un long chemin théorique. Leur désaccord sur la question de l’État mondial ne permet pas de négliger tout ce qui les unit philosophiquement, notamment leur définition commune du politique.
La critique schmittienne du droit naturel est un point névralgique du désaccord entre Carl Schmitt et Leo Strauss. Le rejet du droit naturel par le premier, en particulier le rejet de sa variante thomiste, fait figure d’anomalie pour un juriste catholique. Dans l’Allemagne de l’entre-deux-guerres et du second après-guerre, de nombreux juristes conservateurs4 et la plupart des juristes catholiques se sont tournés vers le droit naturel pour donner un fondement ultime à leur discipline. Si la logique théologique et anti-philosophique, celle de l’obéissance aux dogmes et aux doctrines officielles de l’Église, était bien la logique ultime de la pensée de Schmitt comme l’affirme Heinrich Meier, elle aurait dû reconduire le juriste du côté du droit naturel. Elle aurait dû plus tard provoquer son ralliement au Concile Vatican II. Mais Schmitt, qui refuse de prendre comme idéal un ordre économique planétaire éliminant toute conflictualité politique, s’attriste des décisions du Concile. Il écrit dans la seconde Théologie politique (1969) que le Concile Vatican II a enlevé son fondement à l’éloge qu’il adressait naguère à l’Église romaine dans Römischer Katholizismus und politische Form5. Dans cet essai déjà, le juriste était loin des présupposés jusnaturalistes et personnalistes du catholicisme social et politique traditionnel. À ses yeux, le grand apport de l’Église est le concept de représentation ainsi que la juridicisation du christianisme. Il semble qu’à cet égard la pensée politique de Schmitt ait été d’emblée plus traditionaliste que traditionnelle. Celle-ci se caractérise plutôt comme une volonté d’orthodoxie que comme une orthodoxie véritable. D’accord avec la « forme décisionniste » de l’Église, Schmitt ne l’a pas été souvent avec ses décisions réelles et ses doctrines officielles.
Schmitt a refusé, dès le début et jusqu’à la fin, les services que le droit naturel rend au droit international et au droit public. Son refus, longtemps exprimé de façon lapidaire, est constant : en 1934, il soutient que le droit naturel est pour les juristes contemporains une « fuite dans
la morale6 » (visant le pacifiste allemand Walther Schücking). Son introduction de 1963 à La Notion de politique maintient ce jugement : le juriste y présente le recours au droit naturel, au xxe siècle, par le spécialiste de droit public, comme un pis-aller, typique des périodes de troubles.
Il ne fait pas de doute que dans le conflit entre droit naturel et histoire tel que Leo Strauss le présente7, Schmitt se situe du côté de l’histoire. Dans une lettre adressée à Julien Freund de la fin des années 1950, Schmitt critique la « Schulmeisterei » dont Leo Strauss fait preuve à l’égard de Max Weber dans son livre Droit naturel et histoire, soit son ton de maître d’école8. Il n’a jamais regretté, comme Leo Strauss, ce que ce dernier appelle le « procès d’historisation de la philosophie9 » ni le rapprochement de la philosophie et des sciences sociales. On peut rappeler qu’avec quelques autres juristes anti-kelséniens comme Erich Kaufmann, Rudolf Smend et Hermann Heller, Schmitt fut l’un des promoteurs les plus actifs de la sociologie du droit en Allemagne et en particulier de la sociologie wéberienne.
À Julien Freund, Schmitt écrit encore que c’est Raymond Aron et non Strauss qui a le mieux compris Max Weber. « La philosophie des valeurs (et le relativisme) n’est chez Max Weber qu’une façade10 », ce qu’Aron, selon lui, a compris11. Le sens ultime de la pensée de Max Weber n’est pas pour lui l’historicisme ni le relativisme mais l’éthique de responsabilité.
Dans le Glossarium, Schmitt juge que l’opposition entre le droit naturel et le positivisme juridique est un problème dépassé, qu’a remplacé l’opposition entre légalité et légitimité12. La légalité ne se comprend selon
lui qu’en relation au type de légitimité dont elle dépend, la légitimité n’étant déterminée à son tour que par la sociologie, science à laquelle reviennent les revendications progressistes échues autrefois au droit naturel parce qu’elle montre l’aspect transformable de l’ordre établi. Il qualifie en outre le droit naturel de « non scientifique » parce que le concept de nature est « indéterminé13 ». Le « droit naturel » lui apparaît comme un terme anachronique et trompeur à l’époque des sciences de la nature et de leurs résultats concrets14. « Le droit naturel » se réduit à ses yeux à « quelques dizaines de postulats tout à fait contradictoires, un agrégat de vagues clauses formelles dont les soi-disant concepts – en premier lieu ceux de nature et de droit – restent indéterminés15 ».
Schmitt a retenu la leçon du jeune Hegel dans son opuscule de 1802-1803 sur le droit naturel16 ainsi que la leçon du jeune Marx selon laquelle le rapport entre la construction philosophique du droit naturel et l’économie politique de la société bourgeoise appelle une critique sociologique du droit naturel, qui nous apprend que nous ne pouvons détacher le droit formel du contexte historique et social concret, ni lui donner un fondement purement ontologique, transcendantal ou anthropologique, en le déduisant directement de la nature humaine.
Hegel décrit la raison philosophique de laquelle procède le droit naturel comme raison rentrée en soi, qui a quitté le monde. Il ne place pas cette raison pure à l’origine de la totalité du droit mais voit en elle le produit historique d’une scission (Entzweiung). La théorie de la scission, qui vient de Hegel, est décisive pour comprendre la modernité. Cette scission est décrite dans les Principes de la Philosophie du droit comme étant issue de la société bourgeoise ; le monde historique et concret de l’homme est séparé, dans la société bourgeoise, de la nature abstraite de ses besoins (§ 182). Parce que la société bourgeoise se limite au « système des besoins », parce qu’en elle l’universalité n’est que la nécessité (§ 229), elle devient une puissance de « différence17 ». Hegel nomme la
société civile la « substance éthique dans sa scission (Entzweiung) » (§ 33). La grandeur de l’intuition de Hegel est qu’il ne faut pas s’en tenir à la lamentation sur le déchirement produit par la modernité, ni à la nostalgie de l’unité. Le philosophe comprend l’aspect nécessaire et positif de la scission entre l’idéal abstrait et le monde concret de l’homme18. Le « retour à l’éthique » dont parlent les juristes contemporains est condamné à l’échec, aux yeux de Schmitt, pour une raison que Hegel a soulignée : la crise juridique est ancrée dans la société. Elle est aussi une crise de l’éthique, de la tradition et de l’autorité. Ainsi la grandeur de Hegel vient, pour Schmitt, comme pour Marx et Engels avant lui, de ce que « [son] éthique est la philosophie du droit19 ».
La thèse selon laquelle il existe un fossé infranchissable entre théologie politique et philosophie politique, thèse avancée par Heinrich Meier pour décrire ce qui sépare le juriste et le philosophe, est issue de la pensée de Leo Strauss et non de celle de Schmitt20. Entre l’autorité et la philosophie, nul intermédiaire (inter auctoritatem et philosophiam nihil est medium21), nous dit Heinrich Meier. Peut-être est-ce parce que pour Schmitt l’absolu se loge dans la transcendance divine qu’il peut abandonner sans peine la philosophie au relatif. Néanmoins, sur la question du droit naturel, le juriste n’oppose pas la théologie et la philosophie l’une à l’autre, il les oppose ensemble aux problèmes juridiques concrets. Dans la préface de 1963 à La Notion de politique, Schmitt écrit que nombreux sont ceux qui « cherchent aujourd’hui à étayer ou à revaloriser leur discipline en recourant à un droit naturel à base de théologie morale, voire aux propositions générales d’une philosophie des valeurs22 ». Et que « pris entre la philosophie ou la théologie d’une part, les techniques sociales d’adaptation d’autre part, le spécialiste du droit public se trouve dans une situation de défensive où l’inviolabilité originaire de sa position disparaît et où
le contenu d’information de ses définitions est menacé23 ». On se souvient par ailleurs que dans la Théologie politique de 1922, le leitmotiv est qu’il faut dégager « la théologie ou la métaphysique » de l’adversaire. La philosophie et la théologie ne sont pas opposées l’une à l’autre mais placées côte à côte. Leur vérité est jaugée à l’aune d’un même critère : leur utilité ou leur capacité à garantir l’ordre social.
Pour éclairer le lieu d’où parle Schmitt et ce qui le sépare de Leo Strauss, il nous semble souhaitable de faire un double détour : 1 / par l’une des figures clés de la théologie politique de Schmitt, Louis de Bonald, et sa reprise par Saint-Simon et Auguste Comte 2 / par le Hegel de Kojève, et plus généralement la reprise de Hegel par les hégéliens de gauche, thème qui obsède Schmitt et qui est l’un des objets de sa discussion avec Kojève.
1 / Dans un opuscule de 1810, Bonald se demande « Si la philosophie est utile pour le gouvernement de la société24 ». L’exposé de ce problème, nullement académique à ses yeux, conduit Bonald à opposer la théorie platonicienne du philosophe-roi à une phrase de Frédéric le Grand, qui aurait dit un jour que s’il avait voulu punir une province, il aurait envoyé un philosophe pour la gouverner. Pour Bonald, ces deux conceptions sont peut-être vraies. Leur opposition prouve seulement que la philosophie de Platon est une autre philosophie que celle dont parle Frédéric II et que la société dans laquelle vivait Platon était une autre société que celle du roi de Prusse25.
Pour Bonald, penseur catholique et contre-révolutionnaire, l’ébranlement des fondements de la société fait de la société le premier objet dont doit s’occuper la philosophie. Bonald croyait en Dieu mais dans sa justification philosophique du christianisme se manifeste déjà la fonctionnalisation positiviste de la religion.
Dans son Introduction aux travaux scientifiques du xixe siècle (1808), Saint-Simon, maître d’Auguste Comte, fait l’éloge des écrits de Bonald26. Il écrit qu’il s’agit de l’œuvre la plus remarquable qui soit parue depuis des
années. Il demande seulement à ce que l’on remplace, dans la philosophie de Bonald, le mot « Dieu » par un autre. C’est une science universelle de la nature qu’il cherche à édifier et seul le principe de la gravitation universelle lui semble pouvoir fournir un principe unitaire au savoir humain. Après Saint-Simon, Comte remplace le mot Dieu par le mot « société » et la science reine devient la sociologie. Cette reconnaissance de l’importance de la pensée de Bonald par Saint-Simon et par Comte a fait dire à Léon Brunschvicg que le véritable fondateur de la sociologie n’était pas Auguste Comte mais Bonald27.
La fonctionnalisation sociale de l’idée de Dieu est la pierre de touche de la dissolution de la métaphysique comme philosophie première par la théorie de la société. Comme Louis de Bonald, Auguste Comte cherche à connaître les lois de la société non pour les transformer, mais pour la stabiliser. Comte remplace l’idée de Dieu par le culte du grand être et de l’humanité prise comme un tout. Pour lui, l’idée de Dieu est dangereuse en tant que telle, parce que le rapport entre Dieu et l’individu menace potentiellement tout pouvoir établi. L’ordre théologique de la nature finalisée ayant été brisé, il faut garder l’individu éparpillé, non supporté par un ordre antérieur, mais il faut pourtant révéler en lui une certaine stabilité non individuelle pour éviter de laisser s’établir dans le vide ainsi dégagé autour de lui un rapport trop immédiat de l’homme à Dieu. C’est ce problème que pose Schmitt quand il commente la légende du Grand Inquisiteur exposée par Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. À ses yeux, le Grand Inquisiteur a raison, non le Christ, le plus grand danger étant l’anarchie.
Comte a envisagé de conclure une alliance entre le positivisme et le catholicisme pour empêcher l’alliance anarchiste entre Dieu et l’âme. Montesquiou28 nous apprend que Comte avait envoyé un émissaire à Rome pour conclure cette alliance politique entre les positivistes et les jésuites. Le sociologue a proclamé que tous les croyants devaient devenir catholiques et que tous les athées devaient se faire positivistes afin de lutter ensemble contre le déisme, le protestantisme et les autres formes de l’anarchie moderne qui maintenaient la société dans un état
de troubles constants. Il n’y avait pour lui que deux partis, celui de l’ordre et celui du désordre, les conservateurs et les révolutionnaires. Sa sympathie pour le catholicisme ne reposait ni sur la croyance en la vérité de la doctrine catholique ni sur croyance sur Dieu. Ce qui l’intéressait dans le catholicisme était la fonction sociale, conservatrice de celui-ci.
Plus tard, l’Action française, qui s’est parfois nommée « le parti de Bonald », a voulu réaliser elle aussi une alliance entre positivisme et catholicisme. L’athéisme de Charles Maurras, son principal représentant (antisémite comme Schmitt) ne l’a pas empêché de se consacrer à la restauration de la société chrétienne. Le combat de Maurras en faveur de l’Église romaine était lié chez lui à l’affirmation que la sociologie était la science la plus fondamentale, celle en face de laquelle toute vérité ou toute erreur était abstraite. La relation de Maurras à ce que l’on pourrait appeler « le catholicisme réel » n’a pas été plus heureuse que celle de Schmitt plus tard : l’Action Française a été condamnée par Pie XI en 1927.
Comme la théologie politique de Schmitt, l’Action française de Maurras a un aspect traditionaliste plus que traditionnel. Chez l’un comme chez l’autre, la vérité semble définie à partir de son utilité pour l’ordre social. Or, la conservation du contenu de la foi peut paraître illusoire quand la conservation de la société devient le contenu ultime de la religion. La théologie se renverse trop facilement en sociologie. Dieu tend à devenir une fonction de la foi, dès lors que la foi a un caractère social, il devient une fonction de la société ou de l’Église. C’est du moins cette théologie nihiliste que le Vatican a condamné dans l’Action française. Jean Lacroix montre que c’est seulement parce que le traditionalisme s’orientait déjà vers un catholicisme sans christianisme qu’Auguste Comte a pu le séculariser presque intégralement29.
La difficulté que rencontrent les théoriciens de la contre-révolution (et plus tard ceux de la Révolution conservatrice) est d’avoir à servir, avec les moyens de la réflexion, une autorité qui semble ne pouvoir conserver sa stabilité qu’en étant soustraite à la discussion. Dans une société touchée par la crise, il leur semble que l’ordre ne puisse être ramené par une théorie de la société quelle qu’elle soit. C’est seulement si elle prend la forme d’une théologie que la sociologie peut espérer ne
pas accroître le désordre. Conclusion que Comte n’a pas hésité à tirer, qui est peut-être aussi l’une des clés de la théologie politique de Schmitt et de son ambiguïté.
Rappelons que la Théologie politique de Schmitt s’intitulait au départ « Sociologie du concept de souveraineté et théologie politique », qu’elle avait d’abord été publiée dans un volume édité en l’honneur de Max Weber30. Le texte de Schmitt sur le catholicisme romain et la forme politique se voulait le pendant, pour le catholicisme, mais sur le terrain de la sociologie, de ce que Weber avait fait pour le protestantisme dans L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Alors que selon Max Weber, l’influence de l’Église catholique était secondaire dans la genèse de la modernité comparée à celle de l’individualisme protestant, aux yeux de Schmitt son influence avait été centrale dans la genèse de l’efficacité politique, l’Église catholique étant pour lui le paradigme même de l’État.
On retrouve cette même ambiguïté de la théologie politique schmittienne dans la correspondance du juriste avec Julien Freund. C’est encore en relation à Max Weber qu’il expose à son ami français les réflexions « qui le hantent » sur le terrain de la théologie politique. Il écrit en 1965 qu’il « se sent hanté par le problème de la légitimité charismatique de Weber31 ». Il dit avoir découvert les origines de la légitimité politique de Weber dans la théologie politique luthérienne de Rudolph Sohm, qui pose que « la foi chrétienne est essentiellement spirituelle, charisma, pure grâce32 », la juridicisation du christianisme étant le péché du catholicisme. Mais Schmitt retraduit aussitôt ce problème de théologie politique dans le langage de la sociologie. « La pierre de touche qui m’intéresse pour la théologie politique est le jus reformandi. Qui est compétent pour faire une réforme ? Est-ce la hiérarchie ? Mais c’était (et ce sera toujours) elle précisément qui a besoin d’être réformée33. » E. W. Böckenforde affirme d’ailleurs que la théologie politique de Schmitt n’est qu’une sociologie des concepts juridiques, parce qu’elle ne se veut pas le prolongement de la parole de Dieu ni l’investigation des mystères de la trinité et reste
jusqu’au bout la tentative d’expliquer la genèse et la structure des notions clés de la théorie politique34.
2 / Passons maintenant au second moment de notre réflexion, toujours pour se demander si les analyses schmittiennes sont aussi purement théologiques que ne le dit Heinrich Meier.
La discussion entre Schmitt et Kojève porte sur l’État mondial mais aussi sur le rôle de la théologie dans le système hégélien. Le point de départ de leur correspondance est la réaction de Kojève à l’essai de Schmitt intitulé « Prendre / partager / paître35 ». Dans ce texte, Schmitt reprend l’idée de Marx selon laquelle l’augmentation de la production capitaliste accroît la paupérisation et compromet le partage équitable. Alors que pour Kojève, la période des prises et des conquêtes est terminée dans la politique internationale, l’heure étant au partage, Schmitt soutient que la prise se poursuit, non pas sous la forme des prises de terre coloniales, mais par des prises d’industries planétaires et des conquêtes de marché, bref, sous les formes fluides de l’impérialisme économique. Dans la conférence qu’il donne en 1957 à Düsseldorf sur l’invitation de Schmitt, Kojève répond que l’erreur de Marx est de ne pas avoir vu que les capitalistes allaient devenir intelligents et réaliser l’État social pour rendre leurs clients solvables. Le marxisme n’a pas échoué parce que les capitalistes l’ont pris au sérieux, ce qui a changé l’histoire. Le « capitalisme donnant » a remplacé le « capitalisme prenant ». Le fordisme est son modèle et l’aide au tiers-monde manifeste son extension à l’échelle du monde.
Bien que Kojève souhaite l’avènement d’un État mondial, il est proche de Schmitt à bien des égards. Sa lecture de Hegel le conduit à définir le politique comme la possibilité du combat violent. Kojève pense à l’inverse de Schmitt que le politique tend à disparaître dans le monde contemporain, mais il définit le politique comme lui. Selon lui, depuis la Révolution française, il n’est plus nécessaire de recourir au combat violent car le principe de la reconnaissance – celui de l’égalité
des droits des citoyens – a été établi une fois pour toutes. Dans son Esquisse d’une phénoménologie du droit, Kojève indique que les différends entre États tendront désormais à être résolus par un droit international devenant droit interne ou droit fédéral, par une progressive harmonisation des droits nationaux36. La synthèse de l’égalité des chances sur le marché et de l’égalité socialiste (les droits sociaux) privilégiera selon lui les loisirs, les activités intellectuelles et ludiques (le jeu, le savoir et l’amour) par rapport à la politique et à la guerre. Dans une note fameuse de la seconde édition de son Introduction à la lecture de Hegel sur la fin de l’histoire, Kojève affirme que l’histoire depuis l’époque de Hegel n’a été qu’une extension de la puissance révolutionnaire de Robespierre et Napoléon, Napoléon étant celui qui a réalisé l’idéal révolutionnaire à ses yeux. L’idée de la fin de l’histoire est affirmée avec provocation comme étant la clé du texte hégélien, que le philosophe aurait cachée sous la technicité de ses concepts.
Certains historiens du droit international comme Wilhelm Grewe37 ont confirmé cette idée de Kojève. Grewe montre que la doctrine du droit international de la Révolution française, restée lettre morte au xixe siècle, est devenue réalité après la Première guerre mondiale, avec la SDN puis l’ONU. Kojève accepte ce que Schmitt déplore sous le nom de retour de la théorie de la guerre juste et de criminalisation de la guerre, à savoir le principe de la sécurité collective et l’abolition du jus ad bellum. Mais Kojève et Schmitt sont d’accord sur un point, qui permet de penser leur distance commune à Leo Strauss. Les deux auteurs décrivent la politique mondiale comme une collusion de la dictature et de la démocratie. Leur accord se rapporte à l’intuition centrale de Kojève (ou du Hegel de Kojève), à savoir l’idée que c’est Napoléon qui a réalisé l’idéal révolutionnaire.
Par sa pratique de haut fonctionnaire et de diplomate européen, par sa participation à la construction de l’OCDE, Kojève est bien placé pour constater que c’est l’État bureaucratique et l’administration qui « réalisent » l’État supranational et non un quelconque parlement.
Schmitt pense également de la supranationalité qu’elle est autoritaire38. La dialectique de l’humanisme révolutionnaire et de la terreur stalinienne était assumée par Kojève en ce qui concerne le développement de l’URSS. Il assumait a fortiori le fait que les institutions européennes se développent par le mauvais côté (la bureaucratie des experts). La dialectique des droits de l’homme et de la « police mondiale » est déplorée par Schmitt. Mais le juriste et le philosophe font le même diagnostic. Ils constatent ensemble l’absence de frontière étanche entre l’humanisme philosophique et l’impérialisme.
Dans l’une de ses premières lettres à Kojève, Schmitt écrit que la page décisive de l’Introduction à la lecture de Hegel est celle dans laquelle Kojève explique que la fin de l’histoire dont parle Hegel se manifeste par l’avènement d’un État universel et homogène qui supprime le christianisme du fait qu’il supprime le dualisme de l’Église et de l’État39. La réussite révolutionnaire ruine la théodicée chrétienne. Une autre histoire a commencé, post-chrétienne. Schmitt avait déjà insisté en 1922 sur la lucidité des hégéliens de gauche qui avaient en premier perçu cette « découverte » de Hegel : « Pour autant que la philosophie de l’immanence, qui a trouvé son architecture systématique la plus impressionnante dans la philosophie de Hegel, maintienne l’idée de Dieu, elle inclut Dieu dans le monde et fait surgir le droit et l’État de l’immanence de l’objectivité. Chez les radicaux les plus extrêmes, c’est un athéisme conséquent qui devint la règle. Les hégéliens de gauche allemands furent les plus conscients de ces nouvelles données. Que l’humanité dût venir à la place de Dieu, ils l’ont exprimé aussi fermement que Proudhon40. »
Schmitt relève que l’idée décisive du Hegel de Kojève est l’idée que la théologie qui distingue Dieu et l’homme n’est pas raisonnable et devient nécessairement une mythologie. La religion est détruite par la science mais la science ne comprend pas le sens symbolique de la religion. La philosophie absolue seule, en tant que science de l’histoire et de la société, comprend la signification symbolique de la religion, c’est-à-dire l’idée que chaque peuple se vénère lui-même dans les dieux qu’il adore.
Dans son essai sur Clausewitz (1967), douze ans après la lettre à Kojève dans laquelle il commente cette idée « décisive », Schmitt renvoie systématiquement à toutes les pages du livre de Kojève qui l’évoque41. C’est dire quelle importance avait pour lui « die Hegelsche ‘Gott-Nahme’ » (la prise de Dieu par Hegel). On sait qu’elle signifie pour lui l’avènement de la philosophie de l’histoire comme religion moderne. Mais l’on peut penser que Schmitt reconnaît aussi sa propre division dans « le double visage de Hegel », dans l’athéisme potentiel du philosophe allemand tel que Kojève, et avant lui les jeunes hégéliens et Lukács l’ont mis au jour42.
Kojève explique que pour Hegel, dans le théisme, l’homme prend pour ainsi dire inconsciemment conscience de lui-même, c’est-à-dire qu’il fait de l’anthropologie sous forme d’une théologie tant qu’il parle de soi en croyant parler de Dieu. « Le destin de toute théologie est en fin de compte l’athéisme ». Dans le théisme, l’homme prend conscience de soi mais il le fait sous la forme de la re-présentation (Vor-stellung) et non du concept (Begriff) c’est-à-dire qu’il se projette en dehors de lui-même. Ce qui fait dire à Kojève, dans cette page que Schmitt trouve décisive entre toutes, qu’il « suffit de dire de l’homme tout ce que le chrétien dit de son Dieu pour avoir l’anthropologie athée qui est à la base de la science de Hegel43 ». Kojève ajoute que l’opposition entre l’anthropologie philosophique et la théologie religieuse disparaît avec l’avènement de l’homme parfait Napoléon puis de l’État universel et
homogène qui doit supprimer toutes les différences spécifiques entre nations, races et classes.
La constante affirmation par Schmitt de l’historicité et de la facticité du vrai le conduit à penser que Hegel fait un pas de trop quand, après reconnu la dualité de l’action et du savoir, il construit une philosophie systématique de l’histoire. Le juriste trouve dans la philosophie de l’histoire de Hegel la meilleure description d’une croyance devenue réalité, d’une idéologie active. Il est d’accord avec Kojève pour définir l’idéologie comme « quelque chose qui peut devenir vrai44 ». Il est plus difficile de détruire une idéologie que de scinder un atome, écrit-il un jour à Ernst Jünger. En ce sens, la pensée de Kojève qui décrit l’avènement d’un État mondial n’est nullement utopique à ses yeux. Kojève a certes fait le mauvais choix, choix qui accroît le désordre. Mais pour Schmitt ce choix est concret et au fond réaliste.
Au terme de ce détour, il semble que nous soyons mieux en mesure de juger ce qui sépare Schmitt et Leo Strauss, en dépit de la « coïncidence » de leurs positions concernant l’État mondial. Schmitt est d’accord avec Leo Strauss pour critiquer le droit naturel moderne et la théorie relativiste des valeurs qui lui est sous-jacente. Mais à ses yeux il ne suffit pas de rejeter cette dernière comme « philosophie fausse » et de lui opposer une « philosophie vraie ».
Dans sa discussion avec Kojève, Leo Strauss affirme qu’un État mondial correspondrait au vœux de Platon : l’universel de l’État ne pouvant signifier que l’union du philosophe et du roi, du pouvoir et de la sagesse : « L’État universel exige un accord universel quant aux principes fondamentaux, et un tel accord n’est possible que sur la base d’une connaissance véritable ou de la sagesse. Un accord fondé sur l’opinion ne peut jamais devenir universel. Toute foi qui prétend à l’universalité appelle nécessairement une foi opposée qui élève la même prétention. La diffusion, parmi ceux qui sont dénués de sagesse, de la connaissance véritable qui fut acquise par les sages ne serait d’aucun secours, car, par sa diffusion ou sa dilution, la connaissance se transforme inéluctablement en opinion, en préjugé, ou en simple croyance. Tout ce qu’on peut attendre en matière d’universalité est donc un pouvoir absolu exercé par les non-sages45. »
Dans une lettre à Kojève datée du 22 août 1948, Strauss est plus précis encore : « L’État final doit son universalité à la popularisation de la sagesse, et non à son universalité ni à son homogénéité en tant que telles. Mais si la sagesse n’est pas un bien commun, la masse reste vouée à la religion, c’est-à-dire soumise à une puissance particulière qui particularise (christianisme, islam, judaïsme…), autrement dit, le déclin de l’idée de l’État final et homogène est inévitable46. » Ainsi l’État mondial réel ne pourrait être qu’un « despotisme oriental planétaire47 ».
La philosophie de Platon est à la fois vraie et impossible à réaliser à grande échelle. Cette double affirmation de Strauss contribue à faire apparaître son élitisme et ce qui, d’une certaine façon, est conservateur dans sa pensée, et ce qui risque de la rendre anachronique ou de la confronter à des dilemmes insolubles de son propre point de vue.
Aux yeux de Schmitt, Leo Strauss était un merveilleux philosophe. Dans une lettre adressée à Hans-Dietrich Sander datée de 1977, il assure que la seule perspective d’apprendre quelque chose de Leo Strauss le pousserait « à jeter un regard en arrière même s’il se trouvait dans la barque de Charon48 ». Mais on peut penser qu’à ses yeux, Strauss était seulement un merveilleux philosophe – un exquis historien de la philosophie.
Comme Hegel, Schmitt pense que la raison n’est pas une faculté subjective. Elle consiste à reconnaître la réalité, elle est la subjectivité dépassée. La signification objective d’une philosophie ne correspond pas à ce que le philosophe entend dire subjectivement : celle-ci est politiquement (ou théologiquement) déterminée. Pour les catholiques conservateurs comme Bonald ou Donoso Cortés que Schmitt présente comme ses maîtres, la société chrétienne est la réalisation de l’idée platonicienne du règne de la raison. Contre ce règne les philosophes ne peuvent que raviver les « passions de l’homme49 ».
Il est instructif à cet égard de comparer la position de Kojève dans sa réponse à Leo Strauss50 et celle de Schmitt dans « La tyrannie des
valeurs51 » car elles se ressemblent. Dans une lettre, Kojève affirme à Strauss que sa façon d’opposer sans cesse la « philosophie vraie » et les rapports de pouvoir qui sont pour lui « le seul réel » à un moment donné ne le satisfait pas. Il considère que la philosophie est devenue réalité de bien des manières. « À première vue dans l’histoire les philosophes n’ont eu aucune influence sur les hommes d’État, mais à première vue seulement52 ». Kojève attire également l’attention de Leo Strauss sur le fait que la « philosophie vraie » a de forte chance de devenir fausse si elle se coupe du monde : l’élitisme intellectuel risque de nourrir l’esprit de chapelle. Loin d’exclure les préjugés, le retrait du philosophe dans les académies risque de les perpétuer.
Quant à Schmitt, il montre de manière analogue dans « La tyrannie des valeurs » que le droit naturel des modernes, « philosophie fausse » pour lui comme pour Leo Strauss, a été positivé jusqu’à un certain point53. Mais à ses yeux il ne suffit pas de lui opposer une « philoso
phie vraie » ou un retour au droit naturel antique, et ceci pour des raisons que Hegel a mises au jour et non parce qu’il opère un saut dans la théologie.
Céline Jouin
Université de Caen
1 Pour la discussion entre Leo Strauss et Alexandre Kojève (1948-1950), voir Leo Strauss, De la tyrannie, Paris, Gallimard, 1997. Pour la discussion entre Carl Schmitt et Alexandre Kojève, voir leur correspondance des années 1955-1957 in Schmittiana VI, Piet Tommissen (éd.), Berlin, Duncker & Humblot, 1998, p. 100-125.
2 Heinrich Meier, Carl Schmitt, Leo Strauss und « Der Begriff des Politischen ». Zu einem Dialog unter Abwesenden, Stuttgart, J. B. Metzler, 1988 ; Die Lehre Carl Schmitts. Vier Kapitel zur Unterscheidung Politischer Theologie und Politischer Philosophie, Stuttgart, J. B. Metzler, 1994.
3 Nous traduisons. « Politische Theologie ist die treffende, die einzig angemessene Bezeichnung für Schmitts Lehre ». Heinrich Meier, Carl Schmitt, Leo Strauss und « Der Begriff des Politischen », op. cit., p. 85.
4 C’est le cas notamment d’Heinrich Triepel, d’Erich Kaufmann, et de Friedrich August von der Heydte.
5 Théologie politique, Paris, Gallimard, 1988, p. 99. Römischer Katholizismus und politische Form, Hellerau, Jakob Hegner, 1923.
6 Carl Schmitt, « Nationalsozialismus und Völkerrecht », in Frieden oder Pazifismus ?, Günter Maschke (éd.). Berlin, Duncker & Humblot, 2005, p. 398.
7 Leo Strauss, Droit naturel et histoire, Paris, Flammarion, 1986.
8 Lettre du 2 octobre 1959, in Schmittiana II, Piet Tommissen (éd.), Economische Hogeschool Sint-Aloysius, Bruxelles, 1990, p. 39. Pour l’interprétation straussienne de Max Weber, voir le deuxième chapitre de Droit naturel et histoire.
9 Leo Strauss, The Political Philosophy of Hobbes, The University of Chicago Press, 1963, p. 107.
10 Lettre du 4 décembre 1959, Schmittiana II, op. cit., p. 43.
11 Schmitt renvoie à l’interprétation que Raymond Aron donne de Max Weber dans Les étapes de la pensées sociologiques ainsi qu’à la conférence intitulée « Max Weber et la politique de puissance » tenue à Heidelberg en 1964. Cf. Raymond Aron, Les Étapes de la pensée sociologique, Paris, Gallimard, p. 642-656.
12 Carl Schmitt, Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947-1951, Berlin, Duncker & Humblot, 1991. À chaque fois qu’il évoque ce problème, Schmitt renvoie au chapitre intitulé « Légalité et illégalité » d’Histoire et conscience de classe de Georg Lukács, (Les éditions de Minuit, 1960, p. 293-308).
13 Glossarium, op. cit., p. 49-50.
14 Ibid., p. 195.
15 Ibid., p. 188.
16 G. W. F. Hegel, Le Droit naturel, trad. par André Kaan, Paris, Gallimard, 1972.
17 « La société civile est la différence qui vient se placer entre la famille et l’État, même si sa formation est postérieure à celle de l’État, qui doit la précéder comme une réalité indépendante, pour qu’elle puisse subsister », G. W. F. Hegel, Principes de la Philosophie du droit, § 182 add., Paris, Vrin, 1993, p. 215.
18 Joachim Ritter, « Hegel und die französische Revolution », 1956, in Metaphysik und Politik. Studien zu Aristoteles und Hegel, Francfort-sur-le Main, Suhrkamp, 1969, p. 183-255.
19 Cette phrase de Friedrich Jodl est reprise par Engels dans Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie allemande, Paris, Éditions sociales, 1976, p. 48.
20 Voir Heinrich Meier, Carl Schmitt, Leo Strauss und der Begriff des Politischen, op. cit., p. 51, note 41.
21 Ibid., p. 50.
22 Carl Schmitt, La Notion de politique, Paris, Flammarion, 1992, p. 50.
23 Nous soulignons. Ibid.
24 Louis de Bonald, Mélanges littéraires, politiques et philosophiques, Œuvres, t. 11, Paris, Adrien Le Clère, 1819, p. 379-391.
25 Ibid., p. 379-380.
26 Œuvres de Claude-Henri de Saint-Simon, t. 6, Paris, Anthropos, p. 167-168.
27 Léon Brunschvicg, Le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale, t. 2, Paris, Librairie Félix Alcan, 1927, p. 525. Voir aussi p. 516 et p. 527.
28 Léon de Montesquiou, Le système politique d’Auguste Comte, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1907, p. 16.
29 Voir Jean Lacroix, La sociologie d’Auguste Comte, Paris, PUF, 1956, p. 20-25 et p. 71-81.
30 « Soziologie des Souveränitätsbegriffes und politische Theologie », in Melchior Palyi (éd.), Hauptprobleme der Soziologie. Erinnerungsgabe für Max Weber, Munich et Leipzig, Duncker & Humblot, 1922, tome 2, p. 3-35.
31 En français dans le texte. Lettre à Julien Freund du 16 décembre 1965, in Schmittiana II, op. cit., p. 59
32 Ibid.
33 Ibid.
34 E. W. Böckenforde, « Politische Theorie und politische Theologie. Bemerkungen zu ihrem gegenseitigen Verhältnis », in Revue européenne des sciences sociales, tome XIX, 1981, no 54-55, p. 233-243.
35 Voir Carl Schmitt, La Guerre civile mondiale. Essais 1943-1978, Paris, Éditions Ère, 2007, p. 51-64.
36 Cf. Alexandre Kojève, « Le droit international, le droit interne et la pluralité des systèmes juridiques nationaux », in Esquisse d’une phénoménologie du droit, Paris, Gallimard, 1981, p. 374-392.
37 Voir Wilhelm Grewe, « Die völkerrechtspolitischen Ideen der französischen Revolution », in Epochen der Völkerrechtsgeschichte, Baden-Baden, Nomos, 1984, p. 485-497.
38 Schmitt affirme être entièrement d’accord avec Francis Rosenstiel sur la question de la supranationalité. Voir Francis Rosenstiel, Le Principe de supranationalité, Paris, Pédone, 1962.
39 Lettre à Kojève datée du 9 mai 1955, in : « Der Briefwechsel Kojève-Schmitt », Schmittiana VI, op. cit., p. 101. Schmitt se réfère à la page 215 de l’Introduction à la lecture de Hegel d’Alexandre Kojève (édition de 1947 reprise dans celle de 1979 chez Gallimard, Tel).
40 Nous soulignons. Carl Schmitt, Théologie politique, op. cit., p. 59.
41 Cf. Carl Schmitt, La Guerre civile mondiale. Essais 1943-1978, op. cit., p. 175.
42 Dans les archives de Carl Schmitt à Düsseldorf, se trouve l’exemplaire de Schmitt du livre de Georg Lukács sur le jeune Hegel (Georg Lukács, Der junge Hegel. Über die Beziehungen von Dialektik und Œkonomie, 1948, RW 265-24641), livre que le juriste a lu et annoté en 1948. Le seul passage vraiment annoté par Schmitt porte sur les convictions politiques et religieuses de Hegel au moment de la rédaction de La Phénoménologie de l’esprit. Le juriste souligne tout ce qui touche à la religiosité de Hegel dans le texte de Lukács. Il relève de façon systématique, presque exclusivement, chaque assertion sur l’attitude « tiraillée et ambiguë » (zwiespältig und zweideutig) de Hegel vis-à-vis de la religion. Il encadre les indices que Lukács rassemble touchant l’« athéisme » potentiel de Hegel ainsi que le repérage progressif, par Lukács, d’un plan exotérique et d’un plan ésotérique dans l’œuvre du philosophe allemand. Selon Lukács, Heinrich Heine est le premier à avoir opéré une séparation stricte, chez Hegel, « entre sa prédication exotérique de la religion identifiée à l’Esprit absolu et son athéisme en tant que théorie ésotérique ». Pour Heine, mais aussi pour les Jeunes hégéliens de gauche, il est clair que la philosophie exotérique de Hegel n’est qu’une adaptation extérieure à la conjoncture politique de l’époque. En tant qu’élève direct de Hegel, Heine dit avoir vu Hegel « composer la musique de l’athéisme ».
43 Introduction à la lecture de Hegel, op. cit., p. 215.
44 Ibid., p. 117.
45 « Mise au point », in Leo Strauss, De la tyrannie, op. cit., p. 224.
46 De la tyrannie, op. cit., p. 280.
47 « Mise au point », op. cit., p. 243.
48 Lettre du 3 novembre 1977, in : Carl Schmitt, Hans-Dietrich Sander, Werkstaat-Discorsi. Briefwechsel 1967-1981, Schnellroda, Edition Antaios, p. 414.
49 « La philosophie devait être la seule religion des sages du paganisme, et la religion doit être la seule philosophie des chrétiens ». Louis de Bonald, « Si la philosophie est utile pour le gouvernement de la société », op. cit., p. 383.
50 « Tyrannie et sagesse », in Leo Strauss, De la tyrannie, op. cit., p. 148-199.
51 « La tyrannie des valeurs » (1967), trad. par Patrick Lang et Céline Jouin, in Koch, Isabelle et Lenoir, Norbert (éds.). 2008. Démocratie et espace public : quel pouvoir pour le peuple ?. Hildesheim, Zurich, New York, Olms, p. 211-237.
52 Alexandre Kojève, « Tyrannie et sagesse », dans Leo Strauss, De la tyrannie, op. cit., p. 190. Aristote n’était il pas le professeur d’Alexandre le grand ? L’idée d’un Empire ou d’un État vraiment universel dans lequel fusionneraient conquérants et conquis, qui au lieu d’établir la domination d’une race et d’une patrie supposerait leur dissolution, cette idée politique nouvelle entre toutes à l’époque d’Alexandre, n’est elle pas à mettre en relation avec l’enseignement philosophique qu’Alexandre a reçu ? Si Alexandre était prêt à dissoudre la Macédoine et la Grèce concrètes dans un nouvel ensemble politique détaché de tout noyau géographiquement et ethniquement fixe (programme qui a ensuite servi de modèle à César et à Napoléon), n’est-ce pas parce qu’il partait de l’ « idée » ou de la « notion générale » de l’Homme dégagée par la philosophie grecque ? Ibid., p. 191-192.
53 Décrivant l’évolution du droit depuis 1945, Schmitt observe qu’une « philosophie des valeurs », implicite mais puissante dirige confusément l’interprétation des droits fondamentaux par les juges depuis l’introduction de la Loi fondamentale de 1949. Il montre que la philosophie des valeurs, dont Dilthey fut le chef de file, qui était née en son temps d’une réaction au positivisme et à la domination de la rationalité instrumentale, agnostique et relativiste, des sciences de la nature, s’est infiltrée dans la pratique juridique après la Seconde Guerre mondiale, remplaçant le positivisme juridique tombé en discrédit après 1945 parce qu’il s’était révélé incapable de montrer que les lois nazies n’était pas du droit. Selon Schmitt le « droit naturel moderne » a donc été positivé dans la justice constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ayant reconnu la structure ouverte de la constitution, elle donne lieu à une interprétation constructive du cas particulier. L’interprétation des droits fondamentaux se trouve de fait fortement chargée d’idéologie : les juges constitutionnels n’ayant souvent d’autres recours que leurs valeurs personnelles, qui sont de simples préférences subjectives, pour trancher les conflits entre les différentes normes. Pour pallier aux lacunes du droit, la Cour de Karlsruhe interprète en effet la Constitution comme un « ordre axiologique concret », ouvert et souple, et transforme ainsi l’exégèse du droit en la tâche d’une réalisation des valeurs, au cas par cas, puisque aucune valeur ne peut prétendre par sa nature à une priorité absolue par rapport aux autres.