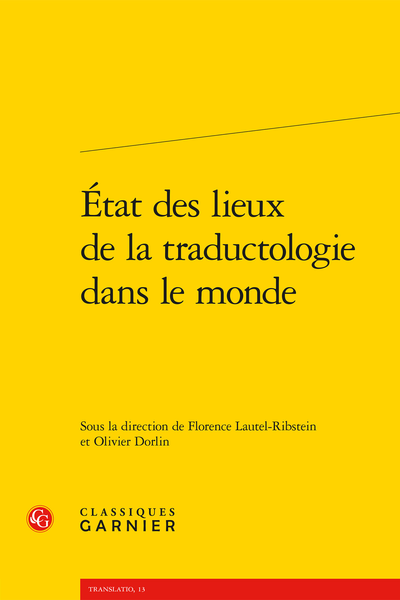
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : État des lieux de la traductologie dans le monde
- Pages : 833 à 844
- Collection : Translatio, n° 13
- Série : Problématiques de traduction, n° 11
- Thème CLIL : 3147 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Linguistique, Sciences du langage
- EAN : 9782406133506
- ISBN : 978-2-406-13350-6
- ISSN : 2800-5376
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-13350-6.p.0833
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 23/11/2022
- Langue : Français
RÉSUMÉS
Florence Lautel-Ribstein, « Préface »
La Préface à État des lieux de la traductologie dans le monde, premier ouvrage du genre publié en France à couvrir autant de pays et de langues/cultures, s’interroge sur la biographie et l’historiographie afin de mieux cerner la nature de ce collectif qui éclaire tour à tour l’enseignement de la traductologie, l’histoire des traductions, les approches théoriques de la traductologie contemporaine et la politique éditoriale des maisons d’édition.
Michael Cronin, « Babel, je t’aime, moi non plus. Europe, migration, traduction »
La relation entre climat, migration et traduction est souvent traitée du point du vue de la traduction en situation de crise humanitaire. Nous proposons de considérer cette relation dans une approche terracentrique de la traduction qui s’inspire de l’écologie politique et recoupe les agents migratoires humains et non-humains. L’ère de l’Anthropocène avec une vision renouvelée du temps et de la base ontologique de nos actions montre la pertinence des approches traductives dans nos sociétés.
Lance Hewson, « L’avenir incertain de la traductologie »
Cet article aborde les menaces qui pèsent sur l’avenir de la traductologie. Il se penche sur les évolutions des pratiques traductives, puis constate le nombre faible de traductions d’ouvrages dans ce domaine et la place de plus en plus dominante de l’anglais comme langue de publication. Il souligne aussi les dangers de l’utilisation massive de la traduction automatique, ce qui aboutit à une diminution de la recherche en traductologie. Des pistes de recherche sont esquissées en fin d’article.
834Annie Brisset, « Traductologies. Des mondes qui s’ignorent »
Diffusée par des éditeurs mondialisés, la traductologie anglophone exerce une hégémonie aux dépens de travaux inaperçus faute de traduction. À l’intérieur même de la discipline, deux grands courants de recherche continuent à se développer séparément alors qu’ils ont vocation à s’interféconder : l’un axé sur l’interprétation et la textualisation du sens et l’autre sur le contexte de la traduction.
Yves Chevrel, « Entreprendre une “histoire des traductions en langue française”. Principes, méthodes, problèmes – résultats ? »
La publication, au début du xxie siècle, de trois entreprises collectives concernant l’histoire de la traduction / des traductions en anglais, français et espagnol est au fondement de cette intervention ; elle examine les choix scientifiques initiaux, les méthodes, les problèmes et enfin les résultats obtenus. Elle compare les trois entreprises et conclut sur des rencontres à venir pour aborder cette histoire à l’échelon européen.
Marianne Lederer, Jean-René Ladmiral, Jean-Yves Masson, Magdalena Nowotna, Florence Lautel-Ribstein et Tatiana Milliaressi, « Les théoriciens français de la traduction au xxie siècle »
Six théoriciens français parlent de leur approche théorique en traduction : l’article revient sur la Théorie Interprétative de la Traduction et les fameux théorèmes pour la traductologie. Il insiste aussi sur « l’observation critique des traductions » et le « pacte de lecture » entre traducteur et lecteur. Il montre l’application de la théorie des instances énonçantes, explore l’approche phénoménologique de la traduction, la traduction épistémique et l’impact de la typologie des langues.
Mathilde Fontanet, « La traductologie en Suisse »
La Suisse ayant quatre langues nationales, la traduction y occupe une place importante. Les principaux établissements de traductologie y sont la Faculté de traduction et d’interprétation de l’université de Genève, l’Institut de traduction et d’interprétation de la ZHAW (Winterthur) et le Centre de traduction littéraire de Lausanne. Chacun de ces établissements a des domaines de recherche particuliers et beaucoup de traductologues helvétiques participent à des collaborations internationales.
835Hanne Cardoen, Catherine Gravet, Kevin Henry, Laurence Pieropan, Thea Rimini et Gudrun Vanderbauwhede, « État des lieux de la traductologie en Belgique francophone »
Cet article discute des travaux en traductologie menés par les chercheurs de Belgique francophone depuis 2008, début de l’académisation des écoles de traduction et d’interprétation. Six disciplines sont examinées : histoire de la traduction, traduction littéraire, linguistique contrastive, interprétologie, terminologie, et technologies de la traduction. Y sont soulignées les grandes tendances thématiques et les interactions entre chercheurs.
Winibert Segers, « Raymond van den Broeck. Un personnage clé de la traductologie »
Cette étude s’inscrit dans le projet Griffels[Crayons d’ardoise / Greffes], qui se concentre sur le travail du traductologue Raymond Van den Broeck. Le projet a plusieurs objectifs : la lecture et relecture des articles et des livres de Van den Broeck, l’enquête sur ses sources et la continuation de son travail.
Jörn Albrecht, « Le rapport entre recherches traductologiques et enseignement de la traduction en France et en Allemagne »
Cette contribution propose de distinguer entre trois niveaux de recherche à l’intérieur de la traductologie moderne : la technique de la traduction ; la stratégie de la traduction et l’industrie de la traduction. Après une présentation de l’ensemble des problèmes qui se posent dans le domaine de ces trois niveaux, l’article propose d’examiner l’apport que ceux-ci peuvent apporter à l’enseignement de la traduction.
Martina Mayer, « La traductologie en Autriche. Traduire ne suffit pas : une didactique pour la professionnalisation précoce de futurs traducteurs »
La situation dans l’enseignement de la traductologie en Autriche est au centre de cette contribution qui cible les exigences que rencontrent les jeunes traducteurs pour réussir leur entrée sur le marché. Elle compare aussi les différentes approches de formation au niveau licence et expose comment la réalisation de projets universitaires de traduction non-lucratifs peut contribuer à optimiser les résultats d’apprentissage pour atteindre une professionnalisation précoce.
836Gabriel González Núñez, « Politique de la traduction au Royaume-Uni, dans un monde linguistiquement diversifié »
En Europe, les approches politiques envers les anciennes et nouvelles langues minoritaires sont différentes. Si le but ultime des politiques sociales est de créer un État plus inclusif, il serait utile de considérer les locuteurs des anciennes et nouvelles minorités comme n’étant pas différents en termes d’inclusion. L’auteur se concentre sur le Royaume-Uni, et examine les politiques relatives à la traduction lorsque l’État fait des choix linguistiques qui affectent une population multilingue.
Pilar Ordóñez-López et Rosa Agost, « La traductologie en Espagne. La traductologie dans une conception dynamique de l’enseignement »
Cette contribution mène une révision critique des modules de théorie de la traduction dans les programmes de licence des universités espagnoles. L’objectif est d’identifier les aspects susceptibles d’être améliorés, d’une part pour répondre aux besoins et aux attentes des étudiants, et d’autre part pour faire de de la théorie de la traduction un espace dynamique d’interaction entre la réflexion théorique et la pratique professionnelle de la traduction.
Jorge Almeida ePinho, « Un voyage dans le monde des traducteurs et maisons d’édition au Portugal. 1974-2009 »
L’article analyse les résultats d’une enquête par questionnaires envoyés à différentes maisons d’édition portugaises. Il livre des informations sur les ouvrages publiés depuis les premiers imprimeurs et éditeurs jusqu’au marché éditorial actuel et aborde également le développement des associations portugaises d’éditeurs et la situation des traducteurs portugais. Enfin, il examine les comportements des maisons d’édition au Portugal dans un passé récent (1974-2009).
Fabio Scotto, « Théories contemporaines de la traduction en Italie »
Cette étude propose de faire état des recherches contemporaines les plus significatives sur le traduire en Italie des quarante dernières années. Il prend en considération les démarches du philologue Gianfranco Folena, du sémioticien Umberto Eco, du néo-phénoménologue Emilio Mattioli, des poètes Franco Fortini et Franco Buffoni et de la revue semestrielle Testo a fronte (née 837en 1989), dans le but de montrer les rapports synergiques entre théorie, poétique et pratique de la traduction.
Titika Dimitroulia et Evangelos Kourdis, « État des lieux de la traductologie grecque »
Cette étude porte sur la formation et l’institutionnalisation de la traductologie grecque, pendant les derniers 45 ans (1974-2019). Après un bref survol historique de la traduction en Grèce moderne, où la traduction interlinguale a occupé une place importante, nous essayons d’en identifier les principales tendances à travers les programmes de formation des traducteurs et un échantillon de thèses et de publications portant sur divers aspects de la traduction et de la traductologie.
Brankica Bojović, « Problèmes et défis de la traductologie au Monténégro »
Après avoir mis en évidence les caractéristiques principales de la traductologie en Europe, l’article se concentre sur les aspects linguistiques, ontologiques et cognitifs développés au Monténégro, puis sur la notion de culture, à partir du corpus du manuel Les Bases de la traductologie, utilisé à l’université du Monténégro.
Georgiana I. Lungu-Badea, « La traductologie en Roumanie. Relations synchrones et différées avec la traductologie européenne : quelques pistes de recherche »
Cette contribution explore quelques aspects liés aux études de traduction actuelles en Roumanie, et tente d’identifier les influences, les convergences et les divergences entre les diverses directions de recherche en traductologie d’Europe occidentale, centrale et orientale et de Roumanie. Une proposition de typologie des travaux de traductologie dans et en dehors de l’espace étudié s’accompagne de l’examen des facteurs conduisant au choix de langues non maternelles pour la publication de ces travaux.
Teresa Tomaszkiewicz, « La traductologie et la formation des traducteurs en Pologne avant et après 1989 »
Cette étude présente l’évolution de la recherche en traductologie et de l’enseignement de la traduction et de l’interprétation dans les universités 838polonaises de 1946 à nos jours. L’auteur se concentre sur quelques moments cruciaux de l’histoire du pays qui ont influencé les changements dans la formation des professionnels et la méthodologie de la recherche. L’article se termine par certaines propositions concernant l’avenir de cette discipline en Pologne et dans le reste du monde.
Marina Guister, « Les Anciens et les Modernes. État des lieux de la traduction et de la traductologie en Russie »
L’article est consacré à l’histoire de la pensée traductologique en Russie du xviiie au xxe siècle. Y sont présentés tout d’abord les domaines principaux de la recherche traductologique actuelle. Sont étudiées ensuite les polémiques sur l’art de la traduction, très ardentes au milieu du xxe siècle, et à nouveau d’actualité aujourd’hui.
Katarína BednÁrovÁ, « La traductologie en Slovaquie. Écrire l’histoire de la traduction face à l’héritage de l’hétérolinguisme géo-temporel »
La contribution invite à une réflexion sur les modalités conceptuelles de l’historiographie traductionnelle déterminée par les particularités de la situation géopolitique, linguistique, confessionnelle ainsi que par le geste politique dans un pays au sein de l’Europe centrale, la Slovaquie. La réflexion proposée est centrée sur l’hétérolinguisme dans la littérature ainsi que sur la production des traductions romanesques.
Vladimír Biloveský et Martin Djovčoš, « La formation du traducteur et de l’interprète en Slovaquie. Évolution historique et situation actuelle »
La formation des traducteurs et interprètes en Slovaquie hérite d’une longue tradition tchécoslovaque du début des années 1960. Ce modèle, approfondi en Slovaquie par A. Popovič, rassemble en une même formation traduction et interprétation. Poursuivant cette tradition, le nouveau programme d’études de l’université Matej Bel de Banská Bystrica (Slovaquie) entend davantage répondre aux besoins actuels du marché grâce à un système souple de modules optionnels.
839Tamara MikoličJužnič, Marija Zlatnar Moe et Tanja Žigon, « La traduction littéraire en Slovénie »
La langue et la culture slovènes occupent une position périphérique dans le système mondial de la traduction et se caractérisent par un pourcentage relativement élevé de textes traduits, de traducteurs travaillant avec des combinaisons de langue différentes et d’autres intervenants dans le processus de traduction. La dynamique de la traduction dépend des influences régionales, des possibilités d’apprentissage, du financement national et de celui du pays d’origine, etc.
Irena Kristeva, « La traductologie en Bulgarie. Hier, aujourd’hui… et demain ? »
L’article trace les grandes lignes de l’évolution de la réflexion traductologique en Bulgarie. Son point de départ concerne les ouvrages pionniers du domaine. Ensuite, il fait le tour des études qui ont jalonné le développement de la théorie de la traduction au cours des deux décennies précédant la chute du Mur de Berlin. Enfin, il s’arrête sur quelques ouvrages saillants de la période post-totalitaire dans un effort de dresser l’état des lieux de la traductologie en Bulgarie au tournant du xxie siècle.
Annie Brisset et Raúl E. Colón Rodríguez, « La traductologie au Canada. Origines et domaines de recherche »
À l’historique des conditions qui ont permis le développement de la traductologie canadienne, avec ses particularités et son cadre institutionnel, succède un exposé des recherches effectuées depuis 1970 jusqu’à ce jour. Un recensement des publications (monographies, collectifs, revues) fait ressortir les domaines privilégiés et leur évolution.
Isabel Gómez, « State of emergence. The hospitality of translation studies in today’s United States »
L’article examine les défis pour la traductologie aux États-Unis au xxie siècle. Les réalités multilingues sont en tension avec un climat politique dans lequel les idéologies du « English-only » permettent à la discrimination linguistique de remplacer la discrimination raciale ou culturelle. Une plus grande attention 840à l’histoire multilingue du pays, à l’activisme de la traduction et aux défenseurs du patrimoine – traducteurs potentiels –, pourrait accroître la visibilité de la traductologie.
Nayelli Castro, « Vers une traductologie latino-américaniste ? »
La traductologie est devenue un des outils les plus puissants pour l’analyse des rapports interculturels. L’article interroge les présupposés d’un certain latino-américanisme en traductologie tant en Amérique latine qu’aux États-Unis. Le but de notre réflexion est de problématiser et de déterminer la spécificité des études traductologiques latino-américaines.
Marta Pragana Dantas, « Traduction et inégalités littéraires. La littérature brésilienne en France »
L’espace transnational où circulent les traductions est profondément marqué par des hiérarchies et des asymétries. Les difficultés auxquelles les littératures dites périphériques doivent faire face pour s’y inscrire sont liées aux lois qui régissent le fonctionnement de cet espace. L’article examine la circulation de la littérature brésilienne en France en réfléchissant sur le rôle joué par quatre intermédiaires : éditeurs, traducteurs, agents littéraires et enseignants-chercheurs.
Alejandrina Falcón, « L’institutionnalisation de la traductologie à Buenos Aires »
Le but de cet article est de contribuer à une analyse critique du champ national de la traductologie en partant d’une étude de cas centrée sur la faculté de philosophie et lettres de l’université de Buenos Aires et du centre de formation professionnelle, l’Institut d’enseignement supérieur en langues vivantes « Juan Ramón Fernández » (IESLV-JRF).
Ana María Gentile, María Leonor Sara et Daniela Spoto Zabala, « Contribution à un état des lieux de la traductologie en Amérique latine. La recherche dans les universités argentines »
Ce travail vise à apporter des données et des suggestions en vue de dresser un aperçu utile à la connaissance de l’état de la recherche en traductologie en Amérique latine, particulièrement en Argentine. Les informations fournies 841concernent les perspectives historiques, pratiques et théoriques, les formations à la recherche, les publications et les rencontres de la spécialité, les projets labellisés et les échanges universitaires régionaux et internationaux.
David Elder, « Réflexions préliminaires sur la traduction en Océanie »
Ces « Réflexions préliminaires sur la traduction en Océanie » constituent un survol rapide de la situation en Australie et en Nouvelle Zélande (avec leurs revues spécifiques dans ce domaine). L’article propose ensuite quelques jalons pour une meilleure inclusion des études de traductologie au cœur des programmes existants. Il passe également en revue les contributions australiennes et néo-zélandaises lors du 1er Congrès mondial de traductologie.
Marie-Josée de Saint Robert, « La traduction en Chine »
La pratique millénaire de la traduction en Chine s’est très tôt érigée en école, à l’occasion notamment de la traduction des textes bouddhiques. Elle a permis de définir des règles de restitution du sens dans des langues qui n’ont souvent rien en commun du point de vue de la terminologie, de la syntaxe et des façons de penser. En voie de professionnalisation rapide et en forte demande depuis une trentaine d’années, la traduction en Chine doit encore relever un certain nombre de défis.
Ito Hiromi et Tanabe Kikuko, « L’état des lieux de la traductologie au Japon »
Au Japon, longtemps isolé géographiquement, puis par volonté politique, la traduction joue un rôle essentiel depuis 1 500 ans dans le développement du pays. Elle a d’abord introduit les connaissances par des textes traduits du chinois, puis par des langues occidentales depuis le xixe siècle. Ce n’est que dans les années 1980 que s’amorcèrent les échanges entre les traductologues japonais et étrangers qui conduisirent au développement des recherches traductologiques dans ce pays.
Annie Montaut, « Traduire en milieu plurilingue. Les littératures indiennes tributaires de l’anglais »
La domination croissante de la traduction et de la diffusion de la littérature indienne d’expression anglaise sur les autres langues littéraires indiennes 842s’explique par le rôle de plus en plus hégémonique de l’anglais, pourtant très minoritaire, en Inde même. Les littératures dites « vernaculaires » représentent dans ce contexte multilingue un foyer de résistance à l’élitisme linguistique et culturel, qui fait de leur traduction un enjeu majeur du maintien de la diversité humaine.
Bénédicte Diot-Parvaz Ahmad, « Traduction juridique et judiciaire en hindi, ourdou et pendjabi. État de l’art en Inde »
En Inde comme au Pakistan, pays plurilingues, la loi prévoit la traduction du droit de l’anglais vers les langues nationales. Or si l’on trouve des outils numériques pour certains domaines de spécialité, il n’existe en pratique pas de formation pour la traduction officielle du droit. Le manque de ressource en ce domaine est tel que les pays accueillant une diaspora sud-asiatique ont dû créer des contenus inédits dans les pays d’origine pour permettre aux minorités d’accéder au droit local.
Rachel Weissbrod, « Du polysystème et des normes au postmodernisme et au postcolonialisme. L’impact persistant des années 70 en Israël »
Dès les années 1970, la traductologie en Israël a été fortement marquée par les idées de l’École de Tel Aviv. Les plus déterminantes furent celles de la théorie du polysystème de I. Even-Zohar et du concept de normes de G. Toury. La traductologie en Israël a depuis suivi d’autres directions, en particulier sous l’effet du postmodernisme et du postcolonialisme. Toutefois, comme le démontre cet article, certaines idées véhiculées par cette École conservent encore une influence considérable.
Beki Haleva, « Translation studies in Turkey. The state of play and perspectives »
La traductologie a pris place extrêmement tôt en Turquie si l’on considère son expansion mondiale. Cet article, qui se situe dans les limites de la traduction écrite en Turquie, tente de dresser un état des lieux non exhaustif et aborde les différents axes qui entrent en jeu pour former le pilier de l’institutionnalisation de la traduction en Turquie : formation pédagogique, politiques éditoriales en traduction et traductologie, colloques, associations, etc.
843Henri Awaiss, « Guerre et traduction au Liban. 1975-2017 »
Cette contribution convoque les textes de poètes, romanciers ou biographes traduits de l’arabe vers d’autres langues pour évoquer la guerre qui n’a cessé depuis 1975 au Liban et en particulier à Beyrouth. Elle aborde ensuite la traduction, comme activité universitaire ou professionnelle, mais surtout comme symbole de paix. Enfin, elle parle d’une sainte guerre menée par la traduction dans le système éducatif et qui vise à apprivoiser la traductologie.
Ranya Salameh et Gisèle Al Riachi, « La traduction au Liban a le vent en poupe »
Cette étude vise à brosser un tableau de l’état de la traduction, de son enseignement et de la recherche traductologique au Liban par le recensement des institutions impliquées dans la formation des traducteurs et des organisations arabes basées au Liban. Une attention particulière sera accordée à la formation théorique, à la politique éditoriale des différentes parties ainsi qu’aux projets de collaboration interuniversitaire.
Marwa Elsaadany et Malak Halabi, « L’évolution des méthodologies d’enseignement de la traduction français-arabe et arabe-français. Vers une formation plus professionnelle : étude de cas »
L’enseignement de la traduction ne répond pas partout aux mêmes critères, étant donné la diversité des situations relatives à chaque pays. L’analyse des facteurs déterminant la didactique de cette discipline à l’université Princesse Nourah bint Abdulrahman en Arabie saoudite permet de mettre en lumière les vrais besoins des apprentis traducteurs et d’évaluer l’efficacité et la validité des méthodes pédagogiques suivies et des descriptifs des cursus enseignés.
Bahareh Ghanadzadeh Yazdi, « Aperçu de la traductologie en Iran »
Cette étude fait un tour d’horizon des études traductologiques en Iran. La traductologie en tant que discipline y est presque absente. D’après les programmes officiels en traduction, les théories de la traduction les plus récentes ne sont pas très connues en Iran, mais des cours de théorie sont tout de même dispensés au niveau du master et du doctorat, et ils sont susceptibles d’ouvrir une voie de réflexion pour les futurs chercheurs en traduction.
844Abdallah Amid, « La traduction au Maroc. Pour une vision globale et une action intégrée »
Cette contribution donne une idée générale de la traduction au Maroc, secteur qui englobe un premier champ, celui des pratiques de la traduction (livres traduits comme indicateur officiel) ; un deuxième champ, celui des études traductologiques ; un troisième, celui de l’enseignement et un quatrième, celui des associations professionnelles et de la promotion de la traduction. La création d’une institution centrale devrait permettre de s’acquitter des objectifs adaptés aux besoins du pays.
Mohamed Réda Boukhalfa et Nesrine Boukhalfa Louli, « État des lieux de la traductologie en Algérie. La scientométrie à la rescousse »
Cet article présente les travaux en traductologie à l’université d’Alger. Il montre la naissance d’une nouvelle génération de traductologues en Algérie et nous emmène sur le chemin de la scientométrie qui permet d’analyser et de mesurer les productions scientifiques dans le domaine de la traduction. Cette contribution conclut sur la distinction qui tend à s’imposer graduellement entre traductologie et linguistique dans ce pays.