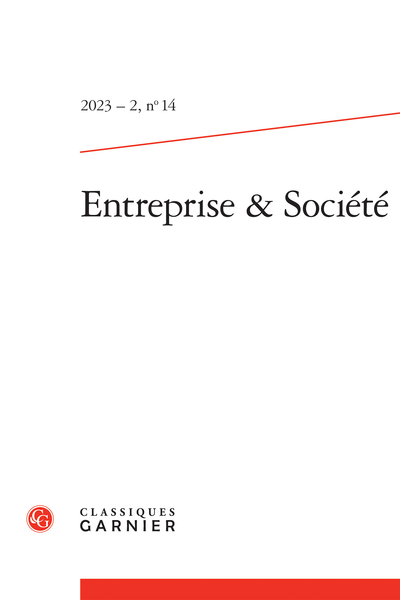
Book reviews
- Publication type: Journal article
- Journal: Entreprise & Société
2023 – 2, n° 14. varia - Authors: Mignon (Sophie), Bazin (Yoann), Goiseau (Élise), Pérez (Roland), Walliser (Élisabeth), Zimnovitch (Henri)
- Pages: 185 to 205
- Journal: Business & Society
- CLIL theme: 3312 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie publique, économie du travail et inégalités
- EAN: 9782406165934
- ISBN: 978-2-406-16593-4
- ISSN: 2554-9626
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-16593-4.p.0185
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 04-03-2024
- Periodicity: Biannual
- Language: French
Franck Aggeri (2023), L’innovation mais pour quoi faire ? Essai sur un mythe économique, social et managérial, Seuil, 255 p.
Recension par Sophie Mignon
Les crises et bouleversements en tous genres que connaissent nos sociétés contemporaines amènent une réflexion des observateurs – parfois des acteurs concernés –sur les faits et évènements survenus. Ces pauses sont souhaitables à la fois pour permettre de faire un point de synthèse avant un nouveau cycle d’actions (menées ou subies) et pour réfléchir sur la signification même de ces actions et sur les modalités de leur analyse.
C’est à ce type d’exercice que s’est livré Franck Aggeri dans l’ouvrage sous revue. Il n’a pas choisi n’importe quel type d’actions, au contraire ; vouloir faire une pause de réflexion sur l’activité qui exprime le changement, pourra passer pour paradoxal (à la limite de l’oxymore). L’auteur devait en être conscient et a même forcé le trait en donnant à son ouvrage un titre un peu provocateur – « L’innovation, mais pour quoi faire ? ».
Le sous-titre de l’ouvrage (dont on sait qu’il révèle souvent les intentions de l’auteur) – « Essai sur un mythe économique, social et managérial » – précise le projet éditorial :
–il s’agit d’un « essai », i.e. une réflexion personnelle sur le thème en question et non pas un « traité » encyclopédique ou un « manuel » pédagogique (même si nous pensons que les étudiants dans les disciplines concernées auront tout intérêt à lire cet ouvrage)
–L’auteur parle de « mythe » pour caractériser son objet d’étude ; l’expression est forte, car elle peut être comprise tant en termes élogieux (un mythe structurant) qu’en termes péjoratifs (des propos « mythos »)
–Le champ concerné – « économique, social et managérial » est très large. Il correspond, au demeurant, au champ scientifique de l’auteur.
Au plan formel, l’ouvrage est rédigé dans un langage clair, évitant le jargon ou les propos alambiqués, parfois peu compréhensibles, auxquels se laissent aller certains chercheurs (trop) spécialisés. Les références utilisées (bibliographiques, commentaires divers…) sont copieuses et émaillent 186nombre de bas de pages ; l’auteur étant soucieux de montrer que son propos, s’il exprime ses convictions personnelles, est solidement étayé par les travaux menés tant par lui-même que par maints chercheurs et autres observateurs du domaine étudié.
La structure de l’ouvrage reflète ce souci de clarté, avec six chapitres regroupés deux à deux, formant trois parties qui peuvent être considérées comme étant consacrées respectivement au passé (constaté), au présent (questionné) et à un avenir (possible).
Le tout est précédé d’une introduction qui situe le thème étudié et présente, en résumé, l’analyse qui en sera donnée. La première ligne du propos est significative « L’innovation est la nouvelle religion moderne » (p. 7).
La première partie porte sur « la formation d’une culture de l’innovation » (p. 35) avec un chapitre 1 intitulé « De quoi l’innovation est-elle le nom ? » (p. 41). L’auteur propose une enquête historique permettant de cerner successivement « les métamorphoses des sens du mot innovation » (p. 42), « l’intensification du rythme des innovations technologiques » (p. 46), et enfin « la théorisation de l’innovation », via « le moment Schumpeter » (p. 50)
Dans le chapitre 2, l’auteur se demande « comment l’innovation est-elle devenue une culture ? » (p. 57). Il tente d’y répondre en distinguant trois temps :
–1o temps : l’invention du modèle linéaire de l’innovation technologique fondé la R & D (p. 60)
–2o temps : à la recherche de nouveaux modèles de gestion de l’innovation (p. 71)
–3o temps : les métamorphoses contemporaines de la culture de l’innovation : vertes, sociales, frugales (p. 100)
Cette première partie historique permet à l’auteur de confirmer que « l’extension de l’innovation à tous les domaines d’application…. est l’une des évolutions marquantes de ces cinquante dernières années » (p. 8) ; ce qui fait que « une culture de l’innovation a progressivement émergé après la seconde Guerre mondiale pour donner naissance à la société d’innovation contemporaine » (p. 11)
La seconde partie, intitulée « l’heure du doute » (p. 117), porte un regard critique sur cette injonction : « Innover. toujours plus, toujours plus vite » (p. 119). Cette critique se déploie en deux temps :
187Tout d’abord (chapitre 3), l’auteur se demande « comment rendre visibles les effets négatifs des innovations technologiques ? » (p. 123). Pour cela, il prend appui sur plusieurs travaux contestant les effets visibles des innovations ou leurs effets ambivalents. F.A. prend comme exemple le véhicule électrique pour tenter d’apprécier les impacts environnementaux et sanitaires des innovations (p. 124).
Ensuite (chapitre 4), il se propose de révéler « la face sombre des innovations financières et managériales » (p. 145).
(i) Pour la finance, il rejoint le constat, dressé par nombre de chercheurs et praticiens sur « l’illusion de la neutralité de la finance » (p. 147) et sur les « effets induits des innovations financières » (p. 150), avec notamment « les mirages de la finance verte » (p. 155) qui relève beaucoup du greenwashing (p. 156).
(ii)Pour les innovations managériales, F.A. s’appuie également sur de nombreux travaux pour montrer « la face sombre de certaines innovations managériales » (p. 160), tant dans le secteur privé avec ses dérives relevées par G. Friedman et Simone Weil (p. 160), que dans le secteur public avec le New public Management, lequel met « la culture de la performance au service de la rationalisation managériale » (p. 174).
Dans la troisième partie, plus prospective, l’auteur se demande « Comment innover autrement ? » (p. 179). La réponse à cette question complexe l’amène à explorer deux pistes.
La première revient à chercher « comment responsabiliser les acteurs de l’innovation ? » (chapitre 5). Partant du « principe de responsabilité » d’Hans Jonas (p. 183), l’auteur examine différents « dispositifs de responsabilisation des innovateurs » (p. 186) :
–Incitations économiques par « intégration du coût social des externalités » (p. 187).
–Transposition au domaine juridique par le « principe pollueur-payeur » (p. 191).
–Corégulation via la REP « Responsabilité élargie des producteurs » (p. 192).
–Autorégulation via la RSE « responsabilité sociale de l’entreprise » (p. 196).
–Dispositif novateur de responsabilisation, comme la « comptabilité en triple capital » du modèle CARE (p. 202).
188Sont par ailleurs évoquées de nouvelles approches visant à « réformer la gouvernance de la recherche et de l’innovation » (p. 203) via plusieurs modalités complémentaires : démocratisation de la gouvernance (p. 206), doctrine dite de « l’innovation responsable » (p. 208), réformes juridiques visant à « protéger les communs mondiaux » (p. 213) et/ou à « doter les entreprises d’une mission sociétale de long terme » (p. 216). F.A. rejoint ainsi des propositions de réforme de l’entreprise sur lesquelles le CGS a été à la pointe.
La seconde piste explorée par l’auteur est celle « la voie de la sobriété » (chapitre 6) ; Partant du constat de « la fin de la société d’abondance » (p. 219), il s’agit d’aller vers une « sobriété volontaire » (p. 225) et, pour cela, de voir « quels types innovations plus sobres pourraient émerger » (p. 228). Plusieurs pratiques et propositions sont évoquées :
–Lutter contre l’obsolescence programmée (p. 229)
–Favoriser l’écoconception (p. 232)
–Passer de la vente de produits neufs aux modèles de produits-services (p. 233)
–Réhabiliter la maintenance (p. 236)
Pour mettre en œuvre ces propositions, il parait souhaitable de créer des conditions institutionnelles favorables (p. 237), mettre en évidence le potentiel des « low tech » (p. 239), enfin, favoriser les « savoirs orientés vers l’économie des ressources » (p. 340).
L’auteur conclut son ouvrage par un petite synthèse des analyses présentées, suivie d’une recommandation pour « changer nos cadres cognitifs » (p. 251) et « pour retrouver le sens de la mesure et de la modération » (ib). Sa dernière phrase est un ultime appel : « il est temps d’agir ».
Comme on peut s’en apercevoir via cette rapide présentation, cet ouvrage va bien au-delà d’un « essai » que produirait un jeune chercheur encore peu expert d’un thème ou, à l’inverse, un professionnel expérimenté mais peu familier des codes académiques en matière de recherche. F.A. n’appartient pas à ces deux catégories ; il travaille depuis plusieurs décennies sur les thématiques liées à l’innovation. Le Centre de gestion scientifique (CGS) de l’École des Mines de Paris – PSL dont il est devenu un élément pivot a toujours été un lieu majeur dans la communauté scientifique des sciences de gestion, en relations croisées avec les autres disciplines scientifiques et avec le 189monde professionnel. Cet itinéraire personnel et cet environnement institutionnel ont permis la production de cet « essai » que nous pouvons qualifier de « magistral ».
Aussi, il nous parait souhaitable que les analyses et propositions présentées dans le présent ouvrage fassent l’objet de débats, d’une part avec les chercheurs des disciplines concernées, d’autre part avec différents types d’acteurs impliqués dans les processus étudiés (praticiens, consultants, régulateurs…). C’est en effet la finalité même d’un chercheur dans le champ des SHS que de mieux comprendre la société dans laquelle il vit et, si possible, d’utiliser cette connaissance pour tenter de l’améliorer. La rigueur du chercheur n’est pas incompatible avec les aspirations du citoyen…
*
* *
Sarah Babb (2020), Regulating Human Research : IRBs from peer review to compliance bureaucracy, Stanford University Press, 184 p.
Recension par Yoann Bazin et Élise Goiseau
Sarah Babb est professeure de sociologie au Boston College où elle conduit de nombreuses recherches sur les phénomènes de privatisation et de règlementation, souvent en lien avec les professions. Elle s’intéresse particulièrement aux différentes facettes de l’émergence et de l’institutionnalisation du néolibéralisme.
Dans cette veine, son dernier ouvrage, Regulating Human Research : IRBs from peer review to compliance bureaucracy, (Stanford University Press, non traduit) publié en 2020, se penche sur l’histoire de l’éthique de la recherche aux États-Unis et de son encadrement. Partant de l’émergence d’instances de régulation dans l’après-guerre (les fameux Institutional Review Boards, ou IRB), elle y analyse finement leurs différentes phases de structuration et les logiques de conformité qu’elles génèrent.
190Son travail historique, précis, rigoureux et assez court (environ 150 pages), se décompose en 6 chapitres. L’introduction et les quatre premiers chapitres sont consacrés à l’histoire détaillée des différentes phases de structuration des IRB identifiées par l’auteure : l’émergence, la répression fédérale, la professionnalisation, la quête d’efficacité et la privatisation. Ces chapitres se concentrent surtout sur la recherche biomédicale, qui a été le point d’attention principal des IRB dans un premier temps. Le 5e chapitre s’intéresse au cas particulier des Sciences Humaines et Sociales (SHS) et aux manières dont ses chercheurs ont réussi à s’affirmer et obtenir des aménagements auprès des instance de régulation de l’éthique de la recherche.
La fin de l’ouvrage est un peu plus conceptuelle. Le 6e chapitre tente d’offrir un cadre théorique aux logiques de conformité générées par la structuration des IRB. La littérature mobilisée en CCA (Comptabilité, Contrôle, Audit) est cependant un peu légère pour construire une articulation convaincante. La conclusion propose une analyse comparative opportune, car l’ouvrage se concentrait exclusivement sur les États-Unis jusque-là. Le cas du Royaume-Uni y est examiné en détail pour montrer que d’autres logiques de régulation et règlementation sont possibles.
Nous tenions à faire une recension critique de cet ouvrage pour deux raisons. La première est de continuer à alimenter le champ des Sciences de gestion sur le sujet de l’éthique de la recherche et de son organisation. En effet, nous constatons des velléités et des préoccupations grandissantes dans ce domaine, et parfois un manque de connaissance de ce qui se fait dans les autres pays. L’ouvrage de Sarah Babb offre une perspective historique bienvenue dans ce sens.
La seconde raison, et probablement la plus importante, est que l’analyse historique de l’ouvrage montre la progression quasi-mécanique allant d’une formalisation de l’éthique de la recherche vers la professionnalisation de son évaluation et la bureaucratisation de son processus, menant ensuite à son externalisation et, in fine, à sa marchandisation. C’est donc en suivant cette progression que nous proposons d’analyser de manière critique son livre.
Respectant la structure de l’ouvrage, nous concluons sur la manière dont les SHS ont pu se défendre face à un système imposant une vision et une épistémologie issues du domaine biomédical. En particulier, nous appelons, avec l’autrice de cet ouvrage, à explorer d’autres formes de contrôle.
1911. Formaliser l’éthique de la recherche
Après une série de scandales dans le monde scientifique, en particulier dans le champ biomédical, dans les années 1950 et 1960, le Congrès étasunien décide d’agir et vote le « National Research Act » en 1974. Cette loi insiste sur l’équilibre à trouver entre les apports potentiels d’une recherche et un certain nombre de principes et de règles déontologiques (la fameuse balance « risques/bénéfices »). Il s’agit avant tout de « protéger d’abus éthiques les sujets humains de la recherche » (p. 2). Avec le temps, cette protection s’est formalisée et bureaucratisée en « une forme routinière de décision réglementaire » (p. 3) au sein de comités spécialisés, les Institutional Review Boards.
Jusque dans les années 1990 règne ce que Babb décrit dans le premier chapitre comme étant « l’ère de la conformité approximative ». Durant cette période, les IRB sont gérés par les chercheurs eux-mêmes qui « bien que prenant leurs devoirs éthiques sérieusement, ne suivent pas forcément la réglementation à la lettre » (p. 11). Cependant, l’inflation des règlementations et règlements, accompagnée de la complexité croissante des recherches et l’arrivée d’acteurs commerciaux puissants (principalement dans le secteur biomédical) a rendu cet amateurisme problématique.
Les IRB se sont ainsi peu à peu professionnalisés.
2. Professionnaliser son évaluation
Dans le courant des années 1990, ces bureaux qualifiés « d’amateurs » se professionnalisent. Les chercheurs y prennent alors de moins en moins de place pour en laisser une plus grande aux professionnels des IRB. Parmi les raisons de ce mouvement vers un nouveau modèle, on trouve de nouveaux scandales ayant engendré des appels au contrôle et une inflation des réglementations gouvernementales.
On assiste donc à une professionnalisation de la régulation de l’éthique de la recherche.
Sarah Babb décrit dans le second chapitre comment la croissance des réglementations gouvernementales en matière d’éthique de la recherche, qu’elle nomme « répression fédérale » (federal crackdown), a servi de terreau à la création d’une nouvelle profession.
En effet, la répression a augmenté le risque pour les institutions de ne pas réussir à se conformer aux nouvelles règles établies. Ce risque est 192d’autant plus craint qu’il impliquait la perte de financements. Cependant, malgré ses exigences, l’organisme de réglementation reste alors très flou concernant ce que signifie « être conforme » générant ainsi de l’anxiété au sein des institutions qui ne savent pas comment appliquer les nouvelles règles en vigueur. Est alors apparue l’ère de « l’hyper conformité ».
Sarah Babb décrit cette ère comme une période où les institutions se protègent en allant bien au-delà de ce qui est requis par la réglementation, par exemple en demandant aux chercheurs de tout documenter, en allongeant la taille des formulaires de consentement, ou encore en imposant à des recherches non financées (en SHS notamment) un passage par l’IRB.
Cette répression fédérale a provoqué au sein des institutions académiques un besoin en experts capables d’interpréter la règlementation en vigueur. On assiste ainsi à la fin des années 1990 et au début des années 2000 à l’arrivée de « professionnels des IRB ». Ces derniers possèdent dorénavant leur propre certificat d’examen, leurs formations, leur réseau national et leur rencontre annuelle pendant laquelle ils échangent les meilleures pratiques.
3. Bureaucratiser le processus
Le troisième chapitre présente l’avènement de l’ère de la « conformité efficiente » au sein des IRB. L’ère de l’hyper conformité a eu pour conséquence de ralentir le processus d’approbation des IRB, et donc in fine, de ralentir la recherche. Ainsi, les institutions de recherche ont fait face à un dilemme : « être conforme » ou « être rapide ». On assiste alors à un glissement de « l’IRB doit permettre d’éviter les risques de non-conformité » vers « l’IRB doit être efficient ».
Cette ère débute avec la fin de la répression fédérale vers la fin des années 1990. À cette époque, l’agence étasunienne de réglementation – notamment parce qu’elle manque de moyens – devient plus conciliante avec les institutions de recherche et leur application des règles en matière de régulation de l’éthique. Le tassement de cette répression est également lié à l’apparition d’un accréditeur d’IRB, l’AAHRPP (« Association for the Accreditation of Human Research Protection Programs ») en 2001. Ce dernier a permis d’alléger quelque peu le travail de vérification effectué jusqu’à présent par l’agence de réglementation. Il a ainsi encouragé la marche vers l’efficience, amenant les institutions à engager encore plus de personnels pour gérer leurs IRB.
193Pour améliorer leur efficience, les IRB mettent en place des routines organisationnelles très précises, rationalisant de plus en plus leur activité via des formulaires, templates et check-lists, fournissant à l’occasion des indicateurs de conformité auditables. On assiste également en parallèle à l’apparition de logiciels automatisant certaines tâches.
Pendant l’ère de la conformité efficiente, les professionnels des IRB ont également de plus en plus de pouvoir au sein des institutions. Avant que le dossier d’un projet de recherche n’arrive devant le comité final, qui cette fois intègre des chercheurs, il passe par une myriade de tâches et de décisions prises par l’administration des IRB. Sarah Babb compare ce processus à une chaîne fordienne où les chercheurs n’apportent leur pierre à l’édifice qu’à la fin. Le personnel des IRB, lui, peut déterminer quels projets peuvent être exempter de comité ou encore ceux qui passeront par un processus expéditif de validation.
Bien que cette rationalisation ait permis de diminuer les coûts de conformité et d’accélérer le processus de validation, elle a aussi créé deux dilemmes. Le premier concerne celui créé par la tension entre l’autorité bureaucratique (de l’IRB) et l’autorité collégiale (des chercheurs). L’un des principaux problèmes est ici de faire accepter à des chercheurs experts le fait qu’une instance non-académique ait autorité sur leurs recherches.
Le second dilemme concerne le détournement de l’objectif initial de l’IRB : protéger les participants à la recherche. Sarah Babb montre que les membres des IRB sont conscients que l’un de leurs objectifs est dorénavant aussi de protéger l’institution pour laquelle ils travaillent, de la préserver des scandales.
Babb décrit ainsi une irrésistible évolution Wébérienne : audits de conformité, bureaucratisation croissante, inflation des documents produits, augmentation constante des coûts et donc finalement la nécessité potentielle de devoir externaliser.
4. Externaliser l’éthique
Si l’amateurisme de certains IRB des premières décennies pouvait par moment être problématique, leur transformation en une « bureaucratie de la conformité » l’est bien plus – mais pour des raisons différentes. Cela s’est intensifié ces dernières années, avec une tendance souvent inconnue en France et que Sarah Babb met au jour : l’externalisation.
194Dans le quatrième chapitre de l’ouvrage, elle explique que l’on assiste lors des deux premières décennies du 21e siècle à l’émergence d’un recours à des IRB externes, dits ‘indépendants’. En effet, depuis les années 1980, les recherches sont, de façon croissante, financées par des entreprises privées. Les recherches sont aussi de plus en plus conduites au sein d’institutions non-académiques (cliniques locales par exemple) qui n’ont pas d’IRB. Dès lors, les recherches biomédicales réalisées sur ces sites doivent faire appel à des ‘IRB indépendants’.
Ces comités sont proposés par des entreprises à but lucratif qui facturent au dossier – un peu moins de 2,000 dollars par soumission d’après une étude de 2018 – avec des ajustements en fonction de la complexité du projet de recherche, sa taille, et les éventuels suivis nécessaires. Au fil des ans, et grâce à l’évolution de la règlementation, les IRB indépendants ainsi ont gagné une part importante des « marchés » des recherches financées par les entreprises privées, mais également de celles financées par le gouvernement.
5. Créer un marché de l’évaluation éthique
En 2016, il est estimé que les IRB indépendants supervisent 70 % des essais de médicaments et de services médicaux aux États-Unis. Notons par ailleurs qu’une partie de ces IRB a été rachetée par des fonds de Capital-Risque. On assiste ainsi à l’apparition de tensions et concurrence entre les IRB académiques et les indépendants. Cependant, les financeurs privés exigent de plus en plus que les recherches qu’ils financent passent par des IRB indépendants car ils sont plus rapides.
Pour garder ces financements privés, les universités elles-mêmes sont donc obligées d’externaliser le processus d’IRB à ces indépendants pour leurs recherches financées par les entreprises. Cette compétition transforme les chercheurs, principalement dans le champ biomédical, en des clients. Sarah Babb documente d’ailleurs l’apparition d’une « logique client » dans les deux types d’IRB.
L’accréditeur AAHRPP profite lui aussi de l’augmentation du nombre de ces IRB indépendants. En effet, son accréditation offre une légitimité aux indépendants qui réussissent à l’obtenir. Notons, pour illustrer la logique d’industrialisation soutenant actuellement le secteur de la protection des participants à la recherche, que l’accréditation coute maintenant entre 10,000 à 90,000 dollars étatsuniens. Tous les IRBs ne peuvent donc pas se permettre de la payer.
195Comme souvent, l’accréditation créée pour des fins d’assurance qualité devient un outil marketing. Sarah Babb explique que les standards attendus par l’AAHRPP infusent au sein de tous les IRB du territoire, même chez ceux qui ne sont pas accrédités, et donc même chez les IRB spécialisés en SHS.
6. Revenir aux sources pour sauver les SHS
En ouverture du cinquième chapitre, Sarah Babb se demande comment les mêmes préoccupations éthiques qui l’ont précieusement guidées dans sa recherche doctorale au milieu des années 1990 ont pu devenir une telle cause de maux de tête pour les chercheurs. Les raisons ont déjà été expliquées plus haut : un système de règles ouvert aux interprétations suivi d’un contrôle accru et agressif qui génèrent « naturellement » une course à l’hyper conformité.
Les SHS se trouvent alors d’autant plus piégées que la possibilité qui leur est accordée de s’autoexempter (ou de demander une exemption) est devenue de plus en plus restreinte – voire impossible. Il faut justifier cette requête à un tel point, nombreux documents à l’appuis, qu’il devient aussi simple (mais tout de même pénible et risqué) de soumettre un dossier classique aux IRB.
Les recherches en SHS, et particulièrement les anthropologues et chercheurs utilisant des méthodes qualitatives, ont commencé à contester ces règles et principes, arguant du fait qu’ils ne s’appliquent pas à leurs approches, éloignées du domaine biomédical. Et, « avec le temps, ces sentiments donnèrent naissance à un nouveau mouvement social – un mouvement défendant le recours à une flexibilité règlementaire » (p. 83).
Cette contestation trouva un écho chez les administrateurs des institutions eux-mêmes pour qui l’hyper conformité s’avérait extrêmement coûteuse, et donc finalement peu efficace. À cela s’ajoute le fait que les nouveaux professionnels des IRB ont développé une expertise les rendant plus confiants, et donc moins sensibles à ce conformisme excessif.
À partir de la fin des années 2000, certaines recherches considérées comme peu risquées virent leur fréquence d’évaluation étendue à deux ans, au lieu d’un. En parallèle, un nombre croissant de projets peuvent à nouveau être exemptés sur simple demande. Pour autant, les institutions qui offrent ces exemptions « continuent d’évaluer les recherches 196non financées et d’appliquer l’éthique du Rapport Belmont de manière universelle » (p. 86).
En plus de continuer à défendre une attention portée aux populations étudiées et à l’évaluation des bénéfices et risques des études, une volonté de ne pas entraver les recherches s’est peu à peu mise en place. Ainsi, certaines méthodes qualitatives comme l’observation participante bénéficient maintenant d’une exemption quasi systématique. De plus, les IRB doivent dorénavant proposer un mécanisme d’appel de leurs décisions.
7. Explorer d’autres formes de contrôle
Le sixième et dernier chapitre est plus conceptuel, moins articulé, et détonne quelque peu dans un ouvrage jusque-là assez cohésif par sa précision et sa méthode historique. Présentant d’autres cas de règlementations appelant à la conformité, comme celles contre les discriminations raciales ou celles encadrant le secteur financier, Sarah Babb explore par touches la littérature en comptabilité, contrôle et audit.
Point le plus intéressant, elle identifie deux logiques de conformité. Celle décrite autour des IRB relève d’une « conformité auditable » (auditable compliance) faite de procédures bureaucratiques et d’enquêtes formelles qui génèrent un coût important par la quantité de documents produits, consultés et stockés. On lui reproche donc souvent son manque d’efficacité, le climat de soupçon qu’elle met en place, et le fait qu’elle soit tramée de stratégies et tactiques de contournement et détournement.
En miroir, et sans idéalisation, Sarah Babb rappelle qu’une autre logique existe avec la « conformité symbolique » (symbolic compliance) qu’elle illustre avec les règlementations contre les discriminations. Dans cette logique, les mécanismes de contrôle se font plutôt par les cours de justice en cas d’infraction que par audits systématiques. Point important, les juges dans ces cas cherchent à évaluer la « bonne foi » des organisations via certains indicateurs de progression, plutôt qu’une conformité des procédures.
Sarah Babb ne conclue pas son ouvrage sur un appel sans réserve à suivre une logique de conformité symbolique – qui n’est pas sans problèmes, limites et dérives. Pour autant, elle souligne que celle-ci serait bien moins susceptible d’encourager une marchandisation et une externalisation de l’éthique de la recherche sur des marchés à but lucratif. Et ce n’est pas rien.
197*
* *
Bernard Christophe (2023), Croissance verte et décroissance – Posons-nous les bonnes questions, éd. Academia, Louvain-la-Neuve, 206 p.
Recension par Roland Pérez
La répétition et l’intensité des crises affectant les écosystèmes contemporains ont amené une inflation de travaux mettant en cause nos modèles économiques actuels pour en proposer de plus vertueux ; même si, le plus souvent, ces recommandations restent peu suivies d’effets, maints acteurs pratiquant un greenwashing, inversant la fameuse injonction relative à « la ligne bleue des Vosges ».
Pour tenter d’y voir plus clair dans ce foisonnement d’analyses et de postures, il est souhaitable de faire appel à un observateur expérimenté qui ne découvre pas depuis peu la contrainte écologique et ses enjeux. Bernard Christophe (BC) donne à cet égard toutes les garanties, ayant l’un des premiers chercheurs à s’être penché avec rigueur sur ces questions, surtout dans un domaine – la gestion de l’entreprise et sa comptabilité – pour lequel les prises de conscience restent minoritaires.
Pour son nouvel essai, B.C. a adopté une posture pédagogique, qui est exprimée par le sous-titre : « Posons-nous les bonnes questions » ; c’est-dire que l’auteur sait – par expérience – combien le débat sur ces thèmes est souvent biaisé. La structure même de l’ouvrage reflète cette volonté didactique : l’auteur pose successivement un certain nombre de questions (17 au total) dont chacune fait l’objet d’un chapitre ; questions thématiques regroupées, par ailleurs, en parties (4) dont l’articulation sert de fil directeur à son argumentaire.
La première partie est elle-même présentée sous une forme interrogative : « la croissance verte est-elle suffisante ? ». B.C. qui est depuis longtemps un partisan de la décroissance y apporte une réponse globalement critique ; position qu’il argumente en plusieurs points :
–La croissance verte qui entend « concilier croissance économique et sauvegarde de l’environnement » (p. 13) reste fondée sur l’augmentation du PIB ; lequel est un indicateur dont le mode de calcul est critiquable, ignorant les externalités négatives (p. 16)
198–L’argument de la croissance comme réducteur des inégalités est réfutable (p. 21) ; un monde plus économe permettrait d’éviter les scénarios catastrophes (p. 27). Par ailleurs la dette écologique étant d’un autre nature que dette financière, « on ne peut pas substituer finance et écologie » (p. 30), ce qui appelle à des comptabilités spécifiques
–Les « piliers » de la croissance verte – l’obsolescence programmée, l’économie circulaire, l’économie de la fonctionnalité – présentent des contradictions (p. 38), appelant à tenter de « réconcilier croissance verte et décroissance » (p. 42) ; processus accompagné d’un volet social permettant de vivre une « sobriété heureuse » (p. 44).
Dans la seconde partie, l’auteur poursuit cette réflexion centrale, également sous forme interrogative : « Est-on démuni pour trouver une solution de remplacement ou d’accompagnement ? ». BC approfondit/élargit quelques aspects du débat :
–À la « décroissance subie » considérée comme une maladie de la société (p. 50), il oppose une « décroissance voulue » qu’il considère plutôt comme un remède (p. 53)
–Il prend en compte divers phénomènes d’inertie liés à d’autres logiques que l’économie : la démographie (p. 60), le réchauffement climatique (p. 62), les peurs liées aux fractures sociales (p. 63)
–Il analyse la gestion de la récente crise sanitaire (Covid 19) comme exemple d’innovation de modèle économique dont pourrait s’inspirer l’écologie (p. 68).
La troisième partie pose « quelques interrogations auxquelles il faudra apporter des réponses ». Ainsi, sont successivement abordés :
–La démocratie qui pourrait être mise en péril du fait de la nécessité d’avoir un État fort pour relever les défis écologiques (p. 81)
–La nature du système économique i.e. du système capitaliste et ses possibilités de résilience (p. 91)
–Le concept même de progrès et sa signification sociétale (p. 99)
–Les politiques monétaires et la nécessité d’en définir une adaptée aux défis écologiques, via notamment les taux d’intérêt négatifs (p. 114)
–Les effets déflationnistes vs inflationnistes des politiques écologiques (p. 121)
–Les effets sociaux d’une décroissance démographique, notamment en ce qui concerne le financement des retraites (p. 133)
199–Le pouvoir d’achat et la possibilité de définir un « pouvoir d’achat écologique » (p. 143).
Dans la quatrième et dernière partie, l’auteur propose d’« agir au cœur du système » en prenant en considération plusieurs niveaux :
–Tout d’abord, celui de l’État qui joue un rôle majeur à la fois comme « compensateur du court terme » (p. 157) et comme « gardien du long terme » (p. 161)
–Ensuite, ceux des entreprises qui doivent faire face à des remises en cause concernant l’esprit d’entreprise (p. 186), les formes de compétitivité (p. 168) et les modes d’innovation (p. 189).
–Pour accompagner ces mutations, il parait souhaitable/nécessaire de revoir les systèmes de gestion des entreprises. BC en donne quelques aspects concernant la mesure de la productivité (p. 173), l’usage disruptif du temps (p. 177) et la nature du profit (p. 181).
–Pour réussir, il sera nécessaire de développer le dialogue État-entreprises et, pour cela, de créer de nouveaux indicateurs à ces deux niveaux (p. 185)
In fine, pour B.C. « la décroissance n’est pas une malédiction, mais un possible » (p. 193).
Comme on pourra le constater, le spectre des questions abordées dans cet ouvrage est très large et l’auteur ne fuit pas les questions gênantes, même si plusieurs thématiques sont abordées de manière parfois (trop) cursive et auraient mérité un débat plus approfondi. Ainsi, concilier à la fois une décroissance écologique, la justice sociale et les libertés publiques constitue une quête du Graal qu’aucun régime politique a réussi, à ce jour, à réaliser.
B.C. est probablement très conscient de ces difficultés potentielles et a évité, tout au long de son ouvrage, d’utiliser des propos péremptoires. Son intention est affichée dès le début de l’ouvrage – « ce livre est d’abord une critique positive de la croissance verte » (p. 7). Pour l’auteur, cet intitulé mixte relève de l’oxymore ; il permet aux responsables de nos sociétés de se donner bonne conscience en donnant l’impression qu’ils prennent en compte les contraintes écologiques Pour B.C., cette croissance verte reste prisonnière de la croissance économique, posée comme « mythe fondateur de nos économies modernes » (p. 13) ; ce qui permet à chacun de considérer que « Hors la croissance, point de salut » (p. 13).
200Ce constat amène B.C. à tenter de déconstruire les raisonnements usuellement utilisés comme allant de soi ; d’où ses efforts pour se montrer didactique et l’utilisation – rappelée supra – du mode interrogatif : proposer de « se poser les bonnes questions » sous-entend que la plupart du temps on ne s’en pose pas ou avec des biais cognitifs majeurs, parfois assumés, le plus souvent implicites. Cet effort d’explicitation de raisonnement via leurs présupposés fait penser à la position qu’avait recommandée François Perroux d’expliciter les « hypothèses implicitement normatives »
Dans cette perspective, le présent ouvrage constitue une contribution significative au débat en cours ; après l’avoir lu on ne pourra plus ni parler de croissance verte comme une solution miracle, ni écarter a priori les scenarii envisageant telle ou telle forme de décroissance. On comprend pourtant que l’essentiel reste à faire : construire un scenario crédible, le faire accepter et le mettre en œuvre. Le parcours est difficile, semé d’embuches, mais la direction est claire ; B.C. nous invite à ne pas nous tromper de chemin…
*
* *
Jacques Richard (2023), Radical Ecological Economics and Accounting to save the Planet – The failure of mainstream economists, Abington & NewYork, Routledge, 135 p.
Recension par Elisabeth Walliser
Il y a plus de deux ans, la revue ENSO consacrait à Jacques Richard un « Grand Angle1 », rubrique qui se veut comme « un instant de pause et de réflexion partagée », permettant aux lecteurs de la revue, à travers les propos de la personnalité « mise à la question » de mieux comprendre son parcours, la genèse de ses travaux et leur portée sociétale. Pour Jacques Richard, cet exercice avait été bien assuré, l’intéressé 201ayant expliqué son itinéraire scientifique qui l’a amené à s’intéresser aux différents systèmes comptables – notamment des pays de l’Europe de l’Est –, et aux différentes parties prenantes, au-delà des détenteurs du capital financier ; en premier lieu les partenaires internes que sont les salariés, puis les partenaires externes, notamment l’écosystème naturel dans lequel l’entreprise déploie ses activités. La méthode CARE qu’il a initiée et qu’il a développée avec ses proches est devenue une référence majeure parmi les nouveaux dispositifs comptables proposés pour faire face aux enjeux économiques et sociaux du monde contemporain.
Ses intuitions successives s’étant concrétisées, ses travaux étant désormais reconnus comme des contributions majeures, sa succession étant assurée par des élèves devenus collègues2, on pouvait penser que Jacques Richard, passé à l’éméritat depuis plusieurs années, allait ralentir son activité scientifique, voire se tourner vers d’autres occupations. C’est le contraire qu’il nous montre, comme en témoigne une impressionnante série de publications ces dernières années. Il a notamment entrepris de publier plusieurs ouvrages en anglais (en collaboration avec Alexandre Rambaud, devenu son principal co-auteur)3. Le présent ouvrage, est également publié par Routledge, en anglais, mais sous sa seule signature. Publié en 2023, après la série mentionnée, on doit s’interroger sur le projet éditorial de l’auteur.
Le titre – Radical Ecological Economics and Accounting to save the Planet – est explicite ; l’auteur considère que « pour sauver la planète » il faut adopter une posture « radicale » permettant de renouveler le cadre conceptuel économique et comptable. Cette position très claire est dans la ligne des travaux précédents de l’auteur, notamment du manifeste, paru en juin 2020 appelant à une « Révolution comptable4 »,
202Le sous-titre – The failure of mainstream economists –est également explicite, mais cette fois au niveau du débat académique concernant les écoles de pensée et leurs positionnements respectifs. Le jugement porté par l’auteur est sans appel ; pour lui l’échec des économistes de l’école dominante, dite néo-classique, est flagrant.
La structure de l’ouvrage et son contenu argumentent cette position péremptoire et proposent une voie alternative, celle de l’ecological accounting.
La première partie – Why the tools of dominants economists are inadequate for ecology (p. 5-32) – est consacrée à une présentation critique des outils utilisés par les économistes néo-classiques ou apparentés, comme le Nobel français J. Tirole.
Dans la seconde partie – Why accountants’ tools are needed to solve ecological problems (p. 33-54) – l’auteur commence par regretter l’ignorance de la plupart des économistes en matière de comptabilité, pour, à l’opposé, mettre l’accent sur l’intérêt de bien connaître ces outils comptables afin de procéder à une remise en cause écologique du système économique.
La troisième partie – How to use accounting concepts to rebuild an ecological and humanitarian economy (p. 55-82) permet de présenter les principes fondateurs du modèle CARE-TDL5 conçu par J. Richard et développé par lui et ses collègues proches ; modèle dont l’auteur donne deux exemples d’application, l’un au niveau micro (comptes d’entreprise), l’autre au niveau macro (comptes nationaux).
La quatrième et dernière partie – Is there any hope to see use of the CARE/TLD model today ? (p. 83-122) est l’occasion, pour l’auteur, de reprendre et d’élargir le débat, d’une part en discutant des approches dites de « finance verte » ; d’autre part en signalant la prise en compte de ces thématiques au niveau international (via la Banque mondiale et le FMI).
In fine, Jacques Richard suggère une « alliance » entre les économistes hétérodoxes (tels que Nicholas Stern) et les approches de type CARE des comptables écologistes. Il recommande de saisir “ces armes comptables efficaces avant qu’il ne soit trop tard / these effective accounting weapons as quickly before it is too late” (p. 123).
Par là-même, le lecteur pourra avoir – nous semble-t-il – une réponse à la question initialement posée sur le projet éditorial de l’auteur en 203décidant de rédiger ce nouvel ouvrage. Approchant des 80 printemps, Jacques Richard souhaite très probablement faire un premier bilan de l’influence que ses travaux et ses prises de position ont pu avoir sur la société dans laquelle il vit et dans celle qui le suivra. Depuis des décennies, ses analyses et propositions sont le plus souvent en avance sur son époque. Gageons que le présent essai aura le même destin…
*
* *
Bruno Villalba (2023), Politiques de sobriété, Paris, Le Pommier, 469 p.
Recension par Henri Zimnovitch
L’auteur est professeur des universités en science politique à AgroParisTech et responsable du master 2 « Gouvernance de la transition, écologie et sociétés » à Paris-Saclay.
Dans son chapitre d’ouverture, il rappelle l’importance accordée à la sobriété tant par les philosophes grecs dans l’Antiquité que par le christianisme ensuite. Pour aujourd’hui, il nous présente la voie offerte en la matière par le cheminement intérieur de Pierre Rabhi et par la perspective humaniste de Jean-Baptiste de Foucauld. Le chapitre ii, « vertus politiques et écologiques de la modération », fait référence aux critiques, dès les années 1960, que Jacques Ellul adressait alors à la « société technicienne » et qui furent approfondies notamment dans la frugalité conviviale défendue par Ivan Illich et dans l’Éloge du suffisant proposé par André Gorz qui réfléchissait sur la crise contemporaine du capitalisme et sur la question écologique. La sobriété n’est plus seulement un cheminement intérieur mais s’inscrit dans un contexte de limite planétaire appelant des réponses collectives.
Le chapitre iii va justement « contextualiser la sobriété ». Même si les hommes n’y sont ni structurellement ni biologiquement enclins à cette dernière, comme le pense Sébastien Bohler dans LeBug humain, les limites planétaires et temporelles nécessitent de repenser nos modes 204actuels de consommation. Cette nécessité est d’autant plus impérative que Bruno Villalba juge trop optimiste la vision cornucopienne selon laquelle la science, la technique, l’innovation, l’efficacité suffiraient à résoudre les problèmes à venir. C’est l’objet de son chapitre iv dans lequel il analyse l’illusion des énergies vertes, du recyclage, de l’efficacité numérique, du nucléaire.
Le chapitre v confronte l’approche technophile, qui appréhende la sobriété comme un outil de l’efficacité, à celle défendue par l’écologie politique dont René Dumont fut le héraut qui place la sobriété comme mesure de la limite. À l’approche restrictive, visible dans les positions de Macron (seules quelques-unes des propositions émises par la Convention citoyenne pour le climat ont été reprises et la planification écologique est placée essentiellement dans une perspective de sobriété énergétique), on peut opposer celle, plus large, défendue par William Ophuls. Avec celle-ci, la délibération est alors ouverte sur les finalités de la sobriété et sur les modalités démocratiques à imaginer pour parvenir à résoudre les problèmes posés par les limites matérielles du système Terre (Ophuls plaide pour un « écoautoritarisme »). Le chapitre suivant s’oppose aux tenants de l’abondance pérenne pour penser la sobriété comme un renoncement aux illusions d’une liberté sans limites matérielles et comme une propédeutique à l’action.
Les chapitres vii et viii sont consacrés aux questions de l’égalité et des institutions dans une perspective de sobriété telle qu’elle a été présentée précédemment. Les questions liées à la carte carbone, défendue par de Foucauld, à la taxe carbone, au rationnement sont abordées.
Les deux derniers chapitres traitent des questions personnelles, liées à des choix individuels, voire intimes : « comment déborder un usage ponctuel de la sobriété […] afin de produire un changement de mode de vie ayant réellement pour effet de réduire notre empreinte écologique ? » Ce qui le conduit à évoquer le cas de la consommation de viande, celui de la pertinence de la reproduction alors que la population de la planète a connu une explosion démographique au cours des deux derniers siècles. Au-delà des hommes, Villalba pose le problème de la relation que ceux-ci doivent entretenir avec les autres êtres vivants sur la planète mais aussi avec les non-vivants.
Face à un opus riche de centaines de pages, le résumé que nous venons de faire rend bien imparfaitement compte d’un livre qui s’adosse à une 205bibliographie de plus de 150 références et dont les notes de fin courent sur plus de 60 pages.
On est face à une somme qui force le respect. Le propos est soutenu par une articulation robuste et logique dans un style clair et plaisant pour le lecteur.
On doit cependant adresser deux critiques fortes :
–Dès l’introduction, l’auteur nous prévient : « évoquer les limites planétaires de la sobriété montre que des politiques construites à partir de cette notion n’auront de pertinence qu’à l’échelle internationale » (p. 20). Ce dont nous sommes bien d’accord. Mais à la page suivante on a la surprise de lire : « cette perspective internationaliste de la sobriété ne sera pourtant pas abordée dans cet essai. » No comment.
–Villalba dénonce à plusieurs reprises les illusions scientistes et ce qu’il nomme le point de vue cornucopien (remercions-le de nous faire découvrir cet adjectif). Certes il apporte quelques arguments à son propos mais des contradicteurs pourraient lui en servir tout autant. En vérité, il est trop rapide d’écarter comme il le fait les apports des innovations à venir, de considérer même cette position comme dangereuse car susceptible de démobiliser là où il faudrait au contraire mettre les bouchées doubles. La citation de Molière tirée du Misanthrope que l’on trouve en épigraphe de l’introduction nous donne une réponse : « la parfaite raison fuit toute extrémité ». La sagesse serait sans doute de laisser une place pour les arguments raisonnés que le progrès pourrait fournir pour surmonter les périls écologiques.
Une dernière remarque peut être formulée. Dans son chapitre « égalité et sobriété », devant l’impossibilité d’élargir à l’échelle de 8 milliards d’individus l’imaginaire consumériste, l’auteur reprend les trois scénarios possibles, selon Arnsperger et Bourg, pour réduire rapidement la consommation : la sobriété choisie, la sobriété involontaire et la finitude du monde. Il en est un qui n’est pas évoqué, cynique, immoral mais possible : le maintien de la consommation débridée, pour un petit nombre, l’austérité, pour une autre partie de la population mondiale, la misère et la disparition pour tous les autres…
Ces réserves ne doivent pas faire oublier les qualités d’un ouvrage qui nous apprend beaucoup et invite à la réflexion. Nous recommandons Politiques de sobriété sans modération…
1 Entretien paru dans le no 9 d’ENSO, 2021-1, p. 25-35.
2 Notamment A. Rambaud & C. Feger (AgroParisTech), Y. Altukhova (Université de Reims Champagne-Ardenne), H. Gbego (Cercle des comptables environnementaux et sociaux – CERCES).
3 Ainsi trois ouvrages, co-signés J. Richard & A. Rambaud, ont été publiés en 2021-2022 par Routledge, dans une série intitulée « Economics and Humanities », 1) Economics, accounting and the true nature of capitalism 2) Capital in the history of accounting and economic thought 3) Humanitarian ecological economics and accounting. Ces ouvrages portent un sous-titre commun ‘ « Capitalism, Ecology and Democracy » – exprimant ainsi leur complémentarité.
4 J. Richard (en collaboration avec A. Rambaud) : Révolution comptable – Pour une entreprise écologique et sociale, Ivry, Les éditions de l’Atelier, 160 p. – Le même tandem a aussi publié, en 2021, au Canada, un autre essai : A. Rambaud & J. Richard Philosophie d’une écologie anticapitaliste, Presses universitaire de Laval (Québec)
5 CARE (Comprehensive Accounting in Respect of Ecology) / TLD (Triple Depreciation Line)