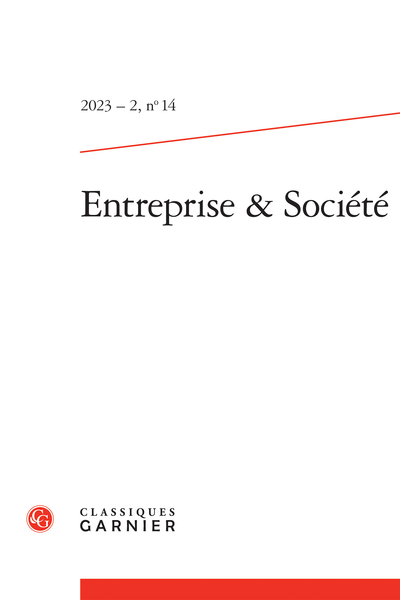
Introduction
- Publication type: Journal article
- Journal: Entreprise & Société
2023 – 2, n° 14. varia - Author: Méric (Jérôme)
- Pages: 19 to 21
- Journal: Business & Society
- CLIL theme: 3312 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie publique, économie du travail et inégalités
- EAN: 9782406165934
- ISBN: 978-2-406-16593-4
- ISSN: 2554-9626
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-16593-4.p.0019
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 04-03-2024
- Periodicity: Biannual
- Language: French
PRÉSENTATION DU NUMÉRO
Jérôme Méric
CEREGE-IAE de Poitiers
Entreprise & Société privilégie l’interdisciplinarité pour embrasser dans leur diversité et leur complexité les relations qu’entretiennent les acteurs de l’économie et le sociétal. La composition des instances de gouvernance de la revue et du comité éditorial reflète cette exigence. Le contexte actuel est à la croissance de l’activité de la revue, comme en témoigne le présent numéro : augmentation du nombre d’articles soumis, rubriques toujours plus riches, nombreuses recensions, etc. Il était donc nécessaire de renforcer l’équipe éditoriale, tout en l’ouvrant à des approches nouvelles ou originales de la recherche. C’est dans le souci de répondre à ces deux exigences que nous avons le plaisir d’accueillir deux rédacteurs en chef adjoints. Nathalie Dubost, forte de son expérience à la Revue Française de Gestion, apporte à la communauté son regard original sur l’inclusion et l’éthique du Care, des thématiques appelées à devenir majeures – si elles ne le sont déjà – dans le champ académique comme dans celui des pratiques d’entreprise. Pierre Labardin associe son expertise dans le domaine de la comptabilité à une approche historique des relations de l’entreprise et de la société. Il a dirigé, pour notre revue, le dossier thématique du numéro 13 consacré à l’histoire de la désindustrialisation. Il interroge aussi, dans des textes captivants, notre incapacité historique à mesurer l’effet de la Révolution Industrielle sur le système Terre. Que Nathalie et Pierre soient chaleureusement remerciés de nous rejoindre. Ils remplacent Rémi Jardat, que des obligations professionnelles éloignent de notre équipe. Qu’il soit lui aussi vivement remercié pour sa contribution à la revue.
20Le « Grand angle » de ce numéro accueille toujours des hautes figures qui confient tour à tour leurs parcours, la recherche qui les a animées, leurs projets. L’invité de ce numéro est un hôte de choix. Henry Mintzberg a construit – ou du moins a présenté – sa pensée à la manière d’un iconoclaste : briser les mythes (le manager-décideur économique, la planification stratégique) pour proposer une vue alternative ancrée dans une forme de common sense et se désoler qu’il ne soit pas la chose au monde la mieux partagée. N’en déplaise à Descartes. Il commente ici, assisté d’Elisabeth Walliser et de Roland Pérez, son dernier opuscule. Le constat de départ – aisément partageable – est celui de la déraison d’une « société de marché », et d’une incomplétude de la dichotomie public-privé. C’est justement ce qui n’est ni privé ni public qui constitue le commun. Et Henry Mintzberg de dessiner les contours de ce qu’il conviendrait d’appeler un « équilibre de la terreur » entre les trois piliers de la société. Sans cela, le despotisme d’état, le capitalisme effréné ou le populisme guettent.
L’ancrage de la revue dans les problématiques de société se mesure également à sa capacité à collaborer avec des acteurs d’influence. C’est le cas du Pacte Civique, fondé par Jean-Baptiste de Foucauld, qui organisait cette année au LIRSA-CNAM une journée sur la thématique de la sobriété et de sa réception par les entreprises. Pour difficile que soit l’interaction entre les chercheurs et les cadres d’entreprise ou de la haute administration, un tel sujet constituait le substrat d’un dialogue. Un dialogue qui a effectivement eu lieu et dont rend compte la restitution proposée en « éclairages » par nos collègues Clément Carn et Mohamed Diakité. Henri Zimnovitch s’est attribué le rôle de la discrète mais essentielle cheville ouvrière de la journée et du dossier thématique « entreprise et sobriété ». Il est vrai que pour les enseignants chercheurs que nous sommes, le concept de sobriété séduit, intrigue, interroge. Il séduit parce qu’il associe à l’économie (au sens d’être économe) une injonction morale. On ne peut s’empêcher de penser que la sobriété vient après l’ivresse, et qu’il est plus que jamais temps d’éviter de s’enivrer de ressources rares. Il intrigue, car scientifiquement, il n’a pas d’assise claire pour l’instant, et nous sommes à l’écoute des contributions et des débats pour faire en sorte de le cerner, et de l’associer à des pratiques précises. Il interroge, car l’engouement qu’il suscite peut tout à la fois faciliter la mise en place de ce que l’on peut appeler, à la lecture des 21dernières pages de Risk, Uncertainty and Profit de Knight, une frugalité de progrès (où l’investissement est vu comme un acte moral de préservation de l’intérêt des générations futures), et devenir le cheval de Troie moralisateur du cost-killing. En ouverture de la journée, Bénédicte Fauvarque-Cosson, administratrice générale du CNAM, livre une leçon (au sens d’une leçon d’agrégation) sur le sujet. En quelques mots elle donne à saisir la complexité de celui-ci et de ses enjeux juridiques et politiques. Sur les quatre contributions d’enseignants chercheurs à cette journée, deux ont été retenues pour nourrir le dossier thématique. Richard Baker, Bruno Cohanier et Laurent Cappelletti appliquent la méthodologie d’analyse des coûts cachés à la sobriété. Arnaud Gautier et Sandrine Berger-Douce explorent sur le terrain les relations entre la sobriété numérique et la pérennité des entreprises.
Comme en écho au numéro 11 de la revue consacré à l’« affaire Faber-Danone », le varia signé de Blanche Segrestin, Jérémy Lévêque et Kevin Levillain propose au législateur et au décideur une taxonomie des finalités des sociétés à mission et des propositions de modes de gouvernance pour chacune des finalités poursuivies.
Après le compte rendu de la journée « entreprise et sobriété », Jacques Ninet propose un « éclairage » pour rappeler la difficulté qu’il y a à imaginer une croissance des dettes souveraines sans provoquer d’inflation. Il s’agit là d’une contribution à un débat qui infuse dans la sphère politique.
L’actualité des parutions a suscité de nombreuses recensions : Franck Aggeri sur l’innovation, Sarah Babb sur l’éthique de la recherche, Bernard Christophe sur le dilemme croissance-décroissance, Jacques Richard sur la comptabilité environnementale « radicale », Bruno Villalba sur les politiques de sobriété. Que leurs auteurs en soient vivement remerciés.
Le dossier du numéro 16 de la revue aura pour thème une question, celle de savoir si la gestion est compatible avec l’émancipation des salariés. Il s’agit là d’une thématique qui s’ouvre aux sciences de gestion, mais également à d’autres disciplines, dont la sociologie et la psychologie. Nous sommes impatients de lire les contributions à venir.