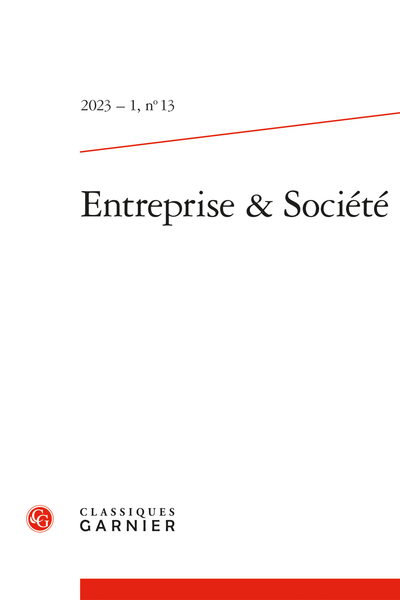
Introduction of the Issue
- Publication type: Journal article
- Journal: Entreprise & Société
2023 – 1, n° 13. varia - Authors: Méric (Jérôme), Zimnovitch (Henri)
- Pages: 19 to 23
- Journal: Business & Society
- CLIL theme: 3312 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie publique, économie du travail et inégalités
- EAN: 9782406150480
- ISBN: 978-2-406-15048-0
- ISSN: 2554-9626
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-15048-0.p.0019
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 06-14-2023
- Periodicity: Biannual
- Language: French
PRéSENTATION DU NUMéRO
Jérôme Méric
CEREGE-IAE,
Université de Poitiers
Henri Zimnovitch
LIRSA-CNAM
Après douze volumes et six années de parutions, nous célébrons dans ce numéro la reprise, sous la dénomination « Entreprise & Société », de la revue Économie & société fondée en 1944 par François Perroux. Cette revue était structurée en cahiers thématiques, dont K (« économie de l’entreprise »), KF (« entreprise et finance ») et W (« dynamique technologique et organisations ») constituent ceux qui nous ont inspirés.
Cette reprise a été accompagnée par un éditeur, les Classiques Garnier, qui inscrit la production scientifique de nos auteurs dans une perspective historique et une sensibilité résolument littéraire. Nous redisons ici notre attachement à ce format singulier pour les sciences économiques et de gestion, car il nous semble fondamental qu’une production en sciences humaines bénéficie d’un support textuel de qualité, et qu’ainsi elle échappe au réductionnisme du format court et à l’obsession démonstrative inspirés des sciences dites dures. Pour assurer cette qualité, le français est privilégié, mais la production anglophone n’est pas exclue de nos pages. Le cahier du numéro 10, consacré au centenaire de la parution de Frank H. Knight, a d’ailleurs été traduit en anglais.
La ligne éditoriale s’est enrichie au cours de ces années, mais elle n’a pas dévié. Elle privilégie toujours l’étude réflexive et originale des effets des pratiques et des innovations managériales sur les rapports humains (au travail ou hors travail) et la société. La pluridisciplinarité, la diversité et la science en conscience demeurent ses marques de 20fabrique, et les articles publiés jusqu’à présent témoignent de cette orientation éditoriale.
Pour mettre en valeur et interroger l’engagement sociétal des entreprises, Entreprise & Société ne pense pas moins le sien, au-delà des seuls contenus. Nous faisons en sorte qu’elle devienne un lieu de dialogue entre les scientifiques expérimentés et les jeunes chercheurs. Entreprise & Société est en mesure de devenir un tremplin à la reconnaissance scientifique de doctorants ou de jeunes docteurs.
La conjonction de l’exigence intellectuelle, scientifique, et de l’ouverture de notre revue lui a valu ou lui vaut d’être reconnue par les instances de référencement des supports scientifiques dans nos champs disciplinaires (CNRS, FNEGE). La rigueur du processus d’évaluation ne se départit jamais de l’humanité dans la relation avec les candidats-auteurs, via la désignation d’un correspondant référent pour chaque article ou chaque dossier, et les séminaires de prépublication.
Au cours de ces années, les numéros se sont structurés autour de thématiques centrales à la relation de l’entreprise et de la société. La récurrence de cahiers « finance et société » ou « comptabilité et société » ne doit pas occulter le caractère large et inscrit dans une vision systémique des questions abordées. La relation du monde des affaires et de la société est questionnée via la relation marchand-non marchand (no 1), les entreprises familiales (no 7), quand ce n’est pas la place de l’entreprise qui est questionnée dans un monde incertain car dépourvu des institutions qui font société (no 10). Les formes alternatives à l’entreprise capitaliste ou du moins les inflexions portées à cette dernière sont étudiées, comme les coopératives (no 2), les communs (no 6 et no 8) ou les sociétés à mission (no 5). À ce titre, notre revue ne pouvait faire l’économie de contribuer aux débats suscités autour de l’affaire Faber-Danone (no 11). Les crises occupent une place centrale, dès lors qu’elles surviennent comme la Covid dans l’ESS (no 12) ou qu’elles appellent un renouvellement des pratiques financières comme a pu la faire la crise des subprimes (no 4). À une échelle plus micro-économique, l’irruption de la RSE dans les pratiques managériales est étudiée (no 3). Il en va de même pour la transposition de pratiques et de concepts managériaux à des univers alternatifs. L’investissement dans l’ESS (no 2) et les spécificités de l’innovation sociale (no 4) sont ainsi analysés. L’étude des évolutions de la RSE (no 3) ouvre le champ à l’extension de l’investissement à l’ESS en contexte « normal » (no 2), et pendant la crise Covid (no 12).
21Les cahiers thématiques s’enrichissent de nombreuses contributions en varia, qui embrassent la plupart des objectifs de développement durable de l’ONU, de l’actionnariat salarié à l’intégration professionnelle des salariés dyslexiques.
La revue est animée du souci de participer à l’animation du débat dans la communauté scientifique, par la restitution de ce dernier lorsqu’il se matérialise par un moment saillant de la vie scientifique (rubrique « Forum »), ou par des notes réflexives ou praxéologiques (rubrique « éclairage »).
Douze numéros, ce sont aussi douze Grands Angles, douze moments singuliers de rencontre avec de grands contributeurs – directs ou non – à nos champs. La libre interaction avec ces grandes plumes aboutit à un large éventail de contributions, qui peuvent prendre le chemin du récit de vie comme celui d’une grande leçon réflexive, quand il ne s’agit pas des deux conjointement. S’il est impossible d’en résumer la grande richesse dans ces quelques lignes, Jean-Claude Thoenig invite le management à se saisir des effets du langage sur la cognition des parties prenantes quelles qu’elles soient ; André Comte-Sponville donne de la chair à la question de la morale managériale pour questionner la responsabilité du « bon dirigeant » (qu’il faut savoir distinguer du « dirigeant bon ») ; Pierre-Jean Benghozi s’appuie sur son parcours pour montrer comment la recherche peut, du moment où l’on sait la transférer, amener à prendre de hautes fonctions managériales ; Julie Battilana livre un parcours exemplaire à la frontière entre la culture éducative française et la recherche en management nord-américaine, et le récit de la réinvention d’un programme structuré autour de l’entreprise et de la société à Harvard ; Jean-Baptiste de Foucauld dessine à grands traits les priorités et les problématiques de l’action publique dans l’accompagnement de la transition écologique ; Gérard Hirigoyen déploie un plaidoyer documenté en faveur de l’entreprise familiale ; Isabelle Huault témoigne de l’évolution du projet porté par Dauphine, seule université française conçue pour répondre aux besoins d’une éducation managériale ; Alain Supiot porte un regard sévère sur le mésusage de la quantification qui conduit au « gouvernement par les nombres », substitut moderne du gouvernement par la loi ; Jacques Richard trace en contrepoint ce que pourrait être un bon usage de la quantification, par la reconnaissance comptable d’une dette de l’entreprise à l’égard de l’environnement et 22de la société ; Romain Laufer célèbre le centenaire de la parution de Risk, Uncertainty and Profit de Frank H. Knight, et voit dans ce texte la prophétie de la crise contemporaine des institutions ; Armand Hatchuel interroge la nature profonde des sciences de gestion, et affirme l’ancrage profond de l’entreprise – de par son rôle et son histoire – dans la société ; Eve Chiapello déroule un cheminement qui l’a amenée à produire une critique du capitalisme, de ses instruments (les outils de gestion) et de la financiarisation comme sa manifestation la plus récente.
Le présent numéro perpétue l’esprit qui anime notre revue. Il s’ouvre par un Grand Angle avec Pierre-Yves Gomez. À l’heure de quitter la carrière, notre collègue revient sur le paradoxe qui a animé sa recherche : pourquoi des sociétés libérales laissent-elles les entreprises déterminer nos actes, que ce soit au travail ou dans nos actes de consommation ? Il lance une invitation à poursuivre cette recherche au-delà, ou envers et contre la prégnance de ce qu’il appelle « l’académisme globaliste ». Son regard critique n’exclut pas quelque forme d’optimisme lorsqu’il observe les apparents renversements de valeurs survenus à la suite de la crise des subprimes, même s’il admet que l’éventuelle « sociétalisation » de l’entreprise demeure dans les mains des décideurs politiques.
S’il est un domaine dans lequel les entreprises déterminent les actes – et la vie – des citoyens, c’est bien celui du choix d’investir ou d’abandonner des territoires ou des activités. La discipline historique, conjointement à la sociologie et à l’économie s’est emparée de cette problématique sociétale dès la fin des années 1970. Les sciences de gestion y sont parvenues plus tardivement, en abordant la question sous l’angle de la financiarisation des choix managériaux. Régis Boulat, Thomas Grandjean et Pierre Labardin livrent, en tête du dossier thématique consacré à « l’histoire de la désindustrialisation de 1970 à nos jours », une invite pour les sciences de gestion à dépasser une vision centrée sur la décision managériale et à ouvrir leur regard aux profonds changements géopolitiques, politiques et sociaux qui bouleversent la relation des élites à l’industrie pendant cette période. À leur suite, Nicolas Berland retrace l’histoire des restructurations chez Saint Gobain entre 1970 et 2000, et le « savoir-faire » acquis par le groupe pour en limiter l’impact social. En contrepoint, Stanislas Kihm met en évidence comment la même entreprise a déplacé ses moyens productifs du local au global en concertation avec l’État. Quentin Belot-Coulomies montre comment la 23désindustrialisation dans le secteur automobile français relève de choix stratégique clairs et s’accompagne d’une instrumentation de gestion financiarisée. Elen Riot interroge la réindustrialisation fondée sur les start-ups à partir d’une variable centrale : l’absence des ouvriers dans ce schéma.
En varia, Cécile Cézanne, Yves Kassi et Sandra Rigot explorent les similarités et les différences de pratiques des sociétés cotées au SBF 120, à l’HDAX et au FTSE 100 quant à la gouvernance des risques climatiques. Il n’échappe pas à leur analyse les défaillances que ces pratiques suscitent. Estèle Jouison et Florence Krémer livrent une analyse du documentaire Demain réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent, et démontrent la capacité d’une production cinématographique à susciter l’intention d’entreprendre.
En éclairage, Michel Capron poursuit sa rétrospective (entamée dans le numéro 12) sur les expertises auprès instances représentatives du personnel.
Roland Pérez et Jérôme Méric proposent respectivement les recensions du Que sais-je ? Le Capitalisme par Pierre-Yves Gomez, et Réfléchir – de l’importance de la tâche réflexive en sciences de gestion,par Yvon Pesqueux.
Pour son numéro 15, la revue Entreprise & Société s’associe à nouveau au congrès du RIODD pour un cahier dont les contributions devront répondre à la nécessité d’une « véritable transformation de la finance au service de la soutenabilité des sociétés humaines et de leurs écosystèmes ».