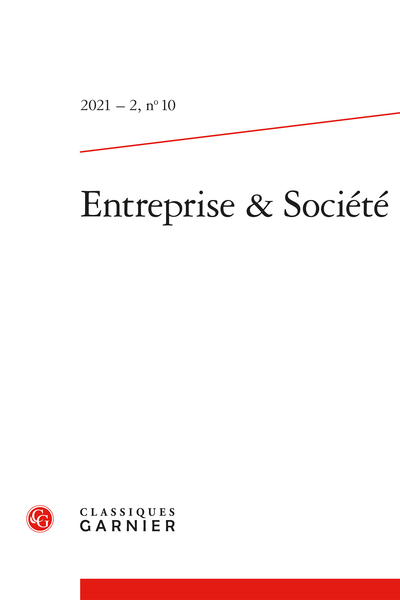
“Wide Angle ‘Frank H. Knight 1921–2021’” Risk, Uncertainty and Profit : un anniversaire qui est à la fois une évidence et une énigme
- Publication type: Journal article
- Journal: Entreprise & Société
2021 – 2, n° 10. varia - Authors: Laufer (Romain), Méric (Jérôme)
- Pages: 21 to 87
- Journal: Business & Society
- CLIL theme: 3312 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie publique, économie du travail et inégalités
- EAN: 9782406126980
- ISBN: 978-2-406-12698-0
- ISSN: 2554-9626
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-12698-0.p.0021
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 01-19-2022
- Periodicity: Biannual
- Language: French
« Grand Angle
“FRANK H. KNIGHT 1921-2021” »
Risk, Uncertainty and Profit :
un anniversaire qui est à la fois une évidence et une énigme
Romain Laufer
HEC-Paris
Jérôme Méric
CEREGE-IAE de Poitiers
Remarque préalable : nous faisons le choix de citer Risk, Uncertainty and Profit dans sa version libre de droits, éditée par the Online Liberty Fund, disponible en ligne1. Lorsque les numéros de page sont livrés sans mention complémentaire, c’est bien à cette version qu’il faut se référer. Les traductions, qu’elles soient de Knight ou d’autres, sont toutes effectuées par les auteurs sur la base des propositions de Deepl Translator ©.
Il y a au moins deux raisons de célébrer Frank Knight en cette année : le centenaire de son grand œuvre Risk, Uncertainty and Profit (que nous désignerons désormais par les trois lettres RUP) et le sentiment général que l’incertitude est désormais au centre des préoccupations des sociétés. Il y a au moins une bonne raison de le célébrer dans Entreprise & Société (ENSO) du fait que l’ouvrage de Knight propose une des premières théories économiques de l’entreprise et que cette théorie y est directement associée à une théorie du fonctionnement des sociétés.
22L’actualité de l’œuvre de Frank Knight, illustrée par le fait qu’un numéro spécial du Journal of Institutional Economics lui est consacré cette même année, ne saurait faire oublier l’oubli paradoxal dont son œuvre a été l’objet parmi les économistes. S’il fallait une preuve de la profondeur de cet oubli il suffirait de citer ce qu’écrivait Edmund Phelps prix « Nobel2 » d’économie le 15 Avril 2009 en première page du Financial Times dans un article intitulé « L’incertitude hante le meilleur système » (Uncertainty bedevils the Best System)
Mais pourquoi les grands actionnaires n’ont-ils pas agi pour mettre fin au surendettement avant qu’il n’atteigne des niveaux dangereux ? Pourquoi les législateurs n’ont-ils pas exigé une intervention réglementaire ? La réponse, je crois, est qu’ils n’avaient pas conscience de l’existence de l’incertitude knightienne. Ils n’avaient donc aucune idée de la possibilité d’une énorme rupture des prix de l’immobilier et aucune idée de l’inapplicabilité fondamentale des modèles de gestion des risques utilisés dans les banques. Le « risque » en est venu à signifier la volatilité sur un passé récent. La volatilité du prix lorsqu’il oscille autour d’une trajectoire donnée a été prise en compte, mais pas l’incertitude de la trajectoire elle-même : le risque qu’elle se déplace vers le bas. Les directeurs généraux des banques, eux aussi, ne comprenaient pas bien l’incertitude. Certains eurent l’instinct d’acheter des assurances, mais ne virent pas l’incertitude de la solvabilité de l’assureur.
Ceci nous confronte à une énigme : comment est-il possible qu’un des deux fondateurs de l’école d’économie de Chicago (l’autre étant Jacob Viner), dont l’ouvrage est constamment republié par les Presses de l’Université de Chicago en 1971, qui plus est avec une introduction de George Stigler (qui recevra lui-même le prix « Nobel » d’économie en 1982), que celui à propos duquel il est possible de lire de vibrants hommages d’anciens étudiants aussi célèbres que Milton Friedman, George Stigler, James Buchanan et Don Patinkin, ait pu être ignoré des économistes ?
Deux indices peuvent nous mettre sur la piste d’une interprétation.
23Tout d’abord Edmund Phelps lui-même pouvait-il faire partie des économistes qui ignoraient la portée de la notion d’incertitude ? Cela semble peu probable étant donné son domaine de recherche qui le conduit à citer la notion d’incertitudes dans 17 des articles qu’il a publiés entre 1962 et 2008, articles dont deux seulement comportent les mots « Knight » ou « Knightian ». Il y a certes quelque chose d’inconvenant, mais pas nécessairement de déplacé, dans le fait de remarquer que ces deux articles sont tous deux datés de 2007 et 2008 c’est-à-dire d’après l’obtention du prix « Nobel » en 2006, l’article de 2007 n’étant autre d’ailleurs que la reprise du discours délivré à Stockholm à cette occasion. Faut-il en déduire qu’il y aurait eu quelque imprudence à y faire référence plus tôt ?
Le deuxième indice pourrait se trouver dans le titre du journal britannique qui a ressenti la nécessité de célébrer le centenaire de RUP : il s’agit du Journal of Institutional Economics. Il existe en effet, depuis le tournant du 21e siècle, une assez abondante littérature autour de la question de savoir si Frank Knight peut être considéré comme un économiste institutionnaliste. La question n’étant pas tranchée il se pourrait que l’oubli de Frank Knight soit dû au fait qu’il soit trop institutionnaliste pour les économistes « mainstream » et pas assez pour les autres.
On ne saurait négliger la part qui revient à Frank Knight lui-même dans les obstacles rencontrés par la réception d’une œuvre qui ne craint d’allier engagement et scepticisme, goût pour la théorie pure et pragmatisme, conflits d’attitudes qui confrontent le lecteur soucieux de comprendre son œuvre à une pensée constamment paradoxale.
Donnons-en un exemple.
Les premiers mots de The Economic Organisation, commencent par une captatio benevolenciae peu commune :
Il est quelque peu inhabituel de commencer l’étude d’un sujet par une mise en garde contre le fait de lui accorder une importance excessive ; mais dans le cas de l’économie, une telle injonction est tout autant nécessaire que le fait d’expliquer et d’insister sur l’importance réelle qu’elle revêt. Il est caractéristique de l’époque dans laquelle nous vivons de trop penser en termes d’économie, de trop voir les choses sous leur aspect principalement économique, et cela est particulièrement vrai du peuple américain. Il n’y a pas de prérequis plus important à une pensée claire en ce qui concerne 24l’économie elle-même que la reconnaissance de sa place limitée parmi les intérêts humains en général.
Or ce scepticisme quant à la portée de la théorie économique semble devoir entrer en collision avec la façon dont Frank Knight, dans Risk Uncertainty and Profit, semble déduire directement d’une proposition purement théorique relative au principe de la concurrence parfaite une vision du futur des sociétés. C’est ainsi qu’il écrit, dans la page qui précède la partie de son ouvrage consacré à la concurrence imparfaite et à l’incertitude qui la caractérise :
Après tout, il semble bien y avoir une certaine auto-contradiction hégélienne dans l’idée de concurrence théoriquement parfaite. Quant à savoir quelle en serait la fin, il est vain de spéculer, mais il faudrait que ce soit quelqu’arbitraire système de distribution sous quelque forme de contrôle social, sans doute fondé sur l’éthique, le pouvoir politique ou la force brute, suivant les circonstances – à condition que la société ou quelqu’un en son sein ait suffisamment d’intelligence et de pouvoir pour empêcher un retour au bellum omnium contra omnes. L’industrie concurrentielle est, ou a été jusqu’à présent, sauvée par le fait que l’individu humain s’est avéré normalement incapable d’exercer à son propre avantage une puissance industrielle nettement supérieure à celle que la société dans son ensemble, aidée par des restrictions légales et morales, peut lui permettre de posséder en toute sécurité. À la lumière de l’évolution actuelle des affaires, on peut se demander combien de temps cette bienfaisante limitation pourra jouer son rôle salvateur. Ce sujet ne nous intéresse pas particulièrement ici, mais il a semblé utile de souligner, dans le cadre de la discussion d’un système idéal de concurrence parfaite, qu’un tel système est intrinsèquement voué à l’échec et ne peut exister dans le monde réel. La concurrence parfaite implique des conditions, notamment en ce qui concerne la présence de limites humaines, qui en même temps faciliteraient le monopole, rendraient impossible l’organisation par le libre contrat et imposeraient à la société un système autoritaire. (p. 98)
De cette collision entre scepticisme et projet théoricien, résulte une œuvre complexe que chaque lecteur tend à démembrer en fonction de ses intérêts.
251. Complexité de Risk, Uncertainty and PROFIT
C’est ainsi que George Stigler dans la préface qu’il donne à RUP en 1971 n’hésite pas à écrire :
Ce livre est en réalité deux livres et si j’avais été le professeur de Frank Knight, Allyn Young, j’aurais plaidé – sans doute faiblement et sans succès – pour que le premier livre (deuxième partie de ce volume) soit imprimé séparément de la thèse. Il s’agit d’une réaffirmation condensée de la théorie de la valeur, qui est la partie centrale de la théorie économique… Le deuxième livre (ici la troisième partie) est une analyse de l’effet de l’incertitude sur la structure et le fonctionnement d’une économie d’entreprise… Il explique comme aucun autre ouvrage l’importance cruciale de l’incertitude et de son inévitable conséquence, l’ignorance, dans la transformation d’un système économique d’une ruche en un processus social conscient avec des erreurs, conflits, innovations et changements d’une durée et d’une variété infinies. L’économie moderne commence à peine à récolter le plein rendement de cette vision3.
Ainsi l’ouvrage se trouve découpé en deux parties : la première pouvant servir à présenter les fondements théoriques de l’École de Chicago tandis que la seconde est tenue à l’écart4.
Mais la possibilité de décomposer la lecture de RUP ne s’arrête pas là. C’est ainsi que Ross B. Emmett dans l’article qu’il publie cette année dans le Journal of Institutional Economics consacre son article aux deux derniers chapitres de RUP dont il nous apprend qu’il s’agit de deux ajouts à la thèse de Knight qui correspondent à « l’étude de l’institutionnalisme, de l’organisation sociale et de l’éthique qui constitueront la plus grande part de ses travaux ultérieurs5. ». Ces chapitres, nous dit-il, sont consacrés 26« aux conséquences les plus générales de l’incertitude qui résulte des défaillances des marchés sur l’organisation économique et sociale ».
De cette complexité résulte la multiplicité des lectures possibles de son œuvre dont les articles rassemblés dans ce numéro, y compris celui-ci, sont autant d’illustrations. Il y a au moins trois manières positives de considérer une situation quelque peu déconcertante, voire décourageante pour tous ceux qui de manière tout à fait légitime cherchent dans les sciences sociales un peu de certitude, fut-ce à propos de la notion d’incertitude. La première consiste à admirer une œuvre capable d’inspirer des interprétations fructueuses dans autant de directions différentes. La seconde consiste à reconnaître en Frank Knight un véritable maître à penser, un maître qui, de manière quasi socratique, enseigne moins des résultats qu’il ne met à l’épreuve les certitudes de ses lecteurs les préparant ainsi à une meilleure appréhension des notions dont ils ont appris à se servir sans les critiquer telles qu’entreprise, libéralisme, concurrence parfaite, utilitarisme, marginalisme, scientisme, pragmatisme et last but not least, incertitude. La troisième lecture consiste, ayant fait ce parcours, à tenter de donner sa propre interprétation de ce qui peut réunir ces diverses lectures.
Avant de tenter de rendre compte de ces trois composantes de RUP, il est nécessaire au préalable de préciser deux points particuliers qui ont fait obstacle à sa réception à savoir ce qu’il en est des relations de Frank Knight avec les doctrines de l’École de Chicago d’une part, avec l’institutionnalisme d’autre part.
2. Knight et l’école de Chicago :
dans la fabrique d’une idéologie
La citation donnée ci-dessus de la préface de George Stigler à RUP devrait suffire à montrer l’ambivalence de l’école de Chicago à l’égard de l’écrit dont nous célébrons le centenaire. Cette ambivalence correspond du reste à celle de Frank Knight qui au moment de franchir le seuil 27qui sépare la deuxième partie de son ouvrage (« perfect competition ») de la troisième partie (« imperfect compétition through risk and uncertainty ») croit nécessaire de livrer à ses lecteurs la sombre prédiction que l’on peut lire ci-dessus, à la façon dont, dans l’Orestie, Cassandre au moment d’entrer dans ce qui était la demeure d’Agamemnon et qui est désormais est celle de Clytemnestre et d’Égisthe, raconte devant le Chœur incrédule, le drame qui se prépare car son destin était de voir le futur et de ne pas être crue6 .
Précisons les principaux termes de cette ambivalence.
Du côté de ce qui appartient à la représentation commune de l’école de Chicago on trouve d’abord et avant tout la place centrale qu’occupe la théorie des prix dans la science économique, c’est à ce titre que le rôle de Frank Knight dans la formation des membres de cette école a été déterminant7. Ross Emmett rapporte que Milton et Rose Friedman aimaient dire à ce propos : « Un tiers des étudiants ne retiraient rien de son enseignement et le tiers qui reste n’en tiraient sans doute qu’un tiers, mais cela valait bien le coût de l’inscription ». Oserait-on prendre ce propos au pied de la lettre et dire que le tiers que ces derniers retiraient de ses cours était précisément la théorie des prix préférant, suivant en cela l’avis de George Stigler, laisser le reste dans l’oubli ?
Il y a en second lieu son hostilité à Keynes et au keynésianisme dont la virulence a de quoi surprendre voire choquer. La tentation est grande alors de rejeter sans plus d’examen un auteur capable d’une telle intolérance. Toutefois, l’exemple de George Shackle montre qu’il est possible à un économiste qui a consacré sa thèse à la Théorie générale de l’emploi et de l’intérêt et de la monnaie en 1937 de surmonter la perplexité que cette attitude ne peut manquer de susciter :
Celui qui insiste tant sur le rôle de l’accident, de l’erreur et de la tournure imprévisible des choses, et qui a déjà écrit Risk, Uncertainty and Profit, peut-il raisonnablement considérer Keynes comme son ennemi intellectuel ? Ce livre 28d’essais donnera au lecteur résolu et patient un aperçu de l’esprit de l’un des plus grands philosophes sociaux de notre époque8.
On accordera sans doute plus facilement à Frank Knight la qualité de philosophe9 et de penseur social quand on saura que c’est à lui que l’on doit la première traduction en anglais d’une œuvre de Max Weber (General Economic History en 1927), un auteur dont il disait qu’il était « l’un des rares hommes pour lesquels j’ai encore du respect après […] avoir lu [ses œuvres]10 ». Une admiration liée à la notion d’idéal type et à la place accordée à l’histoire sociale. Une admiration dont la formulation est une bonne illustration du caractère quelque peu abrupt que pouvaient prendre ses jugements intellectuels.
Il n’est pas inutile pour mieux comprendre sa relation à ce qu’il est convenu d’appeler l’école de Chicago d’évoquer deux conflits, rapportés par Ross Emmett, à l’occasion desquels il a manifesté une opposition frontale avec la position dominante de ses collègues sur des points essentiels de doctrine. Le premier est relatif à la façon de concevoir les sciences sociales et leurs fondements, le second est relatif à la conception du libéralisme.
Le premier conflit s’est manifesté par la démission de Knight en 1944 du « Committee on social thought11 ». Ce comité avait été constitué en 1941 à l’initiative du Président de l’Université de Chicago, Robert Hutchins, pour réfléchir à la place des sciences sociales en Amérique. Il réunissait, autour du président un philosophe, John Nef, un anthropologue, Robert Redfield et un économiste, Frank Knight. L’objet du conflit opposait Hutchins et Nef d’un côté à Redfield et Knight de l’autre. Son enjeu n’était rien moins que l’interprétation des fondements culturels des crises qui affectaient les sociétés modernes. Concrètement il s’agissait de définir les programmes d’études des étudiants de premier cycle. Pour Knight et Redfield les problèmes des sociétés contemporaines exigeaient une approche moderne fondée sur « une étude comparative des différences politiques, légales, culturelles des sociétés, informée par les principes économiques de base et la connaissance des sciences sociales ». À cette 29approche moderniste s’opposait une approche traditionnaliste qui voulait accorder une place importante à la lecture « de textes classiques consacrés aux questions de morale, de justice et de politique dans la tradition de la Grèce ancienne et du thomisme. ». La domination de ce dernier point de vue s’est exprimée en particulier par l’invitation de Jacques Maritain comme professeur visitant, professeur dont l’influence sur les conceptions philosophique de Nef furent telles qu’elles le conduisirent à rejoindre le Catholicisme Romain. Il est possible de résumer le fond de cette opposition en deux points tous deux liés à l’attachement de Frank Knight à la démocratie et à son fondement l’autonomie de la volonté : son rejet du catholicisme est lié au rejet de tout système fondé sur la hiérarchie, de la même façon à la conception thomiste d’un « droit naturel » dont l’universalité et la continuité qui résulte d’une conception fondée sur l’accord entre la volonté divine et la conception aristotélicienne de la nature, s’oppose la notion moderne d’une loi constitutionnelle produite par la volonté du peuple (la constitution américaine commence par « We the people ») formalisation d’un contrat social qui n’est pas sans évoquer la notion de « covenant » des communauté puritaines de la Nouvelle Angleterre. On appréciera mieux la portée de ces questions quand on les retrouve au cœur d’une nouvelle phase du conflit qui cette fois oppose Frank Knight (de retour dans le comité) à Friedrich Hayek dont la venue à l’Université de Chicago était financée non pas par le département d’économie, qui considérait avoir déjà un philosophe social avec Knight, mais par le Volker Fund, fondation qui se consacrait, entre autre, à la promotion des idées « libertaires » et « conservatrices. ». Or si Hayek et Knight partageaient la même attitude favorable au marché et hostile au New Deal, leurs conceptions des fondements des institutions des sociétés libérales s’opposaient, et si tous deux voyaient dans les institutions le produit des actions humaines, pour Knight il s’agissait d’actions conscientes visant la construction d’un système normatif rationnel, pour Hayek il s’agissait d’actions disséminées supposées s’adapter de manière continue aux exigences de la vie sociales en se conformant à une logique qui leur restait extérieure (qu’il s’agisse de volonté divine ou de loi de la nature). Quant à la dimension théologique de cette opposition elle s’est exprimée de façon particulièrement vive lors du choix du nom de la Société du Mont Pélerin, réunion en 1947 de penseurs libéraux à l’initiative d’Hayek. À la proposition de celui-ci de 30lui donner le nom de Société Acton-Tocqueville (deux penseurs catholiques), Knight opposa un veto absolu justifié par le fait que, pour lui, le catholicisme (et sa structure fondée sur la soumission à une autorité hiérarchique) et le libéralisme étaient incompatibles, d’où le choix de ce qui était, par définition, un lieu commun, le nom de la localité où se tenait la réunion (ces considérations prennent tout leur sens quand on les considère comme appartenant à l’infrastructure symbolique des institutions économiques).
Ce conflit qui mettait aux prises Knight, penseur moderniste, tenant d’une histoire institutionnelle marquée par la rupture (qu’elle se soit exprimée dans la réforme religieuse ou dans les Lumières et les révolutions politiques française et américaine), aux traditionnalistes tenant de la continuité culturelle entre les anciens et les modernes, devait tourner à l’avantage de ces derniers. C’est ce qu’indique la façon dont l’Université de Chicago voulut faire le meilleur accueil au philosophe thomiste Jacques Maritain et à l’éminent membre de l’école Autrichienne d’économie Friedrich Hayek, en même temps que la marginalisation relative de Knight12.
Le second conflit avait comme enjeu la conception du libéralisme et plus précisément la façon dont peuvent s’articuler, pour reprendre les termes de Benjamin Constant, la liberté des modernes (le libéralisme économique) et la liberté des anciens (la liberté politique). Il s’agissait en particulier pour les économistes de Chicago de répondre au défi du keynésianisme qui proposait de résoudre les crises du capitalisme par le recours à l’intervention de l’État. Cette crise que Frank Knight avait anticipée dès RUP, ne pouvait être évitée selon lui sans une intervention 31extérieure aux mécanismes du marché, sans que des contraintes « légales et morales » ne soient imposées par la société c’est-à-dire par un processus politique. Mais la délégation d’un tel pouvoir à un État par le système du vote ne saurait satisfaire la conception radicale du libéralisme qui est celle de Knight. Pour lui la solution démocratique suppose que les lois soient produites par la délibération directe de tous les citoyens13. Fidèle à son scepticisme philosophique, il ne croit pas plus à la possibilité d’un tel processus démocratique qu’à la possibilité pour les mécanismes du marché d’échapper à leur funeste destin. On comprend que cela ne fasse pas les affaires idéologiques de ses collègues de Chicago qui choisirent de trouver leur salut dans un recours toujours plus radical aux mécanismes de marché. De ce point de vue il est intéressant de suivre la façon dont l’expression « marché des idées » (market for ideas) a changé de sens depuis l’après-guerre : d’abord utilisée pour désigner le processus de discussion politique requis pour réguler le marché, elle s’est transformée, à travers le développement du mouvement « Law and Economics », sous la direction d’Aaron Director, devenant le nom donné à la façon dont ces enjeux de régulations pourraient être pris en charge intégralement par les mécanisme de marché eux-mêmes. On ne saurait minimiser ici l’apport des articles théoriques de Ronald Coase : qu’il s’agisse du « problem of social cost » qui établissait une équivalence (équivalence quelque peu miraculeuse dans la mesure où elle supposait l’absence de coûts de transaction) entre régulation et marché concurrentiel14 ou de « Market for goods, market for ideas » dont la conséquence logique fut la loi Citizen de 2010 qui visait à donner la pleine citoyenneté aux grandes entreprises15. Paradoxalement, ce long détour nous conduit au cœur des enjeux de la théorie économique de l’entreprise. La question centrale est de savoir s’il est une limite à la taille des entreprises et à leur pouvoir. Pour Knight nous savons que sa réponse est qu’une telle limite n’existe 32pas. L’enjeu est si important que l’Académie Nobel crut bon en 1991 c’est-à-dire plus d’un demi-siècle après la publication de « the nature of the firm » de remercier Ronald Coase pour avoir « démontré » que si l’on suppose que la productivité marginale du facteur management décroit au-delà d’une certaine taille de l’entreprise, celle-ci ne saurait croitre indéfiniment. On peut noter que si dans son article historique deux pages étaient consacrées aux arguments de Frank Knight, le seul, selon lui alors, à avoir écrit de manière pertinente sur ce thème, son nom est « oublié » dans sa Nobel Lecture, qui préfère se référer au point de vue de Friedrich Hayek. C’est que l’enjeu principal du point de vue de « Law and economics » était de justifier les monopoles contre toutes les tentatives et tentations de législation anti-trust. Hayek considérait qu’il était rationnel que l’entreprise la plus efficace dans un domaine donné puisse être en position de monopole, préférant ignorer la possibilité qu’une telle entreprise use de son pouvoir de manière excessive. Une fois de plus la position de Frank Knight était marginalisée, voire reléguée dans l’oubli16.
Ainsi dans ces deux conflits vécus par Knight au sein l’école de Chicago Hayek se trouvait en position d’adversaire : la première fois, s’agissant du processus démocratique de production des lois en défenseur des traditionnalistes, la seconde fois, s’agissant de la place à accorder aux mécanismes de marché, en soutien des partisans de la « liberté des modernes ». Le caractère paradoxal de cette alliance se manifeste de deux façons : il y a d’abord ce que nous dit Ross Emmett du fait que les économistes de l’école de Chicago ne voyaient pas l’utilité d’ajouter un autre philosophe à côté de Frank Knight, maître respecté à qui ils devaient la reconnaissance de la centralité de la théorie des prix, et ensuite le fait qu’Hayek est hostile à une économie mathématisée qui est celle de l’École de Chicago. Ceci semble indiquer que derrière les arguments théoriques qui servent à légitimer les acteurs économiques, il est utile de postuler un autre niveau, plus fondamental, d’argumentation, dont le président Hutchins et le professeur Nef ressentaient la nécessité en invoquant les mânes de Saint Thomas.
Le caractère étrange de ces considérations se comprend mieux si on les considère non plus du point de vue de la confrontation directe entre Knight et l’école de Chicago, mais du point de vue d’une autre question 33qui est au centre du retour de Knight dans la littérature économique : Knight était-il institutionnaliste ?
3. L’énigme du retour de knight
dans la littérature économique :
Frank Knight était-il institutionnaliste ?
Si le titre de l’article de Geoffrey Hodgson qui semble marquer le retour, en 2001, de Frank Knight dans la littérature économique, « Frank Knight as an institutional economist », a pu paraître provocateur17 c’est que le nom de Knight n’apparaît dans aucun des ouvrages de synthèse consacrés à l’institutionnalisme : ni dans celui de Malcolm Rutherford (1994) consacré à l’institutionnalisme économique18, ni dans celui de Richard Scott (2014) consacré à l’analyse institutionnelle des organisations19, ni dans le Sage Handbook of Organizational Institutionalism (2013) et, à vrai dire, à peine plus dans les écrits de Geoffrey Hodgson lui-même ainsi que le montre son absence de la liste de références d’un article de 1998 intitulé « the approach of institutional economics » (le nom de Knight n’y figure en effet que dans une parenthèse à l’intérieur d’une note de bas de page associé au nom de Keynes à propos de la notion d’incertitude)20 .
Pour soutenir que « Knight n’était pas seulement un institutionnaliste, mais aussi un des plus grands institutionnalistes après Veblen21 » , Geoffrey Hodgson prend comme critère son adhésion à « une proposition qui constitue le fil qui court tout au long de la tradition institutionnaliste » à savoir que « la notion d’agent individuel maximisateur d’utilité est considéré comme inadéquate ou erronée. L’institutionnalisme ne considère pas l’individu comme donné. Les individus sont affectés par leur situation institutionnelle et culturelle. Par conséquent les individus ne se contentent pas de créer (intentionnellement ou non) des institutions. À travers “une causalité descendante reconstitutive les institutions 34affectent les individus de manière fondamentale” » (Hodgson, 1998, p. 318). La proposition de Geoffrey Hodgson serait moins provocante si Frank Knight n’avait dépensé autant d’énergie et de textes à critiquer les institutionnalistes. Théorie de l’instinct, behaviorisme, scientisme, utilitarisme, théorie des besoins, rôle de la technologie, pragmatisme (dans la mesure où il implique instrumentalisme où quelque croyance dans l’existence d’un progrès lié au développement de la connaissance scientifique)22, il semble qu’il n’y ait aucune dimension de l’approche des institutionnalistes qui ne fasse l’objet d’un vif rejet de la part de Frank Knight.
Il faut croire que ce retour du nom de Knight dans la littérature consacrée à l’institutionnalisme en économie s’impose désormais puisque Malcolm Rutherford, qui l’ignorait encore dans son ouvrage de synthèse à la toute fin du 20e siècle a cru bon de lui redonner sa place en lui consacrant près de la moitié d’un article consacré aux liens entre l’école de Chicago et l’institutionnalisme, un article où il dit vouloir « révéler une relation bien plus complexe entre l’économie de Chicago et l’institutionnalisme23 » .
Il n’est pas jusqu’à Ross Emmett lui-même qui n’ait cru bon de reprendre la question de « la relation ambiguë de Frank Knight à l’institutionnalisme américain et à la branche de l’économie politique classique qu’il a contribué à établir à l’Université de Chicago24 » . Si bien que Frank Knight nous confronte à une nouvelle énigme, inversée toutefois par rapport à la précédente : là où l’on se demandait pourquoi les auteurs « orthodoxes » de Chicago préférèrent reléguer dans l’oubli celui-là même qui leur avait enseigné l’importance centrale de la théorie des prix en économie, on est amené à se demander pourquoi désormais c’est l’institutionnalisme qui tient à sortir de l’oubli, même tardivement, un auteur qui ne manque pas une occasion de critiquer leurs positions avec un certain acharnement. La réponse de Frank Knight lui-même à cette question, si elle en reconnait la pertinence, n’est pas faite pour nous sortir de notre perplexité :
Quand je parle à un économiste orthodoxe qui expose tous ces principes économiques comme évangile, je suis un institutionnaliste déchaîné, et quand je 35parle à un institutionnaliste qui prétend que ces principes n’ont aucun sens, je défends le système, l’« orthodoxie » qui est traitée avec tant de mépris par les disciples de Veblen et d’autres qui portent l’étiquette institutionnaliste (Knight, 1960, p. 11).
Il est pourtant une occasion au moins où Frank Knight a accepté de dire de lui-même : « je suis en fait aussi “institutionnaliste” que quiconque dans un sens positif. ». Cette circonstance exceptionnelle s’est présentée lors du soixante-huitième congrès annuel de l’American Economic Association en 1957, lors d’une table ronde consacrée à la discussion d’une présentation de Kenneth Boulding intitulée « Institutional Economics : A New Look at Institutionalism25 ». Peut-être que si Knight n’a pas pu échapper au fait de prendre parti de façon claire est-ce parce que son audience était composée d’autant d’orthodoxes (qui peuplent l’American Economic Association) que d’institutionnalistes réunis pour discuter le point de vue de Kenneth Boulding. Du caractère particulier de ce dispositif Frank Knight a parfaitement conscience puisqu’il dit présumer qu’il a été « mis sur le programme en tant qu’adversaire – “Satan” est le mot biblique ». Telle est l’occasion où, fait exceptionnel, devant parler après deux représentants de l’institutionnalisme particulièrement virulents à l’égard des propos de Kenneth Boulding (Allan G. Grutchy et Forest G. Hill), il n’adresse aucune critique à « l’excellent papier du professeur Boulding » dont il dit qu’il « a couvert presque tout ce qui me semble utile de dire à propos de l’institutionalisme ». Il y aurait donc une manière de définir l’institutionnalisme suivant Frank Knight, manière dont nous apprenons en même temps qu’elle tend à être désapprouvée par ceux que l’on associe habituellement à cette position.
Si cette définition semble avoir échappé à tous les excellents auteurs auxquels nous devons une grande part de notre information sur Frank Knight, peut-être est-ce dû au fait que la méthode qu’ils ont utilisée pour répondre à la question de Geoffrey Hodgson, méthode qui consistait à confronter point par point les points de vue des institutionnalistes à ceux de Knight, n’était pas la bonne. Pour tenter de trouver une autre façon de considérer le problème nous allons quitter le terrain de l’énigme de l’oubli (et de la remémoration) de l’œuvre de Knight pour 36revenir à ce qu’il y avait d’évident dans le fait de consacrer un numéro spécial d’Entreprise & Société (ENSO) à l’occasion du centenaire de la publication de RUP.
3.1. Retour sur l’évidence d’un centenaire :
À propos de la notion d’institution.
Des deux raisons de célébrer Frank Knight en cette année, le centenaire de Risk, Uncertainty and Profit et le sentiment général que l’incertitude est désormais au centre des préoccupations des sociétés, laquelle est la plus importante ? Si la première est la plus déterminante, la seconde n’est-elle pas la plus significative ? Et la difficulté que nous rencontrons à interpréter la portée de RUP n’est-elle pas due au fait que, conformément au proverbe chinois qui nous dit que « le sage montre la lune et l’imbécile regarde le doigt », nous avons jusque-là consacré plus d’attention au détail des arguments développés dans un texte qu’à ce qu’il cherchait à signifier à savoir la place que l’économie se devait d’accorder désormais à la notion d’incertitude ?
C’est ainsi qu’Edmund Phelps (associé à Saifedean Ammous) consacre, en 2011, une section entière d’un document de travail relatif au changement climatique à l’incertitude knightienne :
Une définition extrême, mais admirable de clarté de l’incertitude a été introduite par Frank Knight dans son livre de 1921, Risk, Uncertainty and Profit. Dans les termes même de Knight l’incertitude signifie une condition dans laquelle les probabilités attribuées à divers événements et facteurs sont inconnus – non mesurables. Dans sa terminologie. Knight pouvait avoir à l’esprit le fait que dans le monde social, par exemple une économie nationale, des changements de conditions non perçus font qu’il n’y a pas de série temporelle qui permette de produire des estimations fiables des distributions de probabilité désirées….
Mais ce que Knight avait dans l’esprit était peut-être plus important. Ces dernières décennies plusieurs économistes ont insisté sur le fait que notre connaissance du fonctionnement de l’économie – de la façon dont les choses sont interreliées – est condamnée à être imparfaite. Ce problème existerait déjà dans une économie dotée d’un seul innovateur initiant une démarche nouvelle face à l’inconnu. Cet état de fait est considérablement amplifié par la multiplication des expérimentations et l’incessante originalité qui caractérisent désormais toute l’économie tant au présent que dans le futur26.
37Cette « chose plus large » correspond à ce que Ross Emmett dit des deux derniers chapitres de RUP, chapitre qu’il introduit et résume par les mots suivants :
James Buchanan a fait remarquer un jour que Knight était économiste en tant que philosophe plutôt qu’économiste en tant que scientifique. L’observation est loin loin d’être fausse. Knight considérait la théorie économique comme un prélude nécessaire mais non suffisant à une étude approfondie des institutions et processus sociaux, économiques et politiques nécessaires à une société libérale27.
Ces mots, issus de l’hommage rendu par un ancien étudiant à un maître disparu, rejoignent ceux de George Stigler dans son article intitulé Knight as Teacher (1973). Renonçant pour la circonstance à la posture professorale qu’il avait prise dans la préface qu’il avait donnée à l’édition du cinquantenaire de RUP (voir plus haut) il écrivait :
Frank Knight avait une seconde caractéristique qui dotait son érudition d’un objectif. Il concentrait son esprit sur les grandes questions de la vie économique et sociale, sur la nature éthique d’une bonne société et sur la méthodologie des sciences sociales. Les problèmes fondamentaux de ces grands domaines n’ont pas été résolus dans sa classe : ils ont été rendus plus explicites et beaucoup plus difficiles à résoudre28.
Commencée par une énigme l’évocation du centenaire de RUP semble devoir se terminer par une autre énigme, celle de savoir en quoi consistait cette approche théorique nécessaire et non suffisante qui constituait le prélude à la compréhension, à l’explicitation, de ces problèmes fondamentaux dont Knight ne donnait pas la solution si bien que Ross Emmett termine son article en disant que l’examen des deux derniers chapitres de RUP soulève plus de questions qu’il n’apporte réponses.
Si ces complexités permettent de comprendre, peut-être même de justifier quelque peu l’oubli de Knight dans la littérature qui se veut scientifique et non philosophique, elles laissent ouverte la question de l’évidence de son retour dans la littérature économique depuis l’an 2000 autour de la question de l’institutionnalisme de Knight. Prise de ce point de vue, la question conduit à interroger la relation entre institution et 38incertitude puisque telle est bien la notion qu’au plus profond de l’oubli la littérature économique a toujours associée au nom de Knight. Ce que nous apprend l’anthropologue britannique Mary Douglas dans un article de 2001 intitulé Dealing with uncertainty, c’est que pour savoir ce qu’il en est de l’incertitude, il est bon, sinon nécessaire, de commencer par la question de l’institution. C’est ainsi qu’elle écrit :
La certitude n’est pas une humeur, ou un sentiment, c’est une institution : telle est ma thèse. La certitude n’est possible que parce que le doute est bloqué institutionnellement : la plupart des décisions individuelles sur le risque sont prises sous la pression des institutions. Si nous éprouvons plus d’incertitude aujourd’hui, ce sera à cause de choses qui sont survenues au fondement institutionnel de nos croyances. Et c’est ce que nous devrions étudier29.
La thèse de ce texte nous donne un moyen de définir l’institutionnalisme indépendamment de toute référence directe aux économistes américains de la fin du 19e siècle et du début du 20e qui s’en réclament où à la façon dont ils le définissent eux-mêmes. Cela nous permet de dire que si Knight est institutionnaliste c’est tout simplement par le statut qu’il accorde à la certitude et à l’incertitude, les deux termes qui structurent RUP. Mieux encore, ce texte nous permet de comprendre la mise à l’écart de l’œuvre de Knight : tant que règne la certitude institutionnelle le doute doit être tenu à l’écart. Il nous met à même de comprendre du même coup le retour à Knight comme l’effet d’une mutation historique qui voit l’incertitude succéder à la certitude.
Mais si la nature institutionnelle de la prise de conscience du fait que le monde nous paraît plus incertain est désormais une évidence, force est de reconnaitre que ce n’est pas une évidence claire et distincte : par définition, l’incertitude ne saurait tenir à l’écart le doute. C’est du reste ce que nous signifie Mary Douglas en opposant une certitude non empirique (qui n’est ni une humeur ni un sentiment) et une incertitude qui se manifeste comme un sentiment. Pour rendre compte de ce qui se présente comme un processus de refoulement (de l’incertitude) et de retour du refoulé, il nous faut porter notre regard sur ce lieu qui jusque-là nous échappait, le lieu qui recèle le secret de ces processus, le fondement institutionnel de nos croyances.
39Il est habituel, en particulier sous l’influence de la philosophie analytique, de récuser toute référence à des processus inconscients ou, chez tout adepte des thèses de Karl Popper, de refuser l’idée d’accorder une place à un énoncé dogmatique dans une une théorie scientifique. À cela nous pouvons apporter trois réponses : deux réponses théoriques qui ont toutes chances d’augmenter les réticences à l’égard de notre propos, et une réponse empirique qui, si elle ne convainc pas de manière certaine, devrait au moins susciter la réflexion.
Premier argument théorique : Frank Knight différencie de façon radicale les sciences de la nature des sciences de la culture, sciences produites par l’activité humaine à propos de l’activité humaine, auxquelles il lui arrive de refuser le nom de science, ce qui incontestablement aggrave notre cas : pour lui en effet les sciences sociales peuvent échapper à la rigueur des critères qui s’appliquent au sciences de la nature.
Deuxième argument théorique : Mary Douglas elle-même écrit,
Nous avons besoin de la certitude comme base pour régler les différends. Ce n’est ni pour une satisfaction intellectuelle, ni pour l’exactitude ou la prévision pour elles-mêmes, mais pour des raisons politiques et juridiques30
Et plus loin :
…, je considère que la demande de certitude est fondée sur le besoin de coordination. Un leader a besoin de recruter des adeptes sous une bannière, et les adeptes ont besoin d’être recrutés. Il doit y avoir des promesses, des garanties et des justifications, des revendications de connaissances sûres, qui fonctionnent bien lorsque les adeptes veulent être convaincus. L’idée la plus fondamentale qui porte la possibilité d’une société, plus fondamentale encore que l’idée de Dieu, est l’idée qu’il peut y avoir une connaissance certaine. Et cela s’avère extraordinairement solide, passionnément défendu par la loi et le tabou dans les civilisations anciennes et modernes31.
Il peut s’agir de loi, dont le règne dans les sociétés modernes suppose l’adhésion à une présomption irréfragable qui énonce de manière dogmatique « nul n’est censé ignorer la loi » ou de Tabou qui s’exprime par une forme d’interdit qui n’est pas sans évoquer la notion de refoulement. Quant à la façon dont le noyau dogmatique des institutions de la 40modernité fait lui-même l’objet d’un refoulement, il est signalé par la place qu’occupe « la main invisible » dans la théorie des marchés, formule qui n’apparaît que trois fois dans toute l’œuvre d’Adam Smith et dont le sens pourrait correspondre non pas à l’indicatif, mais à l’impératif : « circulez, il n’y a rien à voir ».
Le troisième argument, argument empirique, est relatif à la façon dont le refoulement de la théorie de l’institution se manifeste dans l’histoire des sciences sociales par la succession d’oublis et de prises de conscience de ces oublis qui ne sont pas sans analogie avec ce qui conduit aujourd’hui à célébrer un auteur oublié : Frank Knight. Nous en donnerons quatre exemples.
–Premier exemple
En 1999, James Coleman écrit dans un article de l’American Sociological Review intitulé Commentary : Social Institutions and Social Theory :
Dans son article intitulé « Prolégomènes à une théorie des institutions sociales », Talcott Parsons aborde un problème au sujet duquel peu de progrès ont été réalisés depuis 1934, date à laquelle il a soumis l’article pour publication au Journal of Social Philosophy.
Ce problème est le développement d’une théorie des institutions, ou d’une base pour une telle théorie. Parsons a qualifié son article de « prolégomènes » à une théorie, mais ces prolégomènes n’ont jamais conduit au développement de la théorie elle-même, que ce soit par Parsons ou par d’autres. La réapparition des « Prolégomènes » fournit maintenant l’occasion de se demander comment cette théorie pourrait être développée de la manière la plus profitable32.
Ce dialogue à travers le temps est des plus instructif pour notre problème : le texte de Talcott Parsons nous indique ce que peut bien être cette théorie de l’institution dont il ressent le manque tandis que le commentaire de James Coleman peut nous éclairer sur le changement qui conduit à reprendre la question plus de soixante ans plus tard.
Il ne saurait être question ici d’analyser en détail tout ce que peut nous enseigner le long texte de Talcott Parsons. Nous nous contenterons d’en extraire quelques arguments qui dessinent en creux ce que devrait être une théorie de l’institution suivant Parsons (en creux puisque c’est de son manque qu’il s’agit dans ce texte).
411. La notion d’institution peut être prise selon deux sens dont le plus important est tenu à l’écart par l’usage courant :
En discutant des institutions, comme l’on discute de nombreux autres objets de la théorie scientifique, il est rarement précisé si l’on se réfère à une catégorie analytique ou à une classe de phénomènes concrets. Pour des raisons qu’il est impossible d’exposer ici en détail, il semble hautement souhaitable d’utiliser le terme institution dans le premier sens, même si cela va à l’encontre d’une grande partie de l’usage général. Ainsi, je conçois la théorie des institutions comme l’une des principales branches de la théorie sociologique générale33.
Ceci nous indique que celui qui juge nécessaire de faire suivre sa définition de la notion d’institution d’une liste d’exemples a très probablement manqué le « sens analytique » de la notion.
2. À cette dichotomie correspond la nature objective ou subjective de l’objet d’étude considéré. Tandis que les institutions au sens objectif du terme sont observables empiriquement et sont traditionnellement objet d’enseignements, la notion d’institution au sens subjectif désigne la dimension normative de représentations mentales qui par définition se tiennent au-délà des limites de la partie observable du monde (« …il se trouve au-delà des limites du monde extérieur observable empiriquement34 »).
3. Les normes de l’action se traduisent en termes de fins. Talcott Parsons est amené à distinguer les fins « empiriques » liées à des résultats observables empiriquement de fins « transcendantales » telles que le Salut, le Nirvana etc.
4. Parsons souligne que la situation qui résulte de la relation entre les systèmes de fins de différents individus est particulièrement complexe. Il ajoute,
On peut démontrer négativement que l’état de variation aléatoire de tels systèmes individuels dans la même société serait l’état de nature de Hobbes – c’est-à-dire le chaos ; et qu’en l’absence d’une harmonie préétablie en termes de « Nature » métaphysique, il doit y avoir, pour qu’une société existe, un degré significatif d’intégration des fins ultimes en termes de système commun à la majorité des individus qui la composent. En outre, il existe de nombreuses preuves empiriques que de tels systèmes communs de fins ou de 42valeurs ultimes existent et jouent un rôle essentiel dans la vie sociale. Nous supposerons alors que toute société concrète est et doit être caractérisée par un tel système commun de valeurs supérieures35.
Le commentaire de James Coleman, à l’occasion de la réédition de cet article en 1999, nous permet de mesurer l’effet du passage du temps. Il nous apprend tout d’abord que Talcott Parsons a abandonné l’approche de l’institution comme catégorie analytique pour consacrer ses efforts de théorisation à des systèmes formels de classifications des systèmes sociaux, une activité de classification qu’il dénonçait lui-même dans l’article cité ci-dessus. Pour James Coleman, la raison de ce recul et de cet échec est le fait que Parsons a tenu à l’écart la notion de conflit, conflit des intérêts à court terme et à plus long terme d’un même individu, ou conflits entre intérêts communs et intérêts individuels36. Cependant Coleman note que chemin faisant, Talcott Parsons est conduit à comparer la théorie subjective de l’institution à la jurisprudence (au sens anglo-saxon de « théorie du droit » ou de « philosophie du droit »). Ce que Coleman commente de la façon suivante :
l’identification par Parsons de la théorie de l’institution avec la sociologie du droit pointe en direction d’une région au centre de la théorie du social – une région qui a été largement ignorée par les sociologues des dernières années37.
–Deuxième exemple
Cette association entre théorie de l’institution et refoulement est évoquée doublement par la « Nobel Lecture » de Ronald Coase intitulée « Les Structures Institutionnelles de la Production », une fois volontairement, une autre fois involontairement. Il commence par évoquer sa surprise de se voir attribuer un prix en 1991 pour un article écrit en 1937 ; et écrit :
Au cours de ma longue vie, j’ai connu de grands économistes, mais je ne me suis jamais compté parmi eux et je n’ai jamais cherché leur compagnie. Je n’ai produit aucune innovation de haute volée. Ma contribution à l’économie a été de demander instamment l’inclusion dans notre analyse de caractéristiques du système économique si évidentes que, comme le facteur dans le conte du Père Brown de G.K. Chesterton, L’homme invisible, elles ont eu tendance à 43être négligées. Néanmoins, une fois incluses dans l’analyse, elles entraîneront, comme je le crois, un changement complet de la structure de la théorie économique, du moins de ce qu’on appelle la théorie des prix ou la microéconomie. Ce que j’ai fait, c’est montrer l’importance pour le fonctionnement du système économique de ce que l’on peut appeler la structure institutionnelle de la production. Dans cette conférence, j’expliquerai pourquoi, à mon avis, ces caractéristiques du système économique ont été ignorées et pourquoi leur reconnaissance conduira à un changement dans la façon dont nous analysons le fonctionnement du système économique et dans la façon dont nous pensons la politique économique, changements qui commencent déjà à se produire38.
L’évocation du caractère invisible de ce qui est évident peut donner le sentiment que Ronald Coase est parvenu à échapper à cette illusion et l’éminente marque de reconnaissance qui lui est accordée de la part de la corporation des économistes semble témoigner du caractère général de cette prise de conscience même tardive. Pourtant, Ronald Coase lui-même dans un acte manqué (un de ces actes manqués dont Freud nous dit qu’ils manifestent une intention inconsciente) oublie de citer Frank Knight, auquel pourtant il avait consacré de longs développement (sur trois pages) dans son article de 1937 et qu’il avait eu l’occasion d’évoquer peu avant (en 1988) dans deux des trois articles académiques qu’il avait consacrés à l’origine, au sens et à l’influence de cet article39. Tout se 44passe comme s’il s’agissait de respecter un tabou, le tabou qui suivant Mary Douglas a défendu, dans les civilisations ancienne et moderne, l’idée qu’il y a des connaissances certaines.
C’est du reste à Mary Douglas que nous devons notre troisième exemple. Dans un chapitre de Comment Pensent les Institutions ? (1986) intitulé « où l’on voit les institutions se souvenir et oublier » elle consacre une section à la façon dont l’article de Kenneth Arrow intitulé « A Difficulty in the Concept of Social Welfare » (publié en 1950 où il présentait un désormais fameux théorème d’impossibilité) « n’a suscité qu’un intérêt très limité avant de devenir subitement l’un des concepts dominant de la science politique occidentale ». Par ailleurs Mary Douglas, dans le même chapitre rappelle que ce que cherchait à élucider alors Kenneth Arrow c’était « pourquoi la découverte de J.C. Borda en 1781 et sa reformulation par Condorcet en 1785, avaient été complètement oubliées » Elle écrit à ce propos :
Cette théorie n’est donc devenue pertinente pour la science politique qu’à la fin du xxe siècle quand … le pluralisme rendait plus difficile l’établissement d’un consensus, et que les fondements de la société démocratique étaient de plus en plus remis en cause.
Enfin un quatrième exemple de la manifestation du lien entre institution et oubli peut être cherché du côté de la façon dont ceux qui se nomment eux-mêmes néo-institutionnalistes semblent n’éprouver aucun besoin de rendre compte de l’histoire qui les sépare de ces institutionnalistes du tournant du 20e siècle auxquels pourtant leur nom les rattache.
Ces récits d’oublis et de remémoration mettent en scène la relation entre l’institution au singulier, au sens analytique, dogmatique du terme, qui « constitue le fondement institutionnel de nos croyances40 » et les institutions au pluriel, au sens de catégories empiriques, objets de classements par les sociologues et d’enseignement par les juristes. C’est le sociologue James Coleman qui, en 1999, nous révèle, en faisant émerger le texte de Talcott Parsons de 1934 déjà cité, que ce dont il s’agit dans ces récits, c’est de l’oubli et du retour du souci de donner un fondement théorique à la notion d’institution. Mary Douglas, dans son article de 2001, intitulé « Faire face à l’incertitude », nous indique la direction dans laquelle il nous faut désormais chercher cette théorie 45de l’institution : ce que nous devons désormais étudier, nous dit-elle, c’est le fondement institutionnel de nos croyances. Pour comprendre le sens de cette injonction il semble naturel de se reporter au chapitre de « Comment pensent les institutions » intitulé « Au fondement de l’institution : l’analogie ». Par là un nom était proposé pour la relation entre l’institution au sens dogmatique et l’institution au sens empirique et au-delà de ce nom une interprétation de l’oubli dans lequel les sociétés s’efforcent de tenir « le fondement institutionnel de nos croyances ». Elle écrit :
En histoire de la logique, on enseigne souvent, à la suite de Mill que l’idée de ressemblance est double. Soit elle se fonde sur l’équivalent mathématique de deux relations (par exemple 2/4=3/6)…soit il s’agit d’une ressemblance plus vague qui laisse libre champ aux appréciations arbitraires. On enseigne également que la ressemblance est une base fragile pour le raisonnement.
[…] Mais les ressemblances qui fournissent des analogies socialement valides sont instituées avant tout pour légitimer les institutions sociales et non pour raisonner sur des phénomènes physiques. De plus l’effort qui consiste à renforcer des institutions sociales fragiles en les fondant en nature échoue dès qu’il est reconnu comme tel. C’est pourquoi les analogies fondatrices doivent rester cachées et que l’emprise du style de penser sur le monde de penser doit rester secrètes41.
Le bon fonctionnement des institutions empiriques repose donc sur une analogie postulée avec un fondement dogmatique, une théorie de l’institution : il se maintien tant que l’écart entre le vécu des membres de la société et ses institutions concrètes est considéré généralement comme acceptable. La mesure de la relation entre les institutions concrètes et leur fondement dogmatique a un nom, c’est la confiance. Notons que la notion de confiance tout comme la notion de risque peut s’entendre soit dans un sens relatif soit dans un sens absolu. Mais alors que dans le cas du risque le français dispose de deux termes, risque et incertitude, pour opposer ces deux sens dans le cas de la confiance, elle ne dispose que d’un seul terme pour la caractériser, si bien qu’elle doit y ajouter un qualificatif chaque fois que nécessaire : confiance absolue ou encore confiance aveugle. Il n’en va pas de même en Anglais qui dispose de deux termes distincts : trust et confidence. C’est ce qui permet à 46Kenneth Arrow de nous dire que la confiance (trust et non confidence) est une institution invisible. Lorsque l’écart entre l’expérience empirique du monde et sa représentation dans les institutions devient excessif, la certitude dogmatique investie dans ces institutions, se mute en un sentiment d’incertitude. La théorie de l’institution qui se manifestait paradoxalement par le fait qu’il ne lui était pas nécessaire de paraître pour soutenir les analogies qui servent de fondement aux institutions concrètes se manifeste désormais par la prise de conscience d’un manque : manque de fondement théorique des croyances, manque d’une théorie de l’institution qui se manifeste, comme nous le suggère le texte de Mary Douglas que nous venons de citer, par le fait que les efforts pour la constituer échouent puisque désormais ils sont reconnus comme tels. Il s’ensuit que la confiance (trust) dans les institutions requises pour la résolution des conflits susceptibles de survenir (puisque telle est leur fonction suivant Mary Douglas) fait défaut. Dans une telle situation d’incertitude, l’action repose entièrement sur la confiance (confidence et non trust) que l’on veut bien accorder à une opinion : c’est bien ce que nous dit Frank Knight au tout début de RUP.
3.2. sur l’institutionnalisme de knight
Chercher à rendre compte de l’oubli de Knight nous a momentanément éloignés de lui. Il est temps de revenir à ses écrits pour tenter de voir dans quelle mesure et de quelle façon il est possible d’y trouver le souci de l’élaboration d’une théorie de l’institution. Nous avons la chance de disposer pour cela d’un texte, véritable autoportrait de Frank Knight en économiste institutionnaliste, écrit à l’occasion de sa participation à la table ronde que nous avons déjà évoquée, autour d’un exposé de Kenneth Boulding dont le titre était Institutional Economics : A New Look at Institutionalism42. D’emblée Knight nous dit que contrairement à ce qu’ont pu penser ceux qui l’on inscrit dans le programme (et pourrait-on ajouter, contrairement au préjugé commun qui identifie Knight à l’orthodoxie de l’école de Chicago), il n’est pas l’adversaire de l’institutionnalisme. Il écrit :
Je suis en fait aussi « institutionnaliste » que quiconque, dans un sens positif. Je ne diverge que parce que je ne condamne pas l’« économie » dans sa 47signification essentielle. C’est ce que représente l’étiquette plutôt qu’une quelconque signification positive. C’est un cri de révolte, un appel à « tout sauf » la discussion des fins et des moyens et de la libre coopération […] J’abhorre également l’orthodoxie, dans son sens propre historique : mais cela ne me fait pas dénoncer le théorème de Pythagore, ou les lois de la dynamique, bien que tous ces éléments soient aussi irréalistes que la plus pure théorie de l’économie – pour utiliser une autre épithète institutionnaliste. La haine de l’orthodoxie ne me pousse pas non plus à nier que les hommes économisent et s’organisent pour être efficaces par l’achat et la vente de biens et de services sur des marchés43.
Nous savons déjà que l’institutionnalisme de Knight ne peut être mesuré par sa proximité ou son éloignement des thèses de l’institutionnalisme américain du tournant du 20e siècle mais par rapport à une définition théorique de la notion d’institution. Pour cela nous disposons des écrits déjà cités de Mary Douglas et ceux de James Coleman dans son commentaire de l’article de Talcott Parsons de 1934. Rappelons trois temps-clés qui permettent de circonscrire l’institutionnalisme knightien.
3.2.1. Ce que nous savons sur la théorie de l’institution
à travers les écrits de Mary Douglas (1986-2002)
et le dialogue Parsons-Coleman (1934-1999)
La notion d’institution se comprend en deux sens : dogmatique, transcendantal d’un côté, empirique de l’autre.
La certitude attachée à l’institution au sens dogmatique-transcendantal du terme est nécessaire pour résoudre les conflits qui peuvent surgir dans la société. Un conflit implique deux acteurs sociaux dont la relation ne peut se résumer ni à un échange, comme dans la théorie classique du marché, ni même à une transaction, comme dans la théorie institutionnelle suivant Commons, Coase, ou Williamson, une transaction supposant que les deux parties partagent suffisamment de présupposés pour aboutir à un accord, à une convention, sans intervention d’un tiers. Il s’agit d’un différend que seul le recours à une instance tierce, qu’il s’agisse d’une règle de droit ou d’un juge dont l’autorité est reconnue a priori par les deux parties, permet de résoudre. De là, deux 48traits caractéristiques des instituions : elles sont « considérées comme acquises » dogmatiquement (ce que l’on désigne en anglais par la notion de taken-for-grantedness) et elles sont stables, cette stabilité devant être suffisante pour permettre d’une part l’intériorisation de ces règles par les membres de la société et d’autre part à la confiance (trust) de produire ses effets, la confiance étant une espérance, une attente, relative à la réciprocité d’un comportement.
D’après James Coleman, l’élaboration d’une théorie de l’institution suppose le rejet de l’hypothèse d’une harmonie préétablie entre les systèmes de fins. C’est cette hypothèse qui a détourné Parsons de l’élaboration de la théorie de l’institution dont il ressentait pourtant le besoin.
Le rejet de cette hypothèse implique la reconnaissance de la possibilité d’une crise de la société, d’un risque de chaos social, d’un retour à l’« état de nature » Hobbesien, évoqué explicitement aussi bien par Coleman dans le texte évoqué ci-dessus que par Frank Knight dans RUP44.
Le caractère inquiétant d’une telle perspective permet de comprendre qu’elle soit refoulée tant que l’analogie entre « le fondement institutionnel de nos croyances » et les institutions sociales au sens empirique du terme permet de maintenir une confiance suffisante dans les institutions.
3.2.2. Ce que nous savons de la représentation synthétique que
Knight se faisait de sa propre approche théorique : Knight wébérien
Plusieurs indices convergent pour faire de Frank Knight un auteur wébérien.
Premier indice : Ross Emmett relie bien la question de l’institutionnalisme de Knight au nom de Max Weber dans un chapitre d’ouvrage intitulé « Frank Knight, Max Weber, Chicago Economics and Institutionalim ». Toutefois, il semble qu’un tel rapprochement est sinon rejeté, du moins évité par Ross Emmett qui écrit : « Mais le but ici n’est pas d’apposer un nouveau label wébérien sur l’œuvre de Knight, ni de retracer spécifiquement l’“influence” de Weber sur Knight ou tous les liens divers entre leurs travaux ».
Pour notre part, il ne s’agit pas de dire que Knight est en accord en tout avec Weber, il marquera même son désaccord à propos de la façon dont celui-ci accorde trop d’importance à la religion dans sa théorie de 49l’essor du capitalisme. Ce qui nous intéresse, ici, c’est la façon dont leurs conceptions de la science se rejoignent et en quoi les concepts wébériens nous permettent d’interpréter la théorie institutionnelle de Knight.
Deuxième indice : c’est à Ross Emmett que nous devons de connaître cette citation de Knight (mise en épigraphe au chapitre cité ci-dessus) : « [Max Weber] est l’un des rares hommes que j’ai lus et pour lesquels j’ai encore du respect après les avoir lus45 ».
Troisième indice : Cette admiration est confirmée par une citation que nous devons cette fois à Geoffrey Hodgson : « On a demandé à Knight quel domaine de recherche il aimerait approfondir. Il a répondu : “il y a le travail d’un homme que j’ai beaucoup admiré. Si je devais recommencer, je m’inspirerais de ses idées. Je fais bien sûr référence à Max Weber” (cité par Sweitzer, 1975, p 279)46 ».
Quatrième indice : Dans la préface qu’il a donnée à sa traduction de General Economic History, en 1927, Knight écrit :
À une époque où la pensée économique anglophone, et en particulier américaine, s’est déplacée de la théorie déductive générale vers l’autre des deux coins du triangle méthodologique, à savoir l’interprétation psychologique et historique d’une part et l’étude statistique d’autre part, il y a de nombreuses raisons de mettre à la disposition des lecteurs anglais ce dernier produit de la pensée de Weber, son histoire économique47. p. xv
Il n’est peut-être pas abusif de lire dans ce texte que ce qui intéresse Knight, c’est la façon dont Max Weber permet d’articuler ces diverses façons d’« interpréter la vie économique et le changement » étude pour laquelle il est « célèbre dans d’autres contrées que la sienne48 ».
3.2.3. Comment les catégories wébériennes se retrouvent
à partir du dialogue Boulding-Knight
La raison principale pour souligner le caractère wébérien de l’approche de Knight c’est que cela nous offre une manière de tenter de déchiffrer 50la logique qui sous-tend une œuvre aussi riche que complexe. C’est ce que nous allons tenter en reprenant un à un les principales dimensions de l’approche wébérienne de la science. Pour cela nous pouvons suivre Ross Emmett lorsqu’il nous dit :
L’approche de Max Weber en matière de méthodologie des sciences sociales et sa sociologie historique comparative ont été des ressources importantes dans lesquelles Knight a puisé pour créer une science sociale qui transcende les termes du débat néo-classique-institutionnaliste des années 1920 et 193049.
Vouloir transcender le débat entre néoclacissisme et institutionnalisme, n’est-ce pas vouloir penser le lien que suppose, voire ce qu’impose, l’élaboration d’une théorie de l’institution ?
–Idéaltype
La notion d’idéaltype figure explicitement au centre de son bref commentaire du texte de Kenneth Boulding :
Les institutions, je le répète, s’expliquent plus ou moins historiquement plutôt que scientifiquement et sont peu contrôlables. L’idéaltype est le langage, sur lequel nous pouvons si peu agir que nous ne pensons guère à essayer. C’est pour cette raison que la linguistique est la plus scientifique des disciplines sociales – je répète « pour cette raison » et je note qu’elle est scientifique au sens où le mot s’applique à l’histoire, mais encore de façon incomplète ; autrement dit, la prédiction, même en théorie, ne pourrait être qu’hypothétique50.
Ce qui caractérise l’idéaltype, c’est la façon dont il permet de relier la définition conceptuelle d’un objet avec la réalité empirique qu’elle désigne et ce par un jeu d’analogies qui passe par la définition d’un certain nombre de traits permettant de « coder » la réalité empirique. Il en va ainsi dans l’œuvre de Weber de l’idéaltype de la bureaucratie et des idéaux-types qui définissent les types d’autorité légitime (Charismatique, Traditionnelle, Rationnelle-légale).
De ce point de vue, la théorie du marché peut être considérée comme une représentation idéale-typique de la vie économique. C’est bien ce qu’il nous indiquait déjà dans la citation tirée du texte cité ci-dessus (p. 46-47) où il affirme abhorrer l’orthodoxie.
51–La nature historique des sciences sociales
Si Knight peut se dire institutionnaliste, c’est parce que les sciences sociales, sciences de l’homme, sciences de l’activité humaine produites par l’activité humaine, diffèrent des sciences de la nature du fait du caractère essentiellement historique de leur objet.
L’homme, nous le savons tous, est un animal social, il n’y a là rien de nouveau, mais la vie sociale sur une base institutionnelle, remplaçant largement l’instinct, émerge avec l’homo. Il a une histoire dans un sens si particulier que Dilthey et Ortega ont pu dire qu’il n’a pas de nature mais « seulement » une histoire – qui peut se lire « seulement des institutions51 ».
Les sciences de l’homme, telles que les conçoit Knight comportent deux parties : à l’historicisme s’oppose et se compose la notion de rationalité moyen-fins qui constitue l’idéaltype du comportement économique :
Pour limiter mon champ d’action et m’en tenir au cœur du sujet, j’ai éliminé tous les niveaux inférieurs de la matière à laquelle appartiennent les phénomènes humains52 et j’ai porté mon regard sur deux catégories principales et spécifiques nécessaires à leur étude. L’une, comme on peut le deviner, sera la rationalité des moyens et des fins, simplement le comportement économique. Pour l’autre, l’institutionnalisme est un nom approprié, avec la tradition, la convention et la culture comme équivalents approximatifs et surtout l’« historicisme53 »
–L’histoire des institutions suivant Boulding
L’approbation sans restriction donnée par Knight à l’exposé de Kenneth Boulding54 nous permet de penser qu’il est en accord avec la conception de l’histoire qui y est présentée.
Kenneth Boulding commence par indiquer que la notion d’institutionnalisme ne peut se limiter à désigner le mouvement de contestation qui s’est développé entre les années 1890 et 1920, qui 52représente une sorte d’interlude historique qui s’est achevé dans les années 1930.
Dans un sens étroit, ce jugement peut être justifié. Néanmoins, nous passons à côté de la signification plus large et durable de l’institutionnalisme si nous ne le considérons pas comme une manifestation particulière d’un mouvement beaucoup plus large de dissidence économique. Il n’existe pas de nom unique pour ce vaste mouvement et peut-être est-il trop vaste pour en mériter un. Il présente cependant une certaine unité au milieu de sa diversité, qui tient peut-être au fait que, si les formes de dissidence sont innombrables, elles s’opposent toutes à la même « institution » ou orthodoxie55.
L’histoire c’est tout simplement ce qui résulte de la confrontation entre cette orthodoxie et les diverses formes de contestations qu’elle suscite. Pour ce faire il faut d’un côté rendre compte du mode d’existence de cette orthodoxie et d’un autre côté de la façon dont elle peut être affectée par les diverses formes que peuvent prendre ces contestations.
Répondre au premier point suppose de résoudre une énigme :
Ce qui est perturbant, c’est d’abord de savoir pourquoi certains points de vue ou courants de développement s’imposent comme orthodoxes ou « dominants », et ensuite, pourquoi les dissidents se perçoivent comme tels56.
Sur le second point Kenneth Boulding distingue deux catégories de contestataires : les challengers, qui cherchent à créer une nouvelle orthodoxie et les dissenters qui dit-il (non sans ironie), « […] ne peuvent pas vraiment supporter la perte d’une chose à laquelle s’opposer et ne voudraient donc pas vraiment détruire ce à quoi ils s’opposent, même s’ils le pouvaient57 ».
Remarquons que ce dispositif correspond à l’opposition constitutive de la notion d’institution entre un fondement « transcendantal » de nature dogmatique et une réalité empirique qui lui est liée par une relation d’analogie. Les challengers et les dissenters sont ceux qui considèrent que la réalité empirique ne peut prétendre ressembler au référent idéal postulé par l’orthodoxie.
À partir de ce dispositif, l’histoire s’écoule comme un fleuve, le long duquel de temps en temps se lèvent des challengers tandis que s’en échappent, en particulier dans les deltas quand le cours du fleuve 53devient léthargique, les courants de dissenters dont la signification peut difficilement s’évaluer à l’avance dans la mesure où elle peut se révéler dans le futur quand il lui arrive de rejoindre le courant principal.
On peut noter l’analogie entre cette représentation de l’histoire des doctrines institutionnelles et la façon dont Thomas Kuhn décrit La Structure des Révolutions Scientifiques, challengers et dissenters manifestant la présence des anomalies dont la science normale (mainstream) ne peut rendre compte, la différence majeure semblant être la distinction faite par Boulding entre challengers, dont le type pour lui est Adam Smith et les dissenters, dont le type est Veblen58.
Au côté de ces auteurs, Boulding distingue la position de Max Weber :
Max Weber est un personnage intellectuellement aussi monumental que Marx, et là encore on hésite à le classer parmi les dissidents. Il s’agit plutôt d’une source productrice d’idées quelque peu isolée et éloignée, qui a construit, à partir de sa faiblesse personnelle, un monument à l’esprit, éclairant des pans entiers de l’histoire et de vastes domaines de la science avec des idées sages et pénétrantes59.
Suivant Kenneth Boulding, les reproches adressés au long de l’histoire au doctrines du mainstream par les dissenters et les challengers sont au nombre de trois : une approche statique mal faite pour rendre compte de phénomènes essentiellement dynamiques60 ; une abstraction qui conduit l’économie à ignorer les apports des autres sciences sociales ; enfin, la déficience de leur représentation de la réalité empirique. Chacun de ces reproches met en cause la valeur de l’analogie qui, suivant Mary Douglas, fonde la légitimité des institutions.
–Éthique de la responsabilité – Éthique de la conviction
Indice supplémentaire du caractère Wébérien de l’approche de Knight à l’égard du statut des science sociales, dans son bref commentaire au texte de Boulding, il prend le temps d’exposer de manière tout à fait explicite une conception de la relation entre éthique de responsabilité et éthique de conviction semblable à celle que Weber développe dans Le savant et le politique.
54L’un des derniers produits de l’évolution institutionnelle est la rationalité individuelle, dans un sens double : essayer d’utiliser les moyens de manière efficace – économiquement parlant – pour atteindre les objectifs et adapter les institutions pour rendre possible la liberté d’agir de la sorte. Mais ceux qui vont si loin exigent un degré de liberté impossible à atteindre, ignorant qu’ils ont d’autres valeurs qui entrent en conflit avec la liberté, et deviennent tellement importantes à certain moment qu’elles doivent être équilibrées avec la liberté dans un compromis. C’est dans ce contexte que sont nés deux grands systèmes institutionnels modernes et distincts, étroitement liés entre eux : la libre entreprise et le gouvernement démocratique, ainsi que les sciences qui les étudient : l’économie et la politique. La première – l’orthodoxie du mépris de l’institutionnalisme – produit des lois qui à la fois expliquent et permettent la prédiction dans le double sens nécessaire à l’action intelligente, c’est-à-dire la prédiction de ce qui arrivera si aucune action n’est entreprise et la prédiction des conséquences de toute action proposée. L’autre moitié du problème de l’action sociale est de s’accorder sur l’évaluation des idéaux culturels ; sur ce point, aucune science positive n’apporte de lumière, et l’histoire pas beaucoup plus ; c’est une question de jugement critique61.
–La question des valeurs
Si ces quelques exemples tirés de son échange avec Kenneth Boulding peuvent sembler suffisants pour indiquer la plausibilité du caractère wébérien de la théorie knightienne de l’institution, il semble difficile de conclure cette comparaison sans évoquer, ne serait-ce que brièvement, les thèmes relatifs à la question des valeurs. Nous nous contenterons de quelques indications autour des notions wébériennes de neutralité axiologique et de polythéisme des valeurs.
La neutralité axiologique est un principe méthodologique qui s’applique à l’élaboration et à la critique des travaux qui se veulent scientifiques. Sur ce point, il est utile de noter à partir de quelques exemples la façon dont Knight distingue soigneusement accord idéologique et accord scientifique. C’est ainsi qu’il critique avec la même vigueur la faiblesse théorique des écrits de Veblen, dont il ne partage pas les positions politiques, et celle des écrits de Walter Lippman dont les idées libérales sont plus proches des siennes62. De même, s’il est généralement critique de l’institutionnalisme américain dont il dit volontiers qu’il pose de bonnes questions mais n’apporte pas de réponses, il est capable, en dépit de 55son hostilité vis-à-vis des syndicats et du New Deal, de distinguer le talent de Veblen, brillant polémiste, des tentatives théoriques de John R. Commons dont il conclut une recension par ces mots :
Pour autant, et quoi que l’on puisse penser de tel ou tel détail ou aspect particulier de l’ouvrage, celui-ci n’est pas seulement « curieux et intéressant » mais extrêmement suggestif et précieux pour tout étudiant des phénomènes économiques […] Mais s’ils veulent le prendre dans le bon sens, les esprits formés à la théorie économique orthodoxe et attachés à la clarté, à la précision et au « système » sont ceux-là mêmes qui le liront avec le plus grand profit63.
Toutefois la virulence de Knight à l’égard du syndicalisme, du New deal ou de Keynes montre qu’à l’évidence, neutralité axiologique ne signifie pas absence de fortes convictions, voire de passion, puisqu’il aime citer le fameux adage de Hume, « la raison est l’esclave des passions ». Ce qui semble lier ces diverses aversions, c’est le même primat accordé par Knight à une liberté définie de manière radicale comme absence de soumission non consentie rationnellement des individus constitutifs des sociétés à une autorité supérieure quelle qu’elle soit.
C’est pour cette raison que, bien qu’il partage avec Max Weber l’image d’une histoire de l’occident marquée par l’avènement de la domination de la pensée rationnelle, il s’oppose à lui de manière radicale dans la place que celui-ci accorde à la religion, par exemple dans son analyse de l’essor du capitalisme. C’est cette opposition qui a fait que Knight et Parsons, après avoir été rapprochés par leur admiration commune pour Weber (rappelons qu’ils sont tous deux à l’origine des premières traductions de Weber en Anglais), ont fini par s’éloigner l’un de l’autre. Il est possible de confronter le rapport aux valeurs de Knight et de Max Weber à travers la comparaison de deux textes où ces auteurs présentent de manière particulièrement condensée leur vision de ce qui, suivant eux, fait la spécificité de la culture occidentale : il s’agit pour Max Weber des premières pages de l’introduction à l’Éthique Protestante, et l’essor du capitalisme, et pour Knight d’une brève conférence intitulée The Social Philosophy and Institutions of the West (1959). Pour tous deux, ce qui caractérise l’histoire et les institutions de l’occident est le développement d’une forme particulière de rationalité. Là où ils s’opposent, c’est que 56tandis que Max Weber évoque le lien entre la rationalité et la forme spécifique des institutions occidentales, qu’il s’agisse « du formalisme rigoureux de la pensée si nécessaire à une jurisprudence rationnelle64 », de l’invention d’une gamme rationnelle en musique ou encore d’une recherche scientifique systématique poursuivie par un personnel spécialisé de la recherche scientifique, Knight, pour sa part, met l’accent sur le lien entre liberté individuelle et progrès. Il écrit :
La plus grande « rupture » dans l’histoire de la culture, qui a marqué la pensée occidentale moderne, ce sont les Lumières, avec l’avènement des idéaux jumeaux de liberté et de progrès – la liberté pour le progrès et le progrès par la liberté – la liberté des individus étant généralement conçue en harmonie avec le progrès social (la « révolution libérale »). Le libéralisme est la double incarnation institutionnelle de la « démocratie » et de la « libre entreprise », mais toutes deux supposent la liberté suprême de pensée et d’expression, c’est-à-dire la « révolution libérale ». Le libéralisme est la double incarnation institutionnelle de la liberté de ne pas être dirigé par une autorité – Église et/ou État – prétendant à un statut surnaturel, principalement en « interprétant » une tradition (loi) mais avec plus ou moins de pouvoir d’innovation par décret65.
Ni le mot « individu », ni ses dérivés, ne figurent dans le bref récit que Max Weber nous donne de l’avènement de la rationalité occidentale. Il s’oppose ainsi de manière radicale à l’histoire des institutions esquissée par Frank Knight dans sa réponse à Boulding évoquée plus haut :
Très récemment, comme nous l’avons noté, le changement institutionnel a commencé à produire une représentation individualiste ; les individus sont donc aussi institutionnels, dans ce sens. Au fur et à mesure que les hommes ont pris conscience des institutions sociales, ils ont adopté des attitudes à leur égard – principalement des attitudes romantiques d’amour et de haine. Enfin, ils ont commencé à être un peu rationnels, c’est-à-dire à distinguer et à évaluer les choses de façon critique, suite au progrès de l’approche scientifique de la nature66.
57Cette opposition dans la façon dont Weber et Knight se représentent les « fondements institutionnels de [leurs] croyances », si elle exprime une différence dans leurs idéaux, n’affecte en rien leur proximité, régulièrement réaffirmée par Knight dans leur approche méthodologique des sciences humaines. On peut penser que l’opposition des attitudes de Knight et Weber vis-à-vis de la religion ne sont que l’effet de la différence des fondements institutionnels de leurs sociétés respectives. C’est qu’il est impossible à la pensée du plus rigoureux des penseurs de l’institution de prétendre pouvoir s’en émanciper, peut-être même n’en est-elle jamais plus tributaire que quand elle en ressent le manque. C’est ainsi que là où Weber évoque « le désenchantement du monde », Knight préfère évoquer la « maladie de la société libérale » un diagnostic qui ne porte pas en lui-même la solution au malaise :
Le fait de s’entendre sur l’existence d’un malaise social ne nous conduit pas loin dans la direction de l’acceptation d’un programme d’action commun et peut même aller dans le sens opposé, aggravant la maladie. La prise de conscience du désordre social rend impérative un consensus raisonnable sur la nature du problème et sur ce qu’il faut faire, ou, en termes médicaux, sur le diagnostic et le traitement. Dans la scène actuelle, nous trouvons le désaccord le plus aigu sur ces points cruciaux67.
Étant donnée la réticence de Knight à concéder une quelconque autorité à une divinité quelle qu’elle soit, on ne saurait être surpris de voir le pluralisme des valeurs prendre la place occupée par la notion de polythéisme dans les écrits de Max Weber.
58–Polythéisme ou pluralisme des valeurs
Au-delà de leur différence les deux notions se rejoignent en ce qu’elles évoquent une commune opposition à l’idée parsonienne d’une harmonie a priori des valeurs dans laquelle James Coleman voyait une des raisons qui ont détourné Parsons de son projet d’élaborer une théorie de l’institution68.
La notion de pluralisme des valeurs occupe une place centrale dans la représentation knightienne de la société.
Le pluralisme de la nature humaine culmine dans un pluralisme éthique, également le produit d’une évolution émergente. Il est facile de condamner un arrangement social parce qu’il va à l’encontre d’un certain idéal et d’en approuver un autre qui éviterait ou pourrait éviter ou atténuer ce mal particulier, sans tenir dûment compte des effets que le changement aurait effectivement sur la réalisation d’autres valeurs tout aussi importantes. C’est là que se situe une grande partie du problème social. En particulier, la liberté et le progrès, valeurs distinctives de la civilisation moderne, entrent en conflit avec les valeurs plus anciennes d’ordre et de sécurité, sans pour autant les invalider et les supplanter ; et il semble qu’il n’y ait pas de principe de compromis qui puisse être énoncé en paroles et qui soit d’une grande utilité pour prendre des décisions politiques concrètes. Les hommes doivent avoir une conscience aiguë des problèmes et faire preuve de jugement, de tolérance et de patience ! Ils doivent accepter le caractère inévitable de la gradualité, tout en s’efforçant d’obtenir des améliorations possibles. Prendre les principes moraux trop au sérieux peut être aussi mauvais que de ne pas les prendre assez au sérieux.
L’absolutisme moral rend la discussion impossible, et la situation s’aggrave indéfiniment lorsque l’absolutisme religieux s’y ajoute, comme il tend à le faire. C’est l’essence même de la croyance religieuse que toute discussion et toute remise en question de « la vérité » soient mauvaises, la vérité signifiant ma vérité, qui n’est jamais fondée sur un examen critique69.
L’opposition de Knight à la place que Weber accorde à la religion dans l’Éthique Protestante n’est ni anecdotique, ni localisée, elle touche le cœur de leurs analyses : le statut des relations hiérarchiques dans les institutions des sociétés. Là où Weber interroge sur les formes de domination légitimes, Knight questionne les idéaux-types institutionnels compatibles avec la liberté individuelle, c’est-à-dire avec le rejet de toute soumission des individus à l’égard de toute autorité non consentie rationnellement.
59Ces différences culturelles n’opposent nos deux auteurs qu’aussi longtemps que l’on oublie d’appliquer à l’analyse des théories du social le principe de neutralité axiologique qui seul permet d’accorder une juste place à la diversité des conceptions du monde qui caractérisent les sociétés. La difficulté d’appliquer ce principe est grande : il met en jeu la crainte de chacun de trahir les engagements éthiques ou politiques qui résultent de leur inscription dans l’histoire institutionnelle qui les constitue. C’est qu’il s’agit de séparer le point de vue du savant de celui du politique, de les penser non pas l’un contre l’autre, mais l’un avec l’autre dans la tension des contradictions qu’ils suscitent nécessairement. Il apparaît alors normal qu’une même approche « idéaltypique », puisse conduire Max Weber à consacrer la bureaucratie comme l’expression parfaite de la rationalité occidentale tandis que pour Knight, comme nous le dit George Stigler, « le rôle principal de la théorie économique […] est de contribuer à la compréhension de la manière dont, par un consensus fondé sur une discussion rationnelle, nous pouvons façonner [une] société libérale dans laquelle la liberté individuelle est préservée et où des performances économiques satisfaisantes sont réalisées70 ».
C’est ce projet qui donne toute sa valeur à ces « deux grands systèmes institutionnels modernes et distinctifs, étroitement liés : la libre entreprise et le gouvernement démocratique71 ». Deux systèmes que Knight s’empresse de soumettre à la critique la plus rigoureuse.
Du marché il écrit, non sans ironie :
Il a le mérite suprême de permettre aux gens de coopérer sans accord spécifique sur des valeurs, qu’ils ne parviendront jamais à atteindre une fois que les forces de l’histoire institutionnelle auront cessé d’agir, inconsciemment ou par l’opium de craintes superstitieuses72.
Ce qui permet au marché de produire l’accord de tous c’est ce qu’il y a d’universel dans la logique économique, à savoir le principe de l’adaptation optimale des moyens aux fins. Toutefois il ajoute, immédiatement que s’agissant des fins leur multiplicité et leur mobilité ne sauraient ni se résumer à une notion aussi unidimensionnelle que l’intérêt ni être représentées correctement par la formule « ceteris paribus ». Pour 60Knight, « rien de ce qui est humain ne lui est étranger ». C’est ainsi qu’il écrit :
Les hommes ont d’autres objectifs que l’économie, à savoir la satisfaction maximale des besoins par l’utilisation efficace des moyens disponibles, internes et externes ; par exemple, le jeu et le plaisir esthétique, et nous notons que si les besoins sont mauvais, l’efficacité est nuisible – une considération vitale pour la liberté et la politique73.
Et encore :
Ce n’est pas sur une base sentimentale ou idéaliste, mais comme une simple question de faits sur la façon dont l’homme ordinaire conçoit ses propres désirs et les interprète dans sa conduite que nous argumenterons contre cette vision des choses. Nous suggérons que les désirs ne sont pas seulement instables, changeants en réponse à toutes sortes d’influences, mais que c’est leur nature essentielle de changer et de croître ; c’est une nécessité qui leur est propre. La principale chose que le sens commun désire en réalité n’est pas la satisfaction de ses besoins [wants], actuels mais l’accroissement quantitatif et qualitatif de ces besoins. Les choses qu’il cherche à obtenir au sens le plus immédiat sont bien plus ce qu’il pense devoir vouloir que ce que suggèrent ses préférences spontanées. Ce sentiment de ce que l’on devrait vouloir, par opposition au désir réel, est plus fort chez les moins réfléchis que chez ceux que l’éducation a sophistiqué74.”
Cette conception des fins et des valeurs permet de comprendre la façon dont Knight, au tout début de The Economic Organisation prévenait ses lecteurs contre le fait d’accorder trop d’importance à l’économie. Cette mise en garde est redoublée par la façon dont il évoque le danger que représente la façon dont la liberté économique tend spontanément à favoriser le développement des inégalités :
Dans une société libre, la préservation et l’accroissement de la richesse et de la culture sont largement laissés à l’initiative des individus, des familles et des groupes volontaires. Le résultat inévitable est une tendance à l’augmentation des inégalités entre des groupes de toutes sortes qui se perpétuent, ainsi (si ce n’est plus) qu’entre les individus. Ce phénomène est particulièrement visible en ce qui concerne la capacité de production (interne ou externe), mais il est tout aussi vrai pour tous les éléments de la culture. […]l’inégalité des revenus réels […] est humainement destructrice aux deux extrémités de l’échelle – en 61particulier au bas de l’échelle où le dénuement dégrade les enfants qui sont des êtres humains et de futurs membres de la société, mais aussi aux échelons supérieurs, puisque le pouvoir et le luxe corrompent tout comme la faiblesse et la pauvreté75.
Pour éviter cette marche destructive à l’inégalité, dont il nous dit, s’agissant des inégalités de revenus, qu’elle est destructive aux deux bouts de l’échelle, la société, et le marché, ont besoin d’être régulés par un État, dont les lois pour être véritablement démocratiques doivent être produites par la délibération directe de tous les citoyens.
À ce point nous sommes à même de comprendre ce que voulait dire George Stigler lorsqu’il écrivait que les problèmes fondamentaux étaient posés de la manière la plus large dans sa classe, sans être résolus, et que par là ils étaient rendus plus explicites et plus redoutables.
Ce qui rendait sa façon de poser les questions particulièrement redoutables c’était son refus de recourir à la religion pour résoudre les apories auxquelles la raison se trouvait confrontée.
Les témoignages de l’importance accordée à cette prise de position sont nombreux. C’est ainsi que Knight n’a pas jugé inutile de se livrer, en 1945, à une véritable disputatio publique, dans un ouvrage intitulé The Economic Order and Religion76 où il était opposé à un éminent représentant de la communauté des Baptistes du Nord. L’enjeu du débat était le rapport entre la religion, en l’occurrence le christianisme, et le libéralisme. Knight les juge antithétiques tandis que pour son interlocuteur ils sont essentiellement en harmonie.
La position de Knight est clairement résumée par Ross Emmett :
L’œuvre de Knight exprime la tension entre la nécessité de continuer à donner un sens au monde dans lequel Dieu est absent, tout en restant très conscient de ce que nous avons perdu parce que Dieu n’est plus présent77.
Et il ajoute que la question qui doit nous occuper est de savoir « si les préoccupations de Knight à propos du rôle de la religion dans le monde moderne sont en quelque manière que ce soit liées aux méthodes ou aux résultats de son analyse économique ».
62Une manière de répondre à cette question consiste à remarquer l’analogie entre ce que Ross Emmett nous dit du statut de Dieu dans cette citation et ce que nous avons dit des fondements institutionnels des croyances constitutives des sociétés : c’est à travers le caractère aigu du sentiment de manque que provoque leur absence que leur présence se fait sentir. Toutefois, le lien que l’on peut ainsi établir entre la position de Knight à l’égard de la religion et les questions de méthode ne présenterait qu’un intérêt limité s’il n’impliquait une conséquence majeure quant « aux résultats de son analyse économique », à savoir la possibilité même de penser la notion d’incertitude dans toute sa radicalité78.
Aujourd’hui où l’incertitude est devenue une évidence qui parait aux yeux de tous, l’œuvre de Knight offre le moyen de comprendre ce qui est en jeu dans la notion d’institutionnalisme économique. Quant à la lecture de RUP elle est l’occasion de vérifier la fécondité d’une telle approche.
634. un siècle après :
une lecture de risk, uncertainty and profit
Économiste, Frank Knight ? Il l’affirme, tout en refusant d’admettre que sa discipline puisse prétendre comme elle le fait au statut de science exacte. Elle doit comme toutes les social sciences, embrasser des phénomènes complexes et de ce fait ne délivre qu’une connaissance partielle et l’abstraction qu’elle opère ne peut être qu’une approximation par rapport à ce dont les sciences physiques sont capables. Les modèles que l’économie produit, du fait de leur aptitude à exprimer seulement des « tendances » (tendencies), n’ont aucune commune mesure avec l’efficacité de ces dernières. C’est là que se manifeste un paradoxe, parmi tant d’autres, de la pensée knightienne : économiste assumé, il ouvre le champ de questionnement aux phénomènes sociaux (il est, rappelons-le, un traducteur de l’Histoire économique Générale de Max Weber), à l’analyse des comportements, pour justement embrasser la complexité de son objet d’étude tout en insérant sa démarche, dans ce que l’on pourrait qualifier de projet politique. L’économie knightienne est la science des systèmes d’organisation (the science of a system of organization) – de là, cent ans plus tard, à parler de gestion…
C’est comme l’œuvre d’un institutionnaliste qui pressent la fin de l’institution et la nomme « incertitude » que nous proposons de relire RUP, et d’en livrer des fragments plus rarement cités que d’autres, mais tout aussi fondamentaux pour saisir la richesse, le caractère visionnaire, et la complexité de la pensée knightienne.
4.1. Préliminaire à la lecture de RUP :
Le projet d’une science « fool proof » au service de la société
Contrairement à celles que l’on pourrait qualifier de « sciences démonstratives » (celles qui produisent des résultats tangibles et consommables), Knight conçoit le rôle des sciences sociales comme fragile, car le public croit pouvoir se faire une opinion envers et contre les « informés » qui par ailleurs se contredisent. Cette apparente contradiction est à mettre au compte de paradigmes multiples et éventuellement contradictoires entre eux des sciences humaines, que Knight suppose en reléguant l’avis 64du scientifique social à une « opinion ». Il incombe aux scientifiques de « vendre » leur science aux masses. Par « vendre », il faut entendre parvenir à montrer que les sciences humaines contribuent à une meilleure vie des hommes dans la société. Knight suggère ici d’adopter la posture paradoxale d’un surplomb cognitif du scientifique (the informed) et de son inclusion dans la société. S’il ne propose pas une taxonomie des intérêts de la connaissance scientifique, il souligne l’impérieuse nécessité d’en défendre l’intérêt, au sens de ce qu’Habermas (1968.b) qualifiera de repolitisation.
[Les sciences humaines ne sont pas en mesure de produire des résultats matériels contrairement aux sciences physiques]. Pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes attachés à la politique de contrôle démocratique dans le premier cas [les sciences physiques], et nous ne sommes pas susceptibles d’y recourir dans le second [les sciences humaines]. En ce qui concerne les résultats matériels, il est relativement peu important que les gens soient profondément convaincus que l’énergie peut être fabriquée comme un produit industriel ou qu’un boulet de canon coule jusqu’au fond de l’océan en conservant la même trajectoire ou qu’il demeure en flottaison à la surface, ou toute autre idée fondamentalement fausse. Nous avons au moins établi, dans ce champ, la tradition selon laquelle le savoir et la formation comptent et nous avons persuadé les ignorants de s’en remettre au jugement des informés. Dans le domaine des sciences naturelles, le public peut et veut aisément saisir, utiliser et monter des appareils dont les fondements scientifiques lui échappent autant qu’ils lui sont indifférents. Il est généralement possible de fournir aux hommes une démonstration à leur échelle, et de leur asséner des « résultats ». Dans le domaine des sciences sociales, cependant, heureusement ou malheureusement, ces choses ne sont pas vraies. Toute notre tradition établie tend à faire croire que « Tom, Dick et Harry » en savent autant que n’importe quel « intellectuel » ; les ignorants ne s’en remettent généralement pas à l’opinion des informés, et si le public n’est pas volontairement déférent, il est généralement impossible de fournir une démonstration objective. Si notre science sociale doit porter ses fruits en améliorant la qualité de la vie humaine, elle doit d’abord être « vendue » aux masses. La nécessité de rendre sa littérature non seulement exacte et convaincante, mais aussi presque « à l’épreuve du non-averti » [foolproof] que possible, est donc manifeste. (p. 11)
Au travers des deux parties de l’ouvrage – abstraction faite d’un propos introductif qui annonce clairement un projet philosophique – trois volets se dégagent de la lecture. Le premier expose, à la manière de Weber, l’idéaltype de marché. Le deuxième aborde la décision dans l’incertitude, et le troisième inscrit l’action entrepreneuriale – issue de l’incertitude – dans la société.
65Un grand pianiste de la première moitié du 20e siècle comparait l’interprétation musicale aux regards que l’on pouvait porter, selon la saison, le temps et l’heure du jour au Gotthard : diversité des approches d’un monument immuable. Nous assumons ici de prendre ce chemin de l’interprétation, et d’aborder RUP sous l’angle de deux questionnements qui émergent de l’ouvrage : la question du contrôle et celle du marketing. Pour autant, nous préservons – parce qu’elle est fondamentale à la compréhension du propos – la progression chronologique de la pensée à l’œuvre.
4.2. premier volet : l’idéaltype du marché
Knight évoque dès son propos liminaire la notion de contrôle, et en livre en creux des éléments de définition qui alimentent la totalité de l’ouvrage, en particulier la troisième partie. Knight conçoit le contrôle comme un avatar de la libre entreprise, qui se matérialise en un système ou une méthode dont l’objet est d’assurer (ou sécuriser) et diriger l’effort collectif dans un groupe social. La méthode en question passe impérativement par une compréhension des caractéristiques fondamentales de l’affaire. À cette occasion, Knight pose pragmatiquement en préalable le développement de ce que Drucker (1954) appellera la theory of the business79, et l’organisation devient ainsi le terrain d’expérimentation de cette dernière. D’emblée l’idée d’une théorie économique transférable à toutes les organisations est rejetée, seules des tendances pouvant être dégagées à un niveau général.
Un objectif étroitement lié est celui de formuler les données du problème de l’organisation économique, les éléments matériels immuables avec lesquels, ainsi que les conditions dans lesquelles, tout mécanisme d’organisation doit fonctionner. Une conception claire et précise de ces éléments fondamentaux est considérée comme une base nécessaire pour répondre à la question de savoir ce que l’on peut raisonnablement attendre d’une méthode d’organisation et, de là, si le système en tant que tel est à blâmer pour son incapacité à atteindre un idéal de résultats, dont, le cas échéant, il serait responsable et quel type de 66modification ou de substitution offre des chances d’amélioration suffisantes pour justifier l’expérimentation. (p. 5)
4.2.1. La première forme de l’idéal-type du marché
Si l’on doit faire correspondre cet idéal-type à un moment de l’histoire, c’est le 19e siècle qui est ici visé (rappelons-nous que Knight est sensible aux perspectives historiques, et ses textes en sont émaillés).
À l’époque où les économistes de l’école classique anglaise écrivaient, c’est-à-dire à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, les grandes entreprises étaient rares, se limitant pratiquement à quelques banques et sociétés commerciales. Il y avait, bien sûr, quelques prêts à intérêt, mais dans la forme dominante d’industrie, les hommes utilisaient leur propre capital, engageaient de la main-d’œuvre et louaient des terres à d’autres. (p. 17).
Dans ce contexte, la question managériale se pose peu, et le contrôle se résume encore à la propriété.
La fonction managériale était centrée sur le capitaliste. (p. 17).
Quant au marketing, il n’y est fait aucune allusion.
4.2.2. La seconde forme de l’idéaltype de marché
Elle est concomitante à l’émergence de la grande entreprise, qui se dote de figures managériales et lance des emprunts à large échelle.
Ce n’est qu’à une époque plus récente que l’accumulation des capitaux, le perfectionnement des institutions financières et le développement de la concurrence ont déplacé le centre d’intérêt vers la capacité commerciale, ont rendu facile ou du moins généralement possible la capacité de lever des fonds alors que l’on n’est pas directement propriétaire, et ont rendu courante l’exploitation d’entreprises principalement sur la base de ressources empruntées. (p. 17)
Cette situation nouvelle est vécue par les protagonistes, c’est du moins l’hypothèse de Knight, comme caractérisée par l’existence de « production jointe et capitalisation » (chapitre iv) et des « changements et de progrès sans incertitude » (chapitre v). Il convient de souligner ici l’adoption d’une posture positiviste, pour laquelle le changement peut ne pas conduire à l’incertain. C’est bien ce que Comte entend par la notion de progrès.
67Mais on comprend vite à lire Knight que ce dernier flaire l’imposture derrière la posture dès lors que deux sujets sont en jeu : le contrôle et le marketing.
Partant de son propos introductif, on comprend que Knight ne peut concevoir que comme une abstraction le contrôle par la simple propriété. Le projet libéral où « chacun contrôle ses propres activités [en étant] le juge définitif et absolu de son propre bien-être et de son intérêt » (p. 42) demeure la caractéristique d’une « société imaginaire ». Il en va de même pour les droits à décider qui se transmettent aux « agences ».
La question de l’entreprise – de la grande entreprise – se pose donc comme celle d’une possibilité. Knight met tant de conditions à son existence sous la forme de ce que Jensen et Meckling qualifieront de fiction juridique recelant un nœud de contrats que l’on peut douter, au même titre que l’auteur, de leur réalisation. La première tient à la vérification de l’hypothèse des rendements décroissants (diminishing returns). La seconde tient à la capacité à combiner les contrats en individualisant la performance. Si ces conditions étaient réunies, l’entreprise serait en effet un nœud de contrats, et l’on ne se poserait pas la question de l’organisation. Pourtant, cette question se pose bien. L’injonction faite à l’homme d’affaires d’« arranger » et d’individualiser les contributions de chacun l’atteste. L’hypothèse de l’Agence proposée en 1978 est perçue, dès 1921, comme relevant d’une société imaginaire. Exit donc, sauf sous certaines conditions, le contrôle par la propriété et la seule contractualisation. Quant à la répartition, elle n’est plus l’affaire des économistes, mais celle du business man qui « trouve bien » (nécessité fait ici loi) les moyens de faire la part entre les productifs et ceux qui ne le sont pas. Pradier et Serrano (2000) voient là une démonstration par l’absurde que la question de la répartition n’est pas un sujet d’économiste, mais – osons le mot – de gestionnaire.
La variabilité des contributions des agences de l’organisation productive, et la variabilité du rendement des différentes agences, conformément au principe des rendements décroissants, ne rendent pas seulement possible l’organisation économique de la société par le libre contrat, mais, en leur absence [ndlr : des rendements décroissants], tout ce qui touche à la question de l’organisation n’aurait pas de sens ; ce problème n’existerait pas. S’il n’était pas possible d’utiliser diverses combinaisons de diverses productivités, avec la possibilité de les comparer, il ne serait pas question d’utiliser un arrangement plutôt 68qu’un autre. L’organisation est nécessaire, elle est possible, et elle n’est réalisée que par le fait que les contributions séparées des organismes distincts à un produit commun peuvent être identifiées. L’organisation par le biais d’un contrat libre dans le cadre de la concurrence est possible, réelle et efficace dans la mesure où un tel système tend à rendre au propriétaire de chaque agence la contribution propre à cette agence. La société moderne est organisée par l’association du contrôle des agences productives avec le droit à leur rendement. Ce n’est que parce que le revenu est plus grand là où le produit est plus important que cette organisation est possible. En l’absence d’une loi reliant la part distributive à la contribution effective, notre système social ne serait pas un système, mais le chaos. Il est donc inapproprié pour les économistes de discuter de la possibilité d’une distinction des contributions à un produit commun ; cette distinction se fait tous les jours ; c’est notre rôle d’expliquer le mécanisme par lequel elle s’opère.
L’homme d’affaires détermine la valeur des différentes agences ou des unités de production et leur contribution au processus de production, sinon il ne pourrait pas exercer son activité. Il est évident que l’homme d’affaires, lorsqu’il détermine l’activité à des agences distinctes, doit penser en termes de contributions additionnées d’unités additionnées – dans le langage économique technique, le produit « marginal » – et il est démontrable que lorsque les unités sont suffisamment petites, la somme de la contribution séparée et spécifique de tous les organismes épuise le produit total. (p. 56).
Demeure qu’en situation de certitude, une action déterminée produit un résultat parfaitement anticipable. Le contrôle relève alors de la pensée logique et la décision managériale est le fruit d’une déduction à partir d’une information exhaustive.
La pensée logique est instrumentale par nature, un dispositif permettant de contrôler et d’utiliser l’environnement. (p. 31)
Le contrôle devient alors le fruit d’un jeu déductif où l’intention conduit à la déduction. Mais une fois de plus, ce mode de pensée voit sa pleine applicabilité limitée à la « société imaginaire ». Qu’en est-il dès lors qu’émerge la grande entreprise ? Le projet knightien devient, si l’on peut se permettre de paraphraser Lamartine, de considérer l’homme contemporain comme « un dieu tombé qui se souvient de la certitude ». La déduction et le calcul n’ont plus pour objet de décider, mais en quelque sorte de rassurer.
Dans cette seconde forme d’idéaltype de marché où l’équilibre devient impossible, l’incertitude émerge également de l’évolution des goûts et des besoins créés par la publicité.
69À l’évidence des changements et même de grandes transformations, affectent les besoins de biens de consommation et les attitudes vis-à-vis des divers types d’activités productives. La plupart de ces changements ne peuvent être traités avec profit en fonction du prix et aucune condition d’équilibre ne peut être définie à leur propos. Ils appartiennent à la catégorie des causes externes peu sujettes à la prédiction « surtout du côté de la production » (p. 78).
Ainsi le côté de la consommation, celui qui concerne directement le marketing est associé à la difficulté de prévoir et à la mise en défaut des mécanismes de marché sensés rétablir l’équilibre.
Il y a un problème très important, plus susceptible de traitement scientifique [que celui de l’évolution des goûts et des besoins] tout en étant très retors. Nous faisons référence à un fait familier, l’usage de ressources économiques par l’entreprise privée pour développer, créer, ou diriger les besoins de consommation : c’est-à-dire à l’usage de la publicité (p. 81).
Bien que le mot marketing ne soit toujours pas prononcé ici comme il le sera plus tard dans l’ouvrage (cela pourrait ne pas être dû simplement au hasard) on reconnaîtra que création de besoin et publicité sont des termes qui lui sont habituellement associés. Si l’on peut analyser l’attitude de Knight vis-à-vis du marketing à ce stade c’est par ce qu’il nous dit de la création de besoin trois mots permettent de la caractériser : incertitude, contradiction, déséquilibre. L’incertitude c’est suivant Knight la nature même de l’activité de création de besoin : « elle est incertaine, aléatoire et risquée » (p. 81). La contradiction c’est que bien qu’incertaine elle puisse, dans certains cas, permettre au libre jeu du marché de remplir sa fonction qui consiste à rétablir l’équilibre économique :
La création de besoin est, bien sûr, très incertaine et aléatoire mais il est évident que, comme pour les autres changements, pour autant que les résultats de l’action puissent être anticipés, la concurrence égalisera les gains avec ceux des autres domaines d’action (p. 81)
Mais justement il n’est pas certain qu’une telle anticipation des résultats de l’action soit vraiment possible (du fait de l’incertitude qui la caractérise), pire encore, Frank H. Knight nous dit que, pour sa part, il en doute, comme il doute que l’hypothèse des rendements décroissants puisse tenir dans le cas de l’investissement dans la création de besoins.
70La création de besoin est-elle sujette aux principes des rendements décroissants générant un processus qui tend vers l’équilibre (équilibre ou cette création serait arrêtée) ou bien est-elle de façon inhérente une cause perpétuelle de changements incessants ? C’est une question que nous ne pouvons discuter de façon aussi rigoureuse qu’elle le mériterait. L’auteur inclinerait plutôt pour la dernière branche de l’alternative (p. 81)
Notons au passage que Frank H. Knight prend position sur deux questions récurrentes s’agissant du marketing et de la publicité : une question épistémologique et une question éthique. La question épistémologique est celle de la différence entre l’information et la persuasion ou encore de la différence entre l’apparence d’un produit et sa réalité. Sur ce point Knight insiste sur le fait que de telles différences n’ont pas de valeur opératoire lorsqu’il s’agit d’analyser la création de valeur par la publicité :
La suggestion peut paraître aventureuse [fanciful] mais je considère qu’il est impossible de faire la différence entre d’une part des éléments de pure forme qui n’affectent que l’apparence d’un bien sans affecter son efficacité par rapport à sa finalité propre (des éléments tels qu’une couleur agréable, un élément décoratif qui souvent même interfère avec ses conditions d’utilisations, un emballage original etc.) et, d’autre part, des éléments de séduction tels qu’un nom qui sonne bien ou toute autre forme de mise en valeur [puffling]. Tout ceci compte pour la façon dont le consommateur évalue la marchandise : dans le système d’échange le consommateur est juge de dernier recours. S’il trouve que les choses sont différentes, elles sont différentes ; s’il est prêt à acheter telle chose plutôt que telle autre, c’est que la première est supérieure à la seconde ; elle contient des « utilités » que l’autre n’a pas. Je ne vois pas quelle différence réelle cela fait suivant que ces « utilités » sont dans la chose elle-même ou dans tel élément qui lui est associé (note 92 de la page 81, p. 219)
La question éthique est évoquée à propos de la publicité.
Le dénigrement des marchandises concurrentes doit être écarté de tout examen pour la même raison que le cambriolage et les fraudes grossières… On se rappellera que nous avons explicitement éliminé l’effet des intérêts non représentés dans les transactions du marché (note 92 de la page 81, p. 219).
À l’instar de la grande entreprise, la création des besoins (wants) déstabilise l’idéal type de marché en créant de facto des situations d’incertitude.
714.3. deuxième volet : la situation d’incertitude.
L’incertitude knightienne est synonyme d’inconnu. Elle n’est pas réductible, et le travail managérial y prend une dimension tout autre. Elle occupe la dernière partie de l’ouvrage dont le titre « Concurrence Imparfaite du fait du Risque et de l’Incertitude » évoque directement le point essentiel de son analyse : le rôle central que joue dans la théorie du marché « l’hypothèse de l’omniscience pratique de la part de tous les membres du système compétitif ». Cette hypothèse abandonnée, il s’agit alors « d’éclairer un vaste ensemble de phénomènes économiques qui sont reliés à l’imperfection de la connaissance » (p. 99). C’est alors, dans un chapitre voué aux méthodes permettant de faire face à l’incertitude, que Knight consacre de longs développements au management en général et au contrôle et au marketing en particulier.
Les moyens de faire face à l’incertitude (si tant est que le but soit de s’y opposer), sont de deux ordres. Tout d’abord les dispositifs institutionnels qui correspondent à une forme de contrôle social, ensuite l’usage des heuristiques qui relève du contrôle entrepreneurial.
4.3.1. Le contrôle social est évoqué, mais ses modalités demeurent
à définir au-delà du jeu régi par la constitution.
Dans le schéma libéral qui nourrit la pensée knightienne, l’incertitude découle de l’émergence des situations monopolistiques. Knight souligne le rôle de l’opinion publique dans l’opposition aux situations monopolistiques.
Le monopole des entreprises de production a jusqu’à présent été d’une importance limitée dans les affaires courantes, et ce pour plusieurs raisons. La plupart des ressources productives ne sont spécialisées que dans une mesure limitée, et sont soumises à la concurrence effective d’un large éventail de substituts. Et dans un monde jusqu’ici peu développé et en rapide évolution, la plupart des entreprises, même les plus spécialisées, ont vu leur offre augmenter rapidement et irrégulièrement grâce à de nouvelles découvertes, et ont été sujettes à une croissance volontariste grâce à des dépenses modérées en activités d’exploration et de développement. Enfin, l’organisation à grande échelle nécessaire pour assurer un contrôle unifié s’est révélée rudimentaire et imparfaite, tandis que l’opposition de l’opinion publique a gagné en force. Il est intéressant d’examiner les implications d’une concurrence absolument libre à cet égard. (p. 96)
72Il revient donc à la société, par des moyens que l’auteur ne détaille pas (du moins Knight pense-t-il à la législation anti-trust aux États-Unis, qui découlent de la loi de Sherman promulguée en 1890), de contrer les projets de monopoles.
Mais la question centrale demeure la nature de l’entrepreneur. Tel que Knight le décrit, il incarne celui que l’on qualifiera ultérieurement de décideur. La décision fondée sur la prédiction est impossible, et le recours à la probabilité n’est pas la manifestation d’un « état » mais bien celle de notre méconnaissance du futur.
Pourtant, dans la pratique, il n’y a aucun risque, au sens figuré, que l’un de ces phénomènes puisse un jour faire l’objet d’une prédiction valable dans un cas particulier. Le fait fondamental qui sous-tend le raisonnement probabiliste est de manière générale notre ignorance supposée. S’il était possible de mesurer avec une précision absolue toutes les circonstances déterminantes, dans une situation donnée, nous devrions être en mesure de prédire le résultat dans chaque cas spécifique, mais il est évident que dans de nombreux cas, nous ne pouvons pas le faire. (p. 110)
4.3.2. Pour comprendre l’homme d’affaires anticipatif, une théorie behaviorale de la connaissance, puis de l’organisation est proposée.
À l’homme d’affaires déductif de la « société imaginaire », Knight oppose la figure de l’entrepreneur anticipatif. À défaut de connaître le futur, lorsque des adaptations de ses schèmes sont requises, ce dernier procède par inférence.
Ce que la conscience en tant que telle a à voir avec cela est un mystère qui restera sans doute impénétrable. C’est un simple fait brut que partout où nous trouvons des adaptations compliquées, nous trouvons la conscience, ou du moins nous sommes obligés de la construire par inférence. La science ne peut lui trouver aucune place, ni aucun rôle à jouer dans la séquence causale. Elle est un épiphénomène. L’explication du réajustement se fait nécessairement en termes de stimulus et de réponse, dans cet ordre temporel. Pourtant, dans notre propre expérience, nous savons que nous ne réagissons pas à un stimulus passé, mais à l’« image » d’un état des choses futur ; et pour le sens commun, la conscience, l’« image », est à la fois présente et opérante partout où les adaptations sont dissociées de tout stimulus immédiat, c’est-à-dire qu’elles sont « spontanées » et tournées vers l’avenir. Il est évident que toutes les réactions d’êtres vivants [organic] se rapportent à des situations futures, plus éloignées dans l’avenir, à mesure que le type de vie et d’activité est « supérieur ».
73Quel que soit le succès de la science mécaniste pour expliquer la réaction par des causes passées, il sera toujours irrésistiblement commode pour le sens commun de penser qu’elle est provoquée par une situation future présente à la conscience. Le rôle de la conscience est de donner à l’organisme cette « connaissance » de l’avenir. Pour tout ce que nous pouvons voir ou pour tout ce que la science ne pourra jamais nous dire, nous pourrions tout aussi bien être des automates inconscients, mais nous ne le sommes pas. Du moins, celui qui parle ne l’est pas, et il ne peut s’empêcher d’attribuer à d’autres créatures constituées de la même façon et se comportant de la même manière que lui des « intérieurs », pour reprendre le terme pittoresque de Descartes, comme le sien. Nous percevons le monde avant d’y réagir, et nous ne réagissons pas à ce que nous percevons, mais toujours à ce que nous déduisons. (p. 101)
Il est ici essentiel de comprendre que loin d’inhiber l’entrepreneur (pour ne pas dire le sujet en général), l’incertitude libère. Là où la déduction dicte notre ligne de conduite, nous réagissons à ce que nous nous projetons sur le futur à défaut de ce que nous percevons, qui ne peut être que de l’ordre du passé. L’ignorance est libératrice. Sans l’indéterminisme, nous serions condamnés à suivre des raisonnements logiques que la connaissance exhaustive nous imposerait – c’est ici la différence qu’opère Knight entre conscience et connaissance. Nous devons assumer que nous sommes des sujets réflexifs, et non des agents sachants déductifs. Au-delà de la théorie de la connaissance c’est une question anthropologique qui est en jeu.
Si l’indétermination est bien réelle, et si son siège ultime se trouve dans les activités de la machine humaine (ou peut-être dans l’être vivant), il y a en quelque sorte une porte ouverte à une conception de la liberté dans la conduite de nos actes. Et lorsque nous considérons le mystère du rôle de la conscience dans le comportement et la répugnance qu’éprouve le sens commun à l’égard de la théorie comme épiphénomène, nous nous sentons justifiés de défendre au moins la possibilité que l’« esprit » puisse, d’une manière insondable, être à l’origine de l’action. (p. 111)
Une fois de plus, nous voilà plongés dans le paradoxe d’une réaction à un stimulus…interne. Le discours de Knight glisse clairement dans le domaine de la psychologie cognitive, mais lève le lièvre de l’autoréférence décisionnelle, une posture difficilement tenable pour l’institutionnaliste qu’il dit parfois vouloir être. Comment résoudre ce qui pourrait devenir une « boucle » à la Bateson ou à la Watzlawick ?
74La forme universelle du comportement conscient est donc une action destinée à modifier une situation future déduite d’une situation présente. Elle implique la perception et, en outre, une double inférence. Nous devons déduire ce que la situation future aurait été sans notre intervention, et quel changement y sera apporté par notre action. Heureusement ou malheureusement, aucun de ces processus n’est infaillible, ni même jamais précis et complet. Nous ne percevons pas le présent tel qu’il est dans sa totalité, nous ne déduisons pas l’avenir du présent avec un haut degré de fiabilité, et nous ne connaissons pas non plus avec précision les conséquences de nos propres actions. En outre, il existe une quatrième source d’erreur à prendre en compte, car nous n’exécutons pas les actions sous la forme précise dans laquelle elles sont imaginées et voulues. La présence de l’erreur dans ces processus est peut-être une phase du mystère fondamental des processus eux-mêmes. Elle semble être un gage de leur caractère non-mécanique, car les machines, en général, ne font pas d’erreurs. […]. Quoi qu’il en soit, le fait de pouvoir se tromper nous est douloureusement familier et c’est tout ce qui nous intéresse ici. Il est intéressant de noter que les facultés de perception semblent souvent moins aiguisées et moins fiables dans les formes de vie supérieures que dans certaines formes inférieures. Du moins l’homme civilisé est-il souvent faible à cet égard par rapport à l’homme primitif et aux animaux supérieurs. Les pouvoirs de déduction supérieurs peuvent remplacer dans une large mesure les facultés de perception, et nous avons sans aucun doute développé le pouvoir de raisonnement et perdu du terrain en ce qui concerne l’acuité des sens.
Il faut reconnaître en outre qu’aucune distinction nette ne peut être établie entre la perception et la raison. Nos facultés perceptives sont hautement éduquées et sophistiquées, et ce qui est présenté à la conscience dans la situation la plus simple est plus le produit d’une inférence, plus une construction imaginaire qu’une communication directe des organes terminaux nerveux. Un animal rationnel ne diffère d’un animal simplement conscient que par son degré ; il est plus conscient. Il est indifférent de dire qu’il déduit plus ou qu’il perçoit plus. Scientifiquement, nous pouvons analyser le contenu mental en données de sens et en données d’imagination, mais la différence n’existe guère pour la conscience elle-même, du moins dans ses aspects pratiques. Même dans la « pensée » au sens étroit, lorsque l’objet de la réflexion n’est pas perceptible, l’expérience elle-même est sensiblement la même.
La fonction de la conscience est de déduire, et toute conscience est largement inférentielle, rationnelle. Nous voulons dire par là que les choses qui ne sont pas perceptibles sont actives et dirigent le comportement, que la raison, et toute conscience, est tournée vers l’avenir ; et un élément essentiel du phénomène est son manque d’exactitude mécanique automatique, son risque d’erreur. (p. 101)
75Ainsi est admise l’impossibilité de développer une science sociale des causes, qu’elle soit économique ou non. L’analyse que Knight propose par la suite prend pour point focal la manière dont nous produisons l’inférence. Le mécanisme décrit est proprement psychologique, et nous voyons s’y dessiner une prophétie des théories behaviorales de la firme et de la décision : le sens commun fonctionne dans un monde d’objets ou encore de « choses ». Par conséquent, l’idée de choses qui rendent perceptibles des modes constants ou répétitifs de comportement constitue une meilleure clé de connaissance que celle d’une régularité des relations [causales] entre les phénomènes (p. 102). Le présupposé knightien est que les choses adoptent des comportements réguliers dans des circonstances analogues. Dans l’incertitude, la science économique doit chercher la stabilité.
Bergson a donc raison mais il est mal compris selon Knight (p. 105). Dans la mesure où Bergson nous affirme, à l’instar d’Héraclite, qu’il y a « un changement réel », raisonner est impossible. Nous inférons des similarités qui nous permettent de catégoriser les objets dont nous relevons des régularités. C’est bien là la limite de la connaissance. De ce fait, l’opération mentale par laquelle les décisions s’opèrent n’a que peu d’intérêt, si tant est qu’elle soit analysable tant elle relève de jugements fondés sur des expériences propres à chaque individu. En ce sens, elle constitue une heuristique, qui se distingue de la même notion chez Herbert Simon dans la mesure où celui-ci en fait le mode d’accès à la définition d’une procédure rationnelle.
Les opérations mentales par lesquelles les décisions pratiques ordinaires sont prises sont très obscures, et il est surprenant que ni les logiciens ni les psychologues n’aient manifesté beaucoup d’intérêt pour elles. Peut-être (l’auteur incline pour cette opinion) est-ce parce qu’il y a vraiment très peu à dire sur le sujet. La prophétie semble être un peu comme la mémoire elle-même, sur laquelle elle est fondée. Lorsque nous voulons penser au nom d’un homme, ou nous souvenir d’une citation qui nous a échappé, nous nous mettons au travail pour y parvenir, et l’idée désirée nous vient à l’esprit, souvent lorsque nous pensons à autre chose – ou bien elle ne vient pas, mais dans les deux cas, il y a très peu de choses à dire sur l’opération, très peu de « technique ». Ainsi, lorsque nous essayons de décider ce à quoi nous devons nous attendre dans une certaine situation, et comment nous comporter en conséquence, nous sommes susceptibles de produire beaucoup de divagations mentales non pertinentes, et la première chose que nous savons, c’est que nous avons pris notre décision, que notre ligne de conduite est fixée. Ce qui s’est passé dans 76notre esprit semble avoir très peu de sens, et certainement peu de parenté avec les processus formels de logique que le scientifique utilise dans ses recherches. Nous opposons les deux processus en reconnaissant que le premier n’est pas une connaissance raisonnée, mais un « jugement », un « bon sens » ou une « intuition ». Il y a sans doute une part d’analyse grossière, mais dans l’ensemble, il semble que nous « inférions » largement de notre expérience du passé dans son ensemble, un peu de la même manière que nous traitons des problèmes intrinsèquement simples et inanalysables, comme l’estimation des distances, des poids ou d’autres grandeurs physiques, lorsque nous n’avons pas d’instruments de mesure sous la main. (p. 106).
Demeure la question de l’autoréférence dans la construction de l’opinion. Le substitut nécessaire de la déduction qu’est l’heuristique inférentielle repose sur la référence au passé et à autrui. Le mimétisme (que nous qualifierions aujourd’hui de piagétien en cela qu’il produit une forme d’apprentissage par l’imitation et la répétition des schèmes acquis par le passé) est à la base de l’inférence, si bien que la projection dans le futur n’est pas purement autonome. Pour comprendre cela, il faut revenir aux définitions des probabilités que Knight soumet au lecteur. Certains ont pu y percevoir une gradation ou un continuum de situations réelles, alors que Knight semble tout au contraire catégoriser les heuristiques à l’œuvre en situation d’incertitude. Faut-il rappeler ici que Knight oppose deux situations ? L’une imaginaire, est l’univers certain, l’autre, notre lot commun, est l’univers incertain. Le risque désigne finalement les heuristiques de réduction de l’incertitude fondées sur les probabilités, et Knight les présente non pas comme des états possibles de la nature, mais comme des attitudes adoptées par les individus dans l’ignorance du futur.
La classification des probabilités (p. 113) renvoie aux théories de la connaissance balayées par Knight. Les deux premières relèvent de la pensée du risque en tant que tentative de réduction de l’incertitude, la troisième relève de l’acceptation de l’incertitude :
1. La probabilité abstraite, fondée sur la logique mathématique et sur une connaissance exhaustive des cas possibles (instances) tirée d’inductions de l’expérience en dernière instance ;
2. Les probabilités statistiques fondées sur les observations passées et dont l’usage suppose que la fréquence se reportera dans le futur – et qu’aucun autre événement inconnu ne surviendra.
773. Les estimations, qui relèvent des heuristiques déjà évoquées ci-dessus.
Knight aborde les estimations sous l’angle de leurs complications – à comprendre en français comme une complication horlogère tant l’auteur de RUP prend goût à entrer dans les détails d’une mécanique complexe. En tant que complication, le mimétisme relève justement d’une pensée du probable (nous rejoignons ici quelque 50 ans en avance la théorie des conventions80). Knight parle alors d’une « induction inconsciente ». La régularité des actions inspire l’action propre. Le renvoi vers la psychologie comportementale et l’anticipation des théories behaviorales de la firme est patente.
Une complication encore plus intéressante, et d’une importance pratique beaucoup plus grande, est la possibilité de former une classe de cas similaires sur des bases entièrement différentes. C’est-à-dire qu’au lieu de prendre objectivement les décisions d’autres hommes dans des situations plus ou moins similaires, on peut prendre les décisions du même homme dans toutes sortes de situations. Il est incontestable que cette procédure est appliquée dans une très large mesure et qu’un nombre stupéfiant de décisions repose en fait sur un tel jugement de probabilité, bien qu’il ne puisse être placé sous la forme d’une détermination statistique précise. En d’autres termes, les hommes se forgent, sur la base de l’expérience, des opinions plus ou moins valables quant à leur propre capacité à former des jugements corrects, et même quant aux capacités des autres hommes à cet égard. Bien sûr, les deux bases de classification sont plus ou moins prises en compte ; l’estimation (par A ou par n’importe qui d’autre) de la probabilité que le résultat d’une situation soit celui que A a prédit n’est pas basée sur une estimation parfaitement générale de la capacité de A à former des jugements, mais sur ses pouvoirs dans un domaine de prédiction plus ou moins défini. Le lecteur comprendra immédiatement que cette capacité à former des jugements corrects (dans un domaine plus ou moins étendu ou restreint) est le principal facteur qui rend un homme utile dans les affaires ; c’est l’activité humaine caractéristique, la capacité la plus importante pour laquelle des salaires sont perçus. La stabilité et le succès de l’entreprise commerciale en général dépendent en grande partie de la possibilité d’estimer les pouvoirs des hommes à cet égard, à la fois pour affecter les hommes à leurs postes et pour fixer les rémunérations qu’ils doivent recevoir pour occuper ces postes. Le jugement ou l’estimation de la valeur d’un homme est un jugement de probabilité d’une nature complexe, en effet. Plus ou 78moins fondé sur l’expérience et l’observation du résultat de ses prévisions, il s’agit sans doute surtout, après tout, d’un simple jugement intuitif ou d’une « induction inconsciente », comme on préfère. (p. 115).
L’homme d’affaire dépourvu de sa capacité calculatoire et combinatoire revêt donc d’autres qualités. La confiance qui résulte de cette évaluation de l’homme par l’homme échappe elle aussi au domaine de la science.
La logique ultime, ou la psychologie de ces délibérations est obscure, elle fait partie du mystère scientifiquement insondable de la vie et de l’esprit. Nous devons simplement nous rabattre sur une « capacité » de l’animal intelligent à former des jugements plus ou moins corrects sur les choses, un sens intuitif des valeurs. Nous sommes construits de telle sorte que ce qui nous semble raisonnable a des chances d’être confirmé par l’expérience, sinon nous ne pourrions pas du tout vivre dans le monde. (p. 114)
Cette logique d’opinion permet de penser la spécialisation, reconnaissance de la capacité d’une personne à faire face à certains types de situations. Une justification originale de l’expertise, qui fait de l’expert un individu agissant plutôt que sachant. Une justification, également, de la division du travail managérial.
La spécialisation implique la concentration, et la concentration implique la consolidation ; et quelle que soit l’hétérogénéité des « affaires », les gains et les pertes se neutralisent mutuellement dans l’ensemble, dans une mesure qui augmente avec le nombre d’affaires regroupées. (p. 130)
C’est dans ce contexte que Knight est conduit à parler, cette fois explicitement, du marketing.
Il écrit encore :
En dehors de la spéculation organisée [spécialisation dans le domaine de la prise de risque] telle qu’elle est pratiquée en relation avec les échanges de produits et de titres, le principe de spécialisation est exemplifié par la tendance des domaines hautement incertains et spéculatifs de la vie industrielle à se séparer progressivement des aspects stables et prédictibles et à être assumés par des établissements différents. Ceci est évidemment ce qui s’est passé dans la forme ordinaire de spécialisation déjà remarquée, à savoir, la séparation de la fonction marketing des aspects technologiques de la production, la première étant plus spéculative que les seconds (p. 130).
79Ces considérations conduisent Knight à s’interroger sur les méthodes qui permettent de mieux confronter l’incertitude et, en particulier celles qui permettent d’obtenir une meilleure connaissance et un meilleur contrôle sur le futur. C’est alors qu’il est amené à revenir sur la question de l’information en marketing à travers le phénomène publicitaire.
Dans le champ de l’information des consommateurs, nous avons le développement toujours plus impressionnant de la publicité. Ce phénomène complexe ne peut être discuté ici en détail au-delà du fait qu’il est lié à l’ignorance et à la nécessité du savoir pour guider l’action. Seule une part de la publicité est informative. Une part plus grande est consacrée à la persuasion qui est une chose différente de la conviction et, peut-être, à la stimulation ou à la création de nouveaux besoins, fonction qui peut être distinguée de l’une ou de l’autre. En plus de la publicité, la plupart des dépenses d’éducation sont liées à l’information des populations à propos de la façon de satisfaire ses besoins, à l’éducation du goût. Le fait remarquable est que l’ambiguité de l’incertitude qui traverse toutes les relations de vie apporte avec elle le fait que l’information est une des marchandises principales que tente de fournir l’organisation économique De ce point de vue, il importe peu de savoir si « l’information » est vraie ou fausse ou si elle n’est que suggestion hypnotique. Comme dans d’autres domaines de l’activité économique le consommateur est le juge final… Ceux qui sont moralement scrupuleux (et naïfs) peuvent protester qu’il y a une distinction entre utilité réelle et nominale ; mais ils finiraient par trouver très dangereux pour leur optimisme de tenter de poursuivre cette distinction trop loin. Après examen, on trouvera que la plupart des choses pour lesquelles nous dépensons nos revenus et que nous désirons, et en particulier de façon notable pratiquement toutes les valeurs « spirituelles » les plus élevées, tendent à tomber dans la deuxième catégorie. (p. 133)
En résumé, on voit que le marketing est associé par Knight à la présence de l’incertitude, à l’abandon du modèle de la concurrence parfaite, à la double confusion de l’information et de la persuasion, du réel et du nominal, du vrai ou faux. L’opposition du vrai au vraisemblable, de la raison au raisonnable est ce qui marque le passage de la science à l’art de persuader, à la rhétorique.
804.3. troisième volet : l’entreprise et la société
C’est en examinant la possibilité du contrôle entrepreneurial comme celui qui embrasse l’incertitude que Knight établit le lien entre l’entreprise et la société.
Steiner (1997) a mis en évidence la tradition qui de Cantillon81 (1755) à Knight, relie l’entrepreneur à l’incertitude. Le chapitre viii de RUP, après une longue analyse des processus cognitifs, laisse effectivement la place à des acteurs qui jusque-là demeuraient sinon désincarnés, du moins en retrait du phénomène social (dans la société imaginaire, c’est tout de même à l’homme d’affaires de procéder à la répartition, voir supra). C’est bien l’inclusion sociale de l’entrepreneur dont il est question dans ces propos conclusifs. Le manager-entrepreneur est celui qui embrasse l’incertitude et confie la gestion des risques à des subalternes que Knight ne nomme pas (ce sont « d’autres »). Le contrôle – terme toujours présent – s’y conçoit comme la préparation du futur (p. 191), quand « d’autres » essaient de réduire la décision à des calculs probabilistes. La question de la responsabilité est sous-jacente, et le vecteur de cette action est l’investissement vu comme le renoncement immédiat pour permettre une consommation ultérieure, mais dans un cycle où la consommation ultérieure sera réfrénée par la nécessité d’investir pour le futur. L’abstinence doit être permanente : une manière de « frugalité de progrès » très éloignée des modèles de maximisation de l’utilité.
La théorie sociale de la propriété privée ne repose donc pas tant sur l’hypothèse que les ressources productives seront plus efficacement utilisées dans la création de biens de consommation, que sur la croyance qu’il y aura une plus grande stimulation du progrès en incitant les hommes à prendre les risques d’une action qui augmente les réserves de ressources productives elles-mêmes, comprenant à la fois les choses matérielles et les connaissances et compétences techniques. Nous avons montré, dans notre discussion sur l’intérêt, l’erreur que l’opinion générale commet en considérant que l’accumulation et le sacrifice prospectif peuvent être expliqués sur la base de la préférence temporelle dans la consommation. Un renoncement à la consommation présente au bénéfice de la consommation future n’augmente généralement pas la consommation totale de l’individu qui investit, et en outre le simple report de la consommation ne donnerait lieu à aucune 81augmentation nette considérable de l’équipement social. L’« abstinence » doit être permanente, et non une simple question d’attente. Il s’ensuit que la justification de la propriété privée doit reposer sur l’hypothèse que le simple désir de propriété est un motif plus puissant pour obtenir des sacrifices et un contrôle efficace dans ce domaine que le désir de consommer une plus grande quantité de biens. La politique sociale de la propriété privée est saine, si tant est qu’elle le soit, parce que le désir de posséder des richesses conduira les hommes à sacrifier la consommation et à prendre des risques de perte totale afin d’accroître leur propriété. La véracité ou l’invalidité de cette hypothèse n’est pas notre préoccupation actuelle, mais il semble utile de souligner quelques faits en rapport avec son application. (p. 193).
L’engagement de l’entrepreneur s’inscrit clairement dans la préservation des générations futures.
Outre le flambeau de la vie elle-même, les richesses matérielles du monde, un système technologique d’une complexité vaste et croissante et les habituations qui rendent les hommes aptes à la vie sociale doivent, d’une manière ou d’une autre, être transmis à de nouveaux individus nés sans toutes ces choses, au fur et à mesure que les individus plus âgés disparaissent. (p. 193).
L’histoire knightienne conduit à la généralisation de l’incertitude. L’incertitude semble bien devenir, à regarder autour de soi, la seule pensée possible du moment. Et Knight de dessiner – à titre posthume pour nous lecteurs de son grand œuvre – un monde paradoxal où l’incertitude suscite une défiance délétère à tout lien social, mais où elle permet le doute, qui rend possible la liberté.
en guise d’épilogue
Est-il temps de rappeler à quel point la question de l’histoire est au centre de l’approche knightienne des sciences sociales ? En voulant tronquer RUP de sa partie consacrée à l’incertitude, en prétendant qu’elle aurait dû être un « tiré à part », le Stigler de la préface à l’édition de 1971 nous signifiait clairement que pour sa part il voulait protéger l’exposé de « la partie centrale de la théorie économique » exposée par Knight des atteintes du temps. Il est vrai que Frank Hyneman Knight 82lui-même semble nous dire que le temps n’est pas venu de mettre ces considérations historiques au centre de l’analyse en disant, comme dans le passage ci-dessus, « la véracité ou l’invalidité de cette hypothèse n’est pas notre préoccupation actuelle mais il a semblé utile de souligner quelques faits … » ou encore en parsemant le texte au style prophétique qui évoquait le caractère « hégélien », « autocontradictoire » de la notion de concurrence parfaite, de remarques relative à son cacaractère inactuel :
« l’industrie a été sauvée jusque là … », « pendant combien de temps pourra-t-on compter sur ces bienfaisantes limitations… », « Ce sujet ne nous intéresse pas particulièrement ici, mais il a semblé utile de souligner, dans le cadre de la discussion d’un système idéal de concurrence parfaite … ».
L’œuvre de Knight nous offre une occasion privilégiée de réfléchir à la tension entre théorie et histoire. Le prophète a survécu à sa prophétie ce qui nous permet de mesurer la façon dont son propre point de vue a été affecté par le temps. C’est ce que permet la confrontation de deux textes, la préface de RUP,en 1921, et le début de l’article intitulé Empiricism and Institutionalism de 1952, par lesquels nous conclurons ce « Grand Angle » consacré à Frank H. Knight
Il n’y a pas grand-chose de fondamentalement nouveau dans ce livre ; il représente une tentative pour énoncer les principes essentiels de la doctrine économique conventionnelle avec plus de précision et pour montrer leurs implications avec plus de clarté que cela n’a été fait jusque là ; c’est-à-dire que son objet est le raffinement et non la reconstruction ; c’est une étude de « théorie pure ». La motivation de sa présentation est double. En premier lieu, l’auteur garde l’espoir, face aux tendances pragmatiques et philistines de l’époque actuelle, particulièrement caractéristiques de la pensée de notre pays, qu’une réflexion attentive et rigoureuse dans le domaine des problèmes sociaux a, après tout, une certaine importance pour le bien et le malheur de l’humanité. En second lieu, il a le sentiment que le « pragmatisme » de l’époque est une phase passagère, voire, dans une certaine mesure, une pause ; qu’il existe un fort courant de mécontentement à l’égard d’une pensée lâche et superficielle et un réel désir, par pur respect intellectuel, de parvenir à une compréhension plus claire de la signification des termes et des dogmes qui passent pour représenter des idées. (p. 5)
Maintenant, la théorisation est une fantaisie que certains affectionnent et que d’autres détestent. Ou plus souvent, peut-être, les hommes aiment leurs propres théories et abhorrent ou rejettent celles des autres – souvent en 83se targuant d’être « anti-théorie » alors qu’ils sont notoirement susceptibles d’être les plus théoriques de tous. Ou encore, ils aiment être originaux ou intéressants et donc « reconnus » et plus sollicités.
La psychologie de la croyance et de la controverse est au moins aussi importante que la vérité, et tend de plus en plus à prédominer sur ce dernier intérêt, à mon avis. Quoi qu’il en soit, ma tâche ici n’est ni d’enterrer la théorie ni d’en faire l’éloge, mais d’essayer d’esquisser les relations entre certains points de vue qui ont été proposés pour l’étude de l’économie. Mon seul préjugé est […] que si nous avons une théorie, elle doit être correcte, et je suis sûr que nous l’aurons toujours parmi nous (comme la pauvreté et en partie pour cette raison). Cependant, je dois dire qu’en observant l’histoire, l’état actuel et les perspectives de la pensée économique et de la politique économique, on peut douter de l’importance d’une théorie correcte. Mais je persiste à penser qu’elle devrait être correcte, et que la différence pourrait être significative sur le plan pratique82.
84BIBLIOGRAPHIE
Ammous S., Phelps E. (2015), « Climate Change, the Knowledge Problem, and the Good Life », The Journal of Private Enterprise, vol 30, no 1, p. 35-45. http://journal.apee.org/index.php/Private.Enterprise.v30.n1.2015.Spring_parte2.pdf (dernière consultation le 14/09/2021).
Arrow K.J. (1950), « A Difficulty in the Concept of Social Welfare », Journal of Political Economy, vol. 58, no 4, p. 328-346.
Asso P.F., Fiorito L. (2005), Abstract – « Was Frank Knight an institutionalist ? », Quaderni, Università degli Studi di Siena departemento di economia politica – no 621.
Boltanski L., Thévenot L. (1991), De la justification : les économies de la grandeur, Gallimard Essais, Paris, 483 p.
Buchanan J. (1967), « Politics and Science : Reflections on Knight’s critique of Polanyi », Ethics, vol. 77. no 4, p. 303-310.
Cantillon, R. (1755, rééd. 2010), Essai sur la nature du commerce en général, Kessinger Publishing.
Chase W. G., Simon H. A. (1973), « Perception in chess », Cognitive Psychology, vol. 4, no 1, p. 55-81.
Coase R. H. (1977), « Advertising and Free Speech », Journal of Legal Studies, vol. 6 no 1, p. 1-34.
Coase R. H. (1974), « The Market for Goods and the Market for Ideas », American Economic Review, vol. 64 no 2, p. 384-391.
Coase R. H. (1960), « The Problem of Social Cost », The Journal of Law & Economics, vol. 3, p. 1-44.
Coleman J.S. (1990). « Commentary : Social Institutions and Social Theory », American Sociological Review, no 3, p. 333-339.
DiMaggio P., Powell W. (19 !3), « The Iron-Cage Revisited : Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Field », American Sociological Review, no 48, p. 147-160.
Douglas M. (2001), « Dealing with Uncertainty », Ethical Perspectives, vol. 8 no 3, p. 145-155.
Douglas M. (1986), How Institutions Think, Syracuse University Press.
Drucker P.F. (1957), La pratique de la direction des entreprises, titre original paru en 1954 (Harper and Row, New York) The Practice of Management, traduit par le bureau des Temps Élémentaires, Les Éditions d’Organisation, Paris.
85Emmet R.B. (2021), « Uncertainty and the social organization of economic activity », The journal of Institutional Economics, Tiré à part Cambridge University Press, 20 avril, p. 1-13.
Emmett R.B. (2013), « Frank Knight on Institutionalism and Economics », Working paper. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2307171 (dernière consultation 12/09/2021).
Emmet R.B. (2009), Frank Knight and the Chicago School of Economics, Routledge, Londres, Royaume Uni.
Emmett R.B. (2006), « Frank Knight, Max Weber, Chicago Economics and Institutionalism », Max Weber Studies, Department of Applied Social Sciences, London Metropolitan University, Old Castle Street, London, p. 101-119.
Emmett R.B. (1973), « Frank Knight and The Committee on social Social Thought, contrasting vision of interdisciplinarity in the 1950s », working paper, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2307185 (dernière consultation 16/07/2021), 21 p.
Fiorito L. (2011), « Frank Knight, John Dewey, and American Pragmatism : A Further Note », Research in the History of Economic Thought and Methodology, vol. 29 no 1, p. 59-72.
Gruchy A.H., Hill F.G., Knight F.H., Parsons K.H., Clarence E. (1957), « Discussion – A New Look at Institutionalism », American Economic Review, vol. 47 no 2, p. 13-27.
Habermas J. (1968, trad.1973.a), « Connaissance et Intérêt », in La technique et la science comme « Idéologie », trad. J.R. Ladmiral, Gallimard.
Habermas J. (1968, trad.1973.b), « Scientifisation de la politique et opinion publique », in La technique et la science comme « Idéologie », trad. J.R. Ladmiral, Gallimard.
Hodgson G. (2001), « Frank Knight as an institutional economist », Economics Broadly Considered – Essays in Honour of Warren J. Samuels, Jeff E. Biddie, John B. Davisof G. Medema (éd.), Taylor & Francis Group, 30 p.
Hodgson G. (2004), The Evolution of Institutional Economics, Londres, Routledge.
Hodgson G. (1998), « The approach of institutional economics », Journal of economic literature, vol. XXXVI, p. 166-192.
Knight F.H. (2014), The Ethics of Competition, Martino Publishing.
Knight F.H. (1967), « Laisser Faire : Pro and Con », Journal of Political Economy, vol. 75 no 6, p. 782-795.
Knight F.H. (1966), « Abstract Economics as Absolute Ethics », Ethics, vol. 76 no 3, p. 163-177.
Knight F.H. (1960), Intelligence and Democratic Action, Cambridge University Press.
86Knight F.H. (1959), « The Social Philosophy and Institutions of the West », Philosophy East and West. Preliminary Report on the Third East-West Philosophers’ Conference, vol. 1, no 1/2, p. 71-73.
Knight F.H. (1952), « Institutionalism and Empiricism in Economics », The American Economic Review, vol. 42, no 2, p. 45-55.
Knight F.H. (1949), « Virtue and Knowledge : The View of Professor Polanyi », Ethics vol. 59 no 4, p 271-284.
Knight F.H. (1948), « Free Society : Its Basic Nature and Problem », Philosophical Review, vol. 57 no 1, p. 39-58.
Knight F.H. (1946), « The Sickness of Liberal Society », Ethics, vol. 56 no 2, p. 79-85.
Knight F.H. (1938), « Lippman’s The Good Society », Journal of Political Economy, vol. 46, no 6, p. 861-872.
Knight F.H. (1935), « Review by : Frank H. Knight – Institutional Economics. Its Place in Political Economy by John R. Commons », Columbia Law Review, vol. 35, no 5, p. 803-805.
Knight F.H. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, Houghton Mifflin, Boston, Massachussets. Online Liberty Fund.
Knight F.H., Merriam T.H. (1948), The Economic Order and Religion, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Londres.
Laufer R. (2017), « Peut-on faire l’économie de l’incertitude ? », in Musso P. (coord.), L’entreprise contre l’État ?, Manucius, Paris.
Parsons T. (1990, première édition 1934), « Prolegomena to a Theory of Social Institutions », American Sociological Review, vol. 55, no 3, p. 319-333.
Patinikin D. (1973), « Frank Knight as Teacher », The American Economic Review, vol. 63, no 5, p. 787-810.
Pradier P. C., Serrano D.T. (2000), « Frank H. Knight. Le risqué comme critique de l’économie politique », Revue de synthèse, sem. 4, no 1-2, p. 79-116.
Rutherford M. (2011), « Chicago and Institutional Economics ». Working paper. https://bfi.uchicago.edu/wp-content/uploads/Rutherford_paper.pdf (dernière consultation 12/09/2021).
Rutherford M. (1994), Institutions in economics : the old and the new institutionalism, Cambridge University Press.
Shackle G.L.S. (1958), « Book Reviews – On the History and Method of Economics : Selected Essays. By Frank Hyneman Knight Edited by W. L. Letwin and A. J. Morin », Economica, p. 65-66.
Scott R. (2014), Institutions and Organisations, ideas, interests and identities, 4th edition, Sage, Londres.
Steiner P. (1997), « La théorie de l’entrepreneur chez Jean-Baptiste Say et la tradition Cantillon-Knight », L’actualité économique, vol. 73 no 4, p. 611-627.
87Stigler G. (1987), « Frank Hyneman Knight », The New Palgrave : A Dictionary of Economics, New York – Stockton Press.
Stigler G. (1973), « Frank Knight as Teacher », Journal of Political Economy, vol. 81, no 3, p. 518-528.
Stigler G. (1971), « Preface », Knight F.H. (1971), Risk, Uncertainty and Profit, Chicago University Press, Michigan.
Wick W. (1973), « Frank Knight, Philosopher at Large », Journal Of Political Economy, vol. 81, no 3, p. 513-515.
1 L’édition utilisée par the Online Liberty Fund étant la première : Knight F.H. (1921), Risk, Uncertainty and Profit, Houghton Mifflin, Boston, Massachussets.
2 Chaque fois qu’il est question du prix « Nobel » d’économie on se croit obligé de préciser qu’il s’agit en fait du « Prix de la Banque de Suède en l’honneur d’Alfred Nobel ». On peut remarquer à cette occasion qu’en inventant ce prix l’Académie Nobel avait trouvé le moyen de respecter la lettre et l’esprit du testament d’Alfred Nobel : sa lettre, puisque la liste des prix y était spécifiée de façon limitative, et son esprit, puisqu’elle avait substitué un financement par la banque à un financement par la dynamite. Dans la suite du texte nous nous contenterons donc de mettre à chaque fois que nécessaire le mot « Nobel » entre guillemets.
3 Stigler (1971), p. x.
4 Deux remarques à propos de ce texte. 1/ En disant que « the full yield of this vision has hardly begun to be reaped by modem economics », Stigler semble anticiper un temps, notre temps, où la question de l’incertitude au sens de Knight ne pourra plus être tenue à l’écart. 2/ on remarquera l’allusion faite à la fable des abeilles, une fable contée à l’envers où tout se passe comme si la prise de conscience de la dimension sociale des actions (la vertu publique) rendait vulnérable au vice privé (erreur et conflit) qui accompagne un monde voué à « l’innovation et à l’extension infinie et à la variété des changements »
5 Emmett, 2021. Nous tenons. à reconnaître ici notre dette à l’égard de cet historien de la pensée économique qui a consacré l’essentiel de ses travaux à la connaissance et à la compréhension de l’ensemble de l’œuvre de Frank Knight. Voir en particulier : Emmett (2009). Inutile de préciser que si nous lui devons beaucoup il ne saurait être tenu responsable de nos erreurs ni de nos interprétations.
6 Ce que dit le chœur : « Je ne comprends toujours pas. Ces prédictions, je ne les entends pas » « Je n’ai pas les moyens de voir la fin de tout cela. » « Que dis-tu ? Fais taire ta bouche malheureuse. » Sur quoi Cassandre conclut : « Un mot encore : Io ! La destinée humaine ! Le bonheur, il suffit d’un nuage pour le mettre en déroute. Quant au malheur, il ne faut que quelques coups d’éponge humide. Pour, à jamais, en effacer la trace ; Et c’est ceci beaucoup plus que cela qui me fait tant pitié. »
7 Comme en témoignent les hommages de George Stigler (1973) et Don Patinkin (1973).
8 Shackle (1958)
9 10 Wick (1973). Warner Wick était un spécialiste de philosophie morale qui fut aussi doyen des étudiants de l’Université de Chicago.
10 Cité par Ross Emmett, op. cit. p. 111.
11 Emmett (1973)
12 Si ces débats peuvent paraitre exotiques, vu du point de vue d’une France laïque ou d’économistes qui ne pensent pas leur discipline dans le cadre d’une l’histoire de la scholastique, on peut remarquer toutefois 1/ qu’il s’agit de débats relatifs au sens de la Révolution qui remontent au moins aux Considérations sur la révolution française d’Edward Burke, 2/ que ces débats sont repris régulièrement par exemple dans les écrits de Pierre Manent 3/ que s’agissant des États-Unis le « Volker Fund » a soutenu outre Hayek, des auteurs tels que Aaron Director, Böhm Bawerk, Mises, Roscoe Pound, Léo Strauss, Eric Voegelin. Aaron Director va jouer aux un rôle déterminant dans le développement du courant Law and Economics, dont les options étaient contraires à celles de Knight (voir plus bas). Par ailleurs, on peut relever le rôle que Léo Strauss va jouer dans le développement de la pensée néo-conservatrice (Voir Allan Bloom : The closing of the American Mind). Le lien entre Hayek et la contre-réforme est attesté par lui-même dans sa « Nobel Lecture » lorsqu’il donne comme précurseurs de la pensée économique deux jésuites du 16e siècle.
13 Cette solution n’est pas sans évoquer les conceptions de Jürgen Habermas, sauf que, et la restriction n’est pas mince, le scepticisme qu’il manifesterait sans doute à l’égard de la postulation de l’éthique communicationnelle qui serait requise pour passer de l’idéal à la réalité.
14 Coase (1960).
15 Exemple de la difficulté qu’il y a de suivre les représentations verbales du libéralisme : la notion de marché des idées, après-guerre, désigne un processus de discussion démocratique, avant de désigner, plus tard, la soumission des décisions politiques aux mécanisme de marché. La loi Citizen en 2010 permet aux entreprises de financer la politique sans restriction, voir Coase (1974, 1977).
16 Notons toutefois que mention est faite du nom de Frank Knight dans deux des trois articles que Ronald Coase a consacrés à l’histoire de The nature of the firm.
17 Voir Asso et Fiorito (2005).
18 Rutherford (1994).
19 Scott (2014).
20 Hodgson (1998), p. 167.
21 Hodgson (2004), p. 344.
22 Fiorito (2011).
23 Rutherford (2011).
24 Emmett (2013).
25 Gruchy et al. (1957).
26 Ammous, Phelps (2015), p. 37.
27 Emmett, 2021.
28 Stigler, 1973, p. 520.
29 Douglas (2001), p. 146.
30 Douglas (2001), p. 146.
31 Ibid., p. 154.
32 Coleman (1999), p. 335.
33 Parsons (1990), p. 319.
34 Parsons (1990), p. 320.
35 Parsons (1990), p. 323.
36 Coleman (1990), p. 335.
37 Coleman (1990), p. 337.
38 Leçon pour l’obtention du Prix Nobel de Ronald Coase (1991). The Institutional Structure of Production.
39 La persistance de cet oubli pourrait bien signifier que Coase a pris conscience du fait que Knight n’avait peut-être pas tort, après tout, de penser qu’il n’était pas possible de déterminer de manière scientifique les limites de la taille des entreprises. Si tel est le cas, on peut se demander quelle est cette évidence que Coase préfère éviter qui le sépare de la véritable théorie de l’institution, séparation qui lui permet d’offrir à la communauté des économistes le moyen d’échapper, temporairement du moins, aux sombres prédictions de Frank Knight. C’est ce même oubli qui lui permet de fonder ses analyses sur un ensemble de présupposés que constituent la technologie et les goûts des consommateurs. Ce faisant, les individus, qui suivent leur propre intérêt, sont régis dans leurs choix par un système de prix. Or Knight récuse un par un chacun de ces points : la technologie n’est pas donnée, mais sans cesse bouleversée par l’innovation entrepreneuriale, les goûts des consommateurs ne sont pas donnés mais source de discussion voire de dispute, quant aux intérêts de individus, loin d’être définis comme cela est requis par la définition d’un équilibre économique, ils reflètent la variété des valeurs humaines (le jeu, la rivalité etc.) dont la moindre n’est pas la recherche de valeur supérieure. On peut penser que la référence au nom de Hayek (et du même coup à sa théorie de la législation), plus loin dans le discours, a pour fonction d’articuler la théorie des coûts de transaction, qui vise une sous-optimisation locale des relations économiques, à une vision globale de la légitimité des actions. Sur ce point voir Laufer (2017).
40 Douglas (2001).
41 Douglas (1986), p. 88.
42 Gruchy et al. (1957).
43 Gruchy et al. (1957), p. 18.
44 Précisément à la page 109.
45 Frank Knight dans une lettre à Abram L. Harris, 27 mai 1936 (Frank H. Knight Papers, Box 60, Folder 6) cité par Emmett (2006), p. 101.
46 Hodgson (2004).
47 Knight (1927), préface à sa traduction de General Economic History de Max Weber, p. xv. Greenberg, New York.
48 Ibid.
49 Emmett (2006), p. 101.
50 Gruchy et al. (1957), p. 18.
51 Gruchy et al. (1957), p. 19.
52 Sachant que le phènomène humain relève de tous les domaines du savoir (physique, chimique, biologique, psychologique, social etc.) mais que ce qui est spécifiquement humain, c’est la dimension proprement historique.
53 Gruchy et al. (1957), p. 19.
54 Gruchy et al. (1957).
55 Boulding (1957), p. 1.
56 Boulding (1957), p. 2.
57 Boulding (1957), p. 2.
58 Boulding (1957), p. 3.
59 Boulding (1957), p. 3.
60 Sur ce point voir la réédition récente de Knight (2014), section « Statics and Dynamics ».
61 Gruchy et al. (1957), p. 20-21.
62 Knight (1938).
63 Knight (1935), p. 803.
64 Weber ajoute « une structure telle que le droit canon est connue seulement de l’ouest » précision qui, à l’évidence, ne serait pas du goût de Knight.
65 Knight (1959), p. 71.
66 Gruchy et al. (1957), p. 21. Il est un domaine où le compromis est difficile et le conflit probable c’est celui de l’inégalité. Dans la réponse à Boulding il écrit : La faiblesse la plus radicale de la théorie du laissez-faire est son hypothèse (théoriquement correcte) selon laquelle une économie est composée d’individus « donnés » (responsables), de personnes qui connaissent leurs propres fins et moyens (et respectent la liberté des autres) et considèrent comme acquis la cohérence des fins et des moyens et l’inégalité limitée des moyens qui sont nécessaires à des relations mutuelles efficaces. Le champ crucial de la controverse est l’inégalité des moyens, ses conséquences et ses sources. (Knight, op. cit.) / On peut remarquer l’analogie entre ces déclarations et les deux principes de justice de Rawls. Le voile d’ignorance qui caractérise la situation initiale n’est pas sans évoquer la nécessité de se garder un présupposé dogmatique pour fonder les institutions de la société. Par ailleurs, dans la manière dont Knight décrit ce qui, dans le libéralisme, conduit nécessairement à des inégalités excessives, il mentionne d’une part la tendance selon laquelle la capacité d’accumuler des moyens est fonction des moyens dont on dispose, et d’autre part la manière dont la famille à travers l’héritage, qu’il s’agisse du patrimoine, de la culture ou de l’éducation, est une autre source d’accumulation des inégalités dans le temps).
67 Knight (1946), p. 79.
68 Emmett (2006), p. 115.
69 Knight (1948), p. 51-52.
70 Stigler (1987).
71 Voir citation supra.
72 Gruchy et al. (1957), p. 21.
73 Knight (1967), p. 783.
74 Knight (1946), p. 87.
75 Knight (1966), p. 165-166.
76 Knight et Merriam (1948).
77 Emmett (2021)
78 Il y a de nombreux témoignages de la place centrale occupée par la religion au cœur des institutions des États-Unis et du fait que la sécularisation peut être accompagnée d’un redoublement de la référence à la garantie divine. C’est ainsi que dans son discours inaugural, en 2009, le Président Obama pouvait dire « This is the source of our confidence–the knowledge that God calls on us to shape an uncertain destiny » tout en évoquant, pour la première fois dans pareille circonstance l’existence de « non-believers » (« We are a nation of Christians, Jews And Hindus–and non-believers »). Quant au lien entre économie et religion aux États-Unis il est n’est pas impossible de le suivre à travers la façon dont l’expression « In God we Trust » figure sur les billets de banque depuis une loi votée en 1956. / C’est bien ce que signifie Knight dans sa critique de la façon dont le penseur et économiste libéral qu’est Michael Polanyi (le frère de Karl Polanyi) invoque Dieu pour justifier son optimisme quant aux résultats de la science : « We are to trust and be patient, quit worrying or stirring up troubles, and all will be well ; God’s in his Heaven, all’s right with the world – or will progressively be put right. Science has demonstrated its capacity to solve problems, and we need only understand that those of the social order are of the same kind. Unhappily, both views have the strong appeal of the intellectual get-rich-quick scheme, easy solutions for hard problems and would likely lead to resort to the sword of political power to cut the knot of a political impasse, which the author thinks he is combatting », (Knight, 1949, p. 271). Cette polémique était suffisamment significative pour qu’un ancien étudiant de Knight, également admirateur des deux auteurs, et par ailleurs prix « Nobel » d’économie, consacre un article aux enjeux de la dispute à savoir « le contexte méthodologique de la “science politique” moderne » (Buchanan, 1967).
79 Drucker décrit la théorie de l’affaire comme « rechercher toute la gamme des phénomènes de l’affaire et les exprimer par un petit nombre de lois générales, vérifier ces lois par l’expérience, prévoir, adopter, juger de la qualité des décisions avant qu’elles ne soient prises, et enfin, permettre aux hommes d’affaires expérimentés, d’analyser leur propre expérience et d’améliorer par là leur action » (Drucker, 1957, p. 64). Le savoir se conçoit ainsi par des lois « localement générales ».
80 Boltanski et Thévenot, 1991. DiMaggio P. et Powell W. (1983)
81 Cantillon désigne l’entrepreneur comme un homme « vivant à l’incertain ».
82 Knight (1952), p. 45.