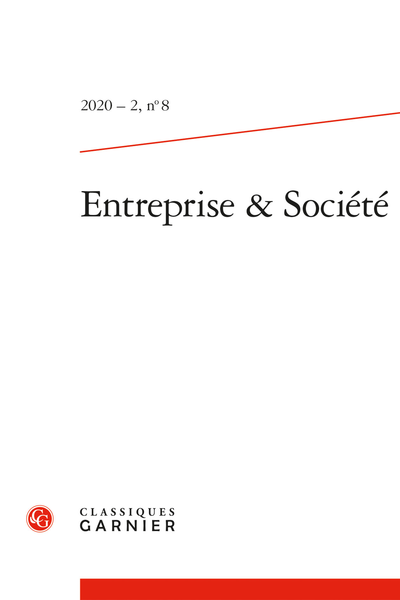
Interview with Alain Supiot Professeur émérite au Collège de France
- Publication type: Journal article
- Journal: Entreprise & Société
2020 – 2, n° 8. varia - Authors: Jubé (Samuel), Lemarchand (Yannick)
- Pages: 21 to 41
- Journal: Business & Society
- CLIL theme: 3312 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Économie publique, économie du travail et inégalités
- EAN: 9782406114161
- ISBN: 978-2-406-11416-1
- ISSN: 2554-9626
- DOI: 10.15122/isbn.978-2-406-11416-1.p.0021
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 02-08-2021
- Periodicity: Biannual
- Language: French
« Grand Angle » avec Alain supiot
Professeur émérite au Collège de France
Samuel Jubé
Grenoble École de Management
Yannick Lemarchand
Université de Nantes
RAPPEL SUR LA RUBRIQUE
« GRAND ANGLE »
Dans sa politique éditoriale, Entreprise & Société (ENSO) a décidé de consacrer, dans chacun de ses numéros, une rubrique spécifique, dite « Grand Angle », mettant en valeur une personne, un groupe, ou un événement particulier. Il ne s’agira pas d’un article académique, d’une recension ou d’une information factuelle, comme d’autres rubriques de la revue peuvent les offrir, mais d’une réflexion menée sur la relation entre entreprise et société, vue à travers l’itinéraire et la vision d’une personne « mise à la question », du groupe étudié, de l’événement analysé. L’objectif recherché est d’aider les lecteurs de la revue dans leur démarche de compréhension – parfois le déchiffrage) de cette relation entre entreprise et société, en ajoutant, aux rubriques usuelles ci-dessus mentionnées, cette rubrique « Grand Angle » qui se veut comme un instant de pause et de réflexion partagée.
22ENTRETIEN avec alain supiot (as)
Professeur émérite au Collège de France
Propos recueillis par Samuel Jubé (SJ)
et Yannick Lemarchand (YL)
Docteur d’État en droit (Bordeaux, 1979), agrégé des facultés de droit (1980), Alain Supiot a été successivement professeur à l’université de Poitiers puis de Nantes avant d’être élu au Collège de France en 2012 – où il a occupé jusqu’en 2019 la chaire « État social et mondialisation : analyse juridique des solidarités ». Il a présidé de 1998 à 2000 le Conseil national du développement des sciences humaines et sociales, et a été membre, de 2016 à 2018, de la Commission mondiale sur l’avenir du travail. À Nantes, il a fondé en 1993 la Maison des Sciences de l’Homme Ange-Guépin, puis en 2008 l’Institut d’études avancées, qui accueille conjointement en résidence scientifique des savants des pays du « Sud » et du « Nord », et dont il a été le directeur de 2008 à 2013. Ses travaux se sont principalement déployés sur deux terrains complémentaires, le droit social et la théorie du droit, pour mettre l’accent sur la fonction anthropologique du droit. Reconnu mondialement et bien au-delà du cercle universitaire, Alain Supiot est l’auteur d’une œuvre intellectuelle extrêmement riche et profonde, à laquelle une cinquantaine de chercheurs internationaux ont rendu un hommage interdisciplinaire en 2020 par la publication de l’ouvrage collectif « Concerter les civilisations ».
Samuel Jubé : Le droit du travail vous a fourni les clés d’une analyse extrêmement riche et profonde sur la nature et les transformations des sociétés. Comment définiriez-vous ce rapport particulier au droit que vous avez su cultiver tout au long de votre carrière ? Dans quelle branche du droit conseilleriez-vous aujourd’hui aux jeunes de s’investir pour saisir et répondre aux enjeux qui nous attendent ?
Alain Supiot : Je dirais que dans l’histoire longue du droit – ou des systèmes normatifs si l’on veut situer le système occidental – le Droit s’est constitué comme une technique à la disposition des êtres humains. C’est en cela que l’histoire du droit se distingue de ce qui s’est passé dans les 23autres civilisations du Livre où la question de la Loi renvoie immédiatement à la question des fondements ultimes de la vie, du comment vivre et du pourquoi vivre. Pour des raisons qui ont été très bien expliquées par les travaux de Berman notamment, et de Pierre Legendre, il y a là quelque chose de spécifique à l’Occident, au sens historique précis de ce terme qui renvoie à la division de l’Empire romain entre Rome et Byzance à la fin du iiie siècle. L’Orient de l’Europe (que nous connaissons si mal, ce qui explique les malentendus permanents avec les Russes et les Grecs), a conservé son empereur à Constantinople jusqu’au xve siècle, l’Église demeurant dispersée en patriarcats. À l’inverse en Occident la chute de l’Empire de Rome a conduit à un émiettement du pouvoir politique, l’Église incarnant l’unité et la continuité, alors qu’elle n’avait pas de doctrine juridique. C’est ce qui l’a progressivement poussée à s’affirmer comme un pouvoir centralisé et à devenir ainsi le prototype de l’État moderne à partir du xiie siècle. Cette invention n’allait pas de soi. Depuis Saint Paul, l’avènement du christianisme signifiait pour ses fidèles la fin du « temps de la Loi » et l’avènement du temps de la grâce. La seule règle à observer dans l’attente du retour du Seigneur est d’aimer son prochain et de se soumettre aux pouvoirs temporels en place (rendre à César, ce qui est à César). Mais ce retour tardant à venir, il a bien fallu se doter de règles, et à cette fin, on a ré-usiné les catégories du Droit romain pour les ajuster aux besoins de l’Église. C’est de là que vient cette figure normative assez singulière qu’on peut appeler le Droit : la source des lois n’est pas une Loi révélée, elle s’incarne dans la figure du souverain Pontife, qui se présentait comme le vicaire du Christ (l’abandon de ce titre intervenu en 2020 suscite des remous au Vatican !). C’est de là que naît la figure de l’État.
Si je le rappelle, c’est parce que le Droit est enseigné depuis lors comme une pure technique de gouvernement. On a pris l’habitude de voir le droit comme un outil, et les juristes comme des techniciens au service du pouvoir et cette façon de voir se retrouve encore chez Bourdieu ou Foucault : le Droit ne serait qu’un instrument de domination. On demande aux juristes ce qu’on demanderait à des plombiers-zingueurs : qu’il n’y ait pas de fuites dans la circulation des créances et des dettes. À quoi sert cette machinerie ? À cette question les juristes ont d’abord répondu « ça ne nous concerne pas : voyez les théologiens ! », puis « voyez les philosophes ! » ; à partir du xixe : « voyez les biologistes ! » et aujourd’hui 24« voyez les économistes ! ». C’est encore massivement comme ça qu’on enseigne le droit aujourd’hui : comme une technique neutre ; comme on apprendrait aux gens à se servir d’une brouette ou d’un ordinateur.
On ne voit pas que les catégories juridiques nous renvoient une image de la société. Je reprends cette métaphore – très présente dès le Moyen-âge – du Droit comme miroir (par exemple le « Miroir des Saxons » Sachsenspiegel au début du xiiie siècle.). Le Droit est le miroir d’une société, mais c’est un miroir déformant, où peuvent se lire à la fois les cauchemars et les rêves. C’est un monde tel qu’il devrait être, et c’est souvent un décalque de ce qui ne va pas dans une société donnée. Donc c’est le lieu d’une tension, d’une articulation, qu’il est très dangereux de négliger, entre le sein et le sollen, l’être et le devoir être, l’ontique et le déontique, dont les rapports sont plus complexes qu’on ne le dit d’habitude. Si on a une vision purement technicienne, on dit qu’il y a d’abord la réalité et que le droit suit. Si on y voit au contraire un des éléments qui structurent une culture, on va dire que le Droit peut aussi bien précéder que suivre l’évolution du monde tel qu’il est. Sur la question de l’égalité des hommes et des femmes, on peut dire que le Droit précède, et qu’il exerce encore aujourd’hui une traction sur la société. Si l’écart avec la réalité est trop grand, le droit perd son efficacité. Il faut garder un lien suffisant avec le réel. C’est cette dialectique de l’être et du devoir être qui fournit une clé d’intelligibilité des sociétés.
Envisagés sous cet angle, tous les domaines du droit sont éclairants. Prenez le problème écologique. Ce qui paraît si naturel aux économistes – la propriété comme droit exclusif – est une construction assez récente s’agissant de la propriété foncière. C’est seulement depuis la Révolution française (dans le cas français) que le rapport des hommes à la Terre est conçu en ces termes. Auparavant on considérait les hommes comme de simples tenanciers des ressources naturelles qui, en dernière instance, appartiennent à Dieu. L’exploitation de ces ressources était placée sous l’égide des rapports d’interdépendance entre les hommes. D’où la distinction médiévale du domaine utile attribué au tenancier, et du domaine éminent, conservé par celui qui lui a concédé. L’idée d’un droit exclusif d’user et d’abuser de ces ressources est récente et c’est elle qui a ouvert la voie à leur surexploitation et à l’avènement de l’anthropocène. Un retour critique sur le concept de propriété est aujourd’hui nécessaire pour faire face aux périls écologiques. Plus généralement, être conscient 25de la normativité de nos catégories de pensée permet de saisir ce que Castoriadis a nommé « l’institution imaginaire de la société ». À un moment historique donné, la science, l’art et le Droit participent d’un même imaginaire. Ainsi par exemple, la théorie juridique de la souveraineté, l’invention artistique de la perspective et le cogito cartésien ont été trois moments d’une même séquence historique, d’une même rupture épistémologique consistant à ordonner un monde objectif autour d’un sujet connaissant. De la même façon, c’est d’abord sous la plume de Grotius qu’apparait dès 1625 « l’hypothèse impie » de l’inexistence de Dieu, qui va lui servir à donner un fondement purement humain à l’ordre juridique. Laplace ne dira pas autre chose en déclarant à Bonaparte deux siècles plus tard n’avoir pas eu besoin de l’hypothèse de Dieu pour mener à bien son Exposition du système du monde. Il ne s’agit pas de prétendre que la pensée juridique serait toujours ainsi annonciatrice d’un changement de nos représentations du monde et de la société, mais seulement de comprendre qu’elle en est une composante essentielle.
Il y a une deuxième raison pour laquelle je continuerai, en dépit des insuffisances des facs de droit, à ne pas dissuader les vocations. En droit comme en médecine, le savoir n’est pas une fin en soi, détachée de toute considération pratique. Si c’était le cas, j’aurais préféré faire de la poésie ou des mathématiques, domaines qui permettent de s’abstraire des misères et de la lourdeur du monde. En droit comme en médecine, se pose la question des remèdes, des dispositions à prendre pour faire reculer ici la maladie et là l’injustice. C’est particulièrement vrai du droit du travail. Quand vous faites du droit international privé, les normes ont un degré d’abstraction tel, qu’on peut oublier les êtres de chair et d’os, mais avec le droit du travail, le texte de la loi ou du contrat ne peut être détaché de son contexte historique, économique, sociologique, philosophique ou politique, tant du point de vue de sa compréhension que de sa réforme éventuelle.
SJ : Vous dites que le Droit s’est construit comme une technique, mais à vous écouter, on pourrait comprendre qu’il est pour vous plus qu’une technique…
AS : Ce n’est pas exactement ça. Chaque technique se définit par la fonction qu’elle est censée remplir. La fonction d’un avion, c’est de voler, mais on peut s’en servir pour détruire les Twin Towers. Je dirais que la 26fonction du droit, c’est une fonction d’interdit au sens éclairé par Lacan, c’est-à-dire d’inter-dictio : ce qui permet d’échanger des paroles plutôt que des coups. Les animaux échangent des signaux. Tel cri de marmotte par exemple signale la présence d’un danger (quelqu’un arrive). Comme l’a montré notamment Peirce, il en va différemment des mots que nous employons. Ils ne signalent pas directement la présence d’une chose, mais ils se réfèrent à un système, à une structure linguistique, qui est la source du sens. Il y a là une distinction radicale entre le langage humain et les systèmes de signaux. Le même mot « rat » peut désigner en français un rongeur, un avare ou une danseuse, tandis qu’en allemand « Rat » peut s’entendre d’un conseil ou d’un organe délibératif. Pour « communiquer » en ayant une chance de se comprendre, il faut partager une référence commune. En sorte que tout dialogue a une structure ternaire et non binaire, comme l’a mis en lumière Dany-Robert Dufour dans son beau livre sur Les Mystères de la trinité. L’interlocution suppose – ce sont les termes de Benveniste – de co-référer et cette coréférence exige un interprète si on ne parle pas la même langue. Autrement dit la première source de l’hétéronomie, celle qui est la garante de l’autonomie des êtres humains, la première institution, c’est la langue. Celui-là même qui veut appeler ses semblables à la révolte doit se soumettre à la loi de la langue. Et le premier visage de cette loi est celui de notre mère qui, en nous inculquant notre langue maternelle, nous ouvre les portes de la liberté d’expression et nous permet de nous confronter à la façon dont chacun de nos semblables se représente ce qui est et ce qui doit être. Confrontation indispensable pour ne pas s’enfermer dans une représentation idiote du monde, idiote au sens grec de ce mot, c’est-à-dire refermée sur elle-même, coupée des réalités et de l’expérience qu’en ont nos semblables.
Dire que la fonction du droit, c’est d’échanger des paroles plutôt que des coups est une façon de signaler cette structure ternaire, qu’il partage avec la langue, et dont la première manifestation fut sans doute la figure du Tiers impartial, c’est-à-dire du juge. Imposant un sens commun, qui s’impose à tous, le droit métabolise les ressources spécifiques de la violence dans l’espèce humaine, espèce que l’accès au langage expose au délire meurtrier. Reconnaître cette fonction anthropologique du droit ne signifie nullement une adhésion au jusnaturalisme, qui postule l’existence de règles éternelles et universelles inscrites dans la nature humaine et dont le dernier avatar est la foi en un « ordre spontané du marché ». 27L’observation anthropologique, ou historique, montre au contraire l’infinie diversité des systèmes normatifs. Le Droit du reste n’a pas le monopole de cette fonction, qui, dans la longue histoire de l’humanité, a plutôt été remplie par les religions, c’est-à-dire par des références normatives échappant à la volonté humaine. Mais tout comme les religions, il ne remplit cette fonction que dans la mesure où il inscrit les humains dans une chaine généalogique assurant une place aux générations nouvelles. On peut se demander si, par exemple, les catégories du droit des biens que j’évoquais tout à l’heure, remplissent bien la fonction de perpétuation de l’espèce qu’on peut reconnaître au Droit.
SJ : Vous soulignez là une fonction qui n’a été relevée ni par les jusnaturalistes, ni par les positivistes…
AS : Oui, ni par les post-modernes… Il y a une remarque de Cioran que j’aime beaucoup. C’est un personnage un peu sulfureux, qui fuit le communisme, arrive à Paris dans les années 50. Observant les intellectuels français, il note « Tous se réclament de la liberté et nul ne respecte la forme de gouvernement qui la défend et l’incarne ». Cette remarque éclaire aussi la crise profonde que traversent les sciences sociales. Elles sont devenues aveugles aux montages institutionnels qui permettent aux humains d’avoir et garder raison, c’est-à-dire d’articuler l’infini de leur univers mental avec la finitude de leur existence physico-biologique. Animaux dénaturés, les humains sont des êtres bidimensionnels. Leur vie intérieure peut s’entendre aussi bien de leurs interrogations métaphysiques que de leurs troubles intestinaux ; ils ont les pieds sur terre et la tête dans le ciel des idées. Au lieu d’affronter cette complexité, les sciences sociales ont tendance à se casser en deux. Il y a d’un côté les scientistes qui entendent rabattre sans reste l’humain sur le physico-biologique. L’homme serait un animal comme un autre, qu’on doit pouvoir dresser à coups de nudges ou de techniques comportementales. De l’autre côté, il y a les têtes coupées, pour qui le progrès technique et l’arbitraire du signe laissent augurer un monde post humain, peuplé d’anges immortels, émancipés de toute espèce de détermination biologique ou sociale et promis à l’immortalité. Cette tension à l’œuvre dans les sciences sociales est le symptôme de la crise institutionnelle qui parcourt toutes les sociétés.
28Yannick Lemarchand : Vous avez proposé de dépasser le clivage habituel entre « entreprise » et « société » pour opposer plus largement le « gouvernement par les lois » à la « gouvernance par les nombres » (en référence au titre de l’un de vos derniers ouvrages). Le triomphe actuel et universel de la gouvernance par les nombres porte-t-il nécessairement atteinte à la figure de la loi ? en d’autres termes, pourrait-il y avoir selon vous une « bonne » gouvernance par les nombres ?
AS : S’il y a un phénomène qui est social, c’est bien l’entreprise, par définition. On ne peut donc pas opposer Entreprise et Société. En revanche, on peut opposer le gouvernement par les lois et la gouvernance par les nombres.
Est-ce que la gouvernance par les nombres porte nécessairement atteinte à la figure de la loi ? Évidemment oui. L’idéal du règne de la loi était fièrement revendiqué par les Grecs affirmant : nous ne dépendons pas des hommes, car chez nous c’est la loi qui est reine. La liberté s’identifiait pour eux à ce règne d’une loi qui a été délibérée par tous et non pas à la possession par chacun de droits individuels.
Il y avait là l’idée d’un pouvoir impersonnel, mais la loi prise dans ce sens se distingue déjà de l’idée de loi hétéronome, religieuse, qui domine d’autres systèmes de pensée. C’est l’invention de la démocratie. C’est un montage juridiquement complexe, qui suppose l’institution d’assemblées de parole, au sens où Marcel Détienne les a décrites (en montrant du reste que les Grecs n’avaient pas été les seuls à les pratiquer), c’est-à-dire des procédures dans lesquelles les membres d’une communauté (réduite le plus souvent aux hommes libres) se réunissent sur un pied d’égalité. Vernant a décrit ces assemblées dans des pages magnifiques. On fait cercle et on pose au milieu un sceptre symbolisant le pouvoir. Chacun a un droit égal à la parole (isogoria). Celui qui veut dire quelque chose sur ce qui est, ou ce qui doit être, s’avance, prend le sceptre et, dès lors, sa parole ne doit plus exprimer ses intérêts privés mais ce qui lui paraît être à la fois le vrai et le juste pour la Cité toute entière. Lorsqu’il a fini, il repose le sceptre et sa parole redevient privée. Montage admirable mais dont la fragilité a été soulignée par de nombreux juristes, notamment Vico et Montesquieu. Il suppose en effet une capacité de l’individu à renoncer à la considération de ses intérêts privés quand il participe à la délibération de l’intérêt public ; cette vertu politique dont Montesquieu notait qu’elle « est un renoncement à soi-même, qui est toujours une chose très pénible ».
29À cet idéal du règne du Droit s’oppose celui de la gouvernance par les nombres, qui est lié à la révolution numérique dans ses formes contemporaines, mais dont les racines sont plus anciennes. Il remonte à Pythagore et plus près de nous à Galilée, pour qui tout l’univers est mathématique. Dieu a écrit en chiffres et non en latin les lois qui ordonnent la nature. Voilà l’idée qui apparaît avec la Renaissance. Déchiffrer les lois de ce Dieu mathématicien laisse entrevoir la possibilité de se rendre « maître et possesseur de la nature », comme le dira Descartes !
À partir du xviiie la quantification s’étend aux « faits sociaux » sur une base clairement normative, qu’ont notamment mis en lumière les travaux de Lorraine Daston ou d’Alain Desrosières. À l’instar de la Terre et des étoiles, la société va ainsi être conçue comme un objet qu’on peut poser devant soi, pour le mesurer et en déchiffrer les lois sur le modèle des lois de la physique ; des lois formalisables en termes mathématiques. Cette unité de la pensée mathématique, physique et juridique est centrale dans la grande œuvre de Leibniz. Le concept générique de « société » n’émerge qu’à cette époque et a connu depuis un prodigieux succès, du « Contrat social » au « socialisme » et à la « sécurité sociale », devenant même l’objet d’une science à part entière : la sociologie.
Pour arriver aux temps présents, ça a d’abord donné, sous l’ère industrielle, l’idée d’un gouvernement par les nombres. On pourrait dire que le taylorisme est un gouvernement par les nombres. Il y a des ingénieurs, des gens qui savent quelles sont ces lois de bon fonctionnement, et il y a des êtres humains qui doivent se soumettre à cela. Ça a donné l’Union soviétique si je puis dire, en faisant des raccourcis terrifiants. Le Gosplan avait pour fonction de faire advenir, sur la base d’un énorme appareil statistique, l’harmonie sociale par des calculs d’utilité collective. D’où les formules de Lénine qui entendait organiser l’Union soviétique comme une vaste usine appliquant une « organisation scientifique du travail » à la Taylor et prophétisait « les temps très heureux où l’on pratiquera de moins en moins de politique et où ce sont les ingénieurs qui auront la parole ».
La gouvernance par les nombres proprement dite, advient avec l’invention de l’informatique. Les liens étroits entre l’invention de la cybernétique et le tournant managérial de l’après seconde guerre mondiale ont été mis en lumière ces dernières années, notamment par Baptiste Rappin. 30La cybernétique envisage les hommes, les animaux et les ordinateurs comme autant de systèmes d’information, capables de rétroagir aux signaux qu’ils reçoivent de leur environnement. Ce seraient des machines programmables, dont le « matériel » est animé par un « logiciel » ou un code interne, et non pas seulement par des forces mécaniques qui leur sont extérieures. Dès lors faire travailler les hommes ne consiste plus à les soumettre à des ordres auxquels ils doivent obéir, mais à les programmer, c’est-à-dire à leur inculquer un code, un « logiciel », qui les conduise à réaliser spontanément les objectifs qu’on leur assigne. Né avec l’invention de l’informatique, cet imaginaire du programme a envahi la biologie (avec la réduction du vivant à l’expression d’un code génétique) mais aussi les sciences sociales, où la philosophie analytique, l’économie ou la psychologie comportementale prétendent au statut de science exacte. D’où ces techniques de dressage fort en vogue que sont les nudges, chers à l’économie comportementale. Côté management, on est ainsi passé du taylorisme à la direction par objectifs.
La Gouvernance par les nombres est l’expression normative de cet imaginaire cybernétique. Elle s’observe non seulement dans les rapports de travail au sein des entreprises, mais aussi dans les rapports entre entreprises au sein des chaînes de production, ou dans les rapports entre les entreprises et les États ou entre les États et les institutions économiques internationales. Ce concept permet d’identifier les transformations profondes qui affectent les systèmes normatifs contemporains. Ce qui est neuf, ce n’est pas seulement « par les nombres », mais aussi « gouvernance », c’est-à-dire l’idée qu’on va pouvoir liquider l’hétéronomie et mettre les hommes et les sociétés en pilotage automatique. Cet imaginaire est même à l’œuvre à l’échelle de la planète, avec les 17 « Objectifs du Développement Durable », déclinés en 169 cibles et assortis de 230 indicateurs de performance, qui envisagent le monde entier comme une vaste entreprise.
Alors est-ce que c’est compatible avec le règne de la loi ? Sûrement pas, car la gouvernance par les nombres vise l’efficacité par le calcul et non pas la justice au moyen des lois. Ce changement était déjà à l’œuvre dans le nazisme ou le stalinisme qui ont eu en commun de liquider l’État de droit au nom de l’efficacité. Il faut lire à ce sujet l’excellent livre de Johann Chapoutot « Libres d’obéir », qui retrace la trajectoire du juriste Reihnard Höhn qui, après avoir théorisé la fin de l’État de 31droit sous le nazisme, est devenu après-guerre l’un des principaux inspirateurs du tournant managérial allemand. Pour comprendre ce tournant normatif, qui n’est pas propre à l’Allemagne, il importe donc de distinguer la règle de droit, qui se réfère à des principes de justice, et la norme technique qui se réfère à la pure efficacité. Foucault, qui a eu le mérite de mettre en lumière un changement de paradigme normatif dans l’Occident moderne, est demeuré en revanche aveugle à cette distinction. Il a mis dans le même sac l’ordre juridique et la normalisation des comportements. L’ordre sadien, qui a tant de traits communs avec l’ordre néolibéral comme l’a montré Dany-Robert Dufour, est un univers hypernormatif, mais ce n’est en aucun cas un ordre juridique. Si vous partez d’un critère de justice, vous direz que le principe d’égale dignité des êtres humains interdit en tout temps et en tout lieu de torturer son semblable. Alors que si vous partez d’un calcul d’utilité, vous admettrez avec Posner, le père de la doctrine Law and Economics, que « si les enjeux sont assez élevés, la torture est licite ». La loi n’est plus le cadre normatif dans lequel on peut procéder à des calculs d’utilité, elle devient elle-même l’objet de ce type de calcul.
Tout le mouvement Law and Economics s’est engouffré dans cette impasse, à la suite de Coase et de sa théorie des property rights. Polluer serait un droit, donc on va faire un marché des droits de polluer. Il ne faudrait surtout pas interdire la pollution ! Pas de contraintes juridiques ! Grâce au marché chacun va calculer son intérêt à polluer ou à ne pas polluer et ça va s’autoréguler. C’est ça la gouvernance. Elle applique aux sociétés humaines l’idée d’autopoïèse venue de la biologie, c’est-à-dire d’une autorégulation des systèmes homéostatiques. On a beaucoup sollicité en ce sens les travaux de Varela, le théoricien des « machines autopoïétiques » en biologie. Mais cette transposition fait l’impasse sur une autre grande spécificité du vivant, soulignée par Giuseppe Longo, qui n’est pas seulement la capacité de reproduction du même, mais aussi la capacité de produire sans cesse du nouveau et du différent. À l’époque même où cet imaginaire commençait de se cristalliser, Canguilhem a montré tout ce qui séparait la régulation biologique de la règle sociale : cette dernière suppose nécessairement de postuler une référence hétéronome, celle-là même que croient pouvoir faire disparaître les néolibéraux. Chassée par l’idéologie du Marché total, cette hétéronomie ressurgit aujourd’hui sous la forme des fondamentalismes religieux.
32En un mot, on est passé au nom de la science, du paradigme de la loi au paradigme du programme. En fait de science, on reste dans le registre théologique des religions du Livre, (le programme c’est ce qui est « déjà écrit », par exemple dans le « Grand Livre du génome »). La programmation d’un ordinateur, c’est très bien. User de la métaphore du programme en biologie était déjà source d’erreurs, car le vivant ne cesse de faire du neuf, de déjouer le programme.
L’appliquer aux sociétés engage dans des impasses. Ne parlons même pas de la Recherche et de la loi de programmation de la recherche !
SJ : Certains ont pu comprendre que, avec la gouvernance par les nombres, vous dénonciez également le recours à la quantification. Pourriez-vous préciser ce point ?
AS : Il y a là un malentendu. La quantification est un outil d’une puissance extraordinaire. Le mot raison (ratio) vient de la capacité de dénombrer. Mais toute quantification procède d’opérations de qualification, dont Alain Desrosières nous a appris l’importance cruciale. Prenons un exemple : j’ai entreposé les pommes de mon verger et me demande combien je vais pouvoir en vendre au marché. Pour ce faire, je dois d’abord distinguer les pommes des poires ou des prunes, puis compter séparément les pommes pourries, les vertes et les comestibles. C’est-à-dire qualifier chaque pomme, qui passe en quelque sorte en jugement : toi tu es comestible, toi tu es pourrie… Il y a une part subjective dans cette qualification : telle pomme qui semble au vendeur encore comestible sera jugée immangeable par l’acheteur. Autrement dit, toute quantification repose sur des opérations de qualification que les statisticiens appellent des conventions d’équivalence. Desrosières avait parfaitement compris la dimension normative de ces conventions qui sont à la statistique ce qu’une constitution est à un ordre juridique. À cette différence près qu’une constitution, comme n’importe quel texte juridique, est écrite en langage naturel et se prête donc à un travail herméneutique sur le sens des mots qu’elle emploie. Avec les chiffres, c’est différent. Une fois qu’on vous dit « le PIB, c’est tant ! », seuls les spécialistes ont accès aux conventions d’équivalence sur lesquelles il repose… Autrement dit les nombres, que tout le monde peut lire quelle que soit sa langue naturelle, ont une puissance dogmatique infiniment supérieure aux lois. On nous les assène ! Pis ! On indexe sur eux les 33politiques publiques, comme l’impose aujourd’hui le droit européen. Un bon usage de la quantification dans un débat rationnel, suppose donc de pouvoir remonter à ces conventions et les soumettre à un débat démocratique. Quand on parle de « création de valeur » dans une entreprise, cela vaudrait la peine de réunir les gens : bon qu’est-ce que c’est, créer de la valeur ? pour qui ? quel type de valeur ? L’industrialisation de l’agriculture a imposé la boussole du « rendement à l’hectare » qui nous rend aveugles à la stérilisation des sols et à la perte de la biodiversité. Autre exemple, le « taux de scolarité », composante de « l’indicateur du développement humain ». Comme l’a montré Ousmane Sidibé dans le cas du Mali, conditionner les aides à cet indicateur (alors même que les plans d’ajustement structurels avaient imposé la réduction drastique du nombre d’enseignants !) a conduit à entasser des enfants dans des hangars pour les confier à des maîtres incompétents. Mieux vaudrait demander aux parents concernés : que souhaitez-vous pour vos enfants ? Sur quelle métrique peut-on s’accorder pour mesurer leurs progrès ? Il est frappant de voir certains travailleurs uberisés revendiquer un accès au mode de fabrication des algorithmes auxquels ils sont soumis. Ils ne discutent pas l’utilité des algorithmes, mais ils aimeraient savoir comment on les fait, et éventuellement participer à leur fabrication. Ce serait cela un bon usage de la quantification : un usage qui parte de l’expérience des personnes concernées et ne vise pas à les contrôler, mais à les aider dans l’exercice de leur liberté. Tout bon comptable sait que l’image comptable est le fruit d’une quantité d’opérations de qualifications dont il doit pouvoir rendre compte. Rendre compte, ce n’est pas seulement donner des chiffres, c’est pouvoir expliquer comment on les a fabriqués.
SJ : Vous proposez d’opposer « mondialisation » et « globalisation » en rappelant que la première suppose le maintien et l’articulation d’une diversité de cultures alors que la seconde en fait précisément abstraction. Quels seraient selon vous les contours d’un ordre mondial plus juste ?
AS : Je dois cette distinction à la lecture d’un petit texte d’Augustin Berque rappelant l’étymologie du mot « mondialisation ». L’anglo-américain ne connaît que le mot globalization et l’allemand Globalisierung, alors que dans les langues latines, on peut faire la distinction. L’opposition du monde et de l’immonde correspond à la distinction que font les Grecs entre le chaos et le cosmos. Le chaos est un lieu humainement invivable. Pour 34vivre, l’être humain doit se fabriquer un monde, un cosmos, qui tienne compte à la fois de ses goûts et croyances et des conditions physiques et biologiques du lieu où il s’établit et qu’il va chercher à embellir (mundus signifie aussi raffiné et cosmos a donné cosmétique). L’idée de cosmos/monde renvoie donc, pour employer les termes de Danouta Liberski, aux « modes de l’habiter ». Habiter le monde suppose de ne pas saccager la nature, mais de s’y inscrire. C’est ce qu’Augustin Berque désigne par le terme de mésologie et Simone Weil par celui de milieu vital.
Mondialiser, c’est maintenir l’habitabilité du monde par l’espèce humaine, ce qui oblige à tenir compte de sa diversité. On a beaucoup caricaturé Montesquieu en ne retenant de la longue liste de facteurs de relativité des lois qu’il énumère en ouverture de l’Esprit des lois, que le facteur climatique. Il est évident qu’il n’existe pas de déterminisme climatique, mais il est aussi évident qu’on ne peut pas avoir les mêmes heures de travail au mois d’août au Gabon, ou à Canberra, sauf à ce que l’humanité entière se dote de la climatisation, ce qui ne serait écologiquement guère soutenable ! Il est évident que les systèmes juridiques dépendent de facteurs historiques, religieux, culturels, linguistiques et géographiques ! L’Angleterre est une île et la France un carrefour. C’est d’ailleurs ce qui fait le charme de l’Europe, cette extrême diversité des langues et des cultures sur un petit territoire. À moins de deux heures d’avion, hormis l’aéroport, vous savez tout de suite en sortant que vous êtes en Italie, en Allemagne, en Pologne ou en Angleterre. Penser en termes de mondialisation, c’est donc penser le monde comme une mosaïque, comme nous y invite Suleiman Mourad s’agissant de l’Islam. C’est divers et on essaye de faire que ça soit beau, que ça tienne ensemble.
La globalisation en revanche, est une notion qui nous vient de la psychologie, où elle désigne une fonction cognitive, la « fonction de globalisation », consistant à saisir l’unité et l’homogénéité d’un phénomène nonobstant la diversité des éléments qui le constituent. D’où la « méthode globale » utilisée pour l’apprentissage de la lecture. Dans le sens qu’elle a aujourd’hui acquise, la globalisation désigne un sens de l’histoire, (voire la « fin de l’histoire ») : la soumission de tous les pays à un même ordre du Marché, qui transcende toute espèce de particularité. C’est l’économiste en chef de la Banque mondiale, Larry Summers, affirmant « Dès que quelqu’un dit ‘les choses fonctionnent différemment ici’, il va dire une bêtise ». Ou c’est Hayek, selon qui « les seuls 35liens qui maintiennent l’ensemble d’une Grande Société sont purement économiques… ce sont les réseaux d’argent qui soudent la grande société ». La globalisation repose sur cette foi en un monde peuplé de particules contractantes s’ajustant mutuellement par des calculs d’intérêt. Distinguer mondialisation et globalisation, permet de ne pas être pris en tenaille entre d’une part cet avatar du fondamentalisme occidental et son projet d’uniformisation du monde et d’autre part les réactions identitaires qu’il suscite inévitablement. La mondialisation suppose de combiner des principes et règles du jeu communes (plus que jamais nécessaires compte tenu de l’interdépendance croissante de tous les pays en matière écologique, sociale et technologique), avec le respect de la diversité des pays et des cultures, telle qu’elle devrait pouvoir partout s’exprimer démocratiquement. Dans le cadre de la Commission mondiale sur l’avenir du travail constituée pour le centenaire de l’OIT, j’avais ainsi avancé trois principes autour desquels repenser l’ordre juridique multilatéral : la solidarité, la responsabilité et la démocratie économique.
Déjà affirmée par la Constitution de l’OIT dans l’ordre social, la solidarité doit être aujourd’hui étendue à la question écologique, comme l’a fait en 2000 la Charte de Nice en droit européen et comme l’a très timidement esquissé l’Accord de Paris sur le climat en 2015. Il s’agit de transformer l’interdépendance de fait de toutes les nations du monde, face aux risques sociaux et écologiques, en une solidarité active. Ces types de risques sont à l’évidence étroitement liés : que l’on songe à l’actuelle crise sanitaire, aux migrations ou à l’impact des délocalisations.
Concernant la responsabilité, la résurgence des liens d’allégeance, notamment dans les chaînes de valeur, ainsi que le déplacement du pouvoir économique vers la propriété intellectuelle, conduisent à une dissociation des lieux d’exercice du pouvoir et des lieux d’imputation des responsabilités, nous plongeant ainsi dans un monde d’irresponsabilité généralisée. Reconnecter pouvoir et responsabilité est un impératif majeur et des outils juridiques existent pour le faire, notamment l’idée de responsabilités solidaires.
Enfin la démocratie économique, nécessaire pour ré-enraciner la direction des entreprises dans la réalité et la diversité des conditions de travail et donner à chacun la possibilité de dire son mot sur le sens et le contenu du travail. C’est une nécessité aussi bien du point de vue écologique que politique. Depuis la naissance du capitalisme, la question s’est 36régulièrement posée en démocratie de soumettre le pouvoir économique au pouvoir politique. Tel fut le sens du New Deal aux États-Unis ou en France du programme du CNR, tel que mis en œuvre à la fin de la guerre. Mais où en sont aujourd’hui les États avec les GAFA ? Qui va contrôler les données de santé par exemple ?
SJ : Mais concrètement, comment fait-on pour construire cet ordre mondial plus juste ? Sur qui s’appuie-t-on, quand on voit que le multilatéralisme s’effondre ?
Il y a des moments historiques où le problème tient à l’absence d’horizon. C’est le propre de la globalisation et du Marché total, qui nous enferment dans un monde réduit aux calculs d’utilité, à un monde plat et donc sans horizon, où la démocratie n’est plus qu’un « marché des idées », tel que théorisé par Coase. Or sans horizon, il n’y a plus de sens à l’action ! Pour en sortir, il faut d’abord avoir en tête l’idée d’un meilleur monde possible. C’est ce que firent les auteurs du programme du CNR, lorsqu’en pleine occupation, alors même que la France était défaite, ils se sont demandé « quel avenir voulons-nous pour notre pays une fois libéré ? ». Cette question, il me semble que beaucoup de jeunes se la posent, qui ne rêvent pas de devenir millionnaires mais de construire un monde plus juste et respectueux de la nature. Mais le discrédit du politique et des institutions est tel qu’ils se replient sur des projets locaux, à la mesure de leurs seules forces ! Je ne vais pas les condamner alors que l’IEA de Nantes a procédé d’une démarche de ce type dans le domaine de la recherche. Mais ces initiatives seront sans lendemain si elles ne portent pas en germe un projet politique plus vaste !
YL : Quels seraient en particulier la place et le statut des entreprises dans cet ordre mondial plus juste ?
AS : Il faut en effet employer le pluriel ! Parler de « l’Entreprise » en termes généraux, engage dans un marécage conceptuel. D’un point de vue socio-économique, l’entreprise va de l’autoentrepreneur jusqu’à Elon Musk ! Alors mettre le même mot sur des phénomènes aussi divers, ça pose problème. Les entreprises publiques ont été un outil puissant de la reconstruction en France, or on ne pense plus du tout à elles. Les entreprises coopératives du secteur dit social et solidaire ne sont guère comparables aux holdings financières. La difficulté est d’autant plus grande 37que l’entreprise ne correspond à aucune forme juridique saisissable. Le droit saisit seulement la liberté d’entreprendre, c’est-à-dire la liberté de mettre en œuvre, seul ou avec des associés ou des salariés, une idée qu’on a d’abord eu dans la tête. Dans le domaine économique, entreprendre supposant le plus souvent de s’associer, la notion juridique d’entreprise se trouve liée, sans s’y confondre, à celle de société commerciale. Le droit accorde à ces sociétés la personnalité morale, c’est-à-dire – au sens étymologique du mot « persona » – un masque derrière lequel se trouvent ses dirigeants. Le monde des affaires est un bal masqué ! Cette notion de personne morale est d’origine théologique. Elle nous vient de l’idée de « corps mystiques », d’êtres immortels transcendant la succession des générations humaines. Doter ces êtres immortels, à la fois d’une capacité d’enrichissement illimitée et d’une responsabilité limitée est une opération extrêmement scabreuse. C’est pourquoi les sociétés anonymes ont vu leur création soumise, jusqu’au milieu du xixe, à un décret en Conseil d’État. Dans son livre sur les outils juridiques du capitalisme, Ripert qualifiait les sociétés anonymes de « monstres », en même temps que des « robots ». Robots très utiles à condition qu’ils n’échappent pas, comme le Golem, à leur créateur. Or c’est ce qui se passe aujourd’hui avec les grandes multinationales, et spécialement les GAFA, qui ont échappé à tout contrôle démocratique.
D’où une espèce de renversement des rôles entre l’entreprise et l’État. Certains soutiennent la thèse selon laquelle les multinationales auraient acquis un rôle comparable à celui des États et se substitueraient même à bien des égards à eux. On a d’un côté ce discours imputant aux entreprises des responsabilités sociales et environnementales qui incombaient à l’État, et de l’autre, l’injonction de gérer les États comme des entreprises ! Étrange renversement qui témoigne d’une incompréhension de ce qui spécifie les États et les entreprises et leur nécessaire articulation.
L’État, et c’est ce qui le définit dans son origine latine status, c’est ce qui est stable, qui demeure et est garant de la succession des générations. Quand une centrale nucléaire explose ou quand les marchés financiers implosent, quand il y a la COVID-19 ou des attentats meurtriers, tout le monde se tourne vers l’État : « l’État, que fait l’État ? » C’est donc tout à la fois l’instance en charge de risques incalculables (et donc inassurables) et le gardien de la longue durée. Les entreprises au contraire se définissent par un objet concret, des produits à réaliser ou des services 38à rendre. Entreprendre c’est mobiliser des hommes et des ressources économiques en vue d’une œuvre déterminée. C’est cette œuvre qui donne sens et « raison d’être » à l’entreprise, mais sa réalisation relève de calculs économiques. Dans le secteur privé en effet, sa poursuite est subordonnée à ses résultats financiers, d’où l’ambivalence de la notion de « finance », dont l’étymologie nous rappelle qu’elle est à la fois un moyen et une fin (du latin médiéval finare : mener une opération à son terme, clôturer une transaction et par extension « payer »).
Pour entreprendre il faut donc calculer et pour calculer, il faut que cette valeur incalculable qu’est la préservation de la vie sur le long terme, celle de l’écoumène, de la succession des générations, de la santé et de la sécurité des personnes — soit garantie par l’État. Milton Friedman porte évidemment un regard borgne sur les entreprises, lorsqu’il affirme que leur seule responsabilité sociale est de faire des profits. Mais, au fond, si elles paient leurs impôts et respectent le droit du travail et le droit de l’environnement, ça ne me choque pas ! C’est une vision borgne car en réalité, ce qui anime l’entrepreneur digne de ce nom et le distingue du spéculateur, c’est de rendre des services ou de produire des objets bons et utiles, qu’il s’agisse de légumes ou de livres, de maisons ou d’avions, de transports ou de spectacles, de prêts bancaires ou de viande de bœuf. Sa « raison d’être » se trouve dans la nature concrète de ces produits ou services.
Soutenable dans un cadre juridique national, cette vision borgne de l’entreprise devient intenable avec la globalisation. Émancipées des lois nationales qui garantissaient la sécurité des personnes et la préservation de l’écoumène, les grandes entreprises qui pratiquent le law shopping sont inévitablement rattrapées par ces questions.
Elles tentent d’y répondre en se réclamant de leur « responsabilité sociale et environnementale ». Mais s’il ne s’agit que de réclame, les effets peuvent en être pour elles dévastateurs, comme le montrent par exemple les déboires de Volkswagen, prise la main dans le sac de ses mensonges. On est dans cette situation paradoxale où on a d’un côté des entreprises qui disent « je m’occupe des générations futures, de la nature, de tout… » et puis de l’autre des États que l’on prétend gérer comme des entreprises. Voyez le cas de la Grèce, qu’on a soumise à un syndic de faillite – la Troïka – lui imposant de démanteler ses services publics, de précipiter ses vieux dans la misère, de brader ses ports et 39aéroports ! On a même envisagé de vendre certaines de ses îles, mais pour aller au bout de cette logique il aurait fallu licencier les Grecs les moins productifs et les jeter à la mer ! En France même la pandémie nous a permis de mesurer les effets dévastateurs d’une gestion des hôpitaux publics « comme des entreprises ».
Inversement, du côté des entreprises, la vogue de la responsabilité sociale et écologique (RSE) a accouché de ce qu’on nomme la compliance. On y retrouve à l’œuvre tout l’imaginaire de la cybernétique. L’idée est d’implémenter un programme dans les modes de fonctionnement des entreprises, comme on télécharge un logiciel sur un ordinateur. C’est-à-dire des batteries de procédures et de contrôles qui garantissent d’avance la conformité de vos agissements aux objectifs de la RSE, ce qui vous évitera de vous poser des questions. La compliance est à la direction d’entreprise ce que la réforme des retraites est à la justice dans les rapports entre générations, c’est l’illusion de croire qu’on a réglé à jamais une question, qu’on peut se dispenser d’avoir à réfléchir chaque jour dans des circonstances nouvelles face à des faits nouveaux. Défendre la liberté d’entreprendre, c’est défendre l’idée de règles du jeu communes préservant la liberté d’agir, et donc la responsabilité de chacun, dans un cadre qui fasse place à la démocratie économique.
SJ : En marge de votre enseignement et de vos recherches, vous avez vous-même fait preuve d’un véritable esprit d’entreprise en créant à Nantes la MSH Ange Guépin (1993) puis le premier Institut d’études avancées français (2008). Ce dernier s’est inspiré des IEA de Princeton et de Berlin, tout en s’en démarquant pour s’ouvrir très largement aux chercheurs venant des pays du Sud. Quelle en était l’ambition de départ ? Après 10 ans de fonctionnement, et plus de 300 chercheurs accueillis à Nantes dans le cadre de ses promotions annuelles, pensez-vous que cet institut soit parvenu à faire émerger un nouveau type de rapport au savoir ?
AS : Au fond, cet institut me fait penser à la démarche de ces jeunes nantais qui se retrouvent au Solilab et qui disent « on coopère, on essaie de faire quelque chose qui ait du sens dans les conditions qui sont les nôtres ».
Je crois qu’il y a une crise profonde des sciences sociales, qui est liée à ce qu’on a évoqué tout à l’heure, c’est-à-dire à l’illusion de pouvoir réduire l’homme et la société à des objets. Or celui qui s’occupe d’une 40tâche sait sur cette tâche des choses que même son supérieur immédiat ne sait pas ; un malade a une expérience de la maladie que le médecin n’a pas, mais qu’il lui importe de connaître ; un pauvre sait de la pauvreté bien des choses qu’ignorent les professeurs d’économie… La plaie des sciences humaines, c’est de vouloir singer les sciences de la matière. C’est déjà une plaie pour la biologie, mais ça l’est encore plus pour les sciences humaines. Je n’en fais pas du tout grief aux sciences exactes. Mais si on prend l’éventail des sciences, il y a le vrai mou : la littérature classique — on apprend énormément des spécialistes de littérature car ils sont au plus près de cette diversité des cultures et n’ont jamais prétendu qu’ils allaient découvrir des lois uniformes – et puis il y a les vrais durs : les matheux et les physiciens. Mais au milieu, il y a les faux mous et les faux durs, les plus exposés à cette fausseté étant l’économie et la biologie ; l’économie, dans sa volonté de dire qu’il y a des lois universelles, et la biologie dans son alignement sur le paradigme mécaniciste du programme. Ces errements deviennent dangereux, l’histoire le montre, lorsque l’on pense pouvoir trouver dans ces sciences les lois ultimes de l’Homme et de la société. C’est une des leçons à tirer de l’expérience nazie et il conviendrait de ne pas l’oublier.
L’organisation du travail universitaire en silos disciplinaires, sur le modèle taylorien, maintenait, malgré ses défauts évidents, une marge de liberté assez importante pour la recherche. Ce n’est plus le cas avec la gouvernance de la recherche par les nombres. Songez que le premier indicateur qui figure sur le CV des chercheurs à l’échelle internationale tend à être la performance de fund raising, autrement dit le prix de marché ! Avant même les indicateurs bibliométriques ! Et que dire de la course au gigantisme engagée par le classement de Shanghaï, sinon que ce système est promis au même avenir que les Combinats de type soviétique, dont il est du reste un produit dérivé ! Dans l’univers taylorien de Metropolis, il y avait encore des gens qui réfléchissaient librement, tandis que la masse des travailleurs étaient réduits à l’état de robots. Cette liberté disparait avec la gouvernance par les nombres, qui traite tous les travailleurs comme des robots, y compris les chercheurs, les condamnant ainsi à la reproduction du même. La MSH Guépin visait à pallier les travers de la spécialisation taylorienne, en promouvant les échanges et collaborations d’une faculté à l’autre. L’IEA de Nantes ajoute à ce concert des disciplines le concert des civilisations. Il promeut 41l’universalisme en creuset, et non plus en surplomb, qu’appelle la mondialisation. Je crois vraiment que c’est le genre de dispositifs dont on a besoin, mais je suis obligé de constater que ces institutions sont tellement à contre-courant de l’imaginaire contemporain qui domine les politiques de recherche, qu’elles sont perpétuellement menacées de normalisation. Il faut tout de même rappeler que l’IEA de Nantes, qui s’est fait reconnaître en moins de dix ans dans le top 10 mondial de sa catégorie, ne bénéficie plus d’aucun financement direct du ministère de la Recherche ! L’IEA a été pour moi un bouillon de culture sans égal et je crois qu’à chaque fin d’année, c’est ce que ressentent les chercheurs venus y travailler. Ils ont le sentiment d’avoir pris part à une institution qui les a transformés et ouvert de nouveaux horizons. Simone Weil parlait de la contemplation de la beauté du monde, comme principe premier de la science. Le libre questionnement est la « raison d’être » du chercheur. C’est de là qu’il faut partir pour progresser sur les fronts avancés de la recherche ! En tout cas, je dois beaucoup aux amis, dont vous-mêmes, qui ont contribué à ces aventures !