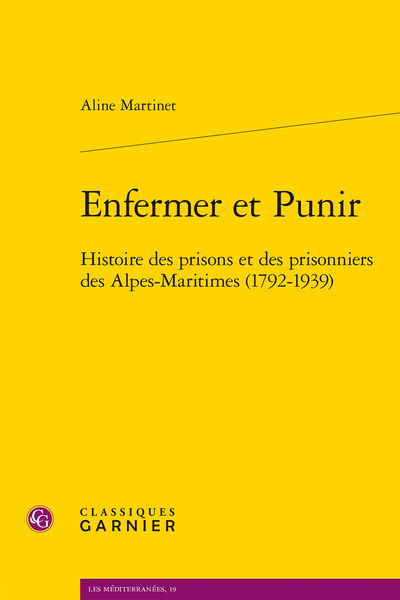
Préface
- Premier prix de la recherche historique du département des Alpes Maritimes
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Enfermer et Punir. Histoire des prisons et des prisonniers des Alpes-Maritimes (1792-1939)
- Pages : 11 à 14
- Collection : Les Méditerranées, n° 19
- Thème CLIL : 3378 -- HISTOIRE -- Histoire générale et thématique
- EAN : 9782406159452
- ISBN : 978-2-406-15945-2
- ISSN : 2264-4571
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15945-2.p.0011
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 10/04/2024
- Langue : Français
Préface
L’ouvrage d’Aline Martinet est la version remaniée de sa thèse de doctorat en histoire contemporaine, soutenue sous ma direction à Nice, au mois de février 2020. C’est donc avec un véritable plaisir que j’ai accepté de rédiger ces quelques lignes de préface. Son projet de recherche avait débuté dès sa première année de Master. Ses qualités d’historienne, sa force de travail et ses innombrables dépouillements d’archives, lui ont permis de pouvoir mener ce projet ambitieux à son point d’aboutissement, concrétisé par cette publication.
Les études sur l’enfermement ne sont pas si nombreuses et jouent un rôle important, tant sur le plan historique que sur celui de l’actualité. La prison et ses maux sont toujours présents à l’heure actuelle et toutes les réflexions sur ces questions interrogent également nos pratiques.
Dans le sillon notamment des travaux de Michelle Perrot, pour qui en 1975, la prison faisait partie du « grand nocturne des sociétés », l’historienne Aline Martinet nous livre ici une fine analyse de l’histoire des prisons et des prisonniers des Alpes-Maritimes de 1792 à 1939, grâce à une étude méticuleuse, s’appuyant sur une multitude de sources écrites françaises et italiennes, réparties aux Archives nationales, aux Archives départementales des Alpes-Maritimes, aux Archives municipales de Nice et de Grasse ou encore aux Archives d’État de Turin.
« Il n’y a de petit pays ni de petit sujet car il suffit que l’on aperçoive un fil abandonné qui traîne et que l’on prenne en main pour que la totalité de l’écheveau apparaisse brusquement », a écrit Albert Silbert, en 1966, dans Le Portugal méditerranéen à la fin de l’Ancien Régime xviiie-début xixe siècle. Cette remarque a conduit la démarche d’Aline Martinet, car si son étude porte sur l’évolution du système des prisons et prisonniers dans une analyse comparative, puisque le cadre géographique correspond aux anciennes limites de l’ancien Comté de Nice et de l’arrondissement de Grasse, c’est au final la société dans son ensemble, celle en « dehors des murs » et celle « enfermée », qui est analysée par l’historienne.
12L’originalité du travail d’Aline Martinet, repose sur une séquence historique relativement longue, allant de 1792 à 1939, une période durant laquelle la région niçoise est ballotée dans le concert des Nations. En effet, celle-ci est successivement administrée côté niçois, et selon les périodes, par l’État français, par le Royaume de Piémont-Sardaigne puis à nouveau par la France, ce qui pose le problème de la continuité de la détention face à l’alternance politique.
Mme Aline Martinet, joue ainsi constamment avec ce jeu d’échelles, des espaces et du temps. Cela permet d’inclure des régimes et des souverainetés nationales différentes et de mesurer et comprendre la manière dont les cadres politiques infléchissent les conceptions, les réformes et les pratiques de l’enfermement. L’historienne nous fait ainsi découvrir la construction du système pénitentiaire dans un cadre à la fois national, international et frontalier.
Aline Martinet nous entraîne ainsi, au fil des pages, dans l’organisation des lieux de détention. Ces derniers sont tous différents et n’y a pas de modèle unique. Durant la moitié du xixe siècle, on assiste néanmoins à un développement des normes architecturales pour standardiser le modèle de la prison. Mais ce que donne à comprendre cette thématique repose sur le fait que les lieux façonnent la vie des hommes et que l’architecture carcérale est une problématique incontournable dans une étude sur l’histoire des prisons et des prisonniers.
Parmi les nombreux points forts de l’ouvrage, figurent cette approche « par le bas », qui donne à comprendre la vie de ces hommes et de ces femmes « qui vivent enfermés » derrière les murs et les barreaux. Ils sont aussi bien prisonniers ou prisonnières que gardiens et gardiennes, et composent cette mini société des lieux de détention. Les forçats ne sont pas oubliés non plus dans l’ouvrage, comme l’illustre la chaîne des condamnés aux fers, arrivant de Turin ou de Gênes, en transfert au bagne de Toulon.
Dans l’ouvrage, les exemples de vie de cette population, vivant à l’ombre de la société, foisonnent. Parmi eux se retrouvent évidemment les rapports, qui sont pluriels, entretenus entre les détenu(e)s et le personnel surveillant. L’étude d’Aline Martinet, nous éclaire admirablement sur la vie « dans les murs » rythmée par la violence, les brimades et le vol, mais encore la sexualité avec des prisonnières qui se retrouvent enceintes ou avec le développement de pratiques homosexuelles. L’historienne analyse 13également les trafics en tous genres et parfois les plus improbables qui peuvent exister dans l’enceinte de ces lieux d’enfermement à l’image de la fabrication de fausse monnaie avec des os de seiche et de l’étain.
L’auteure livre également un éventail des formes de détention qui existent depuis le début de la période étudiée, durant laquelle certaines sont progressivement abandonnées, à l’image du bagne lors des années 1850.
Dans un même registre, se situe la place primordiale des gardiennes et des gardiens. Un personnel nécessaire pour la gestion des locaux et l’organisation de la vie carcérale au sein des lieux d’emprisonnement. Progressivement, les gardiens et les gardiennes deviennent au cours de la période de véritables surveillants professionnalisés et dotés d’uniformes, de fusils et de sabres. La question du genre permet à l’auteure de mettre en évidence l’importance de traitement qui s’instaurent au gré des périodes entre surveillantes et surveillants.
L’ouvrage restitue avec précision le contexte, l’ambiance et le fonctionnement interne qui représentent l’univers pénitentiaire dans son ensemble. Dans les prisons du xixe siècle, la discipline préside au règlement. Elle y règne en maître et Aline Martinet, nous donne ainsi accès à un domaine encore mal connu, que constitue la punition au sein de la prison ou la bastonnade pour le bagne.
Elle démontre comment la peine de prison consiste à éprouver une sensation d’inutilité de soi par le désœuvrement, l’isolement, la fréquentation forcée avec d’autres prisonniers, la nourriture imposée, réglementée, l’hygiène rudimentaire, les problèmes liés à l’absence de sexualité et d’intimité. Le problème de la pauvreté en prison n’est pas oublié. Aline Martinet analyse, non seulement les conditions de vie en prison, mais aussi les stratégies de survie et les résistances à cet univers.
Parmi les points forts de l’ouvrage figurent notamment les études des lettres de détenus, les sollicitations, les demandes de grâces, etc., de même que certaines conditions d’enfermement, dont un éclairage est donné avec l’usage de la paille, ou encore l’analyse « des barbets » et du « barberisme ». L’ensemble de ces domaines représente indéniablement un apport incontestable des recherches d’Aline Martinet.
Cette vue « par le bas », met en lumière avant tout les individus, les hommes tout autant que les femmes. L’analyse nous permet de suivre l’évolution globale de cette population et de mesurer s’il existe des 14constantes dans l’enfermement carcéral. En fait, ce n’est pas automatiquement l’absence de travail qui conduit en prison mais la précarité qui est lié à celui-ci : le manque de stabilité professionnelle, les métiers peu qualifiés, facilement remplaçables et peu payés caractérisent une grande majorité des détenus. L’irresponsabilité est aussi un trait commun : le célibat, l’absence de cadre familial structurant ou encore d’enfant, sont des éléments fragilisant.
Aline Martinet a fourni un travail d’une qualité peu courante, qui a réussi à restituer une histoire « par le bas » à la fois politique, juridique, administrative, mais surtout humaine de l’histoire des lieux d’enfermement. C’est une plongée dans la vie quotidienne des prisons qui est souvent synonyme d’entassement, d’isolement, de pauvreté, de précarité et d’épidémies, malgré les préoccupations morales des autorités politiques et les prises de conscience de l’importance de l’hygiénisme.
La force de l’ouvrage repose sur le regard neuf de l’historienne qui se veut à la charnière entre histoires individuelles et histoires collectives. Son livre est le fruit d’un riche travail, construit avec intelligence et révélant un immense investissement dans la diversité des approches. La démonstration est menée avec le nécessaire sens de la nuance, avec un souci constant du concret et avec finesse. Son étude constitue un réel apport historiographique.
Jean-Paul Pellegrinetti
Professeur Histoire contemporaine Université Côte d’Azur Nice
Directeur du Centre
de la Méditerranée Moderne et Contemporaine (CMMC UPR 1193)