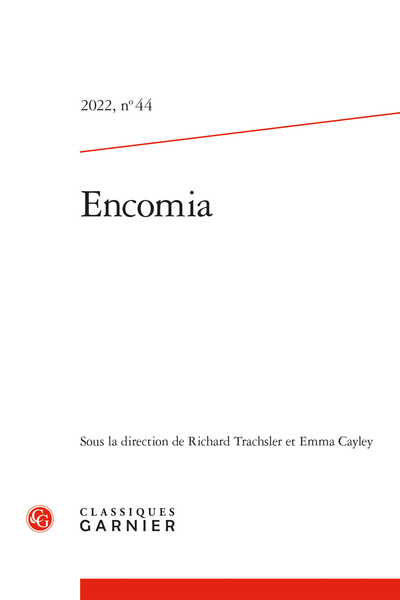
Un nouveau fragment des Vœux du paon dans le Fonds Paul Meyer
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Encomia
2022, n° 44. varia - Auteur : Veneziale (Marco)
- Résumé : Le Fonds Paul Meyer, déposé à la Bibliothèque universitaire de Nancy, outre la bibliothèque du grand savant, conserve aussi, sous la cote Meyer 6, une collection méconnue de fragments et chartes originales du Moyen Âge. Dans cette contribution, nous donnons un premier aperçu de cette collection, et examinons de manière plus exhaustive un fragment inconnu contenant un passage des Vœux du Paon de Jacques de Longuyon.
- Pages : 231 à 248
- Revue : Encomia
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406167266
- ISBN : 978-2-406-16726-6
- ISSN : 2430-8226
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16726-6.p.0231
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 24/04/2024
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
- Mots-clés : philologie romane, histoire de la philologie romane, Jacques de Longuyon, Paul Meyer, collectionneurs
Un nouveau fragment
des Vœux du paon
dans le Fonds Paul Meyer1
Le Fonds Paul Meyer à Nancy
Les études des dernières décennies consacrées à l’histoire de la philologie romane en France (et plus largement en Europe) ont bien démontré l’importance d’une mise en valeur des figures fondatrices de notre discipline, notamment des personnages ‘mythiques’ de la première génération de philologues ayant dirigé des chaires de philologie romane, celles de Gaston Paris, Adolf Tobler et de tous ceux qui avaient grandi scientifiquement en suivant les enseignements de la Grammatik der romanischen Sprachen de Friedrich Diez. Cet intérêt porté à l’histoire de la discipline a conduit à la parution d’intéressantes études fondées sur un large dépouillement des archives personnelles, mais aussi à une remise en question critique des travaux de l’époque.2 En outre, l’édition de plusieurs correspondances a permis de projeter une nouvelle lumière sur le modus operandi de ces savants et sur leurs milieux et noyaux d’associations.3 Pour ce qui concerne la philologie romane en France, on a ainsi vu paraître des monographies capitales consacrées à Gaston 232Paris et à son élève Joseph Bédier ;4 manque encore jusqu’ici un travail d’ensemble sur le troisième médiéviste français capital à cheval entre les xixe et xxe siècles : Paul Meyer.5 Sans avoir autant d’ambition, notre étude entend fournir quelques nouveaux éléments d’analyse concernant ce dernier.
Contrairement aux archives de G. Paris et J. Bédier, presque entièrement conservées dans les institutions parisiennes, les documents relatifs à la vie de Paul Meyer ont en partie pris le chemin de l’Est de la France. Si son énorme correspondance et ses ‘papiers concernant ses recherches dans les bibliothèques et ses travaux philologiques’ ont rejoint après sa mort, légués par sa femme Madeleine, les collections de la Bibliothèque nationale de France (respectivement nouvelles acquisitions françaises 24417–28 et 23955–71), une partie de ses archives privées et sa bibliothèque personnelle, destinées par Meyer lui-même en 1917 à la Bibliothèque Universitaire de Strasbourg, ont été abritées à partir de 1918 ou 1919 par la Bibliothèque universitaire de Nancy : le choix de Nancy était prudent, la ville se trouvant sur le chemin de Strasbourg, mais assez à l’intérieur du territoire français pour ne pas risquer de tomber sous la domination allemande. Cette documentation n’a pas poursuivi ensuite son chemin vers l’Alsace redevenue française : c’est donc en Lorraine que sont conservés tous ces matériaux en large partie inexplorés,6 l’ensemble 233étant constitué à partir de la bibliothèque du savant, de sa collection de tirés-à-part, mais aussi de ses nombreux documents préparatoires (notes, transcriptions, épreuves corrigées, etc.). De plus, parfois, à l’intérieur des tirés-à-part et des livres, on retrouve certaines de ses annotations, mais aussi des lettres qui lui étaient adressées, documents qui ont donc échappé à la construction de la correspondance complète conservée à Paris et qui permettent ainsi de la compléter.7
Parmi les documents les moins explorés du fonds, sous la cote Meyer 6, on retrouve même une collection de fragments médiévaux et de chartes originales datant du xiie au xvie siècle et qui ont appartenu au grand savant. Il s’agit de documents inédits, non catalogués, et qui sont jusqu’ici restés inconnus des philologues et linguistes. On sait bien que grâce à ses missions, P. Meyer, infatigable découvreur de textes et manuscrits, avait eu connaissance de vastes bibliothèques privées anglaises comme celle de Thomas Phillipps, où il avait par exemple retrouvé le poème inconnu sur Guillaume le Maréchal ;8 on sait aussi qu’il s’était lancé, durant sa jeunesse, dans l’exploration des archives du Midi et dans la transcription de chartes occitanes ;9 en revanche, on ignorait quasi entièrement son 234goût de bibliophile et collectionneur. Le seul cas bien documenté d’un manuscrit lui ayant appartenu est celui du célèbre ‘fragment de Passy’ de Girart de Roussillon, ayant porté cette dénomination puisqu’il était conservé chez le philologue au ‘99, rue de la Tour, Passy’ (aujourd’hui entièrement dans Paris).10 Dans ce cas-là, la possession du fragment se justifiait par le fait que P. Meyer avait dédié une longue partie de sa carrière à l’étude de cette chanson de geste, travail qui aboutira non pas à la difficile édition du texte, mais à sa traduction en français moderne.11 P. Meyer possédait le manuscrit depuis la fin des années 1860, comme il le déclare lui-même dans une note à l’intérieur du f. de garde : ‘Ces feuillets servaient de couverture à un registre du xive s. qui appartient à l’étude de M. Gervais notaire à Anduze. Ils m’ont été donnés par mon confrère Lebreton en mai 1867. Paul Meyer.’
À partir du dépouillement du Meyer 6, il est difficile de savoir comment et à quelle époque le fonds de chartes et fragments s’est constitué. Sans doute les documents ont-ils fait l’objet de plusieurs achats dans le temps, sans qu’il soit possible de savoir où et à quelle époque. L’immense correspondance avec G. Paris, par exemple, ne dit rien à ce sujet. Dans certaines chartes, des notes autographes de P. Meyer permettent cependant d’indiquer d’où provenait du moins une partie de la collection.
Dans le document no 8, on lit, en anglais et de la main de P. Meyer :
Bought by Eug. Burnouf about 1821 ; given by Mad. E. B. to Mons. L. D. – Bought from Mad. L. D., for the national subscription. 5 fr.
P. M. 11 Febr. 72.
Et dans le document no 16, en occitan et de manière plus ample :
235Aquesta carta fo comprada entor a l’an 1821 por Eug. Burnouf ; e lonc temps aprés fo donada per ma domna Na E. B. al senhor L. de la Isla ; e puis fo comprada per me, P. Major, di madomna Na L. de la Isla, per V ff apicadoiras al pagamen del trahut que se lia de pagar als Alamans. Aiso fo fach el dia XXII del mes de fevrier c’om comta MDCCCLXXII.
À partir de ces deux documents on peut retenir plusieurs informations. Tout d’abord, les deux chartes avaient appartenu à Eugène Burnouf (1801–1852), linguiste et indologue français – à ne pas confondre avec son cousin germain Émile-Louis Burnouf, le célèbre sanskritiste, dont les archives sont également conservées à l’Université de Nancy –, qui les avait achetées en 1821. La fille d’Eugène Burnouf, Laure, avait ensuite épousé Léopold Delisle (1826–1910), d’abord conservateur, à partir de 1852, puis directeur de la Bibliothèque nationale de Paris entre 1874 et 1905.12 C’est donc Laure Burnouf-Delisle qui avait offert les deux chartes à son mari, et c’est encore elle qui les avait vendues à Paul Meyer à deux moments très proches, les 11 et 22 février 1872, chacune au prix de cinq francs, afin de participer à la souscription nationale ouverte pour payer les dettes de guerre envers l’Allemagne prussienne. Nous croyons que P. Meyer se réfère ici au projet de souscription qui avait été présenté à l’Assemblée nationale le 22 janvier 1872 par le manufacturier et homme politique normand Lucien Fromage,13 repris quelques semaines plus tard dans la Gazette de Rouen et publié comme tiré-à-part par l’éditeur rouennais Cagniard.14 Il ne sera pas inutile de rappeler que Laure Burnouf-Delisle est un personnage qui, quoique largement méconnu, avait des intérêts à la fois érudits et artistiques. Elle s’était consacrée durant sa jeunesse à l’enluminure et devait avoir hérité plusieurs volumes de la bibliothèque de son père ;15 elle travaillait 236d’ailleurs côte à côte avec son mari sur ses projets scientifiques et s’est occupée de faire imprimer, en 1891, un recueil de la correspondance de son père.16
L’ensemble des chartes du Meyer 6 est très hétérogène et présente des documents à la fois en latin et en langues vernaculaires, touchant simultanément aux domaines d’oïl et d’oc. Le plus ancien document en latin est une charte provenant d’Ermenonville (Oise) et datant de 1235 ; la plus ancienne charte en occitan nous paraît être la no 14, datée de 1288 et provenant d’Aurelle (aujourd’hui Aurelle-Verlac, Aveyron) ;17 pour le domaine d’oïl, une charte parisienne datant de 1275.
On peut faire des observations semblables pour ce qui concerne les fragments, en général des feuillets détachés issus de manuscrits latins utilisés pour relier d’autres ouvrages. On a ici des documents qui peuvent être plus anciens, comme un bifolio d’un ms. latin datant sans doute du xiie siècle, mais aussi un fragment d’un ms. juridique bolonais du xive siècle. La collection paraît donc très hétéroclite. Sans vouloir proposer ici un répertoire des différentes pièces, nous voudrions nous concentrer sur le document qui à nos yeux de romaniste paraît le plus intéressant, à savoir un folio détaché contenant un extrait des Vœux du paon de Jacques de Longuyon, poème qui inaugure le Cycle du Paon et qui suit de près le Roman d’Alexandre. C’est en vain qu’on cherchera des informations concernant notre fragment dans l’étude capitale de Paul 237Meyer sur la légende d’Alexandre le Grand ; le savant ne considérait pas nécessaire, dans une page limpide, de se plonger dans la tradition de ce poème difficile et complexe que sont les Vœux : ‘Peu de poèmes du Moyen Âge ont obtenu un succès comparable à celui des Vœux du Paon. J’en connais une trentaine de copies, dont il me paraît inutile de dresser ici la liste.’18 Peut-être P. Meyer n’était-il pas encore le propriétaire du fragment, lorsque, en 1886, parurent les deux volumes (en gestation à partir de la fin des années 1860) ? Ou bien devait-il en juger la valeur philologique si limitée qu’il n’était pas utile de le faire connaître, contrairement au témoignage de Girart de Roussillon ?
Le fragment
Le fragment de Nancy est formé par un feuillet de parchemin qui date à notre avis de la fin du xive siècle. La partie supérieure du feuillet a été coupée au-dessous de la première ligne de texte : la mise en page originaire, qui prévoyait deux colonnes de 40 vers chacune, a donc été réduite aujourd’hui à 39. Le fragment s’ajoute à une très vaste tradition manuscrite qui demeure, encore aujourd’hui, largement inexplorée et qui dépasse désormais la quarantaine de manuscrits complets, sans oublier les fragments qui ont, entre temps, été découverts.19
Les Vœux du paon, poème long et difficile, n’a pas encore bénéficié d’édition critique,20 et n’a pas non plus joui d’une large attention de la part des historiens de la littérature. D’un point de vue diégétique, 238le poème s’insère à la suite du Roman d’Alexandre, dont les Vœux ne sont que l’une des nombreuses continuations. Pour la lecture du texte on se base encore sur l’ancienne édition de Ritchie, qui édita aussi le texte français pour permettre des comparaisons avec la traduction en écossais. L’œuvre a paru entre 1921 et 1929 pour la Scottish Text Society. Pour la version française, le travail est fondé sur le ms. London, British Library, MS Additional 16956, une transcription moderne datant du xixe siècle du manuscrit Paris, Bibliothèque nationale de France (BnF), MS français 12565.21 Ce manuscrit choisi par l’éditeur est nommé W dans son classement, qui reprend celui de P. Meyer sur les mss du Roman d’Alexandre.22 Ce codex, quoique tardif et appartenant à une famille qui remanie le texte, est d’ailleurs le seul de toute la tradition qui conserve le colophon où apparaissent les noms de l’auteur, Jacques de Longuyon, et de son feu protecteur, Thibaut de Bar, évêque de Liège (mort en 1312). C’est pour cette raison que Ritchie et son élève Fletcher furent contraints de supposer une double rédaction d’auteur et que le ms. W, quoique tardif, descendait directement de l’original de la seconde.23 Le manuscrit fr. 12565 soulève plusieurs difficultés : tout d’abord, il est postérieur de plusieurs décennies à la date de mort de Thibaut (alors qu’existent des copies datant presque des années où le roman a été composé, tel Oxford, Bodleian Library, MS Douce 308) ; ensuite, le copiste, sans doute picard, normalise plusieurs traits linguistiques lorrains propres à la langue de l’auteur.24 Il faut aussi souligner que 239Ritchie avait collationné un bon nombre de manuscrits français, mais, comme l’observera quelques décennies plus tard le deuxième éditeur des Vœux, Casey, son apparat s’avère largement inutilisable du fait du nombre d’erreurs qui le déparent.25 Il ne faut cependant pas, à notre avis, réduire encore plus les mérites du travail de Ritchie, qui, à l’époque où il a été mené, fournissait une solide érudition. D’autant plus que son édition portait sa plus grande attention à la version écossaise (The buik of Alexander ; ‘Le livre d’Alexandre’), qu’il imprimait face au français : là aussi, le choix du manuscrit W s’imposait pour Ritchie pour des raisons macrotextuelles, puisque dans le manuscrit W et dans le texte écossais les Vœux suivent le Fuerre de Gadres.26
La tradition du texte a été ensuite étudiée dans deux thèses nord-américaines. La première, déjà citée, de C. Casey, proposait une édition du texte à partir des seuls manuscrits de la famille P et était fondée sur le manuscrit Oxford, Bodleian Library, MS Douce 264 (sigle P,manuscrit picard datant de 1338) ; la seconde, partielle, se basait sur les manuscrits de la famille S, et en particulier sur le manuscrit Paris, Bibliothèque nationale de France (BnF), MS français 1590 (manuscrit S, datant du début du xive siècle).27 Chacun de ces deux travaux possède ses mérites, mais aussi ses défauts : étant fondés sur une seule famille textuelle, les deux ne donnent pas non plus une vision d’ensemble du 240texte ; d’ailleurs, s’agissant de thèses inédites dactylographiées, ils ne sont pas non plus une garantie de précision scientifique. À partir de ces quelques observations, on voit déjà qu’une nouvelle édition qui organiserait la riche tradition textuelle fait partie des desiderata de la communauté scientifique. Cela permettra ensuite de mieux aborder l’étude littéraire du texte qui, exception faite de la belle monographie d’H. Bellon-Méguelle et d’un volume d’actes recueillis par C. Gaullier-Bougassas, est encore largement inexploré, les études s’étant concentrées sur des aspects ponctuels du roman, telle l’apparition du thème des Neuf Preux, ou bien le rapport au reste du cycle alexandrin.28
À cause de la situation éditoriale du texte et de la connaissance très partielle de sa tradition, il nous a été impossible de placer sûrement le texte du fragment à l’intérieur de la chaîne de diffusion du roman. On peut cependant déjà indiquer quelques tendances. Ritchie avait déjà observé l’existence de trois familles principales de manuscrits, dont la plus ancienne était celle qu’il nommait p-q, auxquelles s’ajoutent les familles s et n (à laquelle appartient W).29Selon le chercheur, chacune des familles textuelles représenterait une rédaction différente du roman : on constate en effet que, parmi les différents manuscrits, le nombre des vers peut connaître des variations assez considérables, la laisse d’alexandrins permettant l’inclusion ou l’exclusion de plusieurs vers sans que la structure même de la strophe en soit modifiée. La même laisse peut avoir une dizaine de vers de plus ou de moins selon les différents manuscrits et les différentes familles. À partir de ce constat, nous croyons que, dans la partie du texte qui a survécu, le fragment suit d’assez près un modèle qui devait être proche du manuscrit W et donc appartenir à la version remaniée de n : par rapport à W, le fragment insère un seul vers supplémentaire, le v. 726a, ‘Tant chevaucha qu’il vint a Edeas tout droit’, qui naît pourtant sans doute d’un saut en arrière à partir du deuxième hémistiche du v. 724, ‘Alés a Epheron a Edeas tout droit’. Cette leçon du fragment de Nancy ne se retrouve ni dans le texte, ni dans l’apparat d’aucune des éditions citées supra. De la même manière, les vv. 750–51 ont dû tomber, sans doute à cause d’un saut du même au même à la rime :
241Et entre les vaillans nonmés et esleüs,
[Et li couarz clamés chetis et malostrus
Et ensaigniez au doi, con dolans recreüs]
Cassamus a parlé et a dit a ses drus. (éd. Ritchie, vv. 749–52)
On retrouve une autre erreur du même type à la rime, lorsqu’au v. 770 le copiste du fragment répète le mot final du vers précédent : ‘Or n’i ait reculé ne tenu malvais plait, / Mais ayons en talent que chascuns son droit plait (W ait).’
Par rapport aux très nombreuses insertions ou modifications qui séparent W des manuscrits des familles p-q, il s’agit de variations minimales : on peut ainsi exclure tout de suite que le fragment soit directement apparenté aux manuscrits les plus anciens des familles p-q. Une erreur curieuse s’est produite au v. 758, dans le discours dans lequel Cassamus rappelle à ses soldats ses origines troyennes : son ancêtre ne peut pas être ‘Achilles’ comme dans le fragment, mais le très proche (paléographiquement) ‘Anchises’. Cette banalisation est d’ailleurs bien diffusée dans la tradition, par exemple dans les manuscrits de la famille p : P (Anchises) et P1 (Achilles) se comportant exactement comme W et notre fragment. Dans ces quelques cas, c’est donc notre fragment qui banalise par rapport à une leçon cohérente de W qui est confirmée par le reste de la tradition.
Il est difficile de proposer une hypothèse sur l’origine du fragment à partir de sa langue, d’un côté à cause des problèmes de stratigraphie de la copie (la présence de formes lorraines à la rime pourrait remonter à la langue de l’auteur, par exemple dans la laisse en -al, cf. Fletcher § 2), de l’autre à cause de l’évident effort de normalisation de la scripta de notre témoin, phénomènetypique du moyen français.Nous retrouvons cependant dans le texte quelques éléments qui, à l’intérieur d’une scripta centrale, renvoient de manière assez générique au Nord/Nord-Est du domaine d’oïl, sans qu’il soit cependant possible de resserrer la localisation à une région plus étroite. C’est le cas de quelques picardismes très diffusés comme biaus 689 692 (Gossen § 12),30 ou la fermeture du e protonique atone en signor 753 (Gossen § 34). On peut ensuite reconduire à une vaste région du Nord/Nord-Est la base du futur en ar- dans arons 755 (Bragantini-Maillard et Denoelle, p. 83),31 l’absence d’une consonne intercalaire dentale dans le 242groupe -n’r- (Gossen § 61, trait bien diffusé aussi en wallon, lorrain et descendant jusque vers la Bourgogne), engenra 655 764, vanrai 713 (W vaintrai), aussi bien que la conservation graphique du -t final dans moitiet (Gossen § 46, ‘trait caractéristique des scriptae lorraine, wallonne, ardennaise et picarde’), la réduction -iee > -ie dans alegie 715 (Gossen § 8), la vocalisation de l (Gossen § 23) dans caupa 643, ou les formes affaiblies du possessif no cousin 761 et vo suer 764 (Gossen § 68), qui offrent cependant d’‘indéniables avantages métriques’ et pourraient donc remonter plus haut dans la tradition.32 Enfin, l’ajout graphique d’un <l> dans biaulté 664 sera à considérer comme une reconstruction pseudo-étymologique typique du moyen français, aussi bien que l’abondant usage du graphème <y> – par exemple bysus 680. Pour ce qui concerne le lexique, on trouve deux fois (la première à la rime) le mot régional du Nord, Nord-Est et Est taions ‘grand père’ 678 758.33 Intéressante nous paraît ensuite la forme trisyllabique mïedi(-s) 618 742pour midi ; comme le suggère le Tobler-Lommatzsch (TL vi 12 22 ss.), elle est probablement construite par analogie avec mïenuit.34 Or, il nous semble que cette forme est utilisée dans des textes littéraires provenant principalement du Nord et du Nord-Est – cf., outre les exemples de Tobler, DEAFpré s.v. midi ; nous signalons en outre que la forme se retrouve en moyen français seulement chez Froissart, cf.DMF, s.v. midi ; trois occurrences dans le domaine picard aussi dans les DocLing).35 Les manuscrits des Vœux optent, ici aussi, tantôt pour la variante bisyllabique, tantôt pour la trisyllabique : au v. 618 les mss W et P ont ‘ains qu’il soit miëdi’, alors que N1 et S1 lisent ‘ains quë il soit midis’.
Le fragment contient enfin quelques éléments sûrement postérieurs à la date de démembrement du codex qui s’avèrent utiles à la reconstruction de son histoire. En effet, dans le recto, à quatre reprises, on retrouve, en écriture gothique, la signature d’un certain ‘Guilliermus Cousin’. Quoique le nom soit assez commun et que plusieurs puissent être candidats à l’identification, il vaudra la peine de signaler que l’un des chanteurs de la chapelle royale de Louis XII s’appelait ainsi ; il était d’ailleurs aussi, dans 243une supplication au pape du 25 juin 1512, décrit comme ‘Guillermus Cousin, parrochialis ecclesie teneri de Cuy et Sermonest Suessionensis diocesis rector’,36 recteur de la paroisse de Cuy et Sermonest dans le diocèse de Soissons, donc dans une région proche de celle où, plus d’un siècle auparavant, le manuscrit aurait pu être produit.
Il reste à fournir une transcription du fragment de Nancy. Vu l’état de la tradition textuelle, nous nous limitons à indiquer en apparat les divergences entre le texte du fragment et celui de W, repris de l’édition de Ritchie, dont nous reprenons aussi la numérotation. Cela permettra d’ailleurs au lecteur de compléter les passages où la leçon du fragment est tellement abîmée qu’il est impossible de la reconstruire. Nous avons introduit les lettres majuscules en début de phrase et pour les noms propres, nous distinguons en outre u/v et i/j et insérons la ponctuation selon l’usage moderne. Nous n’avons introduit cédilles ni trémas. Enfin, nous soulignons les leçons dont la lecture est douteuse à cause de l’état de conservation du fragment et indiquons entre crochets les passages qui ne sont pas lisibles. De façon systématique, nous avons résolu ‘ml’t’ comme mout ; ns/vs comme nous/vous ; toutes les lettres restituées sont indiquées en italique.
A[…………] miedis, vera tel ensoignal
Q[…………]it estre en son pais in[…].
Les batailles chevauchent, si […………]620
Cassamus [……] et lor gen[…………]nal
Gadifer se treslance devant tous en herbal,
La lance porte droite au penon de cendal.
Quant Clarvus l’a veu, si a fait autre estal
Andui mainent bruiant parmi le sablonnal,625
Li uns feri si li autre enmi le poitrinal37
Qu ’ il n’i remest estrier ne cengle ne poitral.
A la torneboiel tornant andui aval,
Des hyaumes el sablon font ferir li vassal,
Ambedoi saillent sus que n’i font arrestal,630
Ja y eust bataille et fier estor mortal
Quant les batailles vienent bruiant par le praial,
Mais trop sont li Yndois et poi sont Fezonnal.
244M out fu dolens Clarvuset le cuer eut irais
Quant il se vit cheus du destrier qui fu gays.635
Vistement saut en piés, de grant proesce estrais,
Embrachié ot l’escu, prés de lui ot les ais,
Le branc nu en la main, dont maint tel cop a fais.
Freres fu a Porrus, le signor des Yndois,
Qu ’ Alixandreconquist, li rois macedonois,640
Devant Pantapolus, aprés la mort Daurrais,
Adont quant Bucibal, le bon destrier norrais,
Fu mors et affolés et des .ii. piés contrais,
Car Porrus li caupa, com faus et mauvais ;38
Mais venjement en prist li bons rois des Grijais.645
Cis Clarvus dont je dis et dont je tieng mes plais,
Fu freres cel Porruset fil au roi Sesais.
Clarvus, li viex Yndois, fu enmi le garrais.
Estoit sor son cheval,.ii. pas s’est avant trais
Fors et fiers et hardis, avisés ert ses fais.650
Le dansel apercut, qu’il n’ot veu ainc mais,
Grans estoit et corsus pour soffrir .i. grant fais.
A soi meismes dist : ‘Cis est nés et estrais
Du lignage Priant, de la feme Escabais.
[………] l’engenra li bons []nnes palais655
Tel cop m’a hui doné dont mes escus est frais’.
[………………………………………][rb]
Ga[…………]vient, fait li a[……] eslais
[………………………] assis petit fu ses esmais
[………………………] n’est fors que solais660
[…………………………] vous jamais.
[………………]aume agu, qui fu a or pourtrais,
Feri Clarvus l’[I]ndois, qui d’aimer [……] gais
Pour la tres biaulté grant ma dame Fezonais
Trestous en abati etbercleset balais,665
Et Clarvus le refiert, qui poi prise ses fais.
Ja y eust estor et d’espees grans glais,
Mais trop sont li Yndois et poi li Fezonais.
A l’entree des loges devant les pavillons
[……………………] feri des esperons670
Et Clarvus li Indois plus tost q[u’e]smerillons,
La ot grant hurter d’escus et de bastons,
Et li glais des espees, li esclat des troncons,
La freor des chevaus, la fierté des barons.
En l’ombre des banieres, au ferir des esperons675
245S’en vint poignant Betis, cis jones valetons.
‘Torton !’ va escriant, qui ja fu niés Besons,
Li roi de Somie, qui estoit ses taions,
Et Gadifer ses peres, qui mout fu vaillans […].
Grans fu et[…]et bysuset joins comme facons680
Embronchiés en son hyaume, en son escuiois (sic),
La lance porte droite, que ce fust .i. byons.
Sun cheval va plus tost que uns esmerilons
Ens el grant tas se lance la u il vo[………],
El pis fiert .i. Yndois que estoit grans et bons685
Res a res pres du cuer li trence les fracons,
Amont envers le ciel en torna les talons.
Sa lance brise en trois, puis escria courons :
‘Biaus oncles Cassamus, ici vous semonons
De paier Edeas sa promesse et ses dons690
Que il faist hui au chaucier esperons.
– Biaus niés, dist Cassamus, il est drois et raisons.
Bien se garde Clarvus que, se nous l’ataignons,
V[…]s ci le branc d’acier dont nous le paierons.’
Q uant Cassamus entent que Betis rame[…]695
La promesse Edeas, qui si tres bele […]
[………………………………………][va]
Quant li viés le jura que la bele l’amoit
Cuer et force en son sons ensamble li croissoit.
Volentiers li revint, es estriers s’afficoit700
D’ire et de maltalent tous son cors fremissoit
La lance au pinonncel con[trem]ont39conduisoit
Et li destriers li lance qui les grans saus faisoit,
Parmi le pré herbu comme foudres bruioit.
Cassamus enclinant en l’escu se joignoit,705
Au comble de l’escu le vassal conduisoit,
Trestout en fu couvers aussi com le portoit.
A haute vois s’escrie : ‘Clarvus !’ ou il estoit,
En repuier li dist, si que bien l’entendoit :
‘Je sui viex et vous estes de l’ancienne loy710
Si amés, ce dist on, mais c’est a povre esploit
Que ne vous ainme pas, mais j’ains et si ai droit
Car je vanrai anuit la guerre et le tornoit
Tout pour l’amor de cele dont j’ai l’anel el doit.
Alegie l’avés et mise a grant destroit,715
Se serés ses amis, mais avenir porroit
Encore en aucun tans que s’en repentiroit.’
Aissi dist Cassamus, ou miex esperonnoit,
246Et d’autre part es pres .i. Persans li venoit
Cassamus le feri, qui point ne l’espargnoit,720
Le cuer par le milieu a moitiet li fendoit.
Li Persans chai mort, et Cassamus prenoit
Le cheval qu’ot conquis. A.i. vallet disoit :
‘Alés a Epheron a Edeas tout droit :
Donnés li ce cheval, que bien avoir le doit.’725
Li vallés est montés, en la cité s’en voit.
Tant chevaucha qu’il vint a Edeas tout droit726a
Et de par le viellart .c. fois le saluoit.
La bele en rist de joie et au vallet disoit :
‘Grant merci, Cassamus, quant il li souvenoit
De moi ens el estour ou grant paine souffroit.730
– Dame, dist li vallés, par les diex ou on croit
Il est plus preus que nus ne vous diroit.’
Q uant li vallés ot fait le present Cassamus
A la bele au cors gent c’on appele Edeus,
D’Ephezon se parti, a l’estor est venus.735
[………………………………………][vb]
A trovés combatant desous .ii. pins foillus.
La estoit Edeus et le viel Cassamus,
Cousins germains Porron et hons liges Porrus.
A desviner furent Mais (sic) et Mercurius740
Arivé les y ot pour lui aidier Clarius.
Et aprés miedi au restor de Phebus
Enforca li estors grans et fors et cremus.
La fu mors Philotés, Cas et Androteus,
Li .i. s’en vont fuiant parmi le pré herbus,745
Li bon ne baissierent le chaple limalvais745a40
A l’abaissier des lances fu mervilleus li hus.
Qui la vaut estre preus, tantost fu conneus,
De ses bons fais prisiés et bien ramenteus,
Et entre les vaillans nommés et esleus.749
Cassamus appele et a dit a ses drus :752
‘Signor, soions hardi, li tans en est venus !
En boncommencement gist assés de vertus.
Se bien les assaillons, tost les arons vaincus.755
Ja sommes nous estrait du haut roi Priamus :
Hector fu mes cousins et li preus Troilus,
Achilles mes taions, mes peres Masonus,
Et Albaume ma mere, fille Leomedeus.
Jason et Hercules, Menon et Thentalus760
Si furent no cousin, et lor freres Argus ;
247Et si refu nostre oncle Betis li riche dus,
Gadifer, vostre pere, dont mout sui irascus.
Tous .ii. vous engenra et vo suer Phezonus.
Bien sommes pourveu pour venir au dessus765
Du despit que fait ont celle gent Yndeus.’
‘ Oncles, ce dist Betis, bien nous avés retrait
De quel gent nous sommes et de quel lieu estrait.
Or n’i ait reculé ne tenu malvais plait,
Mais ayons en talent que chascuns son droit plait770
Et de garder s’onnor vraie volenté ait,
Car qui plain doi en part, .c. piés en entrelait.
S’il sont plus et nous mains, de ce nus ne s’esmait,
Que ne fiere partout ou que bataille vait.
D’aidier soncompaignon soit chascunz en agait,775
Quant nous serons lassé, pas ne seron entait.’
Apparat critique
Sont indiquées seulement les divergences entre le fragment et le texte de W, tel qu’il a été édité par Ritchie.
618 A[…]] Ain qu’il soit 619 Q[…]it] Que il revodroit ◊ pais] palais ◊ in[…]] indal 620 […]] muent lor estal 621 […]] et Betis ◊ gen[…]nal] gent communal 622 herbal] l’erbal 624 a fait] refait ◊ autre estal] autretal 625 mainent] viennent ◊ parmi] delés 626 li autre] l’autre 628 tornant] tornent 629 li vassal] le nasal (erreur de lecture de Ritchie pour uasal ?) 630 ambedoi] li vassal 633 sont] li
635 gays] bais 638 tel] bel 639 le signor des Yndois] et filz au roy Cesais 646 et dont je tieng mes plais] et je t. ci les p. 649 Estoit sor son cheval] Estachiés sour ses piés 650 ert ses fais] en ses f. 651 apercut] a veu 654 la] sa ◊ Escabais] Ecubais 655 […]] Gadifers ◊ bons []nnes palais] gentis coens p. 657 Lors est avant passés de fierté lerté lÿonais 658 Ga[…]vient] Gadifers li revient ◊ li a […]] li a un 659 […]] D’un grant pas bien 660 […]] De tex gens assambler ce 661 […]] Plus bel fereur d’espée ne vairés 662 […]aume] Parmi son helme 663 […]] se fait 664 tres biaulté grant] t. g. b. 665 et bercles] bericles 666 ses fais] la pais
248670 […] feri] Ou Gadifers li jouenes bati 672 hurter d’escus et] fereis d’espees 673 glais des espees] g. des escus ◊ esclat] effroi 677 niés Besons] Mazonons 678 Somie] Mazonie ◊ estoit] ja fu 679 […]] hons 680 […]] lons ◊ bysus] drois 681 escuiois] escu escons 683 uns esmerilons] nus alerions 684 se lance la u il vo[…]] s’ebat ou il voit les plus bons 685 grans et bons] gentil hons 686 fracons] roignons 688 courons] tortons 691 il faist] li feistes 693 garde] gart or 694 V[…]s] Vez
695 rame[…]] ramentoit 696[…]] estoit 697 Qui s’amour au matin donnee li avoit 698 le jura que la bele l’amoit] l’embracha qui durement l’a 699 force en son sons] cors et penserz 701 fremissoit] estendoit 703 faisoit] sailloit 706 vassal] nazel 708 s’escrie Clarvus] escrie Clarvon 709 repuier] reproche ◊si que bien] que moult b. 713 tornoit] tournoy 714 Tout… de cele] Pour l’a. de celi 715 alegie] assegïe 716 seres] freres 721 par le mi] parmi le 724 Alés a Epheron] A Ephezon t’en va 725 Donnés] baille 726 Li vallés est montés] de par moy. Et cilz monte ◊ s’en voit] venoit 726a om. W 728 au vallet disoit]moult en merchïoit 729 Grant merci Cassamus]Le vaillant C. 730 moi] soi 732 Il est preus] Plus est p. Cassamus
735 se parti] est issus 736 Gadifer et Betis et auques de leur drus 738 Edeus] Agoris 739 Porron] Dairus 740 desviner] devineour ◊ Mais] Marc 741 arivé] amenés 742 Et après] A l’eure de ◊ restor] retour 744 Philotés] Phylatas ; Androteus] Mardocheus 745a Li bon tiennent le chaple, li mauvais sont confus 752 appele] a parlé 753 soions] soiés 758 Achilles] Ancizes 761 Si furent no cousin] Furent nostre c. 762 nostre] vostre 763 mout] je 764 Tous .ii.] Andeus 766 fait ont] nous font
768 nous sommes] sonmes né 770 plait] ait 772 plain doi].i. doit 774 ou que] quant en
Marco Veneziale
Université de Zurich –
Fonds national suisse
de la recherche scientifique
marco.veneziale@gmail.com
1 Nous tenons à remercier Rosa De Marco et Catherine Angevelle de l’Université de Lorraine, qui nous ont montré une première fois les documents dont il sera ensuite question dans cet article, et qui ont depuis rendu possible la consultation des originaux.
2 La bibliographie est désormais très vaste. Pour une première orientation, voir Charles Ridoux, Évolution des études médiévales en France de 1860 à 1914 (Paris : Champion, 2001) et, pour la situation italienne, Guido Lucchini, Le origini della scuola storica : storia letteraria e filologia in Italia (1866–1883) (Pisa : ETS, 2008).
3 Les correspondances scientifiques publiées jusqu’ici sont très nombreuses. Pour n’en rester qu’aux protagonistes de cette première génération, il faudra citer au moins les initiatives de l’Europe des Philologues publiées aux Edizioni del Galluzzo de Florence, ou bien le projet du HugoSchuchardt Archiv <http://schuchardt.uni-graz.at> dirigé par Bernhard Hurch (consulté le 23/11/2023).
4 Ursula Bähler, Gaston Paris et la Philologie Romane (Genève : Droz, 2004) ; Ead., Gaston Paris dreyfusard. Le savant dans la cité (Paris : CNRS, 1999) ; Alain Corbellari, Joseph Bédierécrivain et philologue (Genève : Droz, 1997).
5 Beaucoup de travaux sont consacrés à la figure de Paul Meyer, sans pourtant qu’elle ait reçu un traitement systématique (un exemple entre tous : personne ne s’est jamais occupé de dresser une liste de ses publications). Beaucoup de nouveautés sur Meyer se retrouvent dans l’édition de sa correspondance avec G. Paris : Gaston Paris – Paul Meyer. Correspondance, éd. par Ch. Ridoux, avec la collaboration d’U. Bähler et A. Corbellari (Firenze : Edizioni del Galluzzo per la Fondazione Franceschini, 2020). Pour encadrer la figure complexe du grand savant, voir les études classiques de Jacques Monfrin, ‘Paul Meyer et la naissance de la philologie moderne’, dans Id., Études de philologie romane (Genève : Droz, 2001), pp. 21–34, ainsi que les deux remarquables travaux d’Alberto Limentani, ‘Girart de Roussillon, Meyer et Bédier’ et ‘Meyer, l’epopea e l’affaire Dreyfus’, dans Id., Alle origini della filologia romanza (Parma : Pratiche, 1991), respectivement pp. 97–121 et 123–44.
6 Sur les conseils de Yan Greub, c’est Richard Trachsler qui, le premier, a mis l’accent sur l’importance de ce fonds : ‘Les hommes, les archives, les livres. À propos du Fonds Paul Meyer conservé à la Bibliothèque Universitaire de Nancy’, Romanische Studien,4 (2018 = Engagement und Diversität : Frank-Rutger Hausmann zum 75. Geburtstag, hrsg. von W. Asholt, U. Bähler, B. Hurch, H. Krauss, K. Nonnenmacher), 433–43, qui fournit une description sommaire des différentes parties composant le Fonds Meyer.
7 Yan Greub a ainsi pu augmenter la correspondance de G. Paris à P. Meyer de trois lettres inédites qui avaient échappé à Ch. Ridoux, cf. Yan Greub, ‘Un ensemble de documents précieux pour l’histoire de la philologie romane’, Revue de linguistique romane,86 (2020), 603–17.
8 L ’ histoire de Guillaume le Maréchal, comte de Striguil et de Pembroke, régent d ’ Angleterre de 1216 à 1219, poème français publié pour la Société de l’histoire de France par Paul Meyer, 3 t. (Paris : Renouard, 1891–1901). Meyer avait découvert le manuscrit à la vente Savile de Londres en 1861, mais il avait pu le consulter, dans la bibliothèque de feu Sir Thomas Phillipps, seulement en 1881. Cf. Paul Meyer, ‘L’histoire de Guillaume le Maréchal, comte de Striguil et de Pembroke, régent d’Angleterre. Poème français inconnu’, Romania, 11 (1882), 22–74. Il s’agissait, pour le savant, d’un moment de profond désespoir personnel, à la suite du décès de sa première femme, Lilly ; cf. la carte postale qu’il envoya de Cheltenham à Ernesto Monaci le 13 septembre 1881 : ‘Je ne sais si j’irai en Italie en octobre, je suis très nerveux et restless, rien ne m’intéresse, pas même la découverte que j’ai faite récemment d’un poème français de 20’000 vers tout historique’, (carte postale conservée à Rome, Università ‘La Sapienza’, Archivio Monaci).
9 Paul Meyer, Documents linguistiques du midi, t. I : Ain, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes (Paris : Champion, 1909), p. ii : ‘J’étais encore sur les bancs de l’École des Chartes, que je copiais toutes les chartes provençales auxquelles je pouvais avoir accès. C’est à l’aide du recueil, bien insuffisant, que je m’étais formé et des textes imprimés, encore peu nombreux il y a trente ou quarante ans, que je rédigeai l’essai sur la langue d’oc et ses dialectes qui me valut, en 1874, le prix du Budget de l’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres […]. J’ai donc reconnu de très bonne heure la nécessité d’une exploration méthodique des archives du Midi de la France. Mais les circonstances ne me permirent pas de l’entreprendre aussi tôt que je l’aurais voulu’.
10 C’est aujourd’hui le manuscrit Nancy, Bibliothèque Interuniversitaire, 10. Comme le reste du fonds Meyer, le fragment a rejoint Nancy au début du xxe siècle ; toutefois, vu l’importance philologique du document, il a été extrait des matériaux de Paul Meyer pour rejoindre la collection des manuscrits.
11 Girart de Roussillon, chanson de geste traduite pour la première fois par Paul Meyer (Paris : Champion, 1884), p. clxxiv : ‘Passy. Fragment de cinq feuillets dont deux fort endommagés, qui est en ma possession. L’écriture est de la première moitié du xiiie siècle’. Sur cette traduction cf. l’étude de Limentani, Alle origini. Une édition diplomatique de Girart de Roussillon avait été publiée auparavant par Wendelin Foerster, cf. le sévère compte-rendu de Paul Meyer, Romania,10 (1881), 305–06.
12 Sur ce mariage, cf. Françoise Vielliard, ‘La jeunesse et la formation de Léopold Delisle’, dans Léopold Delisle : colloque de Cerisy-la-Salle (8–10 octobre 2004), éd. par Françoise Vieillard (Saint-Lô : Archives départementales de la Manche, 2007), pp. 29–47 (p. 45).
13 Lucien Fromage, Projet pratique d’une souscription nationale, soumis à l’Assemblée nationale, le 22 janvier 1872 (Rouen : Imprimerie de E. Cagniard, 1872).
14 Fromage, Aperçu de ce que doit être la souscription nationale pour arriver à payer l’indemnité de guerre due à l’Allemagne (Rouen : Imprimerie de E. Cagniard, 1872).
15 Paris, Bibliothèque nationale de France (BnF), Fac-similé Folio 144, copie de l’Essai sur l’art de vérifier l’âge des miniatures peintes dans les manuscrits de l’Abbé Rive, avait été acheté par Eugène Burnouf le 11 décembre 1842 et est ensuite entré dans les collections de la Bibliothèque nationale comme ‘Don Delisle Burnouf’ : le document doit donc être passé du père à la fille (qui le partagea avec son mari), à la BnF, cf. Francesca Manzari, Anna Delle Foglie, Riscoperta e riproduzione della miniatura in Francia nel Settecento : l’abbé Rive e l’“Essai sur l’art de vérifier l’âge des miniatures des manuscrits”’ (Roma : Gangemi, 2016), p. 199 et p. 214, cat. 73, qui reportent aussi l’information concernant sa jeunesse de miniaturiste.
16 Choix de lettres d ’ Eugène Burnouf (1825–1852) (Paris : Champion, 1891). Nous n’avons pas trouvé d’informations concernant ces ventes dans la correspondance de Paul Meyer, la seule lettre de Léopold Delisle à Meyer datée de 1872 ne mentionnant pas la question (Paris, Bnf, MS NAF 24420). D’ailleurs, dans la collection ne se trouvent pas des lettres de la main de Laure Burouf-Delisle.
17 Il s’agit donc de documents relativement récents par rapport aux chartes vernaculaires issues du Midi de la France. Il n’est pas inutile de rappeler que Paul Meyer s’est consacré aux écrits documentaires durant toute sa vie. Déjà à partir de 1874–1876, des chartes occitanes étaient rentrées dans son Recueil d’anciens textes bas-latins, provençaux et français ; en 1891 il avait fourni une édition de documents dans Le langage de Die au xiiie siècle ; mais surtout, en 1909, il avait publié le premier volume des Documents linguistiques du Midi de la France : Ain, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Paris, Champion. Cf. Martin Glessgen, ‘L’écrit documentaire médiéval et le projet des Plus anciens documents linguistiques de la France’, dans Manuel de philologie de l’édition, éd. par David Trotter (Berlin : De Gruyter, 2015), pp. 267–95.
18 Paul Meyer, Alexandre le Grand dans la littérature française du Moyen Âge, 2 t. (Paris : Vieweg, 1886), t. 2, p. 268. Il est d’ailleurs impossible de savoir si P. Meyer est entré en possession du fragment avant ou après la publication de son étude.
19 Antoine Thomas, ‘Un fragment des Vœux du Paon’, Annales du Midi, 9 (1897), 111–12 ; Jean-Jacques Salverda de Grave, ‘Un manuscrit inconnu des Vœux du Paon’, Studi medievali, 1 (1928), 422–37 ; Madeleine Tyssens, Frank Brooks, ‘Encore un fragment des Vœux du Paon’, Le Moyen Âge, 64 (1958), 449–66 ; Millan S. La Du, ‘Deux nouveaux fragments des Vœux du paon’, Romania, 77 (1956), 78–85 ; Edward B. Ham, ‘Fragments de poèmes français’, Romania, 66 (1940), 98–103 (fragment des Vœux contenu dans le ms. Paris, BnF, MS NAF 5237).
20 On attend l’édition annoncée par Hélène Bellon-Méguelle, à la suite de la publication de sa thèse, Du Temple de Mars à la Chambre de Vénus : le beau jeu courtois dans les Vœux du paon (Paris : Champion, 2008).
21 John Barbour, The Buik of Alexander or the Buik of the Most Noble and Valiant Conquerour Alexander the Grit, edited in four volumes, from the unique printed copy in the possession of the Earl of Dalhousie, with introductions, notes and glossary, together with the French originals (Li fuerres de Gadres and Les vœux du paon) collated with numerous Mss., by R. L. Graeme Ritchie, 4 t. (Edinburgh / Londres : Blackwood (Scottish Text Society, New Series, 12, 17, 21, 25), 1921–1929), t. II, p. xxiv : ‘Our text was originally taken from this transcript [MS Add. 16956], then collated throughout with the Paris original by Mlle. C. Renié of the École des Chartes, and finally large portions were collated by us with rotographs.’
22 Paul Meyer, ‘Étude sur les manuscrits du Roman d’Alexandre’, Romania, 11 (1882), 213–332.
23 Ritchie, The buik of Alexander, t. I, pp. xlvii–xlviii ; Frank T. H. Fletcher, Étude sur la langue des “Vœux du paon”, roman en vers du xive siècle de Jacques de Longuyon (Paris : PUF, 1924), pp. 19–30.
24 Cf. les conclusions du travail de Fletcher, Étude sur la langue, pp. 163–77, le seul ouvrage, à notre connaissance, consacré systématiquement à la langue des Vœux – repris aussi par K. Busby, Codex and context. Reading Old French Verse Narrative in Manuscript, 2 voll. (Amsterdam – New York : Rodopi, 2002), vol. II, pp. 538–39. H. Bellon-Méguelle est aussi revenue sur le témoignage du ms. W et la trop grande importance qui lui a été attribuée : ‘Un puer senex dans la famille des manuscrits des Vœux du paon : le manuscrit Paris, BnF, fr. 12565’, in Alexandre le Grand à la lumière des manuscrits et des premiers imprimés en Europe, éd. par Catherine Gaullier-Bougassas (Turnhout : Brepols (Alexander redivivus, 5), 2015), pp. 171–90 ; selon Bellon-Méguelle, les Vœux ne seraient pas un texte lorrain mais picard, cf. pp. 180–81. Même si ses tentatives ont remis en question l’authenticité du colophon de W, le reste de la critique est aujourd’hui unanime pour accepter la paternité de Jacques de Longuyon. À ce propos, voir Elizabeth Eva Leace, ‘The Provenance, Date, and Patron of Oxford, Bodleian Library, MS Douce 308’, Speculum,97/2 (2022), 283–321 (290–91). Le ms. Douce 308 (Q1), produit à Metz, donc en Lorraine, daterait selon Leace de 1313, donc à une date très proche de celle de la composition de l’ouvrage. Il s’agirait aussi de l’un des manuscrits du groupe p-q de Ritchie, qui remonteraient à l’état le plus ancien de la tradition du texte, comme l’observe aussi Bellon-Méguelle, ibid.,p. 188.
25 Camillus Casey, ‘Les Vœux du Paon’ by Jacques de Longuyon : An Edition of the Manuscripts of the P Redaction, Ph.D. dissertation (New York : Columbia University, 1956), p. ix.
26 Bellon-Méguelle, ‘Un puer senex’, p. 175.
27 Robert Alexander V. Magill, Part I of the ‘Vœux du Paon’ by Jacques de Longuyon : An Edition of Manuscripts S, S1, S2, S3, S4, S5, and S6, Ph. D. dissertation (New York : Columbia University, 1964). Les données de localisations et de datation des manuscrits ont été reprises à la bibliographie du DEAF de F. Möhren.
28 Bellon-Méguelle, Du Temple deMars et Les ‘Vœux du paon’ de Jacques de Longuyon : originalité et rayonnement, sous la direction de Catherine Gaullier-Bougassas (Paris : Klincksieck, 2011).
29 Ritchie, The buik of Alexander, t. II, pp. xlix–lxviii, t. III, pp. xl–lxvii.
30 Charles Théodore Gossen, Grammaire de l’ancien picard (Paris : Klincksieck, 21976).
31 Nathalie Bragantini-Maillard, Corinne Denoyelle, Cent verbes conjugués en français médiéval (Paris : Armand Colin, 2012).
32 Le premier hémistiche du v. 761 ‘Si furent no cousin’ devient dans W ‘Furent nostre cousin’, alors que les deux mss lisent vo au v. 764.
33 Gilles Roques, Revue de linguistique romane, 68 (2004), 292, ‘pic. hain. frandr. wall. champ. lorr ; ajouter maintenant luxemb.’, cf.FEWxxv 649a.
34 Cf. aussi FEW iii 72a, qui observe que la forme est aussi attestée en gascon et en francoprovençal (une attestation dans les Docling docAin006).
35 ChOise059 (2 occurrences) ; ChFlandr026.
36 Texte issu des Registra Supplicationum de la papauté de Jules II, conservés dans l’Archivum Secretum Vaticanum et publiés par Richard Sherr, ‘The Membership of the Chapels of Louis XII and Anne de Bretagne in the Years Preceding Their Deaths’, The Journal of Musicology, 6/1 (1988), 60–82, (p. 66, n. 27).
37 Le vers n’est pas hypermétrique dans W, qui lit dans le premier hémistiche : ‘Li uns feri si l’autre’.
38 Le vers n’est pas hypométrique dans W, qui lit dans le deuxième hémistiche : ‘conme faus et mauvais’.
39 Trou dans le parchemin.
40 Numérotation de Ritchie.