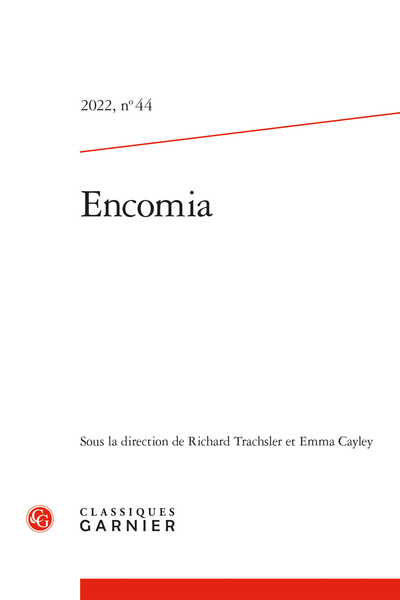
‘Tout ainsi pourrions-nous bien faire de la langue de Court’ Le Champ fleury de Geoffroy Tory, un traité de courtoisie ?
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Encomia
2022, n° 44. varia - Auteur : Maillard (Sandy)
- Résumé : En 1529, Geoffroy Tory publie le Champ fleury avec l’intention de pourvoir la langue française de règles et de modèles qui la porteront à son plus haut degré de perfection, tant linguistique que morale. Cet ouvrage, qui témoigne d’une poétique de la transition entre le Moyen Âge et la Renaissance, a tôt fait de révéler une préoccupation semblable à celle qu’ont nourrie les poètes courtois concernant l’art du bien dire. Cet article souhaite investiguer dans quelle mesure le Champ fleury peut être considéré comme un traité de courtoisie et contribue à redéfinir cette notion.
- Pages : 127 à 142
- Revue : Encomia
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406167266
- ISBN : 978-2-406-16726-6
- ISSN : 2430-8226
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16726-6.p.0127
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 24/04/2024
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
- Mots-clés : Geoffroy Tory, Champ fleury, courtoisie, bien dire, français, langue, lettres, typographie, prononciation, grammaire, nation française
‘Tout ainsi pourrions-nous bien faire de la langue de Court’
Le Champ fleury de Geoffroy Tory, un traité de courtoisie ?
Notre langue est aussi facile à reigler et mettre en bon ordre, que fut jadis la langue Grecque […]. Tout ainsi pourrions-nous bien faire de la langue de Court et Parrhisienne, de la langue Picarde, de la Lionnoise, de la Lymosine, et de la Prouvensalle.1
Voici comment Geoffroy Tory explicite la nécessité de codifier et, ainsi, d’illustrer la langue française, et plus particulièrement ce qu’il nomme la ‘langue de Court et Parrhisienne’. En effet, dans l’ouvrage intitulé Champ fleury publié en 1529 chez Gilles de Gourmont qu’il décrit notamment comme une ‘exhortation à mettre et ordonner la Langue Françoise par certaine Reigle de parler elegamment en bon et plus sain Langage François’,2 l’auteur entend pourvoir la langue française de règles et de modèles qui la porteront à son plus haut degré de perfection, tant linguistique que morale. Avançant qu’‘ung homme qui veult estre veritablement intime en pure Vertus, doibt tousjours et en tous lieux faire et dire chouse qui soit belle, bonne, et honneste’,3 il présente dans ce qui s’apparente à un traité sur la langue des principes d’ordres géométrique, typographique, orthographique et grammatical, qui définissent au même titre qu’ils garantissent un ‘bon’ usage – au sens de ‘correct’ sur le plan linguistique, ‘beau’ sur le plan poétique et ‘vertueux’ sur le plan moral – de la langue française.
128En cela, le Champ fleury révèle la même préoccupation que l’œuvre des poètes reconnus comme courtois, à l’instar de Chrétien de Troyes ou de Conon de Béthune, concernant l’excellence de la langue française, autrement dit l’art du bien dire.4 Dans un vers bien connu du Chevalier de la charrette, Chrétien de Troyes décrit en effet la cour du roi Arthur comme un lieu de raffinement où l’on trouve ‘mainte bele dame cortoise, / bien parlant an lengue françoise’.5 De même, dans sa chanson ‘Mout me semont Amors ke je m’envoise’, Conon de Béthune affirme ne pas vouloir renoncer à l’art de la plume, malgré le fait ‘Ke [s]on langaige ont blasmé li François’ et que ‘La Roïne ne fist pas ke cortoise’ en entendant sa chanson, pourtant ‘parole franchoise’.6 Conon, bien qu’il fasse rimer à deux reprises ‘cortoise’ et ‘franchoise’, échoue à composer selon les codes de cette cour de France – codes précisément courtois et français. Chez ces poètes de cour, langue française et courtoisie, envisagée comme un idéal aussi bien esthétique qu’idéologique ou encore social, modulable en fonction du contexte, mais toujours associée à l’art du bien dire, sont donc étroitement liées.
Le propos et les enjeux du Champ fleury rappellent indéniablement cette vision. Tory n’est certes pas un poète courtois à proprement parler, mais c’est du moins un courtisan : proche de l’entourage du roi François Ier, de sa mère Louise de Savoie dont il édite et publie le Tombeau à sa mort en 1531, il reçoit le titre officiel d’‘imprimeur du roy’ créé pour lui par François Ier lui-même en 1531.7 L’idéal linguistique 129qu’il défend dans le Champ fleury est donc indissociable du milieu curial parisien.8
Par ailleurs, Geoffroy Tory se présente comme un héritier direct des auteurs médiévaux et s’inscrit même explicitement à leur suite. Même si le Champ fleury est publié quelques décennies au-delà du terminus ad quem communément admis pour le Moyen Âge, il est construit sur des savoirs, pratiques et traditions médiévales que la courtoisie a profondément imprégnées. En effet, au moyen d’une forme éminemment médiévale – celle de l’abécédaire, qui consiste à faire commencer chaque strophe ou chapitre par une lettre de l’alphabet en suivant l’ordre de celui-ci –9 qu’il applique à un support matériel rompant avec la manuscriture – son ouvrage est en effet un imprimé, et même un modèle en la matière –, Geoffroy Tory développe une réflexion sur la langue qui, dans le même temps, renégocie l’héritage même dans lequel il s’enracine. Cet ouvrage témoigne donc de façon singulière des transitions – matérielles (passage de la manuscriture à l’imprimé), linguistiques (lissage de la diversité en faveur d’une langue codifiée) ou littéraires (abandon ou transformation de certaines pratiques) – qui s’opèrent entre le xve et le xvie siècle, et vient questionner la notion même de frontière historiographique.
En prenant appui sur ces différents éléments, le présent article se demandera sous quels aspects le Champ fleury pourrait être considéré comme un traité de courtoisie et, le cas échéant, dans quelle mesure il contribue à redéfinir cette notion, indispensable à la compréhension de la littérature médiévale et de toute littérature qui s’élabore à partir d’elle.10
130Mal dire
Dans l’adresse aux lecteurs, à savoir à l’exact seuil de son ouvrage et avant même d’exposer les préceptes nécessaires à la mise en ordre et à la régulation de la langue française, Geoffroy Tory dit espérer ‘persuader à d’aulcuns, que s’ilz ne vouloient faire honneur à nostre Langue Françoise, au moings qu’ilz ne la corrumpissent point’.11 En réalité, il ne se donne pas la peine d’argumenter : il dénonce et réprouve aussitôt, avec une extrême véhémence, les corrupteurs de la langue, qu’il classe en quatre groupes :12
Je treuve qu’il y a Trois manieres d’hommes qui s’esbatent et efforcent à la [la langue] corrumpre et difformer. Ce sont Escumeurs de Latins, Plaisanteurs, et Jargonneurs. […] Je treuve en oultre qu’il y a une aultre maniere d’hommes qui corrompt encores pirement nostre langue. Ce sont Innovateurs et Forgeurs de motz nouveaulx.13
Dans un geste aussi critique que moqueur qui vise à mettre sous les yeux de son lectorat le mal dire de ces corrupteurs, Tory se prête à l’imitation de leur manière de parler et d’écrire, que Rabelais reprendra d’ailleurs après lui.14 Ainsi, il parodie la pédanterie latinisante des premiers qui, sous couvert d’intelligence, se rendent seulement ridicules :
Quant Escumeurs de Latin disent : ‘D’espumon[s] la verbocination latiale, et transfreton[s] la Sequane au dilucule et crepuscule, puis deambulon[s] par les Quadrivies et Platées de Lutece, et comme verisimiles amorabundes captivon[s] la benivolence de l’omnigene et omniforme sexe feminin’, me semble qu’ilz ne se moucquent seullement de leurs semblables, mais de leur mesme Personne.15
131Il reproduit ensuite le langage grossier des ‘Plaisanteurs’, auxquels il reproche avec animosité de détruire la langue :
Quant les Plaisanteurs, que je puis honnestement appeller, Dechiqueteurs de Langaige, disent : ‘Monsieur du Page, si vous ne me baillez une lesche du jour, je me rue à Dieu, et vous dis du cas, vous aure[z] nasarde sanguine’, me semblent faire aussi grant dommage à nostre Langue, qu’ilz font à leurs Habitz, en dechiquetant et consumant à oultrage ce qui vault myeulx entier que decisé et mutilé meschantement.16
L’auteur du Champ fleury s’attaque plus violemment encore aux troisièmes, auxquels il souhaite la potence ou pire, la non-naissance :
Tout pareillement quant Jargonneurs tiennent leurs Propos de leur malicieux Jargon et meschant langage, me semblent qu’ilz ne se monstrent seullement estre dediéz au Gibet, mais qu’il seroit bon qu’ilz ne feussent oncques néz. Jaçoit que Maistre François Villon en son temps y aye esté grandement Ingenieux, si toutesfois eust il myeulx faict d’avoir entendu à faire aultre plusbonne chouse. Mais au fort. Fol qui ne follie / pert sa raison. J’alleguerois quelque peu dudict Jargon, mais pour en eviter la meschante cognoissance, je passeray oultre […].17
Ici, Tory n’imite pas les ‘jargonneurs’, dont François Villon apparaît comme l’exemple-type : en se soustrayant à ce pastiche, il leur refuse en réalité tout espace pour exister. C’est comme s’il opérait lui-même, au sein d’un texte qui a valeur d’exemplarité et dont il est le garant, la peine de mort à laquelle il les condamne. Quand il décide de ‘passer outre’, il choisit de ne pas exposer la ‘meschante cognoissance’ de ces locuteurs et les censure définitivement. Cette virulence à l’égard des jargons – des langues artificielles, réservées à des groupes restreints d’initié·e·s – vient de ce que Geoffroy Tory entend, avec le Champ fleury, créer une langue uniformisée et universelle, en révélant les lettres, en les portant aux yeux et à la connaissance de toutes et tous. Les jargons, qui cultivent une forme de secret, nuisent à cette transmission du savoir si importante pour Tory et constituent en ce sens le parangon du mal dire.
Le dernier vice de langage que fustige l’auteur du Champ fleury vient des ‘Innovateurs et Forgeurs de mots nouveaulx’. L’auteur leur reproche 132leur ‘sotteté’, c’est-à-dire leur bêtise autant que leur déraison, et qualifie leurs inventions d’‘immundices’ qu’il s’agit de polir :
Ce sont Innovateurs et Forgeurs de motz nouveaulx. Si telz Forgeurs ne sont Ruffiens, je ne les estime gueres meilleurs. Pencez qu’ilz ont une grande grace quant ilz disent après boyre, qu’ilz ont ‘le Cerveau tout encornimatibule et emburelicoque d’ung tas de mirilifiques et triquedondaines, d’ung tas de gringuenauldes, et guylleroches qui les fatrouillent incessamment’ ? Je n’eusse alleg[u]é telles sottes parolles, se n’eust esté, que le desdaing Juvénal de y pencer le m’a faict faire. Si natura negat / facit indignatio versum. L’indignation m’a contrainct de monstrer la sotteté. Je croy qu’il n’y a ordre de purement agencer tel langage, car les Personnages qui le forgent sont incapables de saine Raison. Toutesfois si nostre Langue estoit deuement Reiglée et Polye, telles immundices en porroient estre dejectées.18
Il est d’autres ‘sots’ que Geoffroy Tory invective plus loin dans le Champ fleury : les ‘plaisanteurs et jeunes amoureux qui s’esbatent à inventer d[e]vises, ou à les usurper comme s’ilz les avoient inventées’.19 Ceux-ci présentent des traits similaires avec les ‘Innovateurs et Forgeurs de motz nouveaulx’ en ce qu’ils composent ou perpétuent des ‘devises’, soit des jeux de lettres et des rébus, qui déforment la langue et nuisent à sa pureté. Tory réprouve ces ‘sottes choses’ dont ‘ne l’orthographe, ne la pronunciation ne convienent du tout’ :20
En telles sottes choses la bonne Orthographe et vraye pronunciation sont perverties bien souvant, et causent ung abus qui souvant empesche les bons esperits en deue escripture.21
Toutefois, l’auteur du Champ fleury se montre plus indulgent à l’égard de ces ‘plaisans imagineurs et resveurs en Amours’,22 dont il met l’errance sur le compte de la plaisanterie et de l’amour. Il apparaît donc clairement que certains vices de langage sont plus blâmables que d’autres et que l’intention qui préside au mal dire est déterminante.
Par ailleurs, mal dire ne signifie pas uniquement ‘corrumpre et difformer’ la langue pour Geoffroy Tory ; c’est aussi employer une langue qui est tombée en désuétude. Il possède une conscience aigüe 133de l’évolution des langues, qui lui fournit un argument de poids pour défendre son projet de codification du français. En effet, en prenant appui sur une longue liste d’archaïsmes et sur le double constat que ‘le Langage d’aujourd’huy est changé en mille façons du Langage qui estoit il y a Cinquante Ans ou environ’ et que ‘s’il n’y est mys et ordonné, on trouvera que de Cinquante Ans en Cinquante Ans la langue Françoise, pour la plus grande part, sera changée et pervertie’,23 l’auteur du Champ fleury souligne la nécessité de normer le français. Seules des règles fixes permettront de passer de mal dire à bien dire le français, d’en assurer l’immuabilité et, de facto, la pérennité – et, à un niveau supérieur, celle de la nation française elle-même, puisque langue et nation sont, plus encore sous le règne de François Ier, intimement liées.
Bien dire
Avec le Champ fleury, Geoffroy Tory souhaite aussi ‘monstrer qu’avons ung don de grace en nostre beau langage François’24 car, d’après lui,
[n]ous sommes de nostre nature entre toutes les autres Nations, comme dict Pompone Mela, […] faconds et beaux parleurs de leur nature.25
Il voit la ‘facundité’ comme une faculté innée des Français et des Françaises, qui ne demande qu’à être exploitée. Il serait en effet dommageable pour le peuple français de ne pas la mettre au profit de sa propre gloire. En cela, cette éloquence naturelle motive à elle seule la normativisation de la langue car, pour s’épanouir complètement, elle a besoin de règles : ‘Si avec nostre facundité, estoit Reigle certaine, il me semble soubz correction, que le langage seroit plus riche, et plus parfaict.’26 Or la richesse et la perfection d’une langue se mesurent à sa 134qualité grammaticale ; c’est pourquoi Tory veut doter la langue française de ‘certaine reigle de pronuncer et bien parler’.27
Lorsqu’il s’attaque aux corrupteurs de la langue, l’auteur du Champ fleury met en premier lieu l’accent sur la dimension orale de leurs sociolectes, en introduisant leurs discours par ‘disent’28 et ‘tiennent leurs propos’,29 et qualifient ceux-là de ‘sottes parolles’.30 De même, l’injonction qui suit directement la condamnation des vices de langage porte sur des aspects oraux : ‘Faison[s] donques tant que noz ditz et parolles soient saines et recevables en toute Raison et tout Honneur. Acoustumon[s] nous à bien parler et bien dire.’31 Mauvais et bon langages se distinguent d’abord sur le plan de l’oralité, qui doit dès lors être fixée.
Geoffroy Tory enseigne donc pour chaque lettre sa ‘deue façon et requise pronunciation Latine et Françoise, tant à l’Antique maniere que à la Moderne’.32 Il se donne même le titre de ‘Grammarien’, dont la ‘presente matiere est d’enseigner à bien escrire et pronuncer les lettres Abecedaires’.33 À propos de la lettre S par exemple – séparant par ailleurs explicitement la dimension graphique de la dimension phonétique –, il indique que
nous nous aidons bien de le S. en escripture, mais en pronunciation je treuve qu’il en y a qui s’en acquitent mal, car en lieu de dire : ‘Deus deus meus Iustus et fortis Dominus’, ilz begayent et mengent la queue disant : ‘Deu, deu, meu, iustu, et forti. dominu.’ qui est ung très grant vice, et trop commun à beaucoup de simples gens.34
De cet exemple, Tory tire un principe phonétique général qui allie bien dire et bien être :
Ung homme qui veult qu’on le croye facilement, et qui desire qu’on adjouxte pleine foy à ses parolles, doibt en bien disant pronuncer nectement et purement toutes ses syllabes, tant à la fin des dictions que au comancement. Car 135quant on ne pronunce bien, il semble aux auditeurs qu’on les mocque, ou qu’on ne scait qu’on dit.35
On trouve dans le Champ fleury de nombreux exemples de ‘deue façon et requise pronunciation’, en particulier dans la troisième partie de l’ouvrage, soit l’abécédaire à proprement parler, où chaque chapitre décrit une lettre de l’alphabet dans ses aspects tant graphiques que phonétiques. Ainsi, le A ‘veult estre pronuncé à bouche ouverte’,36 le E ‘a trois divers sons en pronunciation et Rithme françoise’,37 la lettre L ‘veult estre pronuncée, comme j’ay dict, el. non pas Ellè’,38 etc. Bien dire consiste donc avant tout à bien prononcer les lettres.
Mais une bonne prononciation ne suffit pas à faire la qualité d’une langue ; celle-ci doit aussi être régie sur le plan grammatical. Geoffroy Tory expose donc en détails dans le Champ fleury certaines règles, à l’instar du paradigme du passé simple, qu’il désigne en manchette comme une ‘Reigle de Grammaire en François’ :
Toutes et quantes fois que l’infinitif se terminera en Re, le preterit en tierce persone singuliere doibt estre proferé en .it. comme Batre, batit. Faire, feit. Vaincre, vainquit. Plaire et ses composéz qui sont Complaire et Deplaire en sont exceptéz, car ilz font leur preterit en eut, pleut, compleut, et despleut. […] infinitifz en .ir. ont leur preterit en .it. Faillir, faillit. Cueillir, cueillit, et non cueilla, ne failla comme disent mainctz indiscrets.39
On le constate, Tory explique cette règle avec force détails. Le Champ fleury est certes un traité théorique, mais il apparaît bien plus ici comme un ouvrage pédagogique et didactique : en plus d’être le lieu d’exposition d’une pensée intellectuelle, il offre un outil directement mobilisable.
Voulant non seulement codifier la langue française, mais encore ‘enrichir nostre dict langage par certaines belles Figures et Fleurs de Retorique, tant en prose que autrement’,40 Geoffroy Tory propose des modèles de bien dire, soit une liste d’auteurs exemplaires, tant sur le plan linguistique que littéraire, dont il loue la ‘grande majesté de langage’136et les ‘maintz beaux et bons petitz coupletz’.41 Il reproduit même un rondeau ‘pour monstrer que nostre dict langage François a grace quant il est bien ordonné’.42 À la dimension linguistique du bien dire s’ajoute un critère esthétique : il ne s’agit pas uniquement de dire la langue française avec une rigueur phonétique et grammaticale, mais aussi de dire bien.
Bien faire
Dans la pensée torinienne, la langue ne peut dire bien (de belle façon) ou dire le bien (être morale) si elle n’est pas bien dite, et encore moins si elle n’est pas bien faite. À cet égard, Tory s’inscrit dans le lignage des arts poétiques médiévaux et des réflexions d’obédience courtoise sur l’éthique et l’esthétique du bien dire,43 mais étend son propos à la lettre à tous les niveaux : littéraire, syntaxique, orthographique, phonique, mais aussi matériel. S’il était question plus haut de phonétique et, partant, de la dimension orale de la langue, l’auteur s’attache ici au plan écrit, visuel. Pour lui, bien dire, c’est avant tout bien faire les lettres : la perfection de la langue passe par la précision et la fixité des proportions géométriques 137qui président au tracé graphique des lettres, puis par leur agencement approprié sur la page d’un livre (à savoir la typographie).44 Geoffroy Tory l’avait d’ailleurs annoncé au seuil de son ouvrage :
Ainsi ne voulant que noz Lettres Attiques fussent en leur Proportion du tout incogneues, Je vous les ay toutes deseignées par Nombre et Mesure afin qu’en puissiez user à vostre bon plaisir, et en faire de tant Grandes et tant Petites que bel et bon vous semblera, et ce, en tenant tousjours le Nombre des Pointz et Tours de Compas à une chascune d’elles requis.45
La deuxième partie du Champ fleury est entièrement consacrée à l’exposition détaillée des principes géométriques indispensables à un tracé parfait des lettres, en l’occurrence, des capitales romaines. Prenant notamment appui sur Léonard de Vinci et Luca Pacioli, Geoffroy Tory élabore un système graphique dont la base est un carré parfait de dix unités de côté – qu’il appelle ‘corps’ –, à partir duquel chaque lettre devra être dessinée en respectant de strictes proportions46. Il pose la lettre I comme ‘Guydon et principalle lettre proportionaire à faire toutes les autres’47 et défend par ailleurs l’idée qu’il s’agit de la lettre à l’origine de toutes les autres48. S’alignant sur de Vinci, Tory affirme et démontre iconographiquement que les ‘lettres Attiques et le corps humain sont très acordans en proportion’,49 quelle que soit la position du corps humain (pieds joints ou jambes et bras écartés) et du visage (de face ou de profil) dans le carré.
Dans la troisième partie de son ouvrage, Geoffroy Tory présente deux versions de la lettre à laquelle le chapitre est dédié, toutes deux dans le carré de base : l’une avec les traits de compas nécessaires à son tracé, l’autre telle que la lettre est censée apparaître dans sa forme imprimée. 138Il commente ensuite longuement les proportions géométriques de la lettre. C’est dire la précision avec laquelle l’auteur expose son propos et incite à bien faire les lettres. En certains endroits, il interpelle directement, avec un degré élevé de technicité, imprimeurs et écrivains à condamner sans hésiter, et nommément, ceux qui ne respectent pas ‘l’art de la façon de lettre Attique’ :50
Je veulx icy très voluntiers advertir Imprimeurs et Escripvains sus ceste Diphtongue A E, et dire qu’elle veult estre escripte en maniere et façon que le A, et le E, soient separéz par le chef, et adherens par la poincte d’em-bas. […] En laquelle chose Forbenius, et quasi tous aultres Imprimeurs ont erré jusques à ce temps-cy […].51
Il s’adresse de même aux orfèvres et graveurs :
Cestuy-cy est faict pour aider et bailler esperit à Orfeuvres et Graveurs, qui de leur burin, echope, ou aultre util gravent et taillent lettre Attique à l’envers et qu’on dit à gauche, afin qu’elle se rencontre à droit quant elle sera imprimée et mise à sa droitte et seine veue.52
Notons que les premiers garants de lettres bien faites sur le plan matériel et de fait bien dites sont précisément les graveurs, qui taillent les caractères typographiques à destination des imprimeurs. Dans une certaine mesure, ils sont donc tout aussi susceptibles de ‘corrumpre et difformer’ la langue que les ‘Escumeurs de Latins’, ‘Plaisanteurs’, ‘Jargonneurs’ et ‘Forgeurs de motz nouveaulx’.
La perfection de la langue, qui passe par la perfection matérielle et graphique des lettres, s’évalue pour Tory également sur le plan visuel : ‘une chascune Lettre soit veue et leue en droitte Ligne, en plaine face, et en bon ordre’53 car ‘la Nature des Lettres, Lesquelles sont faictes au Modele du Corps humain, est d’estre en sa requise et droitte veue, sus bout, et en son entier’.54 La mise en page est donc une composante fondamentale du bien faire la langue, en termes tant techniques qu’esthétiques d’ailleurs, puisqu’en certains endroits du Champ fleury, la disposition 139typographique du texte figure certaines lettres ou formes.55 D’art poétique ou art du bien dire la langue, le Champ fleury se fait art typographique ou art du bien faire les lettres.
Bien être
N’oublions pas le contexte politique et culturel dans lequel s’inscrit la rédaction du Champ fleury. L’ouvrage témoigne largement des intentions nationalistes de François Ier : le pouvoir royal informe la langue autant qu’il s’exerce à travers elle. Celle-ci devient alors à la fois argument et instrument de pouvoir, en ce qu’elle permet d’abolir des frontières géo-politiques et socio-économiques et de rassembler au sein d’une même collectivité des locuteurs et locutrices qui partagent la même faculté innée de ‘facundité’ dont il était question plus haut. La langue revêt une dimension sociologique indéniable qui, en l’occurrence, se traduit par un potentiel certain d’unification des peuples : en rayonnant du milieu aulique vers toutes les régions de France, la langue française contribue de manière fondamentale à la construction de la nation, jusqu’à en devenir le reflet même.
Et c’est là une raison primordiale de codifier la langue. Puisque celle-ci est constitutive d’une nation qui prétend surpasser toutes les autres et qu’elle est même l’image de sa grandeur morale, il est indispensable qu’elle soit exemplaire. Geoffroy Tory affirme à maintes reprises son désir d’‘enluminer aucunement nostre langue’56 et se montre fidèle à son engagement, acté dans le privilège exceptionnel obtenu pour son ouvrage, de ‘toujours divulguer, acroistre, et decorer’ la langue française. Pourvoir la langue de normes linguistiques ne suffit pas : celle-ci étant le reflet de la nation, et la nation étant le reflet de la cour et de son roi,57 il faut la doter, en plus d’une pureté linguistique, d’une excellence 140littéraire et morale. Si la vertu du roi et de son peuple dépend en partie de la langue, alors la langue doit aussi bien être.
Pour Geoffroy Tory en effet, ‘[o]n cognoist les hommes en faictz et en ditz’.58 Paroles, actes et valeur morale sont étroitement liées : la vertu d’un individu s’éprouve notamment à l’honnêteté de ses propos, soit à sa capacité à bien dire et à dire le bien. Si on veut être moralement bon, il convient dès lors de bien user de la langue :
[…] ung homme qui veult estre veritablement intime en pure Vertus, doibt tousjours et en tous lieux faire et dire chouse qui soit belle, bonne, et honneste.59
La qualité morale se mesure ainsi au soin apporté au bien dire et au bien faire (‘faire et dire chouse qui soit belle, bonne, et honneste’), et ce soin doit être constant (‘tousjours et en tous lieux’). Or si la vertu mène nécessairement au souci du bien dire, la réciproque se vérifie également. L’usage d’une langue normée garantit la vertu des locuteurs et locutrices et, partant, de la nation tout entière, et le bien dire devient gage de bien être :
Faison[s] donques tant que noz ditz et parolles soient saines et recevables en toute Raison et tout Honneur. Acoustumon[s] nous à bien parler et bien dire ; en ce faisant trouveron[s] que bien nous en prendra, et que noz parolles auront si grande vertus qu’elles persuaderont en mille beaulx propos.60
Un traité de courtoisie ‘renaissant’
Au terme de ce parcours, la tentation est grande d’affirmer que le Champ fleury est aussi un traité de courtoisie. Rappelons que l’ouvrage, que Geoffroy Tory sous-titre explicitement Art et Science de la deue et vraye Proportion des Lettres Attiques, et qui consiste en une ‘exhortation à mettre et ordonner la Langue Françoise par certaine Reigle de parler elegamment en bon et plus sain Langage François’,61 est élaboré à partir 141d’un vaste héritage médiéval qui se trouve dans le même temps renégocié. Dès lors, la notion de courtoisie, plus précisément telle que nous l’avons définie en préambule – soit au sens de principe et émanation de l’art du bien dire comportant une dimension esthétique, éthique et sociale – est en effet au centre des préoccupations du Champ fleury.
La définition d’une langue ‘belle, bonne, et honneste’62 est la démarche principale de Tory et concerne jusqu’à son unité minimale, la lettre, à tous les niveaux. Cette définition se fait d’abord par la négative : en s’adonnant à l’imitation de différents types de corrupteurs de la langue, c’est-à-dire en montrant ce qu’il ne faut pas faire, l’auteur du Champ fleury esquisse un idéal linguistique pur et lissé. Ainsi la pédanterie latinisante, la grossièreté, la dissimulation, la déraison, la plaisanterie sont autant de vices qui maculent la langue française et relèvent du mal dire. De même, une langue laissée au passage du temps est une langue qui se déprave. Pour en assurer la qualité et la pérennité, il faut la fixer au moyen de règles qui puissent être uniformes et désormais intemporelles.
Le Champ fleury ne livre pas uniquement un discours théorique ; il se présente bien plus comme un ouvrage pratique qui enseigne certains principes linguistiques fondamentaux, qui fournit des outils directement mobilisables et qui met aussitôt en application, dans le texte même qui les théorise, les règles qu’il expose.63 Celles-ci portent sur la phonétique, l’orthographe, la grammaire ou encore la poétique et contribuent à la définition d’un ‘bon et plus sain Langage François’, en d’autres termes, à la construction d’une esthétique et d’une éthique du bien dire.
D’après Geoffroy Tory, la langue doit être fixée dans sa matérialité même. On ne saurait en effet bien dire sans bien faire les lettres : la perfection de la langue française se détermine et s’évalue à la précision géométrique avec laquelle les lettres sont gravées ou dessinées et la méticulosité avec laquelle celles-ci sont disposées sur le support matériel quel qu’il soit. En considérant également la dimension matérielle de la langue, en combinant étroitement art du bien dire et art typographique, Tory contribue à faire évoluer la notion de courtoisie telle que l’avaient définie les poètes de cour médiévaux.
142Autre révolution, le Champ fleury fait sortir la courtoisie du seul milieu curial, auquel les poètes courtois destinaient leurs textes. L’idéal linguistique que défend Tory, bien que pensé à partir de et destiné d’abord à la cour de François Ier, a vocation à dépasser la sphère aulique pour concerner la nation tout entière ‘sans preferer grant à petit’,64 notamment dans l’optique où la langue participe de la construction de l’identité nationale. Puisque l’une est l’image de l’autre, codifier et illustrer la langue française revient à garantir et glorifier la vertu des sujets français. Bien dire la langue française, c’est bien être Français ou Française, et réciproquement.
En définitive, si le Champ fleury est un traité de courtoisie, c’est au sens de vision du monde, où la courtoisie est un art du bien dire qui repose entièrement sur la lettre qui, par sa perfection géométrique, matérielle, graphique, phonétique, esthétique et morale, informe la langue et reflète l’excellence de la nation française elle-même.
Sandy Maillard
Université de Neuchâtel
sandy.maillard@unine.ch
1 Geoffroy Tory, Champ fleury, Paris, Gilles de Gourmont, 1529, fol. 4v–5r. On pourra consulter la reproduction phototypique faite par Gustave Cohen (avec avant-propos, notes, index et glossaire) en 1931 (rééd. 1973 ; 2014) ainsi que la transcription des Bibliothèques Virtuelles Humanistes, https://www.bvh.univ-tours.fr (consulté le 23/11/2023). Nos interventions sur les extraits issus de Champ fleury se limitent à la restitution des apostrophes, à la transcription des abréviations et des ‘s’ longs, à la séparation ou à l’agglutinement de certains mots, à l’ajout d’accents aigus sur les -é finaux et l’emploi de l’accent grave pour distinguer les homophones.
2 Champ Fleury, fol. A1v.
3 Champ Fleury, fol. A8r.
4 Reto R. Bezzola, Les origines et la formation de la littérature courtoise en Occident (500–1200) (Paris : Honoré Champion, 1958–1960).
5 Chrétien de Troyes, Le Chevalier de la charrette, éd. Catherine Croizy-Naquet (Paris : Honoré Champion, 2006) p. 72, vv. 39–40.
6 Conon de Béthune, ‘Mout me semont Amors ke je m’envoise’, in Anthologie de la littérature française du Moyen Âge. ixe–xve siècles, éd. Claude Thiry (Louvain-la-Neuve : Bruylant-Academia, 2002) p. 63. Sur le rapport entre cour et langue française au Moyen Âge, voir notamment Serge Lusignan, La langue des rois au Moyen Âge : le français en France et en Angleterre (Paris : Presses universitaires de France, 2004) ; Anthony R. Lodge, A sociolinguistic history of Parisian French (Cambridge : Cambridge University Press, 2005).
7 Au sujet de Geoffroy Tory, on pourra consulter Geoffroy Tory, imprimeur de François Ier, graphiste avant la lettre, éd. Stéphanie Deprouw, Olivier Halévy, Magali Vène, Fabienne Le Bars (Paris : Réunion des musées nationaux – Grand Palais, 2011) ; Geoffroy Tory de Bourges. Humanisme et arts du livre à la Renaissance, éd. Rémi Jimenes (Bourges : Bibliothèque de Bourges, 2019) ; D’encre et de papier. Une histoire du livre imprimé, éd. Olivier Deloignon (Arles : Actes Sud, 2021), en particulier pp. 26–48 ; Alexandra Pénot, ‘L’art et science de la vraye proportion des Lettres Attiques de Geoffroy Tory (1549) : défense et codification de la langue française’, Corpus Eve, Éditions ou études sur le vernaculaire (2020), 1–74 https://doi.org/10.4000/eve.1788 (consulté le 23/11/2023).
8 Jean-François Courouau, Et non autrement. Marginalisation et résistance des langues de France (xvie–xviie siècle) (Genève : Droz, 2012), pp. 90–94 ; Danielle Trudeau, Les Inventeurs du bon usage (1529–1647) (Paris : Éditions de Minuit, 1992), pp. 30–35).
9 Sur cette pratique, voir Marion Uhlig, Thibaut Radomme et Brigitte Roux, Le Don des lettres. Alphabet et poésie au Moyen Âge (Paris : Les Belles Lettres, 2023) ; Poèmes abécédaires français du Moyen Âge (xiiie–xive siècles), éd. Marion Uhlig (Paris : Champion Classiques, 2023).
10 Notons en préambule que si Geoffroy Tory emploie les expressions ‘langage de Court’ (fol. 1v) et ‘langue de Court’ (fol. 5r), il n’utilise jamais les mots ‘courtois’ ou ‘courtoisie’. Son discours ne porte donc pas sur la courtoisie en tant que telle. Mais cela n’empêche pas que le Champ fleury puisse être étudié sous l’angle du traité de courtoisie.
11 Champ Fleury, fol. A8r.
12 Sur ce passage, voir notamment Olivier Halévy, ‘Des règles poétiques à la norme linguistique. Les fleurs nouvelles du Champ fleury’, Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 21 (2011), 265–82 ; Claude G. Dubois, Henri Weber, Claude Longeon et Claude Mont, ‘“Vice de Innovation” et “Escumeurs de Latin” : quelques aspects du mélange des langues dans ses rapports avec la création littéraire en France au xvie siècle’, Réforme, Humanisme et Renaissance, 16 (1982), 19–36.
13 Champ Fleury, fol. A8r–v.
14 François Rabelais, ‘Comment Pantagruel rencontra ung Lymousin qui contrefaisoit le françoys’ (VI), Pantagruel, Claude Nourry, Lyon, 1532. La critique s’est passablement occupée de ce passage.
15 Champ Fleury, fol. A8r. Geoffroy Tory latinise littéralement la langue française, à savoir qu’il emprunte directement au latin la plupart des mots de cet exemple et y ajoute des suffixes qui les francisent.
16 Ibid. Tory joue ici sur le lexique, censé reproduire un registre de langue familier voire vulgaire.
17 Ibid.
18 Ibid., fol. A8v.
19 Ibid., fol. 42r.
20 Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid., fol. 49r.
23 Ibid., fol. A8r. Sur le statut de l’archaïsme autour des années 1530, voir Nina Mueggler, ‘Bon Pays de France’, Enjeu national et joutes poétiques sous le règne de François Ier (Genève : Droz, 2023), pp. 78–82.
24 Ibid., fol. 2r.
25 Ibid., fol. 1v–2r.
26 Ibid., fol. 3v.
27 Ibid., fol. 1v. Nous soulignons.
28 Ibid., fol. A8r.
29 Ibid.
30 Ibid., fol. A8v.
31 Ibid., fol. A8r. Nous soulignons.
32 Ibid., fol. A1v.
33 Ibid., fol. 52r.
34 Ibid., fol. 25v. Notons l’usage singulier de la virgule et du point dans cet extrait, qui sert à marquer graphiquement l’apocope.
35 Ibid., fol. 25v.
36 Ibid., fol. 31v.
37 Ibid., fol. 39v.
38 Ibid., fol. 49r.
39 Ibid., fol. 1v–2r.
40 Ibid., fol. 3v.
41 Ibid. Sur cette liste d’auteurs illustres dans le Champ fleury, voir Suzanne Bagoly, ‘“De mainctz aucteurs une progression”. Un siècle à la recherche du Parnasse français’, Le Moyen français, 17 (1985), 83–123 ; Jacqueline Cerquiglini-Toulet, ‘À la recherche des pères : la liste des auteurs illustres à la fin du Moyen Âge’, Modern Language Notes, 116–14 (2001), 630–43 ; Olivier Halévy, ‘Des règles poétiques à la norme linguistique’ ; Sandy Maillard, ‘Guillaume Cretin dans le Champ fleury de Geoffroy Tory’, in Guillaume Cretin, écrivain polygraphe, éd. Ellen Delvallée (Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, 2024–1, à paraître.). Sur la pratique de la liste à la fin du Moyen Âge, voir Madeleine Jeay, Le Commerce des mots. L’usage des listes dans la littérature médiévale (xiie–xve siècle) (Genève : Droz, 2006).
42 Champ Fleury, fol. 4r. Ce rondeau est étudié par Olivier Halévy, ‘Des règles poétiques à la norme linguistique’, et Nina Mueggler, ‘Bon Pays de France’, pp. 80–81.
43 Nous renvoyons ici à l’article de Pauline Quarroz, ‘De l’aporie du mesdire à l’esthétique courtoise du bien dire chez Baudouin de Condé’, à paraître dans la revue Encomia, qui avait également fait l’objet d’une communication orale dans la session ‘La parole anti-courtoise du discours courtois : érotodidactisme, mauvaises langues et mauvais langage’ (xviie congrès de la SILC, ‘Redéfinir la courtoisie’, Vancouver, 24–28 juillet 2023), et qui traite de la manière dont Baudoin de Condé réfléchit à la notion de médisance dans ses dits moraux pour définir un idéal du bien dire, précédant ainsi de deux siècles les considérations esthétiques et éthiques sur le bien dire développées dans le Champ fleury.
44 Sur cette question, voir Marie-Luce Demonet, ‘Physionomie de la lettre dans le Champ fleury’, in Geoffroy Tory de Bourges, pp. 106–69.
45 Champ Fleury, fol. A3r.
46 Olivier Deloignon, ‘Une variation autour de Vitruve. L’“esthétique architecturante” des milieux curiaux français sous François Ier’, Cahiers des études anciennes, 48 (2011), 283–302 https://etudesanciennes.revues.org/336 (consulté le 23/11/2023).
47 Champ Fleury, fol. 12v.
48 Voir ‘Une Croix de Vitruve’ et ‘I ou la mesure du monde’, in Le Don des lettres, pp. 42–43 et 222–24 ; Sandy Maillard, ‘“À propos de la susdicte fable de ΙΩ” : la figure d’Io dans le Champ fleury de Geoffroy Tory, une héroïne païenne antique ?’, Bien Dire et Bien Aprandre, 38 (2023), 1–16.
49 Champ Fleury, fol. 17r.
50 Ibid., fol. 32r.
51 Ibid., fol. 32r.
52 Ibid., fol. 34r.
53 Ibid., fol. A3r.
54 Ibid.
55 On en trouve des exemples aux folios 19v, 54v, ou encore 63v.
56 Champ Fleury, fol. 1v.
57 Notons que le parallèle langue-roi-nation est d’autant plus fort sous le règne de François Ier que celui-ci est précisément le premier roi de France à porter le nom de ‘François’, soit à la fois le nom de son peuple et de sa langue.
58 Champ Fleury, fol. A8r.
59 Ibid.
60 Ibid.
61 Ibid., fol. A1v.
62 Ibid., fol. A8r.
63 À cet égard, nous prenons le contre-pied de ce qu’avance Rémi Jimenes en préambule de son article ‘Champ fleury’, dans Geoffroy Tory de Bourges. Humanisme et arts du livre à la Renaissance, éd. Rémi Jimenes (Bourges : Bibliothèque de Bourges, 2019), pp. 96–102.
64 Champ Fleury, fol. A2v.