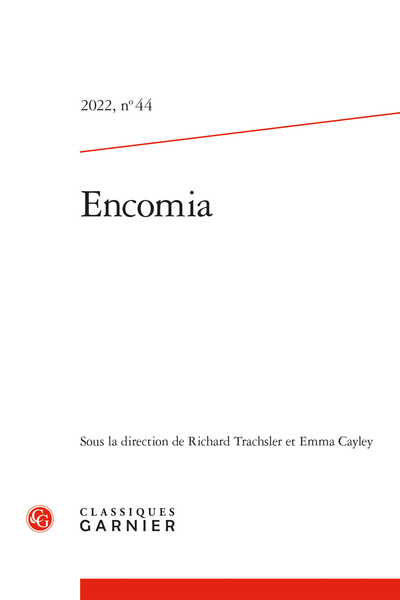
Aimer et écrire Métalepse et mondes possibles dans quelques romans courtois des xiie-xiiie siècles
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Encomia
2022, n° 44. varia - Auteur : Uhlig (Marion)
- Résumé : L’article s’intéresse aux métalepses, c’est-à-dire aux interférences entre les mondes internes et externes au texte, dans Le Bel Inconnu, Partonopeu de Blois et Joufroi de Poitiers, pour en identifier la spécificité médiévale. Celle-ci tient à leur valeur ‘performative’ : au contraire des métalepses disruptives des romans modernes, les métalepses médiévales, parce qu’elles font advenir ce qu’elles énoncent, n’entravent pas le développement narratif en transgressant les frontières de la fiction, mais plutôt le favorisent.
- Pages : 209 à 230
- Revue : Encomia
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406167266
- ISBN : 978-2-406-16726-6
- ISSN : 2430-8226
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-16726-6.p.0209
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 24/04/2024
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
- Mots-clés : métalepse, rivalité, poète-narrateur, amant, inachèvement
Aimer et écrire
Métalepse et mondes possibles
dans quelques romans courtois des xiie-xiiie siècles
Y a-t-il des métalepses dans les textes littéraires médiévaux et, si oui, comment se manifestent-elles et à quelles fins ? Pour répondre à ces questions, je souhaite revenir aux seuls romans médiévaux que la critique a de longue date reconnus comme ‘métaleptiques’ et qui présentent l’avantage, non négligeable dans le cadre qui accueille la présente contribution, d’être reconnus comme courtois.1 Je veux parler de ces romans d’amour et d’aventure qui ont pour particularité d’être traversés par deux types de métalepse : d’une part, le poète-narrateur, amoureux d’une dame, évalue à grand renfort de digressions textuelles l’évolution plutôt malheureuse de ses amours extradiégétiques à l’aune de celle, plus fortunée, des amours diégétiques de son personnage ; d’autre part, étant donné qu’il écrit pour gagner les faveurs de sa dame, le poète-narrateur fait dépendre la poursuite ou l’arrêt de son écriture de la réussite ou de l’échec de ses amours. Double métalepse, donc, qui associe l’auteur à son personnage et l’écriture à l’amour, et rend ces romans largement emblématiques de la courtoisie :2 il s’agit de trois récits dont les liens intertextuels ont été bien commentés par les critiques à partir des travaux 210de Gaston Paris, soit le Partonopeu de Blois, Le Bel Inconnu et Joufroi de Poitiers.3 D’autres romans présentant des traits similaires auraient mérité d’être examinés ici, à l’image du Florimont d’Aimon de Varennes, du Lai d’Ignaure, ou, bien sûr, du Roman de la rose de Guillaume de Lorris et Jean de Meun, mais ne pourront pas être abordés dans le cadre restreint de la présente étude.4 Dans un article récent, Sophie Marnette met en évidence le jeu métaleptique qui, dans la Chastelaine de Vergi et le Roman du Castelain de Couci et de la Dame de Fayel, lie et entremêle les expériences amoureuses et scripturaires du narrateur et du héros. Elle montre de la sorte qu’en vertu de sa dimension exemplaire, la littérature médiévale, en l’occurrence courtoise, est foncièrement métaleptique : en invitant dans son prologue ou son épilogue les lecteurs-auditeurs à suivre ou au contraire à éviter l’exemple des amants dont il s’apprête à raconter l’histoire, le narrateur, souvent lui-même amoureux, pose la perméabilité des frontières entre les mondes diégétique et extradiégétique comme un principe de base qu’on trouve à l’œuvre, pour ne donner 211que des exemples bien connus, dans l’épilogue du Tristan de Thomas comme dans les prologues du Lai de Narcisse ou de Floire et Blancheflor.5
Pour revenir à nos trois romans, si de nombreux critiques en ont relevé directement ou indirectement les métalepses, c’est à Michèle Perret pour le Bel Inconnu et à Nathalie Leclercq pour ce même texte, Partonopeu de Blois et Florimont qu’on doit les travaux les plus significatifs sur la question.6 Dans leurs études, les deux spécialistes reprennent l’une et l’autre la définition élaborée par Gérard Genette et depuis largement acceptée de la métalepse, qui ‘désigne toute intrusion du narrateur ou du narrataire extradiégétique dans l’univers diégétique, ou inversement’, pour envisager la relation entre le poète-narrateur et le héros et l’équation entre l’écriture et l’amour.7 Or les effets métaleptiques qu’elles décrivent et les finalités qu’elles leur prêtent reprennent en les adaptant les constats de Genette à l’endroit de la littérature moderne. Michèle Perret relève ainsi que l’écriture métaleptique du Bel Inconnu, à la faveur d’un ‘mode 212particulièrement transgressif et ludique de narration’, met en œuvre une ‘subversion de l’écriture romanesque’ dans laquelle le ‘narrateur manipule [son héros]’, ‘se prétend le maître du destin des personnages et l’infléchit à son gré’, ce qui vaut au roman d’être considéré comme un ‘lointain ancêtre de Jacques le Fataliste’.8 Quant à Nathalie Leclercq, elle note à propos des trois textes qu’‘en déstabilisant les frontières entre le réel et la fiction, la métalepse d’auteur lui offre la possibilité d’affirmer sa mainmise sur sa création’ et qu’elle ‘met en lumière les fonctions d’un auteur participatif dont l’implication active révèle son désir de liberté d’invention’.9 Ainsi envisagés, les trois romans apparaissent comme les surgeons très précoces et presqu’entièrement isolés, parce sans équivalents au Moyen Âge, d’une pratique moderne vouée à éclore beaucoup plus tard, à partir du xviiie siècle.10
Je voudrais pour ma part proposer une lecture un peu différente, qui tende à dissocier cette double métalepse des effets modernes décrits par Genette pour l’envisager sous l’angle des pratiques médiévales. J’aimerais montrer que ces deux procédés métaleptiques – le parallèle entre les amours du poète-narrateur et celles du héros d’une part, d’autre part l’équation entre l’amour et l’écriture – sont largement emblématiques de la littérature courtoise et que, dès lors, les observer comme tels permet de mettre au jour les caractéristiques de cette littérature. Plus particulièrement, il me paraît que les rapports constants entre le poète-narrateur et ses personnages se négocient dans les trois romans qui vont m’occuper ici, et plus largement dans la littérature courtoise, selon une gestion de la frontière entre réalité et fiction différente de la nôtre. Plutôt que de mettre au jour la ‘mainmise de l’auteur sur sa création’ ou la ‘manipulation’ qu’il exerce sur le héros, ces rapports témoignent à l’inverse de l’emprise de la fiction sur le réel, de ce que j’appellerais une ‘mimesis à l’envers’. Celle-ci est due à la vocation exemplaire de cette littérature, écrite pour être imitée par ses lecteurs-auditeurs, aussi bien qu’à la tendance de l’œuvre médiévale à représenter son auteur en tant que personnage et de la sorte à l’‘engendrer’, pour ainsi dire, semblant inverser l’ordre du geste créateur.11 De manière corollaire, il 213s’agira d’illustrer la propriété ‘performative’ des métalepses médiévales qui, en provoquant de la sorte un épanchement de la fiction dans le réel, font ‘réellement’ advenir ce qu’elles énoncent dans l’univers extradiégétique. En substance, et quitte à décevoir les attentes relatives à la modernité radicale de la littérature médiévale, j’aimerais montrer que ces métalepses n’ont de genettien que la réputation qui les précède, et qu’à bien les regarder, elles sont à vrai dire profondément médiévales, et plus spécifiquement ‘courtoises’. Pour autant, et j’espère en donner la preuve, elles ne sont pas moins stupéfiantes.
À cette fin, je reviendrai pour commencer sur les origines de ces métalepses dans la lyrique amoureuse dont ces trois romans s’inspirent ; j’envisagerai ensuite dans les trois romans la rivalité amoureuse du poète-narrateur et du héros, que les auteurs modulent selon des variations qui produisent autant de mondes fictionnels possibles reflétant leur conception de l’amour. Ce sont ces mondes possibles,12 comme je le soulignerai dans mon troisième et dernier point, qui déterminent la poursuite ou l’arrêt de l’écriture romanesque. J’espère ainsi dégager l’intérêt d’une réflexion sur la métalepse comme instrument heuristique pour réfléchir aux mécanismes spécifiques de la littérature médiévale, en l’occurrence courtoise.
214Échos lyriques, ou la tenso romanesque
Commençons par rappeler l’influence, fort bien étudiée, de la lyrique amoureuse des troubadours et des trouvères sur ces récits. Les critiques ont de longue date mis en évidence la forte empreinte lyrique de ces textes, qu’on pense à la reverdie printanière et au chant des oiseaux éveillant à l’amour qui occupe le prologue du Partonopeu de Blois, à la référence de Renaut de Beaujeu à son activité de trouvère dans le prologue du Bel Inconnu, lui à qui sa dame a ‘doné sens de cançon faire’, ou à Joufroi de Poitiers considéré, depuis les travaux de Chabaneau en 1881, comme une vida de Guillaume IX d’Aquitaine dans laquelle intervient de surcroît le personnage de Marcabru.13 Tout se passe comme si ces textes qui se greffent sur la lyrique courtoise et émanent d’elle à la manière d’amplifications narratives héritaient des thèmes de prédilection de celle-ci en même temps que de sa disposition foncièrement métaleptique. Dans les poèmes lyriques, bien évidemment, le je qui s’exprime est à la fois celui du poète et celui de l’amant qui dit son amour et sa souffrance. La consistance métaleptique de ce ‘poète-personnage’14 est d’autant plus sensible que des vidas accompagnent souvent les pièces poétiques dans les manuscrits afin de restituer l’expérience pseudo-biographique des troubadours et légitimer ou invalider de la sorte leur discours sur l’amour.15 Ainsi, c’est 215du grand chant courtois que proviennent de toute évidence, me paraît-il, les deux types de métalepse qu’on a relevés dans les trois romans.
Le premier type concerne la situation de rivalité entre le poète-narrateur et des amants qui, pour être moins constants et moins loyaux, ‘faux’ en somme, se trouvent plus heureux que lui en amour, et est illustré par des exemples très nombreux dans la lyrique, dont il constitue l’un des topoi les mieux représentés.16 Par souci de concision autant que pour d’autres raisons qui seront exposées plus loin, je choisis un exemple dans les trois poèmes de Raimbaut d’Aurenga, Bernart de Ventadorn et Chrétien de Troyes qui forment le fameux débat de Tristan et Carestia sur l’amour.17 À la fin de la première strophe d’Amors qui m’a tolu a moi, Chrétien évoque pour s’en plaindre les déloyaux plus fortunés que lui en amour :
D’Amors, qui m’a tolu a moi
n’a soi ne me veut retenir,
me plaing ensi, qu’adés otroi
que de moi face son plesir.
Et si ne me repuis tenir
que ne m’en plaigne, et di por quoi :
car ceus qui la traïssent voi
souvent a lor joie venir
et g ’ i fail par ma bone foi.18 (je souligne)
216Pour ce qui est du second type, fondé sur la relation directe entre l’amour et l’écriture, il est au principe même du grand chant courtois : parce qu’elle exprime la position des poètes sur l’amour, la lyrique courtoise fait dépendre la poursuite ou l’arrêt du chant de la réussite ou de l’échec de l’amour chanté par le je. Il est ainsi fréquent que les poètes, dont les incipit répondent de façon récurrente à l’injonction ‘Chanter m’estuet’,19 accueillent dans leurs compositions une réflexion sur la continuation du chant d’amour. Ainsi, et pour reprendre des exemples dans les mêmes textes, Raimbaut d’Aurenga et Chrétien de Troyes aiment et chantent vaille que vaille, quoi qu’il en soit du succès ou des écueils d’une telle entreprise pour le premier –
De midonz fatz dompn’ e seignor
cals que sia·il destinada :
car ieu begui de l’amor,
que ja·us dei amar celada.
Tristan[s], qan la·il det Yseus gen
e bella, no·n saup als faire :
et ieu am per aital coven
midonz don no·m posc estraire.20 (je souligne)
– et même quoi qu’il en soit du mépris de la dame pour le second, qui s’adresse à son cœur :
Cuers, se ma dame ne t’a chier,
ja mar por çou t’en partiras :
tous jours soies en son dangier,
puis qu’empris et comencié l’as.21
Pour autant, il n’en va pas de même chez tous les poètes. Comme on le sait, Bernart de Ventadorn dans la Lauzeta, constatant que rien n’y fait malgré ses efforts, se ‘recre’, c’est-à-dire déserte le service d’amour et renonce au chant :
217Aissi·m part de leis e·m recre ;
mort m’a, e per mort li respon,
e vau m’en, pus ilh no·m rete,
chaitius, en issilh, no sai on.
puis :
De chantar me gic e·m recre,
e de joi e d’amor m’escon.22
Je propose en ce sens de considérer ces deux traits métaleptiques qui structurent les trois romans comme un héritage de la lyrique courtoise, et d’en observer les manifestations comme autant de variations sur ces deux thèmes.23 À l’opposition entre le poète et les faux amants décrite par la lyrique correspond, dans les trois romans, la rivalité entre le poète-narrateur et son personnage, qui, du reste, est lui-même poète dans Joufroi de Poitiers : chaque texte la module à sa façon, donnant lieu à l’histoire racontée, c’est-à-dire à un monde possible exploré par le héros auquel le narrateur ne cesse de se comparer. Quant à la décision de la poursuite ou de l’arrêt de l’écriture romanesque, elle est déterminée au premier chef par l’accueil favorable ou non que la dame réserve au poète-narrateur, mais aussi, en parallèle, par l’adhésion ou le rejet par celui-ci du comportement amoureux adopté par le héros, selon qu’il lui paraît exemplaire ou non. L’un et l’autre thème articule de la sorte, dans chacun des trois romans, la position de son auteur sur l’amour. On pourrait ainsi dire que, tout comme les pièces de Raimbaut, Bernart et Chrétien forment un débat poétique, les mondes possibles explorés par Partonopeu de Blois, LeBel Inconnu et Joufroi de Poitiers et l’influence décisive qu’ils exercent sur la poursuite ou l’arrêt de l’écriture romanesque constituent à leur tour un débat, une sorte de tenso romanesque, entamée entre les deux premiers plus 218tard rejoints par le troisième.24 Envisageons d’abord la façon dont la rivalité amoureuse du narrateur et du héros s’articule dans chacun des textes, avant de nous pencher sur la continuation ou l’arrêt de l’écriture.
Éthique courtoise,
ou le poète-narrateur face à son héros
Dans les trois romans, le narrateur saisit l’occasion des scènes d’amour du héros avec sa dame pour exprimer son propre désarroi de ne pas connaître la même félicité. Ainsi celui de Partonopeu de Blois se lamente-t-il de voir son amie sans pour autant en obtenir les faveurs, contrairement à son héros à qui la sienne demeure cachée par l’obscurité, comme Éros à Psyché, mais qui ‘a loisir / Le sent et en fait son plaisir’ :
Partonopeus a son delit,
Li parlers de lui molt m’ocit,
Car il a tos biens de s’amie ;
Jo n’en ai riens qui ne m’ocie.
Il ne le voit, mais a loisir
Le sent et en fait son plaisir.
Je voi la moie et n’en faç rien ;
J’ai en le mal et il le bien. (Part, vv. 1873–80)
Le narrateur du Bel Inconnu aussi se montre envieux de la joie qu’éprouve Guinglain à tenir la fée dans ses bras :
Ha ! Dius, arai ja mon plaissir
De celi que je ainme tant ?
De Guinglain vos dirai avant.
Il avoit joie en sa baillie :
219Entre ses bras tenoit s’amie
Que il souvent acole et baisse. (BelInc, vv. 4860–65)
De quelle nature est alors la relation entre le narrateur et le héros ? Les critiques ont suggéré que le personnage-héros était le ‘double’ du poète-narrateur ou personnage-auteur qui s’exprime le plus souvent à la première personne, son ‘alter ego’, voire son ‘ancêtre’ – selon la proposition d’Emmanuèle Baumgartner attentive au blason de la famille de Bâgé reproduit sur les armes du Bel Inconnu –, ou encore, toujours à propos du Bel Inconnu, que les aventures du héros constituaient la vida de l’auteur à la faveur d’un procédé pseudo-autobiographique.25 Ces propositions sont convaincantes, mais elles ne doivent pas nous faire perdre de vue pour autant l’écart qui s’instille, puis ne cesse de croître, entre le narrateur et le héros, écart d’autant plus significatif qu’il est de nature morale et a trait au comportement de l’amant courtois. Dans plusieurs passages du Bel Inconnu et de Joufroi de Poitiers, d’ailleurs d’une proximité frappante, le narrateur amoureux revendique à plusieurs reprises sa loyauté, en contraste avec la tromperie et la traîtrise des faux amants :
Quant en arés tot vo voloir,
Adont le vaurés decevoir.
Mal ait qui s’i acostuma,
Et qui jamais jor le fera !
Cil qui se font sage d’amor,
Cil en sont faus et traïtor.
Por ce mius vel faire folie
Que ne soie loiaus m’amie. (BelInc, vv. 1257–63, je souligne)
et
220Ne ja n’ameré tricheor,
Qui ont le siegle mis a mal,
Quar por eus perdent li leial
Les biens que il ont deservi,
Ne no puent trover merci. (Joufroi, vv. 66–70, je souligne)26
La reprise de la même opposition entre loyalamant et traïtor ou tricheor est en effet frappante dans l’un et l’autre extrait. Or si aucun des narrateurs ne précise sur qui s’exerce son acrimonie, on a au fil de la lecture l’impression de plus en plus nette que ces reproches visent le héros. Sans doute n’est-ce d’ailleurs pas un hasard si les vers qui précèdent directement la joie d’amour de Guinglain mentionnée plus haut (BelInc, vv. 4860–65) vitupèrent justement ‘cels qui sont maldisseor / Des dames et de fine amor’ (BelInc, vv. 4853–54). Dans LeBel Inconnu, en effet, la loyauté du je, narrateur et amant aussi loyal que malheureux, s’inscrit en porte-à-faux avec les écarts de comportement de Guinglain, ses manquements successifs au convent d’amour avec la fée, qui rapprochent sa conduite de celle des faux amants comme lui couronnés (du moins dans un premier temps) de succès en amour. Faut-il encore rappeler que Blanches Mains reproche à Guinglain de ‘ne pas savoir aimer’, malgré tous ses talents, et combien elle lui en veut de l’avoir trahie en quittant l’Île d’Or ?27 À son retour, ce n’est qu’au terme d’une pénitence angoissée de quinze jours qu’elle l’autorise à retrouver ses bonnes grâces, non sans lui avoir fait jurer de ne plus jamais la trahir (BelInc,vv. 4917–29) sous peine de la perdre à jamais : ‘Et quant mon consel ne croirés ? Ce saciés bien, lors me perdrés’ (BelInc, vv. 5015–16). À cette occasion, la fée donne en outre à ses propos une coloration impersonnelle, gnomique – ‘Car cil qui dames traïra ? Hontes et mals l’en avenra’ (BelInc, vv. 4927–28) – qui n’est pas sans rappeler le ton adopté par le narrateur à de nombreuses reprises pour vitupérer les déloyaux (par exemple vv. 5395–96) et qui tend à les associer l’une avec l’autre contre Guinglain. Ainsi donc, lorsque celui-ci quitte son amie une seconde fois, en prenant la fuite au petit matin sans même la prévenir, non seulement il la trahit, mais il est encore parjure de son serment. Lui-même d’ailleurs ne l’ignore pas, comme en témoigne le texte qui le décrit, au moment du départ, bien conscient d’avoir perdu son amie :
221Molt fu Guinglains en grant torment ;
Cel jor cevaucha tos iriés
Et tos dolans et coreciés
De ce que s’amie ot perdue ;
Ne set que ele est devenue. (BelInc, vv. 5444–48)
Il me paraît de ce fait difficile de superposer les figures du narrateur-amant loyal et du héros que son propre comportement autant que les autres personnages, y compris le narrateur, dénoncent comme un faux amant.28 Si donc on considère que Le Bel Inconnu se construit bien à partir de la poésie amoureuse des troubadours et des trouvères, on s’aperçoit que l’opposition entre le narrateur-amant loyal et le héros déloyal recoupe et reproduit celle entre le je et les faux amants de la lyrique.29 Tout se passe en somme comme si Guinglain était un faux amant dont on choisissait de développer l’histoire, comme pour voir si, avec les mêmes cartes en main que le narrateur loyal, il s’en sort mieux que lui. Je suis tentée de lire les aventures du Bel Inconnu, mais aussi celles de Joufroi et de Partonopeu, comme autant de tentatives élaborées par le poète-narrateur pour trouver une alternative – un autre monde possible – à sa propre impasse amoureuse : là où la loyauté et l’éthique courtoises échouent, pourquoi ne pas tenter la déloyauté et la traîtrise par le truchement du héros, histoire de voir si elles fonctionnent mieux ?
Dans Joufroi de Poitiers aussi, et de façon exacerbée, le narrateur-amant, aussi loyal que respectueux des lois d’amour au début du texte, se mesure à un héros infidèle dont l’inconstance – il fréquente non moins de quatre femmes dans l’espace du roman !, contre seulement deux, somme toute, pour Guinglain dans Le Bel Inconnu – est de plus en plus flagrante. Or contrairement au narrateur de Renaut de Beaujeu, celui du facétieux roman qu’est Joufroi se laisse peu à peu contaminer par les mœurs légères et l’ethos peu scrupuleux de son héros, au point de l’imiter en devenant, en fin de compte, aussi immoral et déloyal 222que lui, comme l’a bien mis en évidence Richard Trachsler dans son article cité qui compare les stratégies de séduction mises en œuvre par l’un et par l’autre.30 Cette volte-face du narrateur convaincu par les règles amoureuses très discutables de son héros a lieu dans le passage lyrique fameux du bestournement (Joufroi, vv. 4345–93) qui entérine sa métamorphose et redéfinit en noir le code courtois. À la manière d’un troubadour, le narrateur décrit ses propres états d’âme tandis que, ‘Tot changié et bestorné’ (v. 4392), il ne sait plus s’il éprouve ‘joie o dolor’ (v. 4348) ni s’il est ‘vilains o courteis’ (v. 4356).
Ainsi donc, les mondes possibles dépeints par nos trois textes articulent trois modalités différentes du parallèle entre narrateur et héros : si le narrateur du Bel Inconnu prend ses distances face à la conduite de Guinglain et préfère s’en tenir à sa loyauté initiale, dût-elle causer son infortune, le narrateur de Joufroi se laisse quant à lui prendre aux rets de l’inconduite, séduit qu’il est par les succès remportés par son héros. Quant à celui de Partonopeu, dont l’attitude n’a pas été développée dans cette partie,31 il tance les écarts de conduite de son héros et s’en démarque sans pourtant se dissocier de lui, désireux qu’il est de mettre tout en œuvre pour connaître la même félicité matrimoniale que Partonopeu avec Mélior. Les aventures proposées dans ces récits apparaissent ainsi comme autant de laboratoires où sont testés d’autres mondes possibles par les narrateurs-amants qui y projettent leurs doubles sulfureux. De la sorte leur idée de l’amour, leur éthique amoureuse, en somme – qui semble bien correspondre à celle de l’auteur –, se donne à lire en filigrane dans leur choix d’imiter ou au contraire de se distancier du comportement de 223leur héros. On notera bien le sens dans lequel la métalepse s’exerce : le narrateur ne paraît jamais ‘manipuler’ son héros comme celui de Diderot manipule Jacques et son maître ; au contraire, il prend son héros, lequel jouit pour ainsi dire d’une autonomie propre, comme un modèle, et calque sa conduite amoureuse sur la sienne ou refuse de le faire selon qu’il la considère ou non comme exemplaire.32 Reste maintenant à déterminer l’impact de ces mondes possibles et du modèle amoureux qu’ils diffusent sur la poursuite ou sur l’arrêt de l’écriture.
L’amour et l’écriture : textes (in)achevés,
textes (in)achevables
Dans les trois romans, le narrateur entame son projet d’écriture par amour pour une dame. Dès lors, c’est évidemment le bon ou le mauvais accueil que la dame lui réserve qui détermine au premier chef la poursuite ou l’arrêt de l’écriture du roman. Tout porte cependant à croire que le succès ou l’échec du héros en amour, en vertu de son rôle de modèle, exerce sur cette dynamique une influence capitale. Voyons comment dans les trois romans.
Dans Joufroi, la fin manque dans le seul manuscrit qui conserve le texte, lequel s’interrompt sur les noces du protagoniste avec Amauberjon (Joufroi, vv. 4601–13), tandis qu’on n’apprend rien de nouveau sur les amours aux dernières nouvelles malheureuses du narrateur. On ignore de ce fait si le roman a été laissé inachevé ou s’il a subi des dégâts matériels et, le cas échéant, s’il s’achevait ou non par une identité enfin réussie entre les amours du poète-narrateur avec sa dame et celles de son héros avec sa nouvelle épouse. On est cependant aiguillé par un changement dans le projet d’écriture du narrateur ; au moment d’entamer son roman, celui-ci ‘croyait avoir une amie loyale qui l’aimait d’un cœur sincère’, et écrivait donc pour elle :
224Avoir cuidai leial amie
Et qui m’amasst de cuer verai,
Quant ge cest romanz comenchai.
Or si m’a tot changier l’afaire
Que ne sai que g’en doie faire. (Joufroi,vv. 4383–87)
Or juste après son bestornement, le narrateur, désormais assuré du mépris de sa dame, décide de poursuivre coûte que coûte l’écriture du roman sans se laisser abattre par le mautalant :
Or retornerai a l’estoire,
Si vos en redirai avant ;
Ja nel lairai por mautalant,
Que cest romanz voil a chief traire,
Si ne voil ja mais autre faire,
Que trop i ai travail et paine. (Joufroi,vv. 4394–400)
Voilà qui suggère que le narrateur cesse de se soucier du dédain ou des infidélités de la dame pour l’amour de laquelle il avait commencé à écrire, mais achève néanmoins son roman. La tentation est grande d’en déduire qu’il cherche ailleurs la joie d’amour et se tourne vers une autre dame. Si l’équation entre l’amour et l’écriture telle que la pose la lyrique courtoise est vraie, alors il est difficile d’imaginer que le narrateur termine son roman sans plus aimer et pour le simple plaisir du geste. De fait, ni dans les pièces qu’on a citées ici, ni plus généralement dans la production lyrique des troubadours et des trouvères aux xiie–xiiie siècles, on ne trouve d’exemple de poète cessant d’aimer mais continuant à écrire. L’amour, comme moteur et condition de l’écriture, peut à la rigueur se porter sur un autre objet, mais en aucun cas disparaître. Autant penser alors que, persistant dans l’imitation de son héros aussi déloyal et tricheur qu’inconstant, le narrateur fait sienne cette légèreté qui tient lieu d’éthique courtoise à Joufroi et qu’il trouve ailleurs de quoi inspirer sa plume. La fin justifie les moyens. Si les trois romans forment une tenso sur l’amour, alors le poète-narrateur rappelle le Raimbaut d’Aurenga de ‘Non chant per auzel ni per flor’, qui choisit la joie sur toute raison, pourvu qu’elle permette de tenir son (une autre) amie, nue dans ses bras. Le roman s’interrompt pourtant trois cents vers plus loin, nous laissant dans une incertitude génératrice de plusieurs mondes possibles : le narrateur, rattrapé par sa loyauté 225initiale, est-il malgré tout incapable de surmonter son déboire amoureux et donc d’achever son roman (en ce cas, le texte a bien été laissé inachevé), ou l’a-t-il terminé en se tournant, comme son héros l’a fait à quatre reprises, vers une autre dame (en ce cas, le texte a été achevé et un accident matériel nous prive de la fin), voire a-t-il si bien imité son héros qu’il a fusionné avec lui dans une stupéfiante métalepse finale (en ce cas, le texte est achevé dans l’état dans lequel on le conserve) ?33 Je penche pour la troisième possibilité.
Dans le cas de Partonopeu, les amours réussies du héros avec Mélior, couronnées par un mariage, suscitent l’envie du poète-narrateur qui, lui, n’a plus que ses yeux pour pleurer. Dans l’épilogue, il se lamente d’avoir écrit un roman de 10’000 vers pour rien, étant donné qu’il ne lui a valu aucune faveur de la part de sa dame. Au moindre clin d’œil de sa part, pourtant, il aurait de bonne grâce poursuivi son récit en racontant les aventures d’Anselot, de Gaudin et du sultan, qu’il est réduit à évoquer sur le mode de la prétérition :
Par li empris je cest labor
Que j’ai perdu al chef del tor.
Bien sai que je l’ai tant perdu
Quant onques de melz ne m’en fu
N’en dit n’en fait n’en bel semblant.
Tot ai perdu, mais neporquant
Tant la redot et tant la crien
Et tant a son lige me tien
A son servise sens orgueil
Que s’ele me gignot de l’uel
Que je die l’ystoire avant,
Faire m’estovra son comant.
Si m’orrois parler d’Anselot…
[…]
Tot ce dirai se cele vuet
Por cui li cuers del piz me duet ;
Si non, si plorrai mon dehait ;
Ne puis faire el, si mal m’estait.
Si me tenrai en sa merci :
Ne puis garir se n’est par li.
(Partonopeu,B, vv. 10613–25 ; 10643–48)
226Dans l’envoi final, il répète ainsi sa volonté de poursuivre l’écriture si la dame l’y invite, mais ne jure pas moins, dans le cas contraire, de lui rester fidèle à jamais, en silence, comme le Chrétien de Troyes d’‘Amors qui m’a tolu a moi’. On comprend alors doublement la joie qu’il éprouve dans le prologue de la Continuation : la dame veut qu’il ‘en dise plus’ (v. 10659) ! Il s’exécute donc, caressant le rêve de la combler et d’accéder ainsi à l’existence tranquille de Partonopeu qui, savourant sa félicité matrimoniale, s’offre le luxe de reconte[r] les malheurs d’antan (vv. 10668–69). Et on dirait bien qu’il parvient à cette identité au terme de la Continuation :
Partenopex maine grant joie,
Avec lui Melior la bloie ;
Mainent bon tans et boine vie.
Ainssi voussisse user ma vie
A servir la bele plaisant
Que je de fin cuer aime tant ;
[…]
Ele s’apele Passe Rose ;
Icele ai en mon cuer enclose
Et la bonté ne puis escrivre.
Faire en porroie .j. autre livre. (Cont.,vv. 14569–84)
Tout comme Partonopeu connaît la joie avec Mélior, le narrateur touche du doigt la sienne avec Passe-Rose. Ce n’est pas pour rien que les noms des deux dames – celle qui aMéliore et celle qui surPasse – ont été rapprochés l’un de l’autre : leur ressemblance entérine le processus mélioratif accompli en parallèle mais en différé, par le héros d’abord puis, sur son modèle, par le poète-narrateur. L’écriture d’un livre – splendide métalepse – manifeste l’identification enfin réussie de la trajectoire amoureuse du poète-narrateur avec celle du héros : après le Partonopeu de Blois dédié aux amours du héros éponyme du roman avec Mélior, après la Continuation vouée à obtenir enfin les faveurs d’abord refusées par la dame, un livre possible contera les amours enfin comblées du narrateur avec Passe-Rose.
Rien de tel dans le Bel Inconnu, dont la fin déjà largement commentée peut être éclairée par cette analogie. Renaut de Beaujeu y fait dépendre du bel semblant de la dame qu’il se taise ou qu’il poursuive son récit, le cas échéant en orchestrant les retrouvailles de Guinglain avec sa dame :
227Bele, vers cui mes cuers s’acline,
RENALS DE BIAUJU molt vos prie
Por Diu que ne l’oblïés mie.
[…]
Quant vos plaira, dira avant,
U il se taira ore a tant.
Mais por un biau sanblant mostrer
Vos feroit Guinglain retrover
S’amie, que il a perdue,
Qu’entre ses bras le tenroit nue.
Se de çou li faites delai,
Si ert Guinglains en tel esmai
Que ja mais n’avera s’amie.
D’autre vengeance n’a il mie,
Mais por la soie grant grevance
Ert sor Guinglain ceste vengance,
Que ja mais jor n’en parlerai
Tant que le bel sanblant avrai. (BelInc,vv. 6247–66)
À l’endroit de cet épilogue métaleptique, la critique a soutenu que, par un tel chantage, le narrateur-auteur marquait sa mainmise sur sa création et, tout en privant sa dame ingrate de cette suite alléchante de l’histoire, frustrait délibérément les lecteurs et lectrices.34 Dans cet esprit, la ‘vengeance’ dont il est question aux vers 6262 et 6264 serait prise par le poète-amant sur sa dame, aux frais du personnage ; elle consisterait à punir celle-ci en retour de son mépris (v. 6262) en empêchant le personnage de Guinglain de retourner auprès de la fée et en l’abandonnant à un sort désagréable. Ainsi se donnerait à voir non seulement ‘le despotisme de Renaut de Beaujeu sur ses personnages, mais sur le lecteur/auditeur lui-même qui voit son souhait d’une fin heureuse malmené et suspendu au bon vouloir de l’auteur’.35 Je ne crois pas que ce soit le cas. La ‘vengeance’ du narrateur, me semble-t-il, ne s’exerce pas sur la dame, mais bien plutôt sur le rival déloyal, Guinglain (comme le dit le vers 6264, ‘Ert sor Guinglain ceste vengance’, je souligne). En effet, contrairement aux narrateurs de Joufroi et de Partonopeu qui décident d’imiter leur héros, l’un en mal, l’autre en bien, celui du Bel Inconnu228choisit de ne pas le faire. Si donc le narrateur et le héros se retrouvent sans amie à la fin, c’est pour des raisons opposées. Le poète-narrateur n’a pas reçu de sa dame ingrate le ‘beau semblant’ espéré, malgré sa loyauté exemplaire et l’écriture du roman ; dès lors, il se recree comme Bernard de Ventadour, et renonce au chant. Quant à Guinglain, il s’est mal comporté envers sa dame en bafouant toutes les règles d’Amour, et a de surcroît récidivé après qu’elle lui a pardonné une première fois. On voit mal comment il pourrait la regagner à nouveau. Chaque lectrice, chaque lecteur de poèmes lyriques et de romans courtois sait que Guinglain n’a plus aucune chance auprès d’elle : verrait-on la fée de Lanval donner à celui-ci une troisième chance, ou Laudine à Yvain ? La fée est irrémédiablement perdue, et tout espoir pour le héros de la tenir nue entre ses bras est désormais vain. La ‘vengeance’ prise par le narrateur sur le héros est là : elle porte sur l’échec amoureux final de Guinglain, l’amant déloyal qui, fort de ses succès auprès de deux dames, s’était cru tout permis. Voici le narrateur bien vengé, lui le loyal infortuné, de ce héros séducteur prêt à tout, puisque tous deux parviennent en définitive au même constat d’échec, par l’exploration de mondes possibles aux antipodes l’un de l’autre, correspondant à des éthiques amoureuses opposées. Ainsi le chantage du narrateur à sa dame – pour un ‘beau semblant de votre part, je ferai que Guinglain retrouve son amie et la tienne nue entre ses bras’ – n’en est-il pas un ; bien plutôt, il s’agit d’un constat d’impossibilité aussi amer qu’ironique. Il ressortit à un double adynaton qui est le point de mire de la métalepse : le ‘beau semblant’ en question est aussi impossible à obtenir que les retrouvailles de Guinglain avec la fée. Le poète le sait, qui, de fait, y renonce. Le texte n’est donc pas inachevé, mais il est doublement (Dragonetti l’avait dit, mais pour d’autres raisons) ‘inachevable’.36
Quelques mots de conclusion. Prêter attention aux procédés de métalepse qui se jouent dans ces trois romans et aux mondes possible qu’ils explorent met en évidence les idées sur l’amour et l’éthique courtoise qui les traversent et les relient à la tradition lyrique dont ils s’inspirent. Une telle démarche permet de mettre en évidence la persistance de mêmes questionnements dans ces narrations et les traitements divers qu’ils y reçoivent. En les rapportant à une tradition spécifiquement courtoise, on 229comprend mieux les phénomènes d’interférence entre les plans intra- et extradiégétiques qu’on avait jusqu’ici tendance à lire et à comprendre au prisme de la littérature ultérieure, et donc en dehors du cadre courtois. Deux constats me paraissent s’imposer sur la spécificité des métalepses à l’œuvre dans ce contexte.
Le premier a trait à la gestion du rapport entre réalité et fiction. La perméabilité des frontières, telle qu’elle est représentée par les fictions courtoises, construit le comportement amoureux du héros en modèle à imiter ou à rejeter pour le poète-narrateur. On a ainsi le sentiment que, plutôt qu’une mainmise de l’auteur ou du narrateur sur sa créature et sa création, comme dans la littérature moderne, c’est l’inverse qui se produit, c’est-à-dire une emprise de la fiction sur la réalité à l’occasion d’une forme d’anti-mimesis, oude mimesis à l’envers.37
Le second, qui pourrait bien être corrélé au premier, concerne la nature performative de ces métalepses. Si, dans la littérature moderne, les métalepses sont toujours fictives et fictionnelles puisqu’elles n’adviennent jamais que dans l’histoire racontée, comme l’a bien montré Françoise Lavocat,38 il en va autrement dans la littérature médiévale où elles sont effectives, dans la mesure où elles produisent intellectuellement et matériellement du texte – comme la Continuation du Partonopeu – ou au contraire mettent fin à l’écriture, comme dans Le Bel Inconnu.
La métalepse constitue pour ces raisons un instrument heuristique performant pour mettre au jour les interrogations qui traversent les fictions courtoises au Moyen Âge. Quant aux différentes solutions articulées par les textes pour y répondre, à travers les mondes possibles qu’ils dessinent et la position d’imitation ou de distanciation que les poètes-narrateurs adoptent vis-à-vis de leurs personnages, elles reconduisent dans le domaine romanesque les débats qui agitent les poètes lyriques, mais en ajoutant une composante proprement narrative. Car le fait que l’amour conditionne l’écriture fait de la fiction romanesque le lieu où se négocie l’existence matérielle des textes que nous lisons. Autrement 230dit, le comportement amoureux du héros détermine le geste d’écriture du poète-narrateur, partant la réception de la lectrice. La métalepse courtoise n’est-elle pas stupéfiante ?
Marion Uhlig
Université de Fribourg –
Fonds national suisse
de la recherche scientifique
marion.uhlig@unifr.ch
1 La présente étude s’inscrit dans le cadre du projet de recherche Métalepses médiévales (MétMéd), financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, dir. Marion Uhlig (Université de Fribourg), avec Sophie Marnette (University of Oxford), Vincent Debiais (EHESS, Paris), Benedetta Viscidi, Marine Pitteloud et Bastien Racca (Université de Fribourg), 2023–2027. https://data.snf.ch/grants/grant/215004 (consulté le 23/11/2023). Une version orale de cet article a été présentée au Congrès international de littérature courtoise de Vancouver (dir. Patrick Moran, Anne Salamon et Isabelle Delage-Béland, 23–28 juillet 2023), dans la session ‘Courtoisie et mondes possibles’, dir. Richard Trachsler et Marion Uhlig, 28 juillet 2023.
2 J’entends ici ‘l’auteur’ comme la ‘fonction-auteur’ définie par Michel Foucault en tant que ‘le principe d’une certaine unité d’écriture’, dans la mesure où le narrateur qui s’exprime à la première personne dans ces romans tend à se confondre avec l’auteur, parfois évoqué à la troisième personne, qui en assume la composition (‘Qu’est-ce qu’un auteur’, 1969, repris dans Dits et écrits. 1954–1988, t. I, 1954–1975, (Paris : Quarto/Gallimard, 2001), pp. 817–49, (p. 830)).
3 Gaston Paris, ‘Compte-rendu de Joufrois, éd. Konrad Hofmann et Franz Muncker, Halle, Niemeyer, 1880’, Romania, 10 (1881), pp. 411–19.
4 Ils le seront néanmoins au sein du projet de recherche mentionné à la note 1. En effet, l’intrusion d’un je aimant qui mêle son itinéraire amoureux à celui de son héros caractérise aussi le roman de Florimont d’Aimon de Varennes, composé en 1188 (voir en particulier les vers 9207sq, dans lesquels le poète-narrateur compare son aventure personnelle à celle de son héros, éd. Alfons Hilka (Halle : Niemeyer, 1933)). De toute évidence, c’est à Aimon et à l’auteur anonyme du Partonopeu de Blois que Renaut de Beaujeu, ou Bâgé, a emprunté le procédé qu’il met à profit dans Le Bel Inconnu. Un peu plus tard, comme l’a relevé Emmanuèle Baumgartner, l’auteur de la première partie du Roman de la rose, Guillaume de Lorris, ‘radicalise cette attitude en fondant ou presque en une seule et même personne (cinq ans cependant les séparent) le je aimant et acteur principal du rêve d’amour et le je (toujours) aimant et scripteur éveillé de ce même rêve’ (‘Féerie-fiction. Le Bel Inconnu de Renaud de Beaugeu’, in Le Chevalier et la merveille dans Le Bel Inconnu ou Le Beau Jeu de Renaut, dir. Jean Dufournet (Paris : Champion, 1996), pp. 7–21 (p. 10)). Ces textes, ainsi que le Lai d’Ignaure bien étudié par Sophie Marnette et parfois attribué à Renaut de Beaujeu (sur le parallèle entre le poète qui s’exprime à la première personne et le héros Ignaure, tous deux ‘prisonniers d’amour’, voir notamment son article, ‘Ignaure : Gender and Genre’, Medium Ævum, XCI (2022), pp. 100–23 (pp. 114–15)), seront examinés dans le cadre des travaux du projet de recherche susmentionné. Pour la mise au point la plus récente sur les romans médiévaux à construction métaleptique, voir Sylvie Lefèvre, ‘Author, Narrators, and Their Stories in Old French Romance’, transl. Roberta L. Krueger, in Cambridge Companion to Medieval Romance, dir. Roberta L. Krueger (Cambridge : Cambridge University Press, 2023), pp. 60–72 (p. 69).
5 Sophie Marnette, ‘Lire La Chastelaine de Vergy au fil des textes’, Romania, 141 (2023), pp. 90–110 (pp. 90 et 102–07). Voir l’envoi du Tristan de Thomas qui ‘A tuz amanz saluz i dit, / As pensis et as amerus, / As emvius, as desirus, / As enveisiez e as purvers’ (il s’agit de la ‘fin longue’ du roman dans la version Sneyd 2, éd. Félix Lecoy, trad. Emmanuèle Baumgartner et Ian Short (Paris : Champion, 2003), vv. 3276–79) ; l’adresse de Floire et Blancheflor à ‘tot li amant, / Cil qui d’amors se vont penant, / Li chevalier et les puceles, / Li damoisel, les damoiseles !’ (éd. et trad. Jean-Luc Leclanche (Paris : Champion, 2003), vv. 1–4) et le narrateur du Lai de Narcisse annonçant dans son prologue que ‘Narcisus, qui fu mors d’amer, / Nous doit essample demostrer’ et lançant dans son envoi l’avertissement ‘Or si gardent tuit autre amant / Qu’il ne muirent en tel sanblant !’ (in Pyrame et Thisbé, Narcisse, Philomena,éd. et trad. Emmanuèle Baumgartner (Paris : Gallimard, 2000), vv. 35–36 et 1009–10).
6 Je renvoie en particulier à l’article de Michèle Perret, ‘Atemporalités et effet de fiction dans Le Bel Inconnu’, in Le nombre du temps en hommage à Paul Zumthor, dir. Emmanuèle Baumgartner, Giuseppe Di Stefano, Françoise Ferrand, Serge Lusignan, Christiane Marchello-Nizia et Michèle Perret (Paris : Champion, 1988), pp. 225–35, repris dans Le Chevalier et la merveille dans Le Bel Inconnu ou ‘Le beau jeu de Renaut’, dir. Jean Dufournet (Paris : Champion, 1996), pp. 139–52, et à l’introduction et aux notes de son édition du Bel Inconnu deRenaud de Beaujeu, éd. Michèle Perret et trad. avec Isabelle Weill (Paris : Champion, 2003) ; quant à Nathalie Leclercq, on consultera ‘Les usages de la métalepse d’auteur dans Partonopeu de Blois et Le Bel Inconnu’, in ‘Les études médiévales face à Genette’, dir. Isabelle Arseneau, Véronique Dominguez-Guillaume, Sébastien Douchet et Patrick Moran, Perspectives médiévales, 42 (2021), https://doi.org/10.4000/peme.36282 (consulté le 23/11/2023) et, plus généralement, Les Figures du narrateur dans le roman médiéval : Le Bel Inconnu, Florimont et Partonopeu de Blois (Paris : Champion, 2020), ainsi que les comptes-rendus de Sophie Marnette dans Medium Ævum, à paraître, et de Benedetta Viscidi dans Textual Cultures, 16 (2023), pp. 295-97 DOI 10.14434/tc.v16i2.36777 (consulté le 24.02.2024).
7 Gérard Genette, ‘Discours du récit. Essai de méthode’, in Figures III (Paris : Seuil, 1972), pp. 67–273 (p. 244).
8 Michèle Perret, p. 139 et ‘Introduction’, dans Le Bel Inconnu, pp. i–xix (pp. xviv et xvii).
9 Nathalie Leclercq, ‘Les usages’, pp. 2–4, 22–27, 44, et Les Figures, p. 122.
10 Cette singularité est explicitement formulée par Nathalie Leclercq, ‘Les usages’, p. 2.
11 C’est ce que montre bien Valérie Fasseur en commentant la métalepse qui figure au milieu du Roman de la rose et dans laquelle la prophétie du dieu d’amour ‘fait de Guillaume de Lorris et Jean Chopinel des auteurs-personnages engendrés par la narration’. ‘Le rapport spéculaire entre l’œuvre et le monde’ s’en trouve renversé, tandis que ‘l’œuvre contient son auteur et l’engendre’ (Paradoxes du lettré. Le clerc-poète et son lecteur laïc à l’épreuve des polémiques intellectuelles (xiiie siècle) (Genève : Droz, 2021), p. 309). Plus généralement, dans sa réflexion récente sur les constructions métaleptiques dans le roman médiéval, Sylvie Lefèvre relève que ‘the medieval concept of fiction is radically different from that of the periods that followed. It is not until the mid-sixteenth century that the image of an “écrivain-démiurge” (writer-demigod) creates a novelistic discourse that constructs its own world, ready only much later to annex the real world, which includes the reader. Medieval textuality belongs to another cultural and anthropological order ; the reading contract (pacte de lecture) of these tales that we call fictional deploys metalepsis to reveal a natural porousness between the world of narration and the world beyond it’ (‘Authors, Narrators’, p. 70).
12 Pour une mise au point sur cette question, voir La Théorie littéraire des mondes possibles, dir. Françoise Lavocat (Paris : CNRS Éditions), 2010.
13 Les vers 12 à 76 du prologue de Partonopeu de Blois se livrent en effet à un éloge du printemps et du chant des oiseaux propices à l’éveil de l’amour (éd. et trad. Olivier Collet et Pierre-Marie Joris (Paris : Librairie générale française, 2005)). Quant au vers 3 du Bel Inconnu, il fait écho à l’allusion de Jean Renart à ‘La chançon Renaut de Biaujieu, / De Rencien le bon chevalier’ aux vers 1451–52 du Roman de la rose, qui en reproduit en outre les deux premières strophes formant notamment une polémique contre les faux amants (éd. Félix Lecoy (Paris : Champion, 1962)). Sur Joufroi de Poitiers, il s’agit de Camille Chabaneau, ‘Compte-rendu de Joufrois, éd. Konrad Hofman und Franz Muncker’, Revue des langues romanes, 19 (1881), pp. 88–91 et ‘Sur le roman français de Joufroi’, ibid., 22 (1882), p. 49. Surle rôle de Marcabru, je renvoie à l’article de Valérie Fasseur, ‘Anamorphoses d’un discours amoureux : présence de Marcabru dans Joufroi de Poitiers’, Romania, 127 (2009), pp. 86–103.
14 Je reprends ici à dessein la formule de Gianfranco Contini pour évoquer le Dante de la Divine Comédie (‘Dante come personaggio-poeta della Commedia’, L’Approdo letterario, 4 (1958), pp. 19–46, repris dans Secoli vari (‘300–‘400–‘500) (Firenze : Sansoni, 1958), pp. 21–48. Par une heureuse coïncidence, Sophie Marnette l’utilise elle aussi à la page 102 de son article cité sur la Chastelaine de Vergy.
15 Autant dire qu’il n’en va pas autrement de LaChastelaine de Vergi et du Roman du Castelain de Coucy étudiés par Sophie Marnette. Si le premier texte cite les vers d’une chanson du Châtelain de Coucy, amant et trouvère du xiie siècle, et met de la sorte en abyme la situation amoureuse du chevalier héros, le second se choisit pour protagoniste ledit trouvère et émaille la narration de dix insertions lyriques de sa plume.
16 Sur la récupération de ce topos dans les trois romans, voir entre autres Roberta Krueger, ‘The Author’s Voice : Narrators, Audiences, and the Problem of Interpretation’, in The Legacy of Chrétien de Troyes, dir. Norris Lacy, Douglas Kelly, and Keith Busby (Amsterdam : Rodopi, 1987), I, pp. 115–40 (pp. 126 et 129), Lori Walters, ‘The Poet-Narrator’s Address in Partonopeu de Blois’, Medium Aevum, 61 (1992), pp. 229–41 (p. 231), et, plus généralement sur l’héritage de la lyrique dans les trois romans et au-delà dans les récits narratifs courtois, Roger Dragonetti, Le Gai Savoir dans la rhétorique courtoise (Paris : Seuil, 1982), et Jeri S. Guthrie, ‘The ‘Je(u)’ in Le Bel Inconnu : Auto-Referentiality and Pseudo-Autobiography’, Romanic Review, 75 (1984), pp. 147–61.
17 Dans ce contexte, il y a lieu de penser que la tendance des poètes à se comparer à Tristan, lui-même poète et amant, pour s’identifier à lui ou en rejeter le modèle, n’a rien d’anodin. Elle est métaleptique dans la mesure où les poètes, au sein de leurs compositions lyriques, se comparent à un personnage de fiction qui pratique les mêmes activités qu’eux. On pourrait, en extrapolant, considérer de la même façon les comparaisons intertextuelles fréquentes dans les romans courtois avec des personnages littéraires, que Curtius désigne comme des ‘topoi de surenchère’.
18 Chrétien de Troyes, ‘D’Amors qui m’a tolu a moi’ (RS 1664), éd. et trad. Charles Méla, in Romans suivis des Chansons, avec, en appendice, Philomena, éd. et trad. Michel Zink, Jean-Marie Fritz, Charles Méla, Olivier Collet, David F. Hult et Marie-Claire Zai (Paris : Librairie générale française, 1994), pp. 1213–224, vv. 1–9.
19 Au point qu’elle fournit son titre à l’anthologie des chansons trouvères éditées et traduites par Samuel N. Rosenberg, Hans Tischler et Marie-Geneviève Grossel, Chansons des trouvères : ‘chanter m’estuet’ (Paris : Le Livre de Poche, 1995).
20 Raimbaut d’Aurenga, ‘Non chant per auzel ni per flor’, BdT 389.32, in El Trobar ‘envers’ de Raimbaut d’Aurenga, éd. Luigi Milone (Barcelona : La flor inversa, 1998), pp. 99 et 192, IV, vv. 25–32.
21 Chrétien de Troyes, ‘D’Amors’, V, vv. 37–40.
22 Bernart de Ventadorn, ‘Can vei la lauzeta mover’ (BdT 70.43), in Bernard de Ventadour, troubadour du xiie siècle, Chansons d’amour, éd. et trad. Moshé Lazar (Paris : Klincksieck, 1966), XXXI, VII, vv. 53–56 et VIII, vv. 59–60.
23 Valérie Fasseur propose d’ailleurs d’envisager ces deux traits comme des topoi hérités de la lyrique courtoise : d’une part les plaintes du narrateur amoureux et envieux de son héros y sont décrites comme un ‘topos de la lyrique courtoise’, et de l’autre elle note que ‘c’est le désespoir amoureux qui suspend la possibilité de continuer à écrire. Il y a peut-être là l’esquisse d’un topos’ (pp. 97 et 101, n. 42).
24 La compétition entre le narrateur et le héros a été souvent relevée par les critiques comme un thème reliant les trois romans (cf. notamment Richard Trachsler, ‘Parler d’amour : les stratégies de séduction dans Joufroi de Poitiers’, Romania, 113 (1992), pp. 118–39 (p. 135) et John L. Grigsby, ‘The Narrator in Partonopeu de Blois, Le Bel Inconnu and Joufroi de Poitiers’, Romance Philology, 21 (1968), pp. 536–43). Par ailleurs, Valérie Fasseur envisage l’existence d’un débat sur l’amour non pas entre ces textes, mais entre les points de vue opposés du protagoniste et de Marcabru dans Joufroi de Poitiers (p. 101), ce qui était déjà l’idée de Dragonetti (pp. 158–92).
25 Parmi les références critiques nombreuses à ce sujet, voir notamment, sur Le Bel Inconnu mais aussi sur les deux autres textes,l’article cité de Baumgartner, qui mentionne les armoiries des Bâgé citées aux vers 73 et 74 du texte et identifiées par Alain Guerreau (‘Renaud de Bâgé : Le Bel Inconnu. Structure symbolique et signification sociale’, Romania, 103 (1982), pp. 28-32). Voir aussi Claude Roussel, ‘Point final et point de suspension. La fin incertaine du Bel Inconnu’, in Le Point final (Clermont-Ferrand : Association des Publications de la Faculté des lettres et sciences humaines de Clermont-Ferrand, 1984), pp. 19–34, Nathalie Leclercq, ‘Les usages’, p. 12 et surtout Les Figures du narrateur, ainsi que, sur Joufroi de Poitiers, Helen M. Choate, ‘A Literary Analysis of Joufroi de Poitiers’ (thèse de doctorat non publiée, Bryn Mawr, 1979), p. 149. À propos du Bel Inconnu comme vida de son auteur, je renvoie à l’introduction de Perret dans son édition (p. xvi).
26 Voir aussi les vers 588 à 599.
27 ‘ […] Li miens amis, / Molt mar i fu vostre proece, / Vostre sens et vostre largece, / Qu’en vos n’a rien a amender / Fors tant que ne savés amer.’ (Le Bel Inconnu, vv. 4426–30).
28 Plusieurs critiques ont été attentifs à cet écart entre les attitudes du poète-narrateur et du héros dans Le Bel Inconnu et Joufroi de Poitiers, à l’instar de Sara Sturm, ‘The Love-Interest in Le Bel Inconnu : Innovation in the Roman Courtois’, Forum for Modern Language Studies, VII (1971), pp. 241–48 (p. 248), de Norris J. Lacy ‘The Margins of Romance : Art and Artifice in Joufroi de Poitiers’, Symposium, 44 (1990), pp. 264–171 (p. 270), de Trachsler, p. 136, ou encore de Roussel.
29 C’est d’ailleurs également ce que Dragonetti soutient à propos de Joufroi de Poitiers (pp. 180–90).
30 L’article cité de Valérie Fasseur met en lumière avec profit le rôle de Marcabru, qui s’inscrit en contraste et en opposition avec cette identification progressive du narrateur avec son héros.
31 Si la question de l’écart moral entre le narrateur et le héros est moins développée dans Partonopeu de Blois, cela ne signifie pas qu’elle soit complètement absente. Lori Walters a souligné la façon dont le narrateur se sert de l’épisode où Partonopeu séduit la nièce du roi de France pour déclarer que lui ne trompera jamais sa dame (Partonopeu, vv. 4045–54). Plus loin, suite à l’épisode où Partonopeu piège Mélior en franchissant l’interdiction de ne pas la voir, le narrateur se place dans le rôle de Mélior abusée pour soutenir que, même si son aimée lui avait causé du tort, il l’en aurait remerciée (vv. 4543–48). Son obstination à vouloir gagner le cœur de sa dame et à prouver qu’il est digne d’elle se poursuit bien au-delà de la conclusion matrimoniale des amours du héros : dans la Continuation, elle est cause du rallongement du texte, qui ne parvient pas à se clore (Lori Walters, ‘The Poet-Narrator’s Address to his Lady as Structural Device in Partonopeu de Blois’, Medium Ævum, 61 (1992), pp. 229–41 (pp. 231–32)).
32 C’est ce que semblent également suggérer, sans toutefois le développer, Walters lorsqu’elle soutient que ‘the poet-narrator uses the episode of Partonopeu’s seduction of the King of France’s niece as a negative exemplum : he himself would never deceive his lady’ (p. 131), et Fasseur qui, à l’endroit de Joufroi de Poitiers, relève que ‘le narrateur dev[ient] progressivement le personnage’ (p. 100).
33 Pour une discussion et une exploration de ces différentes possibilités, voir essentiellement Dragonetti, pp. 158–92 ; Trachsler, pp. 138–39, et Fasseur, p. 100.
34 Je cite, parmi d’autres, la conclusion de Nathalie Leclercq dans son article : ‘L’auteur du Bel Inconnu va encore plus loin dans [l]e processus métaleptique en proposant une fin déceptive suspendue au bon vouloir de sa dame pour mieux revendiquer sa liberté d’invention et sa mainmise sur sa création’ (‘Les usages’, p. 44).
35 Ibid., p. 31.
36 Dragonetti, p. 77.
37 Ce constat rejoint les conclusions de ma conférence ‘Tuer l’auteur : sur quelques curieux cas de métalepse dans la littérature médiévale en français’, sur la façon dont l’œuvre médiévale semble ‘engendrer’ son auteur, plutôt que l’inverse (‘Medieval French Seminar’, University of Oxford, org. Sophie Marnette, Helen Swift, Daron Burrows, Maison Française d’Oxford, 25 avril 2023). À ce sujet, voir aussi Valérie Fasseur, Paradoxes du lettré,pp. 308–09.
38 Fait et fiction (Paris : Seuil, 2016), p. 520.