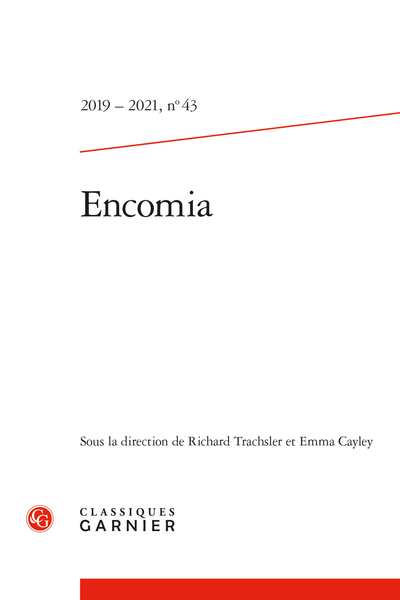
Networking of Texts and Construction of Identity in Twelfth-Century Anglo-Norman Historiography The Roman de Rou by Wace and the History of the Dukes of Normandy by Benoît de Sainte-Maure
- Publication type: Journal article
- Journal: Encomia
2019 – 2021, n° 43. varia - Authors: Laurent (Françoise), Mathey-Maille (Laurence)
- Abstract: The twelfth-century Anglo-Norman historiography offers a privileged field of investigation to address the notions of “courtly communities”. A comparison of the episode of the Battle of Hastings offered by the works of Wace and Benoît de Sainte-Maure testifies to their profound differences in the writing of history: while the first is based on an exclusively Norman reading of events, the second was able to bend its narrative to the requirements of the construction of the Plantagenet Empire.
- Pages: 103 to 115
- Journal: Encomia
- CLIL theme: 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN: 9782406130949
- ISBN: 978-2-406-13094-9
- ISSN: 2430-8226
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-13094-9.p.0103
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 08-24-2022
- Periodicity: Annual
- Language: French
- Keyword: Anglo-Norman historiography, writing of history, Wace, Benoît de Sainte-Maure, courtly literature
Mise en réseau des textes et construction d’une identité dans l’historiographie anglo-normande
du xiie siècle
Le Roman de Rou de Wace et l’Histoire des ducs de Normandie de Benoît de Sainte-Maure
L’historiographie anglo-normande du xiie siècle, composée après la Conquête, offre un champ d’investigation privilégié pour aborder les notions de ‘communautés courtoises’ et de ‘réseaux de cour’. En 1997 déjà, Leah Shopkow articulait sa réflexion sur l’écriture de l’histoire normande à cette idée de communauté, comme le souligne bien le titre de son ouvrage History and Community : Norman Historical Writing in the Eleven and Twelfth Centuries.1
Au xiie siècle, l’affinité entre l’écriture historique et le pouvoir politique justifie la composition des plus anciens récits en langue romane, qu’il s’agisse de sonder l’histoire des règnes ou celle des lignages. Avec le Roman de Thèbes, le Roman d’Énéas et le Roman de Troie, la production littéraire anglo-normande, produite à la cour d’Henri II Plantagenêt, est marquée par des préoccupations historiques et par un questionnement passionné sur les origines, depuis, on le sait, les romans dits ‘antiques’, dépliant la destinée des peuples de l’Europe occidentale, de la ville de Thèbes, conçue dès l’origine comme une préfiguration de Troie,2 jusqu’au Latium où Énée fait renaître en Rome la ville orientale, puis 104jusqu’à la Grande-Bretagne de son arrière petit-fils Brutus, où la ville de Londres incarne à son tour une nouvelle Troie. À cette première trajectoire géographique et littéraire s’ajoute la vaste épopée des peuples du Nord où, selon la légende, les descendants d’Anténor, guidés par le fameux Rollon vont quitter le Danemark surpeuplé en quête d’une nouvelle terre qu’ils baptiseront ‘Normandie’, de leur nom d’hommes du Nord.
C’est cette histoire de la Normandie que Wace avec son Roman de Rou, puis Benoît de Sainte-Maure avec son Histoire des ducs de Normandie3 vont retracer à l’initiative du roi Henri II, lui-même d’origine normande par sa mère, l’impératrice Mathilde, fille d’Henri Ier et petite-fille de Guillaume le Conquérant.4 Les deux chroniqueurs n’ont toutefois pas eu le même succès puisque Wace a dû, à la demande d’Henri II, interrompre, non sans amertume, son œuvre déjà longue de 16000 vers ‘laissier la dei, si m’en dei taire’ (Roman de Rou, troisième partie, v. 11424), le roi ayant en effet décidé de confier l’entreprise de commémorer le passé normand à un autre clerc, le tourangeau Benoît de Sainte-Maure, qui lui livrera une œuvre de plus de 44000 octosyllabes.5
Les raisons qui ont amené Henri II à congédier son premier historiographe ont fait l’objet de nombreux questionnements,6 dont celui 105de l’historien Martin Aurell pour qui Wace n’aurait pas répondu aux ambitions royales. Suivant une conception ‘“grégorienne” de la royauté’, Wace ‘ne fait jamais, écrit-il, l’éloge de la sacralité ducale que le roi attend de lui’ et il ‘évite toute glorification généalogique qui aurait pu insister sur la transmission héréditaire des pouvoirs surnaturels au sein des maisons de Normandie ou d’Angleterre’.7 Ce donné politique est aussi au centre des conclusions de Jean-Guy Gouttebroze pour qui Wace lui-même aurait interrompu volontairement sa collaboration avec le roi en raison de son refus de rentrer dans une stratégie politique visant à soumettre le pouvoir sacerdotal à l’action du sacre et à faire du roi d’Angleterre et de Normandie ‘l’élu de Dieu’.8 ‘Nul doute que, malgré sa place d’historien officiel, [Wace] ne s’associera pas à l’élaboration d’un système de glorification et de justification qui vise à subordonner le sacerdoce à la royauté. D’où sa disgrâce’.9 Benoît de Sainte-Maure va alors assurer la relève, en écrivant une œuvre tout à la gloire du Plantagenêt et en compensant ce que Jean Blacker a très justement nommé ‘Wace’s failure to propagandize’.10
Toutefois, si la dimension ‘propagandiste’ et ‘courtisane’ de la chronique de Benoît semble avérée, les raisons qui justifient que le premier historiographe royal ait reçu son congé ne sont peut-être pas celles habituellement données par la critique. Nous nous proposons donc de rouvrir ce dossier des liens entre pouvoir et écriture de l’histoire, dans le cadre plus large de la communauté, des réseaux socioculturels du temps d’Henri II, marqués par la mixité des cultures et le plurilinguisme. Il s’agira dans un premier temps de dresser le contexte mental, langagier et culturel de l’Angleterre du xiie siècle avant d’étudier les deux versions 106du récit de la conquête de l’Angleterre par Guillaume composées respectivement par Wace et par Benoît, et de les comparer.
Situation sociopolitique et sociolinguistique
de l’Angleterre sous Henri II
L’Angleterre du xiie siècle présente une situation sociale et linguistique très particulière. Après la Conquête, une population francophone, pour la plupart des Normands et des Bretons, soit une dizaine de milliers d’hommes, s’installent dans le pays et dominent par la violence un peuple de près d’un million et demi de non francophones11. Après cette période guerrière où la distinction est forte entre les conquérants et les conquis, les relations des deux communautés évoluent, dès le règne d’Étienne, en raison de la politique de mariages mise en place par Henri Ier entre les chevaliers venus de France et des femmes anglo-saxonnes. Ces unions mixtes ont eu pour effet, d’une part, de faire du français originel une langue seconde, au point, écrit Serge Lusignan, que l’anglais aurait commencé à ‘remplac[er] le français à titre de langue maternelle des nobles durant la seconde moitié du xiie siècle’,12 d’autre part, de modifier la conscience identitaire des individus. Ainsi, alors que la référence à la Normanitas reste importante dans l’identification des individus du groupe aristocratique,13 certaines branches, suivant l’analyse de Hugues M. Thomas14 reprise par Fanny Madeline,15 se tournent vers l’identité anglaise. Le panorama culturel, politique et linguistique de l’Angleterre sous Henri II était donc bien différent de celui du règne d’Henri 1er et, bien sûr, du premier duc roi Guillaume le Normand.
107L’évolution du sentiment identitaire en terre anglaise soutenu, en outre, par l’annexion au royaume de principautés composites par leur langue et leur histoire16 – Pays de Galles, Écosse puis Irlande – joue dès lors en faveur de l’instauration d’une mixité culturelle et favorise la création d’une unité politique par-delà l’existence de contextes historiographiques nationaux distincts. Dans le cadre de cette étude, il n’est pas possible d’être exhaustif et de rappeler toutes les manifestations de cette volonté centralisatrice réalisée, par exemple, avec le développement de la common law, par laquelle le roi veut imposer sa paix dans le royaume, ou encore avec la constitution de tribunaux royaux où, selon la tradition normande et anglo-saxonne, la justice est rendue en langue vernaculaire devant des jurys formés de pairs. Certes, la politique royale connut de violentes et régulières oppositions, on le sait, mais le règne d’Henri II est l’occasion de faire de ce que l’on a appelé l’Empire Plantagenêt une véritable puissance européenne,17 à laquelle concourent de nombreux récits du temps, produits dans et pour la cour royale, comme ce fut le cas du Roman de Rou de Wace et de l’Histoire de Benoît.
Ainsi du Draco Normannicus qu’Étienne de Rouen,18 moine du Bec, écrit en 1167 lors de la mort de l’impératrice Mathilde, et où se manifeste à travers une correspondance imaginée entre Henri II et le roi Arthur, champion des Gallois, le désir du roi de faire servir le mythe arthurien à des fins politiques. Ainsi encore quelques années plus tard, de la Chronique de la guerre entre les Anglois et les Ecossois, composée entre 1174-1175 par Jordan Fantosme,19 qui, favorable à la politique du ‘Gentil rei d’Engleterre’ (v. 5), loue en Henri II ‘Del mieldre curuné qui unkes fust en vie’ (v. 2). Ainsi aussi de la Topographia Hibernica,20 que Giraud de Barri d’origine galloise dédia en 1187 au roi à qui il permit la découverte de l’Irlande, récemment soumise. L’évocation de cette île mystérieuse 108et barbare permet à Giraud de célébrer Henri II comme un porteur de civilisation et de culture.
L’image royale glorieuse que composent ces trois textes trouve un appui et une réalisation dans les traités politiques et moraux du temps. Le Policraticus de Jean de Salisbury en 115921 puis Le Livre des Manières d’Étienne de Fougères en 117422 cherchèrent à théoriser la figure royale, et à concentrer la réflexion, comme l’écrit Amaury Chauou, ‘sur le rôle et la place de la royauté dans le corps social […], fournissant à l’idéologie Plantagenêt les cadres conceptuels dont elle avait besoin’.23 Dans ces textes, pour reprendre les termes d’Amaury Chauou, le roi est donné comme un ‘serviteur de la communauté’ et se voit ‘extrait complètement de l’ordre des bellatores’.24 Enfin, le De Nugis Curialium composé entre 1181 et 1193 par Gautier Map,25 clerc d’origine normande et anglaise, forge à son tour le portait d’un roi généreux, juste et plein de tempérance.
Ces écrits qui, dans les années 1170–80, font d’Henri II l’incarnation d’une monarchie idéale ont fait évoluer les mentalités, et l’arrière-plan politique dans lequel ils s’inscrivent et qu’ils contribuent à conforter n’a pas manqué d’avoir une incidence et une répercussion sur la conception et l’écriture de l’histoire. Et, d’en avoir bien sûr, pour ce qui nous occupe, sur la façon dont la conquête normande a pu être conçue et traitée plus de cent ans après les événements dramatiques qui en furent la conséquence et, dès lors, sur nos deux textes qui rapportent les faits.
109De Wace à Benoît :
deux lectures de la conquête normande
Wace est un Normand, fier de ses origines, et son attachement à la Normanitas, à son image glorieuse comme à ses valeurs, est bien connu.26 Dans le Roman de Rou, l’enracinement géographique du chroniqueur, sa familiarité avec le milieu normand orientent son écriture de l’histoire, qui introduit souvent des épisodes locaux ignorés ou à peine évoqués par les sources. Lorsqu’il relate par exemple les luttes de succession qui opposèrent les fils de Guillaume le Conquérant en rapportant longuement des faits d’armes accomplis sous les murs de Bayeux ainsi que la trahison des habitants de Caen,27 l’accent mis sur ces événements, par ailleurs sans grande conséquence sur l’issue des affrontements, se justifie par les liens particuliers de Wace avec les villes de Bayeux et de Caen, par un simple intérêt local. Mais c’est sans doute dans son récit de la conquête de l’Angleterre que ce parti pris normand est le plus évident.
On a souvent relevé la place privilégiée occupée par cet épisode dans le Roman de Rou, dont il constitue le point culminant et un véritable morceau de bravoure.28 Wace s’y emploie à hisser Guillaume et les Normands au rang de glorieuses figures héroïques, représentant le Bien en lutte contre le Mal qu’incarnent Harold et les Anglais. La différence de conduite entre Anglais et Normands est d’emblée soulignée dans la description bien connue de la veillée d’armes qui oppose la pieuse ferveur des Normands passant leur nuit en prières à la débauche des Anglais s’adonnant à toutes sortes de plaisirs :
Quant la bataille dut joster,
la noit avant, ço oï conter,
furent Engleis forment haitié,
110mult riant e mult enveisié ;
tote noit maingierent e burent,
[…]
Issi se contindrent Engleis ;
e li Normant e li Franceis
tote noit firent oreisons
e furent en afflictions (Roman de Rou, 3, vv. 7323–27 ; 7335–38).
Cette supériorité normande ne cessera d’être réaffirmée au cœur de la bataille, Wace se plaisant à pointer constamment la faiblesse des adversaires : ‘Engleis ne saveient joster / ne a cheval armes porter’ (Roman de Rou, 3, vv. 863–04) ; ‘Mult veïssiez Engleis tumber / gesir a terre e jambeter’ (Roman de Rou, 3, vv. 8771–72). Bien plus, il va prendre soin, sur les quelque mille vers relatant la bataille d’Hastings, d’en consacrer deux cent cinquante à l’énumération des vaillants combattants normands, en une longue liste qui a donné lieu à de nombreuses discussions. Certains y voient un catalogue politiquement orienté.29 Wace aurait intégré à sa liste des noms certes historiques, mais qui ne renvoient pas à la conquête de 1066 ; il aurait puisé ses personnages dans l’entourage d’Henri II et aurait même poussé l’audace jusqu’à choisir les noms de quelques familles rebelles ayant participé à la révolte de 1173–74 dirigée contre le Plantagenêt, ce qui serait peut-être à l’origine de la disgrâce du poète congédié par Henri II.30 Bien que séduisante, cette lecture politique est selon nous loin d’être évidente. Comme l’a bien montré E. Van Houts,31 111la plupart des noms cités relèvent d’une sphère géographique limitée à la région de Caen et du Cotentin, dans les départements actuels de la Manche et du Calvados. Wace sauve donc de l’oubli, pour les glorifier, des personnages appartenant tous à une région normande bien précise, située entre Jersey, son lieu de naissance et Caen, où il passa une grande partie de son existence. A-t-il réalisé qu’un tel chauvinisme normand, un tel ‘intérêt local’, selon la formule de l’éditeur A.J. Holden,32 pouvait irriter ou à tout le moins lasser son illustre commanditaire, dont la vision de l’histoire et du pouvoir n’est pas tout entière centrée sur la Normandie ?
Benoît de Sainte-Maure, qui n’est pas normand, l’a bien compris : ‘je ne nomme pas, écrit-il, tous ceux qui se conduisirent noblement et vaillamment dans cette dure bataille horrible et mortelle. Si je voulais raconter tous leurs exploits, le récit en serait trop long’ :33
Por ce convient l’ovre a finer,
Que tost s’ennuient d’escouter,
Eschis e pensis e destreiz […] (Chronique, vv. 39751–53).
Benoît attaque ici indirectement son rival qu’il accuse de ne pas avoir répondu aux attentes du roi et de sa cour fort déçus, selon lui, par le récit de Wace.
De fait, Benoît porte sur la conquête et ses conséquences un tout autre regard. La critique a déjà noté qu’il ne développait pas l’épisode de la bataille d’Hastings,34 mais il serait plus juste de relever que, tout en ne lui donnant pas l’ampleur qu’il a chez Wace, il traite des différentes phases du combat avec assez de détails. La différence avec la version de son devancier réside dans le point de vue qu’il adopte pour raconter les faits, car sa vision n’est ni ethnocentrée ni partisane.
Il dresse, en effet, le tableau des combats avec un certain recul et avec un souci d’équité. Les deux armées et leurs chefs bénéficient respectivement d’une présentation fort élogieuse : les Normands se déploient en trois grandes légions (v. 39462 sq.), les Anglais sont ‘Si bel 112armez, si richement / Que des armes d’or et d’argent / Resplent la terre d’environ’ (vv. 39525 sq.) ; et, si les vertus militaires ne manquent pas d’être rappelées, Harold n’est pas en reste, lui qui est ‘proz’ e ‘vertuos / E enprenanz e corajos’ et ‘N’estoveit pas en nule terre / Sos cel meillor chevaler querre’ (vv. 39355 sq.). Aussi, lors de la description des combats, le point de vue descriptif s’attache-t-il toujours à rendre compte de ce qui se passe ‘d’ambedeus parz’ (v. 39533) et s’intéresse-t-il aux grands mouvements de masse des deux armées dont les actions sont évoquées ensemble. Les combattants normands et anglais perdent leur identité et leur origine nationale dans la seule description des flèches et des dards qui volent ‘A foison’ (v. 39535), des lances ‘acerees’, dans les cris et les hurlements et dans les corps qui ‘s’entrefierent si durement / E si tres aïrement’ (vv. 39544–46),
Que des costez e des eschines,
Des chés, des braz e des peitrinnes
S’en ist li sanz a fais vermeiz. (Chronique, vv. 39547–49)
Hastings offre une peinture des combats où les grands faits d’armes de l’épopée guerrière le cèdent à une ‘ovraigne amere e fiere’ (vv. 39587).35 À grand renfort d’anaphores et de répétitions, Benoît cherche à susciter chez son auditoire la pitié et l’horreur, et non la fierté et la gloire. Un événement se distingue dans ce qu’il désigne comme un ‘martire’, celui de la déroute des Normands qui croyant Guillaume mort s’enfuient avant d’être, à nouveau, galvanisés par leur chef. Mais ce n’est pas pour autant que le récit sacrifie à une représentation glorieuse. Le discours de Guillaume à ses hommes est très bref et n’a rien de la traditionnelle harangue aux troupes (v. 39643 sq.) et, bien que les combats reprennent et que la victoire normande se profile, l’évocation finale est celle des ‘milliers’ d’hommes qui ‘I chaïrent’ et ‘qui tuit finerent’ (v. 39676 sq.), et celle des Normands qui ‘En sanc erent vers les jenoiz’ (v. 39679). D’autre part, loin de provoquer la satisfaction du duc de Normandie, l’issue heureuse de la bataille avec la mort d’Harold et la défaite anglaise 113font naître sa compassion et ses larmes devant les morts, même ceux qui furent ses ennemis :
Mais li duz est pleins de pitié ;
Des lermes a lo vis moillié,
Quant il regarde les ocis.
S’il tuit li furent enemis
Mortex vers lui e vers les suens,
Dum moct li unt ocis de buens,
S’il tot deit aveir joie grant
D’aveir si vencu un tirant
Vers lui parjur, faus, desleié,
Toteveies a il pidié
Que li plus bel e li meillor
E deu renne tote la flor
Seient eissi peri e mort
Par sa grant coupe et par son tort. (Chronique, vv. 39811–24)
Le passage est clair : Guillaume fait preuve d’une grande hauteur de vue en n’imputant qu’à Harold, le roi parjure, la responsabilité de la guerre et non à une haine viscérale entre Anglais et Normands. Il ne prend pas le parti des uns contre les autres, mais est sensible aux conséquences de la conquête qui prive le royaume de ses meilleurs chevaliers. Sa générosité lui fait refuser la somme d’argent que lui propose l’épouse du roi Harold pour inhumer le corps de son mari qu’il lui remet ‘por rien nule’ (v. 39866), et l’amour qu’il éprouve déjà pour son nouveau peuple dont il admire la nature fière, digne et courageuse, l’invite à la clémence :
Quant d’eus oct esté venqueor,
Ne voct, ne conseil ne li donne,
Maintenant saisir la coronne,
Ne voct la terre mesbaillir,
Ardeir, rober ne apovrir
Ne destruire les plus puissanz. (Chronique, vv. 39886–91)
Il tend la main à ses ennemis afin qu’ils viennent à lui ‘en buenne peis’ (v. 39895) ; aussi est-ce d’un commun accord ‘Que li Engleis e li Normant / Communaument, petit e grant, / Voustrent qu’il fust roi coronnez’ (vv. 40067–69). Guillaume se pose ou, plutôt, est posé par Benoît qui contribue à construire le mythe d’un duc-roi noble et pacifique, 114en réconciliateur et en prince soucieux du peuple tout entier, accédant ainsi en quelque sorte au statut de père fondateur d’une nouvelle nation, d’un royaume dont les frontières vont désormais s’étendre de l’espace insulaire anglais à la Normandie et bien au-delà.
Il est significatif, à cet égard, de relever un autre écart entre les deux textes. En effet, juste avant de relater la conquête de l’Angleterre, Benoît insère un chapitre consacré à célébrer ‘cil de Normendie / Qui Puille e Calabre conquistrent / E qui Sezile a eus sosmistrent’ (vv. 38298–300). Cette prise en compte de la dimension méditerranéenne de la conquête normande va dans le sens d’un élargissement des frontières, d’une ouverture européenne que Wace n’évoque à aucun moment. De la même manière, si Benoît, à la différence de Wace, s’attarde sur les couronnements de Guillaume en 1066 et de la reine Mathilde en 1068,36 c’est sans doute pour bien marquer ce début ‘du brillant cycle européen de la monarchie anglo-normande dont les Plantagenêt furent ensuite les fortunés bénéficiaires’.37 Benoît de Sainte-Maure ouvre ainsi une nouvelle page de l’histoire de l’Europe occidentale, propre à plaire à Henri II dont l’action unificatrice s’inscrit dans cette vision du royaume que dessine déjà la version de son Histoire des ducs de Normandie où est léguée au public de la cour royale l’image d’un premier duc-roi capable de se placer au-dessus des haines nationales et ethniques. La réécriture de la conquête de l’Angleterre par Benoît contient en germe cette nation nouvelle, formée d’un ensemble de principautés territoriales différentes, telle que l’a conçue le Plantagenêt.
En conclusion, la comparaison de l’écriture de l’histoire chez nos deux chroniqueurs montre comment l’un des historiographes a su, mieux que l’autre prendre en compte les attentes du souverain mécène et du public de cour, en offrant à Henri II une lecture de la conquête conforme à ses ambitions. Si Wace a préféré s’en tenir à sa propre lecture normande de l’événement, au risque de décevoir le roi, Benoît quant à lui a su plier son récit aux exigences de la construction de l’Empire 115Plantagenêt. Ce faisant, en précurseur des historiens modernes, il s’est employé à penser l’histoire de la Normandie et de l’Angleterre ‘comme un processus évolutif qui doit être interprété au sein d’un contexte social et culturel’.38
Françoise Laurent
Université Clermont Auvergne
francoise.laurent@uca.fr
Laurence Mathey-Maille
Université Le Havre Normandie
laurence.mathey@univ-lehavre.fr
1 L. Shopkow, History and Community: Norman Historical Writing in the Eleven and Twelfth Centuries (Washington: The Catholic University of California Press, 1997).
2 Voir Francine Mora-Lebrun, L’‘Énéide’ médiévale et la naissance du roman (Paris: Presses Universitaires de France, 1994); et id., ‘Mythe troyen et histoire thébaine: le manuscrit S du Roman de Thèbes’, in Entre fiction et histoire: Troie et Rome au Moyen Âge, dir. by Emmanuèle Baumgartner and Laurence Harf-Lancner (Paris: Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1997), pp. 23–51. Voir aussi Sarah Kay, Courtly Contradictions: The Emergence of the Literary Object in the Twelfth Century (Stanford: Stanford University Press, 2001); et Catherine Croizy-Naquet, Thèbes, Troie et Carthage: poétique de la ville dans le roman antique au xiie siècle (Paris: Champion, 1994).
3 Wace, Le Roman de Rou, éd. A. J. Holden, 3 vols (Paris: S.A.T.F., 1970-73). Benoît de Sainte-Maure, L’Histoire des ducs de Normandie, édition de Carin Fahlin, La Chronique des ducs de Normandie par Benoît, publiée d’après le manuscrit de Tours, avec les variantes du manuscrit de Londres, vols 1 et 2 (Uppsala: Bibliotheca Ekmaniana, 56 et 60, 1951–54); vol. 3. Glossaire entièrement revu et complété par les soins d’Östen Södergard, (Uppsala: Bibliotheca Ekmaniana, 64, 1967); vol. 4. Notes par Seven Sandqvist (Stockholm: Acta Universitatis Lundensis, I, 29, 1979). Pour ce qui est d’intituler l’œuvre Histoire et non Chronique, nous suivons la suggestion d’Emmanuèle Baumgartner.
4 Ces deux récits sont inspirés eux-mêmes de deux œuvres en latin produites dans l’entourage des princes: le De moribus et actis primorum Normanniæ ducum de Dudon de Saint-Quentin écrit pour le duc Richard Ier (Dudon de Saint-Quentin, De moribus et actis primorum Normanniae ducum, ed. J. by Lair (Caen: Le Blanc-Hardel, 1865) et les Gesta normannorum ducum de Guillaume de Jumièges, dédiées au duc-roi Guillaume le Conquérant: The Gesta Normannorum Ducum of William of Jumièges, Orderic Vitalis and Robert of Torigni ed. and trans. by E. Van Houts, 2 vols, (Oxford: Clarendon Press, 1992–94).
5 Pour la connaissance de la vie de Wace et la bibliographie s’y rapportant, voir Laurence Mathey-Maille, ‘Wace’, Dictionnaire du Moyen Âge, dir. Claude Gauvard, Alain de Libera and Michel Zink (Paris: Presses universitaires de France, 2002), p. 1473.
6 Voir E. Van Houts ‘The Adaptation of the Gesta Normannorum Ducum by Wace and Benoît’, in Non nova, sed nove, Mélanges de civilisation médiévale dédiés à Willem Noomen, ed. by M. Gosman and J. van Os (Groningen: 1984), pp. 115–24 (p. 118 sq.), où la critique s’interroge sur les raisons qui ont conduit Wace à devoir renoncer à son travail. Voir aussi les raisons esthétiques et stylistiques (style suranné de Wace) parfois avancées: Hans-Erich Keller, Étude descriptive sur le vocabulaire de Wace (Berlin: Akademie-Verlag, 1953), pp. 15–16. On se reportera également à l’article de Jean Blacker, ‘Wace’s Craft and His Audience: Historical Truth, Bias, and Patronage in the Roman de Rou’, in Kentucky Romance Quarterly, 31.4, 1984, p. 355–62. Voir enfin, pour analyser l’échec de Wace, Laura Ashe, Fiction and History in Medieval England (Cambridge: Cambridge University Press, 2007).
7 Martin Aurell, L’Empire des Plantagenêt 1154-1224 (Paris: Perrin, 2003; repr. 2004), pp. 152–53.
8 Jean-Guy Gouttebroze, ‘Pourquoi congédier un historiographe? Henri II Plantagenêt et Wace (1155–1174)’, Romania, CXII (1991), 290–311 (p. 297).
9 Ibid., p. 311.
10 Jean Blacker, The Faces of Time: Portrayal of the Past in Old French and Latin Historical Narrative of the Anglo-Norman Regnum (Austin: University of Texas Press, 1994), p. 183.
11 Serge Lusignan, Le Langage des rois au Moyen Âge. Le français en France et en Angleterre (Paris: PUF, 2004), p. 159.
12 Ibid., p. 160.
13 Voir Ian Short, ‘Anglice loqui nesciunt: monoglots in Anglo-Norman England’, Cultura Neolatina, 69, (2009), 245–62, et, du même auteur, ‘Tam Angli quam Franci: Self Definition in Anglo Norman England’, Anglo-Norman Studies, 18 (1996), 153–75.
14 Voir Hugh M. Thomas, The English and the Normans: Ethnic Hostility, Assimilation, and Identity 1066–c.1220 (New York: Oxford University Press, 2003).
15 Voir Fanny Madeline, ‘Les processus d’identification et les sentiments d’appartenance politique aux frontières de l’Empire Plantagenêt’, Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes, 19 (2010), pp. 63–85.
16 Jim Bradbury, Stephen and Matilda: the Civil War of 1139–1153 (Phoenix Mill: Sutton, 1996).
17 John Le Patourel, ‘The Plantagenet Dominions’, History, 50 (1965), 289–308.
18 Latin Arthurian Literature, ed. and trans. by Mildred Leake Day (Cambridge: Brewer, 2005).
19 Jordan Fantosme, Jordan Fantosme’s Chronicle, ed. by R. C. Johnston (Oxford: Clarendon Press, 1981).
20 John J. O’Meara, ‘Giraldus Cambrensis in Topographia Hibernie: text of the first recension’, in Topographia Hibernie: Proceedings of the Royal Irish Academy, 52 (1948–50), pp. 113–77.
21 Johannes von Salisbury, Policraticus, eine Textauswahl, Lateinisch-Deutsch; ausgewählt, ed. by Stefan Seit (Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder, Herders Bibliothek der Philosophie des Mittelalters, 14, 2008).
22 Étienne de Fougères, Le livre des manières, ed. and trans. by Jacques T. E. Thomas (Paris; Louvain: Peeters, Ktēmata, 20, 2013).
23 A. Chauou, L’idéologie Plantagenêt, Royauté arthurienne et monarchie politique dans l’espace Plantagenêt (xiie-xiiie siècles) (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2001), p. 115.
24 Ibid., p. 120.
25 Walter Map, De nugis curialium. Courtiers’ Trifles, ed. and trans. by M. R. James; revised by C. N. L. Brooke and R. A. B. Mynors (Oxford: Clarendon Press, 1983).
26 Voir Laurence Mathey-Maille, Écritures du passé (Paris: Champion, 2007).
27 Roman de Rou, troisième partie, respectivement vv. 10945–1060; vv. 11163–336.
28 Voir en particulier l’article de P. Eley et Ph. E. Bennett, ‘The Battle of Hastings according to Gaimar, Wace and Benoît: Rhetoric and Politics’, Nottingham Medieval Studies, XLIII (1999), 47–78. Sur les sources de cet épisode dans le Roman de Rou, voir l’introduction de l’édition de A. J. Holden, vol. 3, p. 150 sq.
29 Idem.
30 C’est l’analyse que propose M. Bennett dans ‘Poetry as History? The Roman de Rou of Wace as a Source for the Norman Conquest’, Anglo-Norman Studies, V (1983), 28–32.
31 E. Van Houts, ‘Wace as Historian’, in Family Trees and the Roots of Politics, ed. by K.S.B. Keats-Rohan, (Woodbridge: Boydell, 1997), pp. 103–32. Voir aussi un autre article d’E. Van Houts, ‘The Ship List of William the Conqueror’, Anglo-Norman Studies, X (1988), 159–84, dans lequel l’auteur étudie les différentes sources que nous possédons sur la fameuse liste. Nous nous permettons également de renvoyer à l’étude de L. Mathey-Maille, ‘La liste des compagnons de Guillaume: un défi à la mémoire’, in Guillaume le Conquérant face aux défis, dir. Huguette Legros (Actes du colloque organisé par Cl. Letellier à Dives-sur-mer les 17 et 18 septembre 2005) (Orléans: Paradigme, 2008), pp. 171–80. David Bates souligne également cette tendance de Wace au localisme. Étudiant la bataille de Val-ès-Dunes, il note que ‘dans la mesure où le récit [de Wace] ressemble à la célébration de la prouesse des ancêtres des familles normandes occidentales de son temps, nous ne savons pas réellement qui combattit aux côtés de Guillaume à Val-ès-Dunes […]’, David Bates, Guillaume le Conquérant (Paris: Flammarion, 2018 pour l’édition française), pp. 104–05.
32 A. J. Holden, Introduction de l’édition du Roman de Rou, vol. 3, p. 100.
33 Chronique des ducs de Normandie, vv. 39743–48. Traduction de Paul Fichet, La Vie de Guillaume le Conquérant, traduite du français du xiie siècle en français moderne (Bayeux: Heimdal, 1976).
34 Voir sur ce point l’article cité de P. Eley et Ph. E. Bennett, ‘The Battle of Hastings’.
35 Sur ce point voir E. Baumgartner, ‘Du “roman” à l’histoire: le motif de la bataille rangée chez Wace et Benoît’, in Histoire et roman, Bien dire et bien aprandre, 22, (Lille: CEGES, 2004), pp. 23–37. Dans cet article, l’auteur interroge le motif de la bataille rangée dans le Roman de Brut et le Roman de Rou de Wace ainsi que dans le Roman de Troie et la Chronique de Benoît. Les pages 32 à 36 proposent une comparaison des relations que Wace et Benoît font de la bataille d’Hastings.
36 Chronique des ducs de Normandie, vv. 4068 sq. et 40713 sq. Wace ne mentionne pas du tout le couronnement de la reine Mathilde.
37 D.I. Mureşan, ‘950 ans après: de l’actualité d’un passé (re)composé’, introduction du volume des Annales de Normandie, Les couronnements royaux de Guillaume Ier et de Mathilde (1066, 1068): La Normandie, l’Angleterre, l’Europe, in Annales de Normandie (69e année, no 1, janvier-juin 2019), p. 8.
38 David Bates, Les couronnements royaux de Guillaume Ier et de Mathilde (1066, 1068), p. 219. S’interrogeant sur son propre travail d’historien rédigeant une biographie de Guillaume le Conquérant, David Bates souligne également qu’il faut ‘abandonner le stéréotype normand […] et mettre l’accent sur la diversité et le multiculturalisme’, David Bates, Guillaume le Conquérant, p. 612.