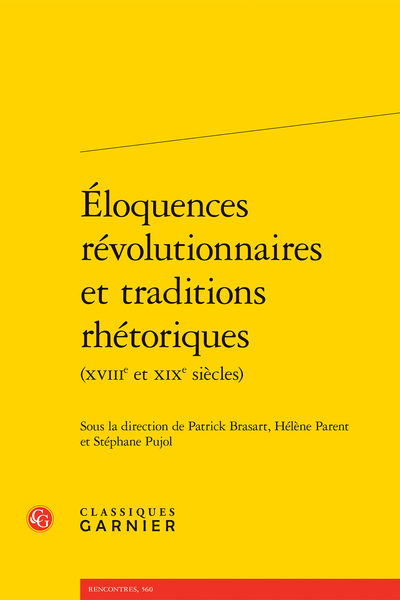
Résumés
- Type de publication : Article de collectif
- Collectif : Éloquences révolutionnaires et traditions rhétoriques (xviiie et xixe siècles)
- Pages : 363 à 368
- Collection : Rencontres, n° 560
- Série : Le dix-huitième siècle, n° 41
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406141365
- ISBN : 978-2-406-14136-5
- ISSN : 2261-1851
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-14136-5.p.0363
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 11/01/2023
- Langue : Français
Résumés
Hélène Parent, « Introduction »
Au xviiie siècle se cristallisent de nombreuses tensions autour des notions d’éloquence et de rhétorique. Ces tensions s’amplifient avec la Révolution française, qui voit renaître le genre délibératif, soulevant la question du lien entre éloquence et action (voire violence) politique. La Révolution française se trouve ensuite placée au cœur de nombreux écrits historiques et fictionnels du xixe siècle, devenant un nouveau mythe ainsi qu’un modèle ou un repoussoir pour les révolutions suivantes.
Blandine Poirier, « “Ah ! je le sens bien, je ne suis plus de ce monde”. L’éloquence neckerienne à l’épreuve de la Révolution française »
En 1789, Jacques Necker est un ministre important, mais aussi un écrivain. Son œuvre peut être un terrain d’analyse pour évaluer les changements survenus dans la langue, à partir de ses différents textes, de l’Éloge de Colbert de 1763 à son ouvrage de 1792, Du pouvoir exécutif dans les grands États. Car Necker, conscient du tournant politique et linguistique de la Révolution, affronte un faisceau de questions, de manière théorique et pratique : comment écrire, pour qui, et dans quelle langue ?
Stéphanie Genand, « “On dit que ma plume a quelque énergie”. Sade orateur de la Révolution »
Si l’œuvre de Sade a traditionnellement été considérée comme un univers du signe, son éloquence est longtemps restée sous silence. La faute au cynisme de ses personnages, souvent incapables d’insuffler la moindre valeur à leurs propos, et aux stratégies énonciatives souvent perverses d’un auteur soucieux d’anéantir son destinataire, plutôt que de le convaincre ou de lui plaire. Or le corpus politique de Sade, orateur avéré de la Révolution, révèle un talent et un intérêt réels pour l’éloquence.
364Anne Quennedey, « Saint-Just et l’éloquence révolutionnaire, de la théorie à la pratique »
La réflexion sur l’éloquence et la pratique oratoire de Saint-Just ont connu une évolution similaire. Alors que l’effet pressant de ses premiers discours est surtout produit par l’enchaînement de raisonnements serrés, les rapports de l’an II tirent leur force de l’alternance des arguments et des mouvements pathétiques, ce que Saint-Just théorise en assignant pour but à l’éloquence de « toucher les âmes » du plus grand nombre. Son éloquence aux armées relève aussi de cet art sublime du discours.
Maïté Bouyssy, « Barère à la tribune ! »
Bertrand Barère « gros de pathos et de douleur » persifla André Chénier. Un logos soutenu par un pathos politiquement défini par ce qui incombe à « l’improvisateur politique » selon la formule de Barère fut effectivement insupportable à ceux qui adhérèrent aux discours de l’an II comme à leurs détracteurs rétrospectifs. Le retour du jugement vers l’ethos de ce qui fut un engagement au cœur de la pratique ne peut être posé a priori pour clarifier la notion de reluctant terrorist de L. Gershoy.
Hélène Parent, « L’invention d’un vir bonus dicendi peritus révolutionnaire ou la régénération de l’orateur romain »
L’éloquence d’assemblée de la Révolution française a souvent été lue comme une prose rébarbative saturée d’images antiquisantes passées de mode. Pourtant, ces représentations, le plus souvent romaines, constituent une clef de compréhension de la manière dont les orateurs révolutionnaires se représentent eux-mêmes et construisent leur ethos. Ils fondent ainsi un nouvel idéal de l’orateur politique, un Cicéron moderne par rapport auquel les révolutionnaires du siècle suivant devront se situer.
Patrick Brasart, « Rhétorique en Révolution. Résilience et réinventions (1789-1793) »
La rhétorique, discipline scolaire centrale, mais décriée, au temps des Lumières, a montré une réelle résilience aux débuts de la Révolution, à travers des remotivations de sa nature et de son rôle dans l’enseignement secondaire. 365Par ailleurs, cette période de renaissance de la parole politique a vu éclore un type inédit de manuel oratoire, avec l’Essai sur la sorte d’éloquence la plus propre à servir utilement la cause de la liberté dans un gouvernement populaire (1793), de Théophile Mandar.
Michel Biard, « “Révolutionnaire” et “extraordinaire”. Deux adjectifs devenus des synonymes politiques dans les discours prononcés à la Convention nationale »
Connaisseurs de l’Histoire antique, les conventionnels n’ignoraient pas la phrase de Cicéron Salus populi suprema lex esto, tout comme ils avaient lu divers ouvrages susceptibles de justifier le recours à l’extraordinaire. Proposer, agir, épurer « révolutionnairement » devinrent autant de formules récurrentes dans la rhétorique d’Assemblée ou dans les courriers des représentants en mission, préparées en amont par diverses réflexions qui assimilaient déjà les adjectifs « extraordinaire » et « révolutionnaire ».
Éric Avocat, « Les armes de la parole. L’éloquence révolutionnaire au risque de la violence »
L’avènement de la parole délibérante dans les assemblées de la Révolution fut porteur d’une ambivalence difficile à appréhender : l’éloquence politique offre-t-elle une alternative aux discordes civiles – Cedant arma togae, écrivait Cicéron – ou bien ne fait-elle que les attiser ? La parole est une arme : ce topos circule dans une bonne partie de la littérature. L’examen de la question met ici à contribution quelques acteurs de l’événement, comme le constituant Adrien Duquesnoy, le Montagnard Lequinio.
Jean-Numa Ducange, « Parler au peuple pour agir. Jean Jaurès et l’éloquence révolutionnaire »
Cet article présente la figure de Jean Jaurès à travers la question de l’éloquence, qui joue un grand rôle dans sa trajectoire politique. À partir de là, la contribution propose une réflexion plus générale sur la place de l’oralité dans le mouvement ouvrier. Il s’agit de penser ensemble à la fois la grande admiration que peuvent susciter les orateurs mais également la défiance et l’anti-intellectualisme qui constituent des phénomènes majeurs dans l’histoire de la gauche.
366Renaud Bret-Vitoz, « L’éloquence de la cicatrice sur la scène tragique à la fin du xviiie siècle »
L’article étudie l’image de la cicatrice corporelle qui, au théâtre, dénote un mal moral et lointain mais qui est revivifiée à la Révolution par le spectacle scénique de marques physiques concrètes. Le corps cicatrisé n’est plus limité au cadre privé mais rendu public et héroïsé pour signifier un traumatisme collectif d’une toute autre ampleur. Avec en référence le public antique, les poètes tragiques trouvent dans le corps cicatrisé l’image fantasmée d’une cohésion patriotique et fraternelle.
Thibaut Julian, « La tribune de la Convention au prisme du théâtre durant la Révolution »
Cet article analyse les usages délibératifs et judiciaires de la parole dans les pièces d’actualité révolutionnaires centrées sur les députés de la Convention, qui, hostiles aux gouvernements en place, ne furent en général pas représentées. Les parodies de discours agrègent un héritage rhétorique qui varie en fonction des genres et du positionnement politique des auteurs, ainsi que des représentations comme le motif de l’histrionisme ou l’image du Peuple, objet de fantasme et de manipulations.
Fabienne Bercegol, « L’éloquence révolutionnaire mise en portraits dans les Mémoires d’outre-tombe de Chateaubriand »
Dans les Mémoires d’outre-tombe, François-René de Chateaubriand a choisi de rendre compte de l’éloquence politique pendant la Révolution à travers des portraits d’orateurs. Cela n’est pas sans incidence sur la représentation de l’éloquence, fortement esthétisée, donnée en spectacle, et jugée à l’aune de la personnalité des tribuns. Parsemés de citations à charge, ces portraits relèvent du discours judiciaire : ils illustrent la déchéance de la parole publique, réduite à la violence et à la grossièreté.
Corinne Saminadayar-Perrin, « Le mythe de l’éloquence révolutionnaire. Une création du xixe siècle »
Le mythe de l’éloquence révolutionnaire est essentiel dans la réflexion politique au xixe siècle. Cette tradition exerce une emprise puissante, malgré 367son anachronisme manifeste et la domination des notables qu’elle perpétue. Les mises en perspective critiques revêtent dès lors une visée pragmatique : instaurer une République démocratique et sociale suppose une refondation rhétorique. La fiction se veut à la fois espace de réflexion sur les usages des discours, et expérimentation d’une éloquence alternative.
Olivier Ritz, « Les discours politiques dans les premières histoires de la Révolution »
La présence des discours dans les premières histoires de la Révolution est d’abord le résultat d’un intérêt partagé par les orateurs, les auteurs d’histoires, les libraires et le pouvoir. Les choix d’écriture révèlent des tensions entre différentes conceptions de l’histoire comme genre. Les histoires montrent la conflictualité, par un procédé d’écriture qui est un équivalent incarné et en action de la confrontation des sources. La Révolution a ainsi été un court moment de démocratisation de l’éloquence et de l’historiographie, suivi d’une réaction fondée sur des exigences poétiques et politiques.
Gérard Gengembre, « Joseph de Maistre, ou comment déconstruire l’éloquence révolutionnaire »
Au discours révolutionnaire, pastiché dans son « Discours du citoyen Cherchemot » de 1799, déconstruction ironique et dévastatrice, Joseph de Maistre oppose une éloquence contre-révolutionnaire où se déploie à coup de formules saisissantes une esthétique du sublime oratoire. Dire, c’est nier et renvoyer les hommes et leur histoire à l’agent omnipotent. Le discours maistrien vise à réorienter vers l’horizon indépassable de la Providence. On a affaire au contraire de l’éloquence révolutionnaire.
Élise Pavy-Guilbert, « “Plus naturelle qu’éloquente, voilà mon cachet”. Gouges contre Robespierre »
Contre les grâces et le charlatanisme d’un style brillant et recherché, Olympe de Gouges revendique ses « fautes » et son « cachet naturel ». Or cet ethos qui est aussi éthopée et logopée repose sur des mythes : l’origine, l’oralité, la langue féminine. Gouges façonne cette éloquence profane et républicaine grisée par une efficace de la parole. La rhétorique politique rencontre alors la fiction poétique qui s’invente dans des ultima verba, avec une foi démesurée dans l’engagement et les serments solennels.
368Huguette Krief, « La rhétorique des humiliés. Barbault-Royer (1767-1831), tribun jacobin, Libre de couleur »
Ses humanités achevées à Paris, Barbault-Royer, écrivain, Libre de couleur de l’Isle de France, s’engage en 1789 pour abolir l’esclavage des Noirs et délivrer les peuples colonisés. Journaliste, tribun de talent, il se réclame de l’éloquence de Démosthène, Isocrate, Cicéron. Pour soulever les enthousiasmes, il joue sur des effets de rythme dans sa prose. Accusateur de l’Europe, il innove dans le débat politique en déconstruisant l’histoire des civilisations pour que cessent les humiliations noires.
Dominique Dupart, « Toasts en révolution ! 1789-1848 »
La forme du toast révolutionnaire miniaturise dans la sphère du familier les bouleversements qui touchent l’expression de la parole publique au cours de la Révolution. Morceau oratoire et révolutionnaire, le toast a pour but d’incarner la concorde tout en ritualisant l’expression collective d’une souveraineté nationale : principe d’exclusion et d’inclusion à la fois, c’est enfin un morceau de parole idéal qui fait office de preuve dans la presse, figurant la réalité sensible et politique de la Révolution.
Hélène Parent, « Conclusion »
Cette conclusion synthétise les différentes tensions mises au jour entre les éloquences révolutionnaires et les traditions rhétoriques au sein des contributions.