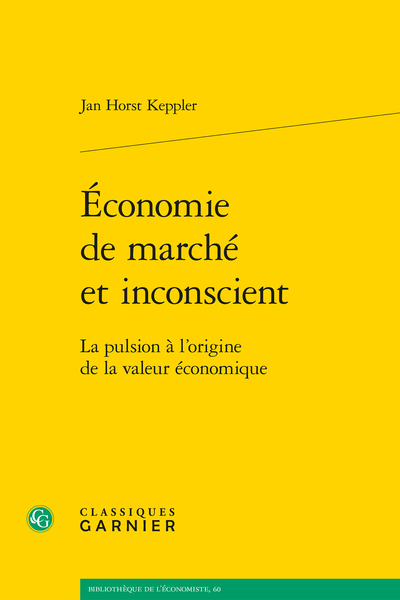
Avant-propos
- Publication type: Book chapter
- Book: Économie de marché et inconscient. La pulsion à l'origine de la valeur économique
- Pages: 7 to 16
- Collection: Library of Economics, n° 60
- Series: 1, n° 38
- CLIL theme: 3340 -- SCIENCES ÉCONOMIQUES -- Histoire économique
- EAN: 9782406165910
- ISBN: 978-2-406-16591-0
- ISSN: 2261-0979
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-16591-0.p.0007
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 04-24-2024
- Language: French
Book chapter: 1/16 Next