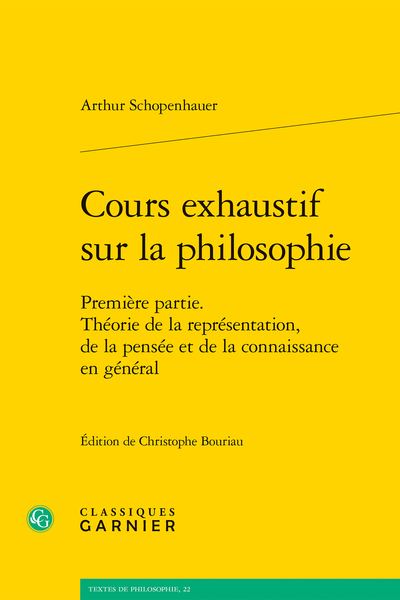
Préface du traducteur
- Publication type: Book chapter
- Book: Cours exhaustif sur la philosophie. Première partie. Théorie de la représentation, de la pensée et de la connaissance en général
- Pages: 9 to 13
- Collection: Philosophical Texts, n° 22
- CLIL theme: 3126 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Philosophie
- EAN: 9782406145004
- ISBN: 978-2-406-14500-4
- ISSN: 2261-0693
- DOI: 10.48611/isbn.978-2-406-14500-4.p.0009
- Publisher: Classiques Garnier
- Online publication: 04-26-2023
- Language: French
Préface du traducteur
Après avoir soutenu son habilitation à l’Université de Berlin sur les quatre différentes sortes de causes : Über die vier verschiedenen Arten der Ursachen, Schopenhauer, à partir du printemps 1820, commence à rédiger ses cours pour les étudiants de la même université1. Nous donnons ici la traduction de la première partie de son cours, consacrée à la philosophie de la connaissance, achevée en hiver 1820.
Il existe deux éditions scientifiques allemandes de ce cours. La plus ancienne fut assurée par Paul Deussen et Paul Mockrauer en 1913 dans un ouvrage titré :
Arthur Schopenhauers handschriftlicher Nachlass. Philosophische Vorlesungen. Erste Hälfte. Theorie des Erkennens, München : R. Piper Co. Verlag, 1913.
Cet ouvrage correspond au tome 9 des Sämtliche Werke de Schopenhauer publiées aux éditions Piper. Nous traduisons en bas de page les notes des éditeurs Paul Deussen et Franz Mockrauer, constituées pour l’édition de 1913 à partir de la lecture du texte manuscrit des cours de Schopenhauer. Ces notes indiquent pour la plupart les passages que Schopenhauer a barrés, ou encore les corrections qu’il a apportées à son manuscrit. À l’instar des précédents éditeurs allemands du texte, toutefois, nous conservons les passages barrés. Rappelons que ce cours n’était pas destiné à la publication. On peut comprendre que Schopenhauer ait voulu alléger son texte. Cela ne signifie pas qu’il renie les passages biffés, lesquels présentent par ailleurs un réel intérêt philosophique.
Lorsque que la note émane de nous-même, elle est précédée de la mention [Note du traducteur] ; lorsqu’elle est de Schopenhauer lui-même, de la mention [Note de l’auteur]. Lorsque la note émane des 10éditeurs Deussen et Mockrauer, ce qui est le cas le plus fréquent, nous n’ajoutons aucune indication.
L’édition scientifique la plus récente de ce cours, assurée par Volker Spierling, est parue en 1986 aux éditions Piper, sous le titre :
Vorlesung über die gesammte Philosophie. Die Lehre vom Wesen der Welt und von dem menschlichen Geiste. In vier Teilen.
Erster Teil : Theorie des gesammten Vorstellens, Denkens und Erkennens, 1820.
Nous indiquons dans le corps de notre traduction la pagination allemande de cette édition (celle de Spierling), qui est plus facile d’accès pour le lecteur soucieux de consulter le texte allemand.
L’ouvrage édité par Volker Spierling réunit 4 textes :
Probevorlesung über die verschiedenen Arten der Ursachen (1820)
Declamatio in laudem philosophiae (1820)
Dianoiologie (1821)
Theorie des gesammten Vorstellens, Denkens und Erkennens (1820)
Le premier texte, qui occupe les p. 30 à 53 de l’ouvrage édité par Spierling, a été traduit par Marie-José Pernin sous le titre : Leçon inaugurale sur les quatre genres de causes, in Schopenhauer, Cahier de l’Herne no 69, dir. J. Lefranc, Paris, éditions de L’Herne, 1997, p. 222-233. Le second est un court panégyrique en faveur de la philosophie rédigé par Schopenhauer en latin ; il a été traduit en allemand par Max Friedrich sous le titre Feierliche Lobrede auf die Philosophie, et occupe les p. 54 à 60 de l’ouvrage. Le troisième, titré Dianoiologie (synonyme d’épistémologie) est un cours inachevé que Schopenhauer a rédigé durant la période où il enseignait celui que nous traduisons. Ce cours d’épistémologie, qu’il devait donner en 1821, n’eut jamais lieu, Schopenhauer ayant dû renoncer à enseigner au terme de l’année 1820, faute d’étudiants. Il avait commis l’erreur de placer ses cours aux mêmes horaires que ceux de Hegel, qui attirait tous les étudiants. Souvent, dans le cours que nous traduisons, Schopenhauer souligne certains passages en indiquant en marge qu’il entend les replacer dans sa Dianoiologie. Ce projet de cours, qui occupe les p. 61 à 83 de l’édition Spierling, n’a toujours pas été traduit en français.
C’est le quatrième texte : Theorie des gesammten Vorstellens, Denkens und Erkennens, formant la première des quatre grandes parties du cours 11préparé par Schopenhauer pour les étudiants de Berlin, que nous traduisons ici pour la première fois en français. Le contenu de cette première partie de cours a bien été enseigné en 1820, contrairement aux trois autres parties prévues. La seconde partie s’intitule Metaphysik der Natur, la troisième Metaphysik des Schönen, la quatrième Metaphysik der Sitten2. La première partie est de loin la plus volumineuse. Elle s’étend dans le volume édité par Spierling entre la page 85 et la page 572. Il s’agit donc d’un cours substantiel de 514 pages, soucieux d’aborder tous les aspects de la théorie de la connaissance. Il présente l’immense intérêt de ne pas simplement reprendre, mais de compléter ce que Schopenhauer a écrit par ailleurs sur la question.
Rédigé peu de temps après Le Monde comme volonté et comme représentation (1819), c’est-à-dire dans l’hiver 1819-1820, on pouvait s’attendre à une version plus ou moins didactique de ce dernier. En effet, la structure des cours pris dans leur totalité ressemble à celle du Monde : dans les deux textes, le philosophe développe une théorie de la connaissance, une métaphysique de la nature, une métaphysique du beau et une métaphysique des mœurs.
La partie du cours que nous traduisons, consacrée à la théorie de la connaissance, est beaucoup plus longue (537 pages dans l’édition Spierling) que la première partie du Monde (un peu plus de 100 pages). Elle est également beaucoup plus longue que les trois autres parties consacrées respectivement à la nature, au beau et aux mœurs, qui, de leur côté, n’apportent pas beaucoup d’éléments nouveaux par rapport aux textes du Monde (si ce n’est, dans le cours sur les mœurs, l’analyse très développée de l’essence du droit comme négation du tort).
Le texte sur la connaissance que nous offrons au public n’est pas seulement plus détaillé que celui du Monde. Il traite en outre de plusieurs 12sujets importants absents de tous les autres écrits du philosophe : au premier chef, un important cours de logique (plus de 100 pages), une solide théorie de la science (50 pages environ), une justification de l’idéalisme transcendantal plus détaillée et précise que dans ses autres écrits, une impressionnante théorie de la perception visuelle, offrant une synthèse originale de considérations transcendantales, physiologiques et psychologiques, une claire définition de la philosophie et de sa différence avec la science, etc.
Dans la mesure où il s’agit d’un texte destiné à l’enseignement, il arrive que Schopenhauer se contente d’indiquer par de simples mots détachés un moment du cours, comme le font tous les enseignants. C’est le cas lorsqu’il écrit entre parenthèses « (Illustration) » ou encore « (Exemple) », et autres termes isolés, sans plus de précision. Il songe alors à un développement qu’il réserve à l’expression orale de son travail. Ou encore, Schopenhauer se dispense parfois de répéter des parties antérieures de son cours clairement identifiées par le lecteur, en se contentant alors de mettre des petits points, par exemple p. 387 : « à savoir : … » (il renvoie en l’occurrence aux quatre formes du principe de raison qu’il a déjà maintes fois exposées dans ce qui précède).
Abordons enfin la question des schémas. Schopenhauer illustre les analyses de son cours d’optique et de son cours de logique par des schémas qui rendent la chose intuitive. Ceux-ci sont reproduits en fin d’ouvrage, et appelés, dans le corps de la traduction, par les expressions suivantes : [cf. schéma 1], [cf. schéma 2], etc. Seuls les deux premiers schémas, qui concernent la géométrie, sont réalisés par le signataire de ces lignes et non par Schopenhauer. Nous avons en effet jugé utile de donner ces deux schémas supplémentaires.
Pour des motifs de clarté, puisqu’il s’agit à présent d’un texte destiné à être lu par des contemporains, nous avons choisi d’aérer le cours de Schopenhauer en créant des paragraphes qui certes ne sont pas dans le texte original, mais qui rendent la lecture plus aisée. Ce faisant, nous nous sommes efforcé de ne pas faire violence à la progression logique de son propos. Cette liberté de traducteur nous semble justifiée par le caractère extrêmement dense du cours, qui risque de fatiguer le lecteur.
Quel style de traduction avons-nous choisi ? À l’encontre des traducteurs soucieux de coller le plus exactement au style, à la construction, au rythme et à la longueur réelle des phrases allemandes, nous avons 13opté pour une manière de traduire plus libre, la plus proche possible de la langue française et de ses idiomes. Notre traduction n’hésite pas à couper les phrases, à changer l’ordre de la construction, à remplacer un idiome allemand par l’idiome qui s’en rapproche le plus en français, etc. Notre travail de traducteur en effet est animé par cette question : comment exprimerait-on cette idée en français ? Tout en respectant l’esprit du texte, et autant que possible son style académique, nous entendons épouser la manière proprement française d’exprimer les choses.
Nous espérons que le lecteur partagera notre enthousiasme pour le travail impressionnant accompli par Schopenhauer enseignant, et qu’il saura admirer non seulement le philosophe, mais aussi le pédagogue de talent, limpide, concret, élégant, soucieux de se faire comprendre de son jeune public, et accessible, au fond, à tout esprit patient intéressé par la philosophie.
Christophe Bouriau
Metz, septembre 2021
1 Voir à ce sujet A. Hübscher, Schopenhauer’s Lebensbild. Sämtliche Werke, tome I, p. 86 sq., et R. Safranski, Schopenhauer und die wilden Jahre der Philosophie, München, Hanser Verlag, p. 372 sq.
2 Ces trois autres parties du cours sont initialement parues dans le dixième tome de l’édition des œuvres complètes assurée par Deussen et Mockrauer, Munich, 1913. Ce dixième volume contient Metaphysik der Natur,Metaphysik des Schönen, Metaphysik der Sitten. L’édition plus récente de Spierling présente ces trois parties du cours dans des volumes différents aux éditions Piper : Metaphysik der Natur est parue en 1984, Metaphysik des Schönen en 1985, Metaphysik der Sitten en 1985. Ces trois autres parties du cours ne sont toujours pas traduites en français, à l’exception du chapitre 6 de la Metaphysik der Sitten : « Du juste et de l’injuste : théorie philosophique du droit », trad. R. Poels et C. Bouriau, in : Ruptures et innovations dans la philosophie allemande, avec deux traductions inédites de textes de Tetens et Schopenhauer, Céline Denat et Patrick Wotling (éd.), Épure (éditions et presses universitaires de Reims), 2021, p. 117-148.