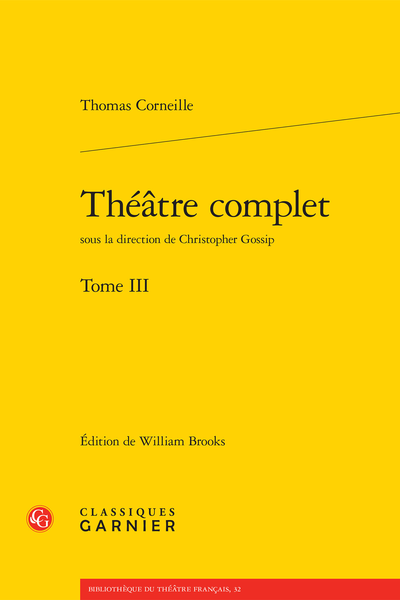
Glossaire
- Type de publication : Chapitre d’ouvrage
- Ouvrage : Théâtre complet. Tome III
- Pages : 569 à 577
- Collection : Bibliothèque du théâtre français, n° 32
- Thème CLIL : 3622 -- LITTÉRATURE GÉNÉRALE -- Théâtre
- EAN : 9782812448324
- ISBN : 978-2-8124-4832-4
- ISSN : 2261-575X
- DOI : 10.15122/isbn.978-2-8124-4832-4.p.0569
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 09/03/2018
- Langue : Français
GLOSSAIRE
Abréviations
|
A |
Académie Française, Le Grand Dictionnaire de l’Académie Française |
|
B |
Bérénice |
|
C |
La Mort de l’empereur Commode |
|
Commentaire |
Commentaires sur les Remarques de Vaugelas, éd. Jeanne Streicher, s.v. Streicher |
|
D |
Darius |
|
Dub |
Dubois, Lagane & Lerond, Dictionnaire du français classique |
|
F |
Furetière, Dictionnaire universel |
|
L |
Littré, Dictionnaire de la langue française |
|
R |
Richelet, Dictionnaire français |
|
Rob |
Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique |
|
T |
Timocrate |
Pour chaque ouvrage cité, le complément de bibliographie est reporté à la section Bibliographie.
abord : voir d’abord et d’abord que
abus : « erreur, tromperie. Si vous croyez que cela soit, c’est un abus » (F) (B 736, 1480 ; C 283 ; D 91, 511, 1691, 1899).
achever : « accomplir, réaliser » (Dub) (T 628, 772 ; B 1188 ; C 118, 1644 ; D 1144).
aigreur : « hostilité, irritation » (R) (T 704, 710, 1758 ; B 908 ; C 590).
ailleurs : « à (ou en) quelqu’un d’autre » (Dub) (T 872, 1872 ; B 406, 432, 1714 ; C 332 ; D 280, 293, 1654, 1684, 1923).
amorce, amorces : « appâts qui attirent et persuadent l’esprit » (F) (T 610, 1118 ; D 130, 245).
appas : « au pluriel, se dit particulièrement en poésie, et signifie charmes, attraits, agrément, ce qui plaît. Il se dit encore plus particulièrement en parlant des attraits et de la beauté des femmes » (A). Au sens de délices ou d’attraits, ce mot pouvait s’employer indifféremment au singulier et au pluriel ; la distinction moderne entre appas et appât(s) n’était pas observée jusqu’au cours du xviiie siècle (C 528, 1035, 1479 ; D 867).
armer, intransitif : « Il signifie, étant mis absolument, Lever des soldats, lever des troupes » (A) ; « s’apprêter pour faire la guerre » (R) ; en parlant de l’individu, il signifie prendre des armes, sauf au v. 1345 de Timocrate, où le mot « armé » signifie plutôt muni d’une armure, d’un bouclier etc., dont Trasille commente la richesse (T 143, 944 ; B 1659).
570arrêt : « jugement souverain contre lequel il y a nul appel » (R) (T 492, 1480, 1724, 1841, 1922 ; B 94, 181, 324, 624, 1692 ; C 523, 961, 971, 1195, 1452, 1640, 1668, 1931 ; D 700, 1836, 1844, 1851, 1950).
assez (sens fort) : « beaucoup » (F) ; « beaucoup, très » (Dub) (T 61, 413, 965 ; B 701, 1012, 1120, 1825 ; C 976 ; D 579, 1095).
atteinte (au figuré) : « coup qui fait souffrir ; blessure amoureuse » (Dub) ; « on dit encore fig. Donner atteinte à quelque chose pour dire, Commencer à le détruire » (A) (T 875, 1238 ; B 723, 1266 ; C 309, 597, 847).
avant que suivi de l’infinitif : avant de (usage courant au xviie siècle) ; de même « avant que de » suivi de l’infinitif (T 638 ; B 984, 1673 ; D 668, 1000, 1430).
aveu : « protection, ordre ou consentement donné » (F) ; « action de déclarer qu’on agrée, qu’on autorise […] approbation » (Rob) (T 1174, 1681 ; B 136, 184, 225, 374, 614, 788, 955, 1119, 1178, 1993 ; C 154, 1936 ; D 334, 630, 1060).
avouer : approuver, accueillir avec faveur ; « il signifie aussi, Autoriser une chose, déclarer que l’on l’approuve » (A) (T 518, 842, 963 ; B 872 ; C 1440 ; D 1834).
balancer : « se dit figurément de l’examen qu’on fait dans son esprit des raisons qui le tiennent en suspens, et le font incliner de part et d’autre. Le Juge a longtemps balancé les raisons de ces parties, il y avait longtemps qu’il balançait s’il se marierait ou non » (F). Examiner, donc, avec un soupçon de l’idée de différer l’action qui s’ensuivra ; ailleurs plutôt aux sens modernes, hésiter, juger entre deux choix (T 333, 1052 ; B 824 ; C 335 ; D 507, 1754).
brigue, substantif : « menées secrètes, intrigue, cabale » (Dub) (B 1085 ; C 1025, 1901).
briguer : « tâcher d’avoir » (R) ; « chercher à obtenir » (Dub) ; solliciter par la brigue (B 1269, 1640 ; C 424, 1038, 1900 ; D 1930).
brûler : « figurément signifie être agité d’une violente passion d’amour, d’ambition, de désir, d’impatience » (F) (T 997, 1509 ; B 1299 ; C 545 ; D 411, 476).
cependant : « pendant ce temps » (Dub) (T 38, 108, 321, 361 ; B 1647 ; C 1513 ; D 1981).
chaleur : « zèle, empressement, passion » (Dub) ; « ardeur, feu, véhémence » (R) (T 653, 1500 ; B 140 ; C 433, 1243 ; D 151, 805, 833, 1338, 1373, 1416, 1480, 1661).
charme : « se dit figurément de ce qui nous plaît extraordinairement, qui nous ravit en admiration » (F) (D 495, 765, chaque fois dans un sens politique). Ailleurs, le terme, que ce soit au singulier ou au pluriel, indique plutôt un aspect de l’amour ou de la passion.
clarté : explication, idée explicative ; « tout ce qui éclaire l’esprit » (L) ; au pluriel, « explications, renseignements » (Dub) (B 842, 1156 ; D 12, 1512, 1793).
confondre : « brouiller de telle sorte qu’on ne reconnaisse plus » (R) ; embarrasser, troubler, déconcerter, consterner, anéantir ; se trouve aussi avec les sens modernes de réduire quelqu’un au silence (en lui démontrant son erreur) et de faire une confusion (T 547, 921, 1200, 1252, 1269, 1431 ; B 1821 ; C 1111 ; D 895, 913, 1111, 1153).
571se connaître : « avoir conscience de son état, des conditions où l’on est » (Dub) ; « savoir vraiment qui on est » (R). Se dit d’une personne ou, figurément, d’un cœur, pour indiquer être capable de se juger, ou, plus précisément, savoir sa place ou son rang dans une hiérarchie, p. ex., d’un roi qui apprécie sa grandeur, d’un personnage moins bien né qui apprécie sa bassesse relative (T 450, 570 ; B 924, 1152, 1153, 1375, 1750 ; D 899). L’on comparera Darius, v. 1114-1116, 1558 et 1858 où l’expression me/vous connaître souligne un quiproquo.
couleur : prétexte (D 152).
courage : « ardeur, affection » (F) ; « Il se prend quelquefois pour Sentiment, passion, mouvement. Il a gagné cela sur son courage. Il n’a su vaincre son courage » (A) (B 241, 1438 ; C 1473, 1677 ; D 58). Ailleurs aux sens modernes, p. ex. fermeté devant le danger.
couvrir : « On dit, Se couvrir d’un prétexte, couvrir sa faute, pour dire, s’Excuser » (A) ; « couverture signifie un beau prétexte pour couvrir, pour déguiser un dessein, pour excuser une faute » (F) ; au v. 1285 de Timocrate ce mot signifie plutôt dissimuler : « voiler » (R) ; « cacher, dissimuler » (Dub) ; donc, prétexter, justifier – toujours avec un soupçon de mauvaise foi (T 934, 1254 ; D 276).
d’abord : « aussitôt » (Dub) ; tout de suite, dès le début (T dédicace, 250, 545 ; B 1859 ; C 1159).
d’abord que : « dès que, aussitôt que » (Dub) (T 565, 1907).
se défier de : « n’être pas assuré de quelque personne, de quelque chose » (F) ; « Se donner de garde de quelqu’un, Ne pas se fier à ce qu’il dit, à ce qu’il fait paraître, parce qu’on le soupçonne de peu de fidélité, de peu de sincérité » (A) ; donc, avoir peu de confiance en (T 1821 ; B 333, 915 ; D 1107).
déguisement : « artifice pour cacher la vérité » (L) (C 416, 1053, 1623).
se déguiser : « cacher ce qu’on pense, ce qu’on sent » (L) (C 1056 ; D 385).
déplaisir : « chagrin, tristesse » (F), profond désespoir (sens fort au xviie siècle) (B 306, 467 ; D 963, 1019).
déplorable : « qui mérite d’être pleuré, qui attriste » (F) (B 1077 ; C 369, 710 ; D 513).
dérober : « soustraire » (A) (B 1521).
désabuser : « détromper quelqu’un, lui faire connaître ses erreurs » (F) (T 679 ; B 751 ; D 9).
dispenser, se dispenser : « organiser, repartir » (Dub) ; disposer, se disposer (T 598, 1139 ; C 1458 ; D 873, 1192).
doute : voir sans doute.
droit : voir prendre droit de.
éblouir : « tromper, surprendre l’esprit et les sens par de fausses raisons » (F) (T 630, 647, 1119, 1831 ; B 204, 854, 1148 ; C 196, 1330 ; D 398) ; ailleurs au sens moderne d’émerveiller.
embarras : « l’irrésolution dans laquelle on se trouve souvent lorsqu’on ne sait quel parti prendre, ni par quelle voie sortir de quelque difficulté […] ; chagrins, inquiétudes de l’âme » (F) ; « tracas, souci, contretemps » (Dub) ; situation inquiétante dont on sort difficilement (T Au lecteur ; B 1915 ; C 783).
enflammer : « se dit figurément en choses morales, de l’émotion des passions, et surtout de l’amour et de la colère » (F). Dans les exemples que nous avons indiqués, rendre amoureux (ou 572bien, s’enflammer : tomber amoureux) : voir flamme (B 227 ; C 527 ; D 283). Ailleurs dans ces textes, ce mot porte plus souvent le sens moderne de remplir d’ardeur, de passion, exciter.
enfler : « enorgueillir » (Dub) ; « rendre plus vain » (F) (T 164 ; B 924, 1851 ; C 278, 1062).
ennui : « tristesse, déplaisir » (R) ; « chagrin, fâcherie que donne quelque discours ou quelque accident déplaisant » (F) (T 488, 1292, 1411, 1764 ; B 307, 1007, 1058, 1361, 1447, 1507 ; C 264, 387, 1058, 1699 ; D 723, 1299).
entreprendre, sens intransitif : « vieux, diriger une attaque (contre quelqu’un) » (Rob) (D 767, 1821, 1918) ; entreprendre sur : « vieux, porter atteinte à » (Rob) (B 1580) ; ailleurs, au sens moderne.
équipage : « costume, façon de se vêtir » (Dub) (T 1425 ; B 1947 ; C 96).
étonner : « causer à l’âme de l’émotion, soit par surprise, soit par admiration, soit par crainte » (F) ; « faire trembler par quelque grande [ou] violente commotion » (A) ; signifie donc ébranler, stupéfier dans les vers que nous avons énumérés (T 43, 225, 262, 785, 929, 1876 ; B 474, 947, 974, 1138, 1187, 1281, 1339, 1495, 1518, 1987 ; C 131, 1191, 1384 ; D 739, 1013, 1653, 1748, 1874), mais ailleurs, causer la surprise.
exact, exactement : « parfait, minutieusement fait » (Dub) ; « consciencieux, fidèle, rigoureux, sévère » (Dub) ; exigeant (T Au lecteur, 1674 ; C dédicace, 29 ; D dédicace, 574, 1289).
s’expliquer : « expliquer signifie quelquefois, Déclarer, donner à connaître » (A) (B 136, 161, 829, 1292, 1713, 1784 ; C 346, 1129 ; D 637).
fantôme : « apparence trompeuse, illusoire » (Dub) ; imposteur, remplaçant (au sens moderne de doublure) (T 1345, 1587, 1590 ; D 146, 176, 852).
feu, feux : « se dit poét. pour sig. La passion de l’amour » (A) ; « au sing. et au plur. […] passion, amour » (Dub) (T 30, 407, 415, 464, 467, 511, 515, 533, 552, 566, 652, 780, 891, 1400, 1528, 1698 ; B 135, 183, 247, 318, 333, 419, 492, 607, 640, 880, 935, 1695 ; C 104, 142, 211, 225, 403, 519, 525, 532, 601, 663, 830, 903, 1639, 1701 ; D 57, 239, 290, 415, 432, 441, 459, 568, 827, 1178, 1584, 1652, 1675, 1676).
fier, fierté : « sauvage, cruel, violent, terrible […] sauvagerie, cruauté » (Dub) ; « cruauté, violence » (F) ; emporté ; se trouve plus souvent au sens moderne d’orgueilleux, ou bien au sentiment digne, élevé, noble (T 226, 262 ; B 29 ; C 926).
flamme : « la passion de l’amour » (A) ; « amour » (F) ; on peut également parler de la flamme de l’amour (T 41, 48, 377, 435, 537, 650, 758, 806, 1234, 1286 ; B 41, 177, 214, 238, 286, 346, 435, 442, 513, 622, 785, 804, 829, 917, 938, 957, 985, 1123, 1192, 1309, 1337, 1381, 1409, 1482, 1491, 1525, 1678, 1739 ; C 165, 206, 458, 514, 534, 666, 685, 802, 825, 837, 897, 938, 1077, 1105, 1203, 1244, 1393, 1505, 1562, 1572, 1577, 1598, 1738, 1933 ; D 137, 241, 263, 335, 347, 381, 418, 482, 729, 829, 890, 1021, 1041, 1075, 1185, 1257, 1278, 1694, 1973).
flatter, flatteur : « flatter se dit figurément en choses spirituelles […] : flatter son amour, c’est-à-dire, Se donner de belles espérances. Flatter son 573imagination, c’est la repaître de chimères agréables » (F) – donc séduire, mais ailleurs (T 423, 502, 541, 950, 965, 1226, 1512 ; B 1742) plutôt adoucir, soulager (« on dit flatter sa douleur, flatter ses déplaisirs » (A)) (T 221, 347, 497, 657, 770, 792, 809, 1082, 1286, 1460, 1538 ; B 127, 147, 165, 203, 267, 823, 900, 913, 955, 1120, 1247, 1329, 1336, 1472, 1660, 1689, 1890 ; C 205, 294, 683, 1283, 1528, 1742, 1915 ; D 91, 251, 275, 339, 400, 629, 1015, 1137, 1204, 1239, 1315, 1716, 1839).
foi : « la foi conjugale […] l’obligation qu’un mari et une femme contractent l’un envers l’autre en s’épousant » (A) ; « consentement au mariage, dans le langage de la poésie » (L) ; ou bien, dans le contexte du mariage, « l’assurance donnée de garder sa parole, sa promesse » (A) (T 499, 843, 1050, 1221, 1533, 1540, 1748 ; B 36, 235, 603, 787, 863, 984, 1255, 1476, 1688, 1728, 1879, 1995 ; C 239, 895, 902, 1080, 1107 ; D 743, 775, 930, 1187, 1227, 1307, 1339).
forfait : « crime » (R) ; « se dit des crimes en général » (F) (B 1584 ; C 400, 711, 1316, 1343, 1428 ; D 1939).
fourbe, au féminin : « fourberie, tromperie. Faire une fourbe à quelqu’un » (R) (T 1285, 1360 ; B 674 ; D 80, 1743, 1767, 1877).
gêne : « peine ou affliction de corps ou d’esprit » (F) ; « douleur violente, souffrance ; torture morale, tourment » (Dub) (T 405 ; B 1249 ; C 1273).
gêner : rarement au sens moderne, « troubler, mettre mal à l’aise » ; dans les exemples que nous avons repérés ce verbe a plutôt le vieux sens plus fort, « causer une tourmente affligeante, mettre dans une situation très pénible » (Rob) (T 118, 564, 1823, 1877 ; B 10, 134, 1617, 1801 ; C 126, 363, 465, 599, 728, 902, 1779 ; D 385, 1453, 1712).
généreux : « magnanime, de naturel noble ; quelquefois […] vaillant, hardi dans les combats » (A) (T 800, 1207, 1444, 1994 ; B 197, 220, 346, 653, 794, 836, 854, 1244, 1284, 1411 ; C 487, 613, 1652, 1899 ; D 419, 720, 1405, 1643, 1824).
générosité : « grandeur d’âme [etc.], et toute autre qualité qui fait le généreux » (F) (B 1547).
hautement : « hardiment, librement, résolument » (A) ; « d’une manière haute […] impérieuse » (F) (T 213, 631, 842, 1840 ; B 547, 710, 1747 1802 ; C 280, 422, 1458, 1512 ; D 1159, 1623).
heur : « bonne fortune » (A) ; « ce mot signifie bon-heur » (R) ; « chance, hasard favorable » (Dub) (T 83 ; B 1243, 1467 ; D 297, 469, 537, 1183, 1712, 1777).
imposteur : « trompeur, affronteur, calomniateur » (F) (T 1315, 1340, 1421 ; B 993 ; D 27, 32, 50, 491, 497, 532, 839, 1486, 1715, 1735, 1812, 1831, 1892).
imposture : « tromperie, mensonge, calomnie » (F) (T 313, 574, 1329, 1547, 1563 ; B 717, 734, 1110, 1241, 1621 ; D 6, 89, 146, 156, 282, 454, 1109, 1604, 1698, 1772, 1802, 1826, 1870, 1981).
ingrat, adjectif : « stérile, infructueux » (A), en ce sens qu’une naissance ingrate, un destin ingrat, ne permettra jamais au personnage d’aspirer à un rang 574supérieur (T 1202 ; B 646, 1330 ; C 206) ; au v. 320 de Bérénice l’adjectif signifie que cette contrainte est inutile.
intestin : « On appelle figurément Guerre intestine, discorde intestine, La Guerre civile » (A) (D 602).
jour, jours : « en termes de guerre, se dit de l’ouverture qu’on fait dans les rangs des ennemis » (F) (T 163). Ailleurs : « facilité, moyen pour venir à bout de quelque affaire » (A) ; « se dit […] d’une lumière, d’une ouverture qui nous vient dans l’esprit, qui nous donne bonne espérance de la réussite d’une affaire » (F) (T 1232 ; B 335, 383 ; C 1163 ; D 1063). Encore ailleurs : « se dit figurément de la vie » (F) (T 896, 1476, 1636 ; B 672, 1232 ; C 39, 1188, 1543 ; D 395, 760, 947, 1695) ; de même au pluriel (B 775, 1001, 1053, 1868, 1935 ; C 304, 312, 1287, 1342, 1361, 1500, 1596, 1656 ; D 35, 87, 851, 1244, 1457, 1543, 1799).
loi : « obéissance volontaire qui fait qu’on se soumet aux volontés d’autrui. Cet amant vit sous les lois de sa maîtresse […] » (F) ; « On dit poét. & en matière de galanterie, Être sous les lois d’une belle. » (A) (T 1368 ; C 374, 512, 1723 ; D 423). Ailleurs au sens moderne.
lors. Au sens d’alors, « lors » est condamné par Vaugelas, et Thomas Corneille « défère entièrement au sentiment de M. de Vaugelas », pour en citer son Commentaire (I, 446) (T 153, 575, 1286 ; B 1029, 1061 ; C 173, 1865 ; D 165, 1597).
malaisé : « difficile, incommode » (F) (B 248 ; C 454 ; D 1415).
malaisément : « difficilement, avec peine » (F) (T 936).
mendier : « rechercher avec empressement et avec quelque sorte de bassesse et contre la bienséance » (A) ; « chercher avec soin […] mendier des louanges » (R) (B dédicace, 244 ; D 271).
mouvement : « se dit […] des différentes impulsions, passions ou affections de l’âme » (A) (T 1061, 1830 ; B 304 ; C dédicace, 1869 ; D 163, 1084, 1255, 1271, 1283, 1785, 1807).
murmure, murmurer : protestation, plainte, parfois sourde ; protester, se plaindre, parfois sourdement. « Murmure. Plainte secrète de plusieurs personnes, sur quelque tort qu’on leur fait ; se plaindre tout bas et avec timidité » (F) ; se dit aussi de paroles de protestation prononcées par un individu (T 385, 750, 862, 1788, 1893 ; B 101, 134, 230, 357, 411, 634, 733, 792, 1619, 1686 ; C dédicace, 266, 271, 334, 582, 1018, 1050 ; D dédicace, 56, 83, 145, 281, 1156, 1251, 1331, 1657, 1974).
objet : « On dit poétiquement, L’objet de ma flamme, l’objet de mes désirs &c, pour dire La Personne qu’on aime » (A) ; « se dit poétiquement des belles personnes qui donnent de l’amour » (F) (T 785 ; B 580 ; C 172, 1207 ; D 958, 1439).
ombre : « se dit figurément de ce qui est opposé à effectif, réel & corporel […] l’apparence pour la réalité ; […] s’emploie hyperboliquement pour signifier qu’il n’y a aucune apparence » (F) ; « se prend pour […] Apparence » (A) (T 1121 ; C dédicace, 93 ; D 114, 1282, 1707).
pieux : « qui tient à un sentiment d’amour filial, de compassion pour les malheureux » (L) (C 63, 1792).
575pompeux : « triomphant, glorieux […] ; qui se fait avec pompe et magnificence » (F) ; « qui a de la grandeur, de la majesté » (Dub) (T dédicace ; C 117, 1443 ; D 249, 671). Ailleurs, on entrevoit le sens actuel de l’adjectif « [qui] s’applique […] le plus souvent avec une nuance péjorative » (Dub) (T 606 ; B 853).
presser : « accabler, angoisser » (Dub) (T 37, 1411 ; B 137, 1361, 1813 ; C 433, 506, 978 ; D 1005, 1105).
prétendre : « signifie quelquefois vouloir » ; « revendiquer […] ; courtiser, rechercher en vue du mariage » (Dub) (T 145, 462, 621 ; B 1334, 1404, 1979 ; C 498, 502, 904 ; D 2, 450, 1221, 1410) ; ailleurs, prétendre reflète un des sens modernes, compter, affirmer, aspirer, réclamer : cet emploi transitif est également courant au xviie siècle.
prison : « le temps qu’on est en prison. Emprisonnement. Sa prison lui a été glorieuse » (R) (T 1169, 1348 ; B 391, 1007) ; ailleurs au sens moderne de lieu de détention.
publier : « rendre public et manifeste » (A) ; « signaler, désigner à tous » (Dub) ; annoncer (T dédicace, 5, 313, 1529 ; B dédicace, 547, 1904, 2015 ; C dédicace, 1039, 1053, 1888 ; D dédicace, 1147, 1919, 1983).
raison : faire raison, tirer raison : « se faire rendre justice par force » (A) ; « Raison se dit de la justice qu’on fait, ou qu’on demande à quelqu’un, de l’éclaircissement de quelque doute, de la réparation de quelque injure reçue. […] Les braves se font eux-mêmes raison des affronts qu’on leur fait, ils en tirent raison l’épée à la main » (F) ; « (Vieux.) tirer raison, faire raison de quelqu’un : s’en venger » (Rob) (T 1053, 1349, 1585 ; B 868 ; C 1064, 1668 ; D 947, 1508).
retour : « revirement, retournement, changement brusque et total » (Rob) (C 1583 ; D 1586) ; ailleurs aux sens modernes.
sans doute : « sans aucun doute, assurément » (Dub) (T dédicace, 237, 471, 549, 772, 791, 920, 927, 936, 1007, 1072, 1150, 1182, 1345, 1367, 1396, 1434, 1451, 1530, 1633, 1656, 1832, 1895 ; B 163, 207, 585, 875, 943, 1326, 1390, 1500, 1509, 1621, 1649, 1665, 1725 ; C dédicace, 289, 461, 521, 632, 645, 673, 733, 778, 821, 861, 1002, 1217, 1230, 1897 ; D 266, 515, 557, 729, 870, 985, 1368, 1885).
séduire : « tromper, abuser, faire tomber dans l’erreur » (A) ; ailleurs au sens moderne d’attirer de façon irrésistible (T 1125 ; B 1109, 1157, 1385 ; C 566 ; D 10, 275, 1426, 1661).
soi, soi-même. Au xviie siècle, soi et soi-même remplacent indifféremment lui, lui-même, elle et elle-même, même avec un sujet déterminé (T Au lecteur, 417, 602, 1488, 1491 ; B 236, 295, 864, 1484, 1550, 1611, 1623, 1781 ; C 503, 526, 771, 776 ; D 298, 669, 676, 820, 822, 1246).
soins : « soin est l’attache particulière qu’on a auprès d’un maître ou d’une maîtresse, pour les servir ou leur plaire » (F) (B 144, 226, 462, 814, 938 ; C 108 ; D 375, 449, 485).
solliciter : « induire à faire ou à entreprendre quelque chose » (F) ; « inciter, exciter, induire à faire quelque chose » (A) (T 285, 1271, 1989 ; C 1753).
sortable : « qui est d’une sorte et d’une 576manière convenable » (A) ; « qui est propre, qui convient à la personne, ou aux choses » (F) ; « convenable » (R) (T 660).
soudain : tout de suite, « promptement, et sans perdre de temps » (F) ; on trouve aussi la signification moderne, tout à coup, « subitement » (R) (T 173, 996 ; B 711, 725, 1632, 1639, 1659, 1845 ; C 964, 1149, 1887, 1905 ; D 141).
soupir, soupirs : « c’est l’action de soupirer. Sorte de gémissement qu’on tire du fond du cœur et qui sort par la bouche. […] Un soupir d’amour » (R) ; « respiration plus forte et plus longue qu’à l’ordinaire, causée souvent par quelque passion, comme l’amour. » (A) ; « Les amants font de tendres soupirs en présence de leurs maîtresses » (F) (T 540, 1448 ; B 240, 352, 414, 468, 500, 583, 620, 1016, 1420, 1440 ; C 124, 138, 140, 152, 232, 237 ; D 413, 991) ; ailleurs, le mot indique plutôt l’expression de la tristesse, des regrets, du chagrin (T 1032 ; C 754, 1114 ; D 226). Comme de nos jours, on rend son « dernier soupir » au moment de mourir (B 1448 ; D 1002). On notera éventuellement le potentiel d’un jeu de mots autour du concept des soupirs et du verbe soupirer ci-dessous.
soupirer, soupirer de : « gémir, jeter des soupirs » (R), se plaindre ; « pousser, faire des soupirs » (A) : « regretter » (Dub), car ce sont dans les vers que nous avons indiqués des soupirs de regret (T 1765, 1925 ; C 176, 244, 596, 756, 758, 1000, 1122, 1525, 1700 ; D 224, 1074). Ailleurs, les soupirs étant aussi une marque d’amour, soupirer est un synonyme du verbe aimer à l’intransitif (B 465, 613, 1121, 1716, 1735 ; C 122, 664, 725).
soupirer pour : « On dit, qu’Un homme soupire pour une fille, pour une femme, pour dire, qu’Il en est amoureux » (A) ; « désirer avec ardeur » (R) ; « aspirer, prétendre à » (F) (T 804, 1255, 1661 ; C 152, 512, 664).
succès : « issue d’une affaire. Il se dit en bonne et en mauvaise part. Il faut voir quel sera le succès de cette affaire » (F) ; résultat (T 337, 1557 ; B 209, 1323, 1588 ; C 1483 ; D 550, 576, 798, 1204).
supposer : « mettre une chose à la place d’une autre par fraude et tromperie. On dit aussi, On lui a envoyé une personne supposée, pour dire, qu’il y a eu de la tromperie en la personne » (F) ; faire ou se faire passer pour un autre (T 1325, 1425, 1589 ; B 682, 700, 1908, 1973 ; D 1744).
surprendre : « tromper, décevoir, abuser, induire en erreur » (A) (T 397, 1123 ; C 1330, 1473, 1690 ; D 1486, 1626, 1681). Ailleurs, ce mot signifie étonner.
tendresse : « penchant, pente et inclination qui porte à aimer » (R) ; « sensibilité de cœur et d’âme. […] Les amants ne parlent que de tendresse de cœur […] et même ce mot signifie le plus souvent, amour » (F) (T 1627 ; B 78, 232, 409, 886, 950, 1371, 1722 ; C 140, 241, 1347, 1837 ; D 942).
trait : « se dit particulièrement de la flèche qui se tire avec l’arc ordinaire. […] Se dit desregards, des blessures qu’ils font dans les cœurs quand ils y inspirent l’amour » (F) ; « cemot est très fréquent dans le langage galant du xviie siècle pour désigner une blessure d’amour » (Dub) (T 634, 1429, 1857 ; C 1055 ; D 1642).
transport : « se dit […] du trouble ou de l’agitation de l’âme par la violence 577des passions. […] Les amoureux ont de doux, de violents, d’agréables transports » (F) (T 1061, 1456, 1828 ; B 489, 727, 881, 1749, 1820 ; C 219, 275, 995, 1223, 1231, 1396, 1417, 1462, 1484, 1521, 1717, 1735, 1778, 1856 ; D 71, 354, 523, 832, 959, 1451).
triste : « qui cause de l’affliction, de la mélancolie ; malheureux, déplorable ; fâcheux, pénible » (L) (T 1732 ; B 309, 663 ; D 973, 997).
vers : « s’emploie, 1o, là où nous employons envers, à l’égard de ; 2o, là où nous employons auprès de » (Dub) (T 343, 687 ; B 816, 1186 ; C 544, 1155, 1576).
vertu : « force, vigueur, tant du corps que de l’âme » (F) ; « courage » (Dub) ; « efficacité » (A) ; effort, énergie (T 289, 604, 612, 811, 1185 ; B 85, 668, 774, 840, 1133, 1520, 1546, 1661, 1899 ; C 1732).
vil : « bas, abject, qui fait des lâchetés » (F) ; « contemptible » (A) (B 1641 ; C 96, 279, 1057 ; D 1611).
vœux : « ce mot se dit en parlant d’amour, & signifie hommage. Le sujet que j’adore et qui reçoit mes vœux » (R) ; « souhait, prière, serment, suffrage. Tous les vœux et tous les soins d’un amant sont pour sa maîtresse » (F) ; « désirs amoureux » (Dub) (T 48, 68, 347, 536, 569, 707, 741, 1175, 1872 ; B 8, 176, 206, 266, 292, 574, 860, 1334, 1557, 1682, 1713, 1736, 1890 ; C 70, 106, 153, 233, 294, 911, 1008, 1042, 1925 ; D 85, 136, 288, 324, 475, 990, 1220, 1290, 1619, 1703, 1914, 1971) ; dans d’autres contextes, il signifie expression ou déclaration d’amour.