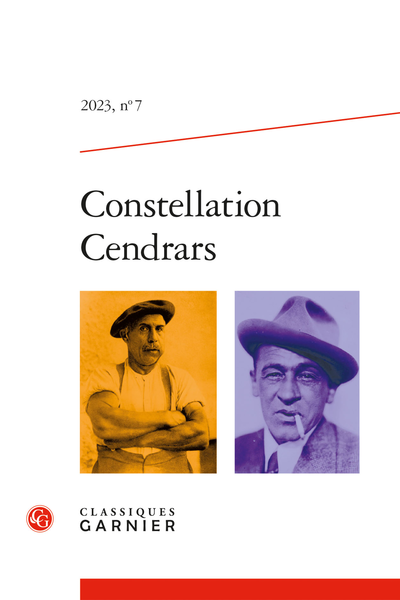
Comptes rendus
- Type de publication : Article de revue
- Revue : Constellation Cendrars
2023, n° 7. varia - Auteurs : Postal (Cendrine), Berranger (Marie-Paule)
- Résumé : Ce volume illustré est une magistrale démonstration des liens puissants, bien que perçus contre-nature, entre la littérature et la publicité. La pratique de l’une grâce à l’autre s’avère une transgression : art et commerce ont souvent joué les frères ennemis, alors que depuis le XIXe siècle et le développement de la réclame, ils se fréquentent, se provoquent et collaborent au vu et au su de tous, stimulés par de très nombreux auteurs.
- Pages : 113 à 118
- Revue : Constellation Cendrars
- Thème CLIL : 4027 -- SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES -- Lettres et Sciences du langage -- Lettres -- Etudes littéraires générales et thématiques
- EAN : 9782406157830
- ISBN : 978-2-406-15783-0
- ISSN : 2557-7360
- DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-15783-0.p.0113
- Éditeur : Classiques Garnier
- Mise en ligne : 18/10/2023
- Périodicité : Annuelle
- Langue : Français
- Mots-clés : publicité, littérature, collaboration, commerce, écrivains
Myriam Boucharenc, L’Écrivain et la publicité. Histoire d’une tentation, Paris, Champ-Vallon, 2022.
L’essai magnifiquement illustré de Myriam Boucharenc, paru chez l’éditeur Champ Vallon, est l’un des résultats passionnants du projet collectif ANR « Littérature publicitaire et publicité littéraire de 1830 à nos jours » que chaque cendrarsien et cendrarsienne a pu apprécier grâce aux rencontres internationales, colloques et ateliers organisés par l’auteure et Laurence Guellec, entre 2015 et 2020. Le site « LittéPub1 », riche d’une multitude de supports médiatiques, permet encore de découvrir avec surprise et amusement la réclame du xixe siècle et la publicité littéraire du xxe, dont les derniers usages contemporains relèvent pourtant plus du cynisme que d’un jeu esthétique. Que dire d’un Frédéric Beigbeder qui tourne en ridicule les publicitaires tout en usant des mêmes armes, dans 99 francs, et d’une agence mise en cause qui rétorque en publiant, contre celui qu’elle considère ironiquement être un « excellent publicitaire » : « Avec une campagne bien orchestrée, même un produit à deux balles peut se vendre 97 francs de plus2. » On semble bien loin de toute tentation !
Pourtant, celle que propose Myriam Boucharenc dans L’Écrivain et la publicité se savoure à chaque exemple, illustré et situé avec finesse, habileté et humour ; s’y apprécie le fameux vin à la coca du Pérou conçu par le Corse Angelo Mariani, père du fameux « Album Mariani », « bible de Gutenberg de la littérature commerciale » (213) : il contenait « 6-7 mg de cocaïne par bouteille, issus de la macération de la feuille de coca dans du bordeaux à 110 » et pouvait être consommé allègrement en deux ou trois verres par jour, sans qu’aucune limite ne soit prévue par la posologie ! Un tel échantillon informe d’une stratégie commerciale, de la littérature qui va avec, mais tout autant des mœurs d’époque. Les cas d’école distillés avec intelligence tout 114au long du volume pimentent un essai extrêmement bien documenté, attestant des nombreuses recherches d’archives nécessaires à son aboutissement. Celles-ci s’apprécient avec curiosité grâce à un ton enlevé qui répond aux intitulés de chapitres, posant la paire littérature et publicité au cœur d’une crise de couple : liaison sulfureuse, lunes de fiels, album de famille et littérature sous influence… ! Ce partenariat n’échappe pas, pour le bonheur de notre instruction, aux considérations et alliances économiques révélatrices de stratégies de représentation, liées à d’autres plus esthétiques. Mais il ne s’agit jamais de placer face à face des polarités contradictoires, car les tendances et les choix d’écrivains sont multiples : Colette, Giono, Ponge, Cendrars, Valéry, Guitry et Claudel ont des profils suffisamment différents pour concevoir un rapport contrasté à la publicité. Myriam Boucharenc reprend à ce propos l’idée d’une « équivoque du modernisme » (95), puisque certains auteurs se positionnent clairement pour la mort de la publicité alors que d’autres la désirent pour changer la poésie… Le chapitre consacré aux trois « C » – Colette, Cendrars et Claudel – est à cet égard très révélateur.
Construit en trois parties, l’ouvrage prend le temps de définir et situer précisément des appellations, certaines en usage dès le xixe siècle, telle la réclame, avant d’évoquer la publicité, passant ainsi du « puff au bluff » (36). Les écrivains ont très vite, et souvent, collaboré à ce qui a semblé une alliance contre nature, celle d’une « littérature jetable » (25), l’aboutissement selon Valéry de « l’infernale combinaison du sacerdoce et du négoce » (26). Ces « antithèses rituelles » (27), selon la formule de Myriam Boucharenc, sont un jeu de dupes car le monde littéraire a intégré la réclame au processus de création, qu’elle soit admirée ou vouée aux gémonies, depuis toujours : évidence peut-être, mais la démonstration n’en avait jamais été faite jusqu’à ce jour, ni par les historiens de la littérature, ni par les publicitaires.
De fait, il n’y a pas d’antithèse mais un tabou que l’autrice met à nu en se jouant allègrement des a priori. S’y dévoile un panorama qui attise la curiosité et trouverait une place intéressante au sein du carré axiologique de Clifford3, obligeant à discuter et réévaluer la hiérarchie 115des biens culturels. Mais comme il ne s’agit pas ici de faire la réclame de l’article, laissons le lecteur courir chez son libraire… :
Puff et bluff
Sont les deux agents INC.
D ’ une liaison dangereuse
Que Myriam Boucharenc
En hydre fabuleuse
Nous sert hic
… et nunc !
Cendrine Postal
*
* *
François Sureau, Un an dans la forêt, récit, Paris, Gallimard, coll. Nrf, octobre 2022.
Le livre de François Sureau, de l’Académie française, ne pouvait passer inaperçu parmi les actualités cendrarsiennes de l’automne 2022. Sur le bandeau qui sème un grain de vitesse sur la sage livrée de la collection Nrf, une photographie peu souvent reprise montre Blaise au volant d’une voiture décapotable, en chauffeur de dames (la famille Lallemant), un sourire aux lèvres, un air bon enfant qu’on ne lui connaissait pas sous son béret bien vissé. Cette image, juste assez floue pour rendre la griserie de l’équipée, a été prise par Élisabeth Prévost lors du séjour de Cendrars dans les Ardennes, qui nous est connu par le livre de Monique Chefdor4 et par les lettres que Cendrars adressa à Jacques-Henry Lévesque en 1161938–1939. François Sureau traite cette matière connue de la Geste cendrarsienne en reportant son regard sur Élisabeth Prévost, alias Diane de la Panne, alias Mozambique, alias Bee and Bee, alias « Madame mon copain », inversant l’ordre de préséance qui place les écrivains au premier plan, les muses et les passantes en décor à l’arrière. Du moins en apparence, car il consacre aussi à Cendrars des pages bien informées et d’autre part, le narrateur masculin, dans un subtil jeu d’échos et de miroir, est bien le sujet-objet d’un récit autobiographique.
Élisabeth se serait-elle fait encore voler la vedette ? Sureau offre un beau portrait de l’aventurière, en exploratrice globe-trotter au caractère bien trempé. Née à Charleville-Mézières en 1911, dans une famille de maîtres de forge, cette Ardennaise « du monde entier », qu’on retrouve chasseuse d’éléphants en Afrique, éleveuse de chevaux à Sigy-la-forêt, près de Brognon, intendante/régisseuse de la tournée de Louis Jouvet en Amérique du Sud, restera une aventurière impénitente jusqu’à sa mort sur l’île d’Houat en 1996, à défaut d’être l’écrivaine que Cendrars aurait voulu qu’elle fût pour enrichir sa collection des Têtes brulées au Sans Pareil. L’auteur ne cache pas sa sympathie pour sa trajectoire hors norme, somme toute assez mystérieuse. « J’aime les hommes qui se laissent prendre par de telles femmes, mais ce sont surtout ces femmes que j’aime » avoue-t-il (p. 46). Mystérieuse aussi cette relation qui conduit Cendrars, en plein marasme et grande instabilité, à trouver refuge au haras des Aiguillettes pour y vivre dans les bois, une parenthèse enchantée d’un an environ, entrecoupée de quelques retours à Paris. Dans ses descriptions sensibles de la forêt (p. 17-20), François Sureau mesure à l’aune de ses propres souvenirs cette sensation de féerie shakespearienne dont Blaise s’ouvrait dans ses lettres à Jacques-Henry Lévesque. Il fait de cette expérience mystique – Blaise emploie lui-même le mot – la condition de possibilité de la régénération de l’« homme foudroyé » et du retour à l’œuvre. Cendrars, s’il a été sensible à l’enchantement de la forêt d’Ardenne, a cependant brisé le cercle magique à la déclaration de guerre, abandonnant le projet de voyage autour du monde avec Élisabeth sur un des derniers navires à voile pour s’enrôler près de l’Armée anglaise. « Quand tu aimes il faut partir » : l’aventurière fera seule, plus tard, le tour du monde. Cet épisode unique dans la vie de Cendrars comme dans celle d’Élisabeth constitue dans ce récit, pour reprendre une métaphore baudelairienne, le bâton du thyrse, autour 117duquel serpentent et se recroisent les méandres d’associations sous le signe des « mystérieuses coïncidences ».
L’écriture, en effet, recrée ce moment suspendu en tissant entre les protagonistes un réseau des réminiscences comme autant de liens magiques qui prennent dans leurs rets narrateur et lecteur : ainsi de la sensation du froid et de la condition du jeune soldat apprenant à dormir à la Belle Étoile sur le sol gelé près de Sedan en 1978, qui nous ramène à Blaise Cendrars dans les bois pendant l’hiver de 1938–1939 ou dans les tranchées de la première guerre. Ainsi du Cadre noir de Saumur qui fut la vocation première de l’aspirant Sureau et qui avait inspiré un projet de film inabouti à Cendrars. Citant la devise de la Légion, « Là où bat le cœur du monde », le narrateur nous livre un des hypotextes du titre d’un recueil de poésie de Cendrars, laissant le lecteur s’en apercevoir – ou non. Sans surligner ses effets, il multiplie les aiguillages : la légion dont il a aussi fait l’expérience, l’attente de Blaise entre Somme et Champagne en 1914-1915 comme celle de Grange dans Le Balcon en forêt de Gracq, renvoient aux expériences du narrateur qui a parcouru sous l’uniforme les mêmes paysages longtemps après. La référence à Breton prend tout son sens dans cet art de nouer les « coïncidences » et de percevoir leur angle de réfraction.
Procédant à un tressage habile des récits de Cendrars, des mémoires et témoignages d’Élisabeth, des lettres à Lévesque et à Élisabeth, avec ses lectures et sa propre histoire, Sureau nous invite à entrer dans une forêt d’échos. Une crise personnelle – la vente de la maison d’enfance – engage la rêverie sur la mémoire, les lieux enchantés, les héritages, familiaux, politiques et littéraires. Les blancs de l’histoire laissent latitude au romancier d’imaginer pour nous les jours dont on sait peu de choses. « C’était l’abbaye de Thélème, une abbaye réglée par l’entrainement des chevaux, les conversations et la vodka, le dimanche à l’église » (p. 71). Le séjour aux Aiguillettes fut-il vraiment cette idylle romantique ? François Sureau mêle aux faits avérés quelques fictions de Blaise, comme son passage au mont Athos, confiant à Élisabeth la défense et illustration du « mentir vrai » du romancier qui savait si bien écouter mais « en partie double », pour s’approprier et transformer l’histoire des autres, « vivre dans l’idée des autres d’une vie imaginaire » (Pascal, cité p. 65). Sureau prend soin de livrer ses sources dans le récit, d’embarquer le lecteur dans une aventure livresque conduite comme une partie de billard à trois bandes : le 118souvenir, ce qu’on en a dit ou lu et l’imaginaire ne constituent-ils pas aussi ce que nous appelons le réel ? Le tressage des références que certains lecteurs pourront ressentir comme un effet chargé de name-dropping (Gide, Proust, Apollinaire, Breton, Styron, Genevois, Michaux …) rappelle au lecteur de Cendrars le « bourlingueur de bibliothèques » dressant le catalogue de ses livres au fil de ses poèmes, de ses récits, de ses lettres. Mais Sureau place Cendrars dans une autre constellation, la sienne, qui va des Eaux-étroites ou d’Un balcon en forêt deGracq à Rimbaud, passage obligé sur la route des Ardennes. Il ne manque pas d’humour dans l’expression (voir les « bicornes mentaux ») comme dans ces hasards dont il tire les ficelles – ainsi Musil est-il en contexte un fabricant de couvertures pour automobiles, et pas l’écrivain autrichien. Il se nourrit aussi de l’ironie de l’histoire, et des déterminismes obscurs : c’est un fusil que son père offre à la future chasseuse d’éléphants pour sa première communion. Les objets cristallisent la mémoire, figent le temps. Ainsi la boîte qui contient sa ration de soldat « (un flacon de Schnaps, 2 paquets de cigarettes, un morceau de fromage dur comme la pierre) » ressemble-t-elle à celle de Blaise. Les temps ainsi se superposent dans des lieux où la nature ravagée à plusieurs reprises par la guerre garde les stigmates de la violence destructrice des hommes.
François Sureau tient son lecteur par une écriture de haute tenue, façon cadre noir de Saumur, un peu sanglée dans son uniforme bien coupé, un art de la confidence qui réussit subtilement, presque sans mouvement, ses passages, changements d’allures et exercices cavaliers. Et c’est sans pathos que François Sureau donne envie de s’arrêter au restaurant du Bon Vieux Temps… qui a fermé depuis.
Marie-Paule Berranger
1 http://littepub.net (consulté le 5 juin 2023).
2 Marie Gobin, « Les écrivains corrompus par la pub ? », L’Express le 1er novembre 2001 (consulté le 28 mars 2023).
3 James Clifford, Malaise dans la culture. L’Ethnographie, la littérature et l’art au xxe siècle, Paris, (énsb-a), 1996 [1988].
4 Madame mon copain. Blaise Cendrars et Élisabeth Prévost : une amitié rarissime, Nantes, Joca Seria, 1997.